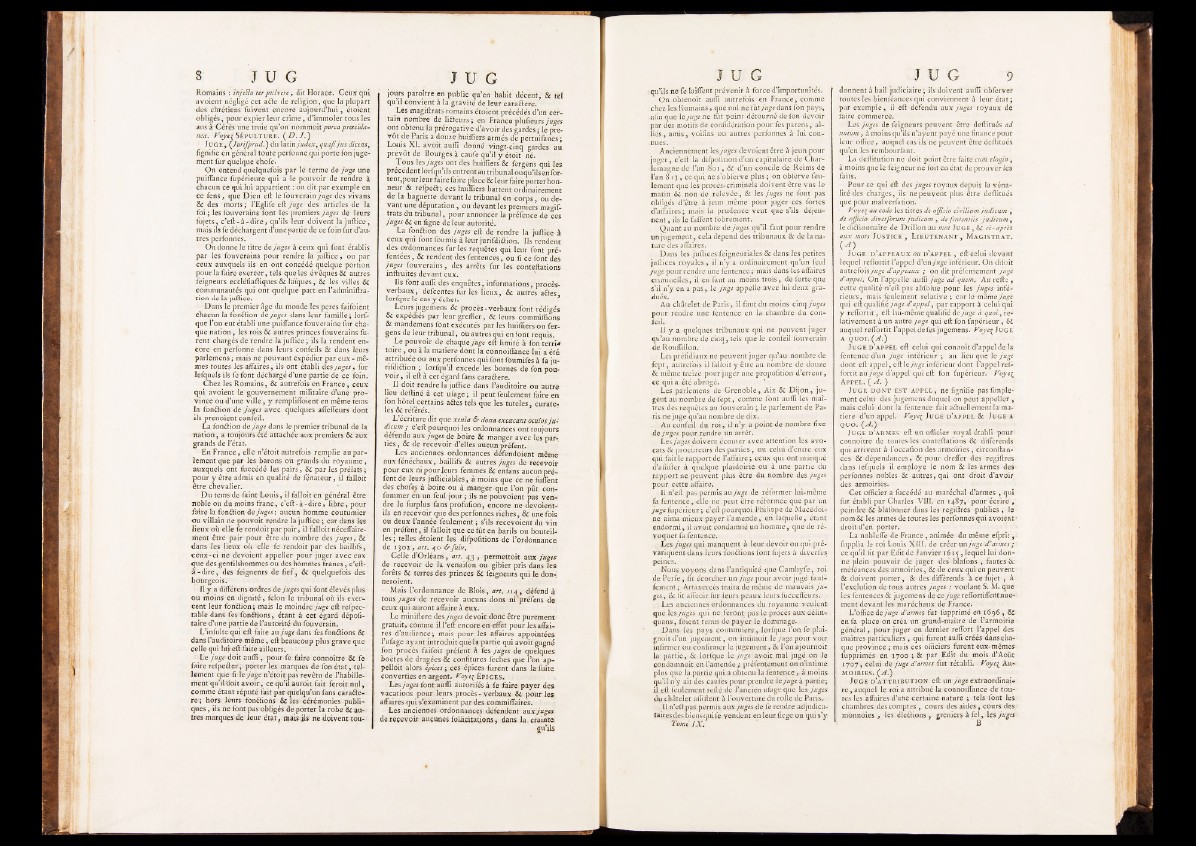
Romains : injtclo ter pulvere, dit Horace. Ceux qui
avoient négligé cet a&e de religion, que la plupart
des chrétiens fuivent encore aujourd’h u i, étoient
obligés, pour expier leur crime, d’immoler tous les
ans à Cérès une truie qu’on nommoit porca prcecida-
nea. Foye{ SÉPULTURE. (Z>. J .)
JüGE, (,Jurifprud.) du latin judexf quafi jus dicens,
lignifie en général toute perfonne qui porte Ton jugement
fur quelque chofe.
On entend quelquefois par le terme de juge une
puiffance fupérieure qui a le pouvoir de rendre à
chacun ce qui lui appartient : on dit par exemple en
ce fens, que Dieu ell le l'ouverain juge des vivans
& des morts ; l’Eglife eft juge des articles de la
foi ; les fouverains font les premiers juges de leurs
fujets, c’eft - à - dire, qu’ils leur doivent la juftice,
mais ils fe déchargent d’une partie de ce foin fur d’autres
perfonnes.
On donne le titre de juges à ceux qui font établis
par les fouverains pour rendre la juftice, ou par
ceux auxquels ils en ont concédé quelque portion
pour la faire exercer, tels que les évêques & autres
feigneurs eccléfiaftiques & laïques, & les villes &
communautés qui ont quelque part en l’adminiftra-
tion de la juftice.
Dans le premier âge du monde les peres faifoient
chacun la fonélion de juges dans leur famille; Iorf-
que l’on eut établi une puiffance fouveraine fur chaque
nation, les rois & autres princes fouverains furent
chargés de rendre la juftice ; ils la rendent encore
en perfonne dans leurs confeils & dans leurs
parlemens ; mais ne pouvant expédier par eux - mêmes
toutes les affaires, ils ont établi des juges, fur
lefquels ils fe font déchargé d’une partie de ce foin.
Chez les Romains, & autrefois en France, ceux
qui avoient le gouvernement militaire d’une province
ou d’une v ille , y rempliffoient en même tems
la fonâion de juges avec quelques affeffeurs dont
ils prenoient conl'eil.
La fonélion de juge dans le premier tribunal de la
nation, a toujours été attachée aux premiers ôc aux
grands de l’état.
En France, elle n’étoit autrefois remplie au parlement
que par les barons ou grands du royaume,
auxquels ont fuccédé les pairs, & par les prélats ;
pour y être admis en qualité de fénateur, il failoit
être chevalier.
Du tems-de faint Louis, il failoit en général être
noble ou du moins franc, c’eft-à -d ire , libre, pour
faire la fonûion de juges : aucun homme coutumier
ou villain ne pouvoit rendre la juftice ; car dans les
lieux où elle fe rendoit par pair, il failoit néceffaire-
riient être pair pouf être du nombre des juges, &
dans les lieux où elle fe rendoit par des baillifs,
ceux-c i ne dévoient appellèr pour juger avec eux
que des gentilshommes ou des hommes francs, c’eft-
à'-dire, des feigneurs de fie f, & quelquefois des
bourgeois.
Il y a différens ordres de juges qui font élevés plus
ou moins ën dignité , félon le tribunal où ils exercent
leur fondion ; mais le moindre juge eft refpec-
table dans fes fondions, étant à cet égard dépofi-
taire d’une partie de l’autorité du fouverain.
L’infulte qui eft faite au juge dans fes fondions &
dans l’auditoire même, eft beaucoup plus grave que
celle qui lui eft faite ailleurs.
Le juge &ow auffi , pour fe faire connoître & fe
faire relpeder-ÿ porter les marques de fon état, tellement
que fi le n’étoit pas revêtu de l’habillement
qu’itdoit avoir, ce qu’il âuroit: fait feroit nul,
comme étant réputé fait par- quelqu’un fans caradere
; hors leurs fondions & les cérémonies publiques
, ils ne font pas obligés dé porter la robe & autres
marques de leur état, mais ils ne doivent toujours
paroître en public qu’en habit décent, & tel
qu il convient à la gravité de leur caradere.
Les magiftrats romains étoient précédés d’un certain
nombre de lideurs ; en France plufieurs juges
ont obtenu la prérogative d’avoir des gardes ; le prévôt
de Paris a douze huiffiers armés de pertuifanes ;
Louis XI. avoit aufli donné vingt-cinq gardes au
prévôt de Bourges à caufe qu’il y étoit né.
Tous les juges ont des huiffiers & fergens qui les
précédent lorfqu’ils entrent au tribunal ouqu’ilsen for-
tent,pour leur faire faire place & leur faire porter honneur
& refped; ces huiffiers battent ordinairement
de la baguette devant le tribunal en corps, ou devant
une députation, ou devant les premiers magistrats
du tribunal, pour annoncer la préfence de ces
juges & en ligne de leur autorité.
La fondion des juges eft de rendre la juftice à
ceux qui font fournis à leur jurifdidion. Ils rendent
des ordonnances fur les requêtes qui leur font présentées
, & rendent des fentences, ou fi ce font des
juges fouverains, des arrêts fur les conteftations
inftruites devant eux.
Us font auffi des enquêtés, informations, procès-
verbaux, defcentes fur les lieux, & autres ades,
lorfque le cas y échet.
Leursjugemens & procès-verbaux font rédigés
& expédiés par leur greffier, & leurs commiffions
& mandemens font exécutés par les huiffiers ou fer-
gens de leur tribunal, ou autres qui en font requis.
Le pouvoir de chaque juge eft limité a fon terri*#
toire, ou à la matière dont la connoiftance lui a été
attribuée ou aux perfonnes qui font foumifes à fa jurifdidion
; lorfqu’il excede les bornes de fon pouvoir
, il eft à cet égard fans caradere.
II doit rendre la juftice dans l’auditoire ou autre
lieu deftine à cet ufage ; il peut feulement faire en
fon hôtel certains ades tels que les tuteles, curate-
les & référés.
L écriture dit que xenia & dona exccecant oculos ju *
dicum ; c’eft pourquoi les ordonnances ont toujours
défendu aux juges de boire & manger avec les parties
, & de recevoir d’elles aucun préfent.
Les anciennes ordonnances défendoient même
aux fenechaux, baillifs & autres juges de recevoir
pour eux ni pour leurs femmes & enfans aucun préfent
de leurs jufticiables, à moins que ce ne fuffent
des chofes à boire ou à manger que l’on pût con-
fommer en un feul jour ; ils ne pouvoient pas vendre
le furplus fans profufion, encore ne devoient-
ils en recevoir que des perfonnes riches, & une fois
ou deux l’année feulement ; s’ils recevoient du vin
en préfent, il failoit que ce fût en barils ou bouteilles
; telles étoient les difpofitions de l’ordonnance
de 130 1 , art, 40 &fuiv,
Celle d’Orléans, art. 43 , permettait aux juges
de recevoir de la venaifon ou gibier pris dans les
forêts & terres des princes & feigneurs qui le don-
neroient.
Mais l’ordonnance de Blois, art. 114, défend à
tous juges de recevoir aucuns dons ni#préfens de
ceux qui auront affaire à eux.
Le miniftere des juges devoit donc être purement
gratuit, comme il l’eft encore en effet pour les affaires
d’audience; mais pour les affaires appointées
l ’ufage ayant introduit quèla partie qui avoit gagné
fon procès faifoit préfent à fes juges de quelques
boëtes de dragées & confitures feches que l’on ap-
pelloit alors épices ; ces épices furent dans la fuite
converties en argent. Voye^ Ép ic e s .
Les juges font auffi autorifés à fe faire payer des
vacations Jpour. leurs procès r verbaux & pour les.
affaires qui s’èxaminent par des commiffaires.
Les anciennes .ordonnances: défendent aux.juges
de recevoir aucunes folficitat^ons, dans la. craintes
gu’ils
qu’ils ne fe laiffent prévenir à force d’importunités.
On obtenoit auffi autrefois en France, comme
chez les Romains, que nul ne fût juge dans fon pays,
afin que le juge ne fut point détourné de fon devoir
par des motifs de confidération pour fes parens, alliés
, amis, voifins ou autres perfonnes à lui connues.
Anciennement les juges dévoient être à jeun pour
juger, c’eft la difpolition d’un capitulaire de Charlemagne
de l’an 801, & d’un concile de Reims de
l’an 8 13 , ce qui ne s’obferve plus; on obferve feulement
que les procès-criminels doivent être vus le
marin & non de relevée, & les juges ne font pas
obligés d’être à jeun même pour juger ces fortes
d’affaires; mais la prudence veut que s’ils déjeunent
, ils le faffent fobrement.
Quant au nombre de juges qu’il faut pour rendre
lin jugement, cela dépend des tribunaux & de la nature
des affaires.
Dans les juftices feigneuriales & dans les petites
juftices royales , il n’y a ordinairement qu’un feul
juge pour rendre une fentence; mais dans les affaires
criminelles, il en faut au moins trois, de forte que
s’il n’y en a pas ,: le juge appelle avec lui deux gradués.
Au châtelet de Paris, il faut du moins cinq juges
pour rendre une fentence en la chambre du con-
feil. ,
il y a quelques tribunaux qui ne peuvent juger
qu’au nombre de cinq, tels que le eonfeil fouverain
de Rouffillon.
Les préfidiaux ne peuvent juger qu’au nombre de
fept, autrefois il falîoit y être au nombre de douze
& même treizè pour juger une propofition d’erreur,
ce qui a été abrogé.
Les parlemens de Grenoble, Aix & Dijon, jugent
au nombre de fept, comme font auffi les maîtres
des requêtes au fouverain ; le parlement de Paris
ne juge qu’au nombre de dix.
Au eonfeil du ro i, il n’y a point de nombre fixe
de juges pour rendre un arrêt.
Les juges doivent écouter avec attention les avocats
& procureurs des parties, ou celui d’entre eux
qui fait le rapport de l’affaire ; ceux qui ont manqué
d’aflifter à quelque plaidoirie ou à une partie du
rapport ne peuvent plus être du nombre des juges
pour cette affaire»
Il n’eft pas permis au juge de réformer lui-même
fa fentence, elle ne peut être réformée que par un
juge fupérjeur ; c’eft pourquoi Philiope de Macédoine
aima mieux payer l’amende,, en laquelle, étant
endormi, il avoit condamné un homme, que de révoquer
fa fentence.
Les juges qui manquent à leur, devoir ou qui pré-
variquent dans leurs fondions font fujets à diverfes
peines.
Nous voyons dans l ’antiquité que Cambyfe, roi
de Perfe, fit écorcher un juge pour avoir jugé faul-
fement ; Artaxerc.ès traita de même de mauvais ju ges
, & fit affeoir fur leurs peaux leurs fucccffeurs.
Les anciennes ordonnances du royaume, veulent
que les juges qui ne. feront pas le procès aux délin-
quans, foient tenus de payer le. dommage..
Dans les. pays coutumiers.,.lorfque l’on fe plaL
gnoitd’un jugement, on intimoit le /«ge pour voir
infirmer ou confirmer le jugement, & l ’on ajournoit
la partie, & lorfque .le juge avoit.mal jugé.on le
çondamnoit en l’amende ; préfentement on n’intimé
plus que la partie qui a obtenu la fentence, à moins
qu’il n’y ait des caufes pour, prendre le juge à partie;
il eft feulement relié de l’ancien ufage que les juges.
du châtelet affilient à Pouverture du rolle de Paris.-
Il n’eft pas permis aux juges de' fe rendre adjudicataires
des biensquile vendent en leur fiege ou qui s’y
Tome IX ,
donnent à bail judiciaire ; ils doivent auffi obfervet
toutes les bienféances qui conviennent à leur état;
par exemple, il eft défendu aux juges royaux de
faire commerce.
Les juges de feigneurs peuvent être deftitués ad
nutum, à moins qu’ils n’ayent payé une finance pour
leur office, auquel cas ils ne peuvent être deftitués
qu’en les rembourfant.
La deftitution ne doit point être faite cum elogio,
à moins que le feigneur ne foit en état de prouver les
faits.
Pour ce qui eft des juges royaux depuis la vénalité
des charges, ils ne peuvent plus être deftitués
que pour malverfation.
V a u code les titres de officié civiLium judicum ,
de officio diverforum judicum , de fententiis judicum ,
le dictionnaire de Drillon au mot Ju g e , & ci-après
aux mots JUSTICE , LIEUTENANT , MAGISTRAT.
(* * )
Juge d ’a ppe au x ôu d’appel j eft celui devant
lequel reffortit l’appel d’un juge inférieur. On difoit
autrefois juge d’appeaux ; on dit préfentement jugé
d'appel. On l’appelle a u juge ad quemt Au refte ,
cette qualité n’eft pas abfolue pour les juges inférieurs,
mais feulement relative ; caf le même jugé
qui eft qualifié juge d'appel, par rapport à celui qui
y reffortit, eft lui-même qualifié de juge à quoi, re^
lativement à un autre juge qui eft fon fupérieur, &t
auquel reffortit l’appel de fes jugemens. Voye^ Juge
a q u o i. (A .)
Juge d’appel eft celui qui connoît d’appel de la
fentence d’un juge inférieur ; au lieu que le jugé
dont eft appel, eft le juge inférieur dont l’appel rel-
fortit au juge d’appel qui eft fon fupérieur» Voye{
Appel. ( A . )
Juge dont est a p p e l , ne fignifie pas fimple-
ment celui des jugemens duquel, on peut appeller ,
mais celui dont la fentence fait actuellement la matière
d’un appel. Foye^ Juge d’appel & Juge a
q u o . (A .y
Juge d’armes eft un officier royal établi pour’
connoître de toutes les conteftations & différends
qui arrivent à l’occafion des armoiries , circonftan-
ces & dépendances, & pour dreffer des regiftres
dans lefquels il employé le nom & les armes des
perfonnes nobles & autres, qui ont droit d’avoir
des armoiries.
Cet officier a fuccédé au maréchal d’armes , qui;
fut établi par Charles VIII. en 1487, pour écrire ,
peindre & blafonner dans les regiftres publics , le
nom & les armes de toutes les perfonnes qui avoient ■
droit d’ en porter*
- La nobleffe de France, animée du même efpri:,
fupplia le roi Louis XIII. de créer un juge-d'armes ;
de qu’il fit par Edit de Janvier 16 15, lequel lui donne
plein pouvoir de juger des'-blafons , fautes ùj
méféances des armoiries, & de ceux qui en peuvent
& doivent porter, & des différends à ce fujet , à
l’exçlufion de tous autres juges ; voulant S. M. que
les fentences & jugemens de ce juge reffortiffentnue-
ment devant les maréchaux de France.-
L’officede juge d'armes fut fupprimé en i 696 , &
en fa place on créa un grand-maître de l’armoirie
général, pour juger en dernier reffort l’appel des
maîtres particuliers , qui furent auffi créés dans chaque
province ; mais ces officiers furent eux-mêmes
lupprimés en 1700 ; & par Edit du mois d’Août
1707, celui de juge d'armes fut rétabli» • Voye{ A rmo
iries» (^ .)
Juge d’a t t r ib u t io n eft un juge extraordinair
e , auquel le roi a attribué la connoiftance de toutes
les affaires d’une certaine nature ; tels font les
chambres-des comptes , cours des aides, cours des;
monnoies , les éleôions, greniers à fe l, les juges
B