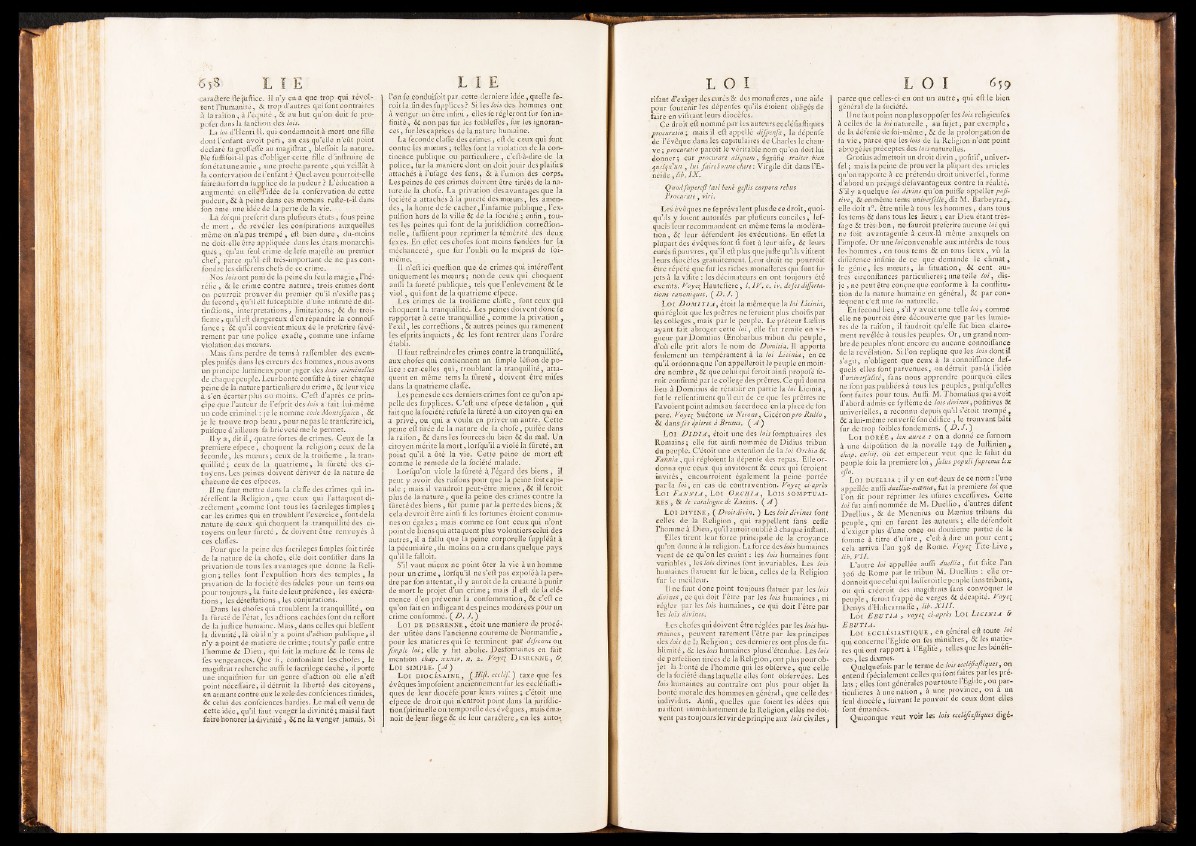
ls58 L I E
cara&efeflejuftice. Il n’y en a que trop qui révoltent
l’humanité, & trop d’autres qui font contraires
à la raifon, û l’équité , & a u but qu’on doit fe pro-
pofer dans la lanéiion des lois,
La /oi.d’Henri Il.qui condamnoit à mort une fille
dont l’enfant avoit péri , au cas qu’elle n’eût point
déclaré fa groffefî'e au magiftrat, bleffoit la nature.
Ne fuffifoit-il pas d’obliger cette fille d ’inftruire de
fon état une amie , une proche parente ,-qui veillât à
la confervation de l’enfant ? Quel aveu pourroit-elle
faire âu fort du fupplice de fa pudeur ? L’éducation a
augmenté en elleft’idée de la confervation de cette
pudeur, & à peine dans ces momens refte-t-il dans
fon ame .une.idée de la perte de la vie.
Là /ei qui prefcrit dans plufieurs états , fous peine
de mort, de révéler les confpirations auxquelles
même on n’a pas trempé , eft bien dure, du,-moins
ne doit-elle être appliquée dans les états monarchiques
,' qii’au feul crime.de.lefemajefté au premier
chef ; parce qu’il. eft très-important de ne pas confondre
les diffé rens chefs de ce crime.
Nos .lois ont puni de la peine du feu là magie, l’hé-
réfie , & le crime contre, nature, trois crimes dont
on pourroit prouver du premier qu’il n’exifte pas ;
du fécond , qu’il eft fûfceptible d’une infinité de dif-
tinfiions, interprétations , limitations ; & du troifieme.,
au’ileft dangereux d’en répandre la connoif-
fance ; & qu’il convient mieux de le profcrire févé-
rement par une police exafie, comme une infâme
violation des moeurs.
Mais fans perdre de tems à raffembler des exemples
puifés dans les erreurs des hommes, nous avons
un principe lumineux pour juger des lois criminelles
de chaque peuple. Leur bonté confifte à tirer chaque
peine de là nature particulière du crime, & leur vice
à s’en écarter plus ou moins. C ’eft d’après ce principe
que l’auteur de l’efprit des lois a fait lui-même
un code criminel : je le nomme code Montefquieu, &
je le trouve trop beau, pour nepas le tranfcrire ici,
puifque d ’ailleurs fa brièveté me le permet.
Il y a , dit-il, quatre fortes de crimes. Ceux de la
première efpece, choquent la religion ; ceux delà
fécondé, lés moeurs; ceux de.la troifieme ,.la tranquillité.;
ceux de la quatrième, la fureté des citoyens.
Les peines doivent dériver de la nature de
chacune de ces efpeces.
Il ne faut, mettre dans la claffe des crimes qui in-
téreffent la Religion, que ceux qui l’attaquent di-
refiement, comme font tous les facrileges fimples ;
car les crimes qui en troublent l’exercice, font de la
nature de ceux qui choquent la tranquillité des citoyens
ou leur fureté, & doivent être renvoyés à
ces daffes.
Pour que la peine des facrileges fimples foit tirée
de la nature de la chofe; elle doit confifter dans la
privation de tous les avantages que donne la Religion
; telles font l’expulfion hors des temples, la
privation de la fociété des fideles pour un tems ou
pour toujours , la fuite de leur préfence, les exécrations
, les déteftations , les conjurations.
Dans les chofes qui troublent la tranquillité, ou
la fureté de l’état, les afiions cachées font du reflort
de la juftice humaine. Mais, dans celles qui bleffent
la divinité, là où il n’y a point d’afiion publique, il
n’y a point de matière de crime ; tout s’y paffe entre
l ’homme & Dieu ., qui fait la mefure & le tems de
fes vengeances. Que li, confondant les chofes, le
magiftrat recherche aufti le facrilege caché, il porte
une inquifition fur un genre d’afiion où elle n’eft
point néceffaire, il détruit la liberté des citoyens,
en armant contre eux le zele des confciences timides,
&c celui des confciences hardies. Le mal eft venu de
cette idée, qu’il faut venger la divinité ; mais il faut
faire honorer la divinité , de ne la venger jamais. Si
L 1 E
l’on fe conduifoit par cette derniere idée, quelle feroit
la fin des fuppliccs ? Si les lois des, hommes ont
à venger; un être infini, elles fie régleront fur fon infinité
, & non pas fur les foibleffcs, fur les ignorances,
fur les caprices de la nature humaine.
La fécondé cia fie des crimes, eft de ceux qui font
contre les moeurs ; telles font la violation de la continence
publique ou particulière, c’eft-à-dire de la
police, fur la maniéré dont on doit jouir des plaifirs
attachés à l’ufage des fens, & à l’union des corps.
Les peines de ces crimes doivent être tirées de la nature
de la choie. La privation des avantages que la
fociété a attachés à la pureté des moeurs,, les amendes,
la honte defe cacher, l’infamie publique, l’ex-
pulfion hors dé la v ille & de la fociété ; enfin , toutes
les peines qui font delà jurifdifiion correfiion-
nelie, iuffifent pour, reprimer la témérité des deux
fexes. En effet ces chofes font moins, fondées fur la
méchanceté, que fur l’oubli ou le mépris de foi-
même.
Il n’eft ici queftion que de crimes qui intéreffent
uniquement les moeurs ; non de ceux qui choquent
aulïi la fureté publique, tels que l’enlevement & le
v io l , qui font de la quatrième efpece.
Les crimes de la troifieme claffe, font ceux qui
choquent la tranquillité. Les peines doivent donc fe
rapporter à cette tranquillité , comme la privation ,
l’ex il, les correfiions, & autres peines qui ramènent
les efprits inquiets, Ôc les font rentrer .dans l’ordre
établi..
Il faut reftreindreles crimes contre la tranquillité,
aux chofes qui contiennent un fimple léfion de police
: car »celles qui, troublant la tranquilité, attaquent
en même tems la fureté, doivent être mifes
dans la quatrième claffe.
Les peines de ces derniers crimes font ce qu’on appelle
des fupplices. C ’eft une efpece de talion , qui
fait que la fociété refufe la fûreté à un citoyen qui en
a privé, ou qui a voulu en priver un autre. Cette
peine eft tirée de la nature de la chofe, puifée dans
la raifon, & dans les fourcesdu bien & du mal. Un
citoyen mérite la mort, lorfqu’il a violé la fûreté, ail
point qu’il a ôté la vie. Cette peine de mort eft
comme le remede de la fociété malade.
Lorfqu’on viole la fûreté à l’égard des biens , il
peut y avoir des raifons pour que la peine foit capitale
; mais il vaudroit peut-être mieux, & il feroit
plus de la nature, que la peine des crimes contre la
fûreté des biens, fût punie par la perte des biens ; &
cela devroit être ainfi fi les fortunes étoient communes
ou égales ; mais comme ce font ceux qui n’ont
point de biens qui attaquent plus volontiers celui des
autres, il a fallu que la peine corporelle fuppléât à
la pécuniaire, du moins on a cru dans quelque pays,
qu’il le falloit.
S’il vaut mieux ne point ôter la vie à un homme
pour un crime, lorfqu’il nes’eft pas expoféà la perdre
par fon attentat, il y auroit de la cruauté à punir
de mort le projet d’un crime; mais il eft de la clémence
d’en prévenir la confommation, & c’eft ce
qu’on fait en infligeant des peines modérées pour un
crime confommé. ( JD. J. )
L o i d e d e s r e n Ne , étoit une maniéré de procé-i
der ufitée dans l’ancienne coutume de Normandie,
pour les matières qui fe terminent par defrenne ou
fimple loir, elle y fut abolie. Desfontaines en fait
mention chap. x x x iv . n, z . Voye{ D e s r e n n e , &,
L o i s im p l e . (A )
L o i d i o c é s a i n e , (W fi- eccléf.') taxe que les
évêques impofoient anciennement fur les eccléfiafti-
ques de leur diocèfe pour leurs vifites ; c’étoit une
efpece de droit qui n’entroit point dans 'la jurifdic-
tionfpirituelle ou temporelle des évêques, mais éma-
noit de lçur fiege & de leur carafiere, en les auto-
L O I
rifant d’exiger des curés & des monaftercs, une aide
pour foutenir les dépenfes qu’ils étoient obligés de
faire en vifitant leurs diocefes.
Ce droit eft nommé par les auteurs eccléfiaftiques
procuratio ; mais il eft appellé difpenfa, la dépenfe
de l’évêque dan&.les capitulaires de Charles le chauv
e ; procuratio paroit le véritable nom qu’on doit lui
donner ; car procurare aliquem, fignifie traiter bien
quelqu’un , lui faire bonne chere : Virgile dit dans l’Enéide
, lib. IX ,
Quodfuperejl læti benè gefiis corpora rebus
1} ro citrate , viri.
Les évêques ne fe prévalent plus de ce droit, quoiqu’ils
y foient autorifés par plufieurs conciles, Ief-
quels leur recommandent en même tems la modération,
& leur défendent les exécutions. En effet la
plupart des évêques font fi fort à leur aife, & leurs
curés fi pauvres, qu’il eft plus que jufte qu’ils vifitent
leurs diocèfes gratuitement. Leur droit ne pourroit
être répété que fur les riches monafteres qui font fu-
jets à la vifite : les décimateurs en ont toujours été
exemts. Foye^ Hauteffere, /. IF . c. iv. de fes dijfertâtions
canoniques. ( D. J. j
L o i D o m i t i a , étoit la même que la loi Licinia,
qui régloit que les prêtres ne feroient plus choifis par
les colleges, mais par le peuple. Le préteur Lælius
ayant fait abroger cette lo i, elle fut remife en vigueur
parDomitius (Enobarbus tribun du peuple,
d’où elle prit alors le nom de Domitia. Il apporta
feulement un tempérament à la loi Licinia, en ce
qu’il ordonna que l’on appelleroit le peuple en moindre
nombre, & que celui qui feroit ainfi propofé feroit
confirmé par le college des prêtres. Ce qui donna
lieu à Domitius de rétablir en partie la loi Licinia,
fut le refl’enfiment qu’il eut de ce que les prêtres ne
l’avoient point admis au facerdoce en la place de fon
pere. Foyeç Suétone in Nerone, Cicéronpro Rullo,
& dans fes épîtres à Brutus. ( A )
L o i D i d i a , étoit une des lois fomptuaires des
Romains ; elle fut ainfi nommée de Didius tribun
du peuple. C ’étoit une extenfion de la loi Orchia 6c
Fannia, qui régloient la dépenfe des repas. Elle ordonna
que ceux qui invitoient & ceux qui feroient
invités, encourroient également la peine portée
parla loi, en cas de contravention. Foyeç ci-après
L o i F a n n i a , L o i O r c h i a , L o is s o m p t u a i r
e s , & le catalogue de Zazius. ( A )
L o i d i v i n e , (Droit divin. ) Les lois divines font
celles de la Religion , qui rappellent fans ceffe
l ’homme à Dieu, qu’il auroit oublié à chaque inftant.
Elles tirent leur force principale de la croyance
qu’on donne à la religion. La force des /o« humaines
vient de ce qu’on les craint : les lois humaines font
variables , les lois divines font invariables. Les lois
humaines ftatuent fur le bien, celles de la Religion
fur le meilleur.
Il ne faut donc point toujours ftatuër par les lois
divines, ce qui doit l’être par les lois humaines , ni
régler par les lois humaines, ce qui doit l’être par
les lois divines.
Les chofes qui doivent être réglées par les lois humaines
, peuvent rarement l’être par les principes
des lois de la Religion ; ces dernieres ont plus de fu-
blimité, 6c les lois humaines plus d’étendue. Les/o/s
de.perfefiion tirées de la Religion, ont plus pour objet
la bonté de l’homme qui les obferve , que celle
de la fociété dans laquelle elles font obfervées. Les
lois humaines au contraire ont plus pour objet la
bonté morale des hommes en général, que celle des •
individus. Ainfi, quelles que foient les idées qui
na iffent immédiatement de la Religion, elles ne doivent
pas toujours feryir de prinpipe aux lois civiles,
L O I 659
parce que celles-ci en ont un autre, qui eft le bien
général de la fociété.
Il ne faut point non plus oppofer les lois religieufes
à celles de la loi naturelle , au fujet, par exemple,
de la défenfe de foi-même, & de la prolongation de
fa v ie , parce que les lois de la Religion n’ont point
abrogé les préceptes des lois naturelles.
Grotius admettoit un droit divin , pofitif, univer-
fel ; mais la peine de prouver la plûpart des articles
qu’on rapporte à ce prétendu droit univerfel, forme
d’abord un préjugé défavantageux contre fa réalité.
S’il y a quelque loi divine qu’on puiffe appeller pofi-
tive, & en même tems univerfelle, dit M. Barbeyrac,.
elle doit i°. être utile à tous les hommes, dans tous
les tems 6c dans tous les lieux ; car Dieu étant très-
fage & très-bon, ne fauroit preferire aucune loi qui
ne foit avantageufe à ceux-là même auxquels on
l’impofe. Or une loi convenable aux intérêts de tous
les hommes , en tous tems & en tous lieux , vû la
différence infinie de ce que demande le climat,
le génie, les moeurs, la fitùation, 6c cent autres
circonftances particulières; une telle lo i, dis-
je , ne peut être conçue que conforme à la conftitu-
tion de la nature humaine en général, & par con-
féquènt c’eft une loi naturelle.
En fécond lieu , s’il y avoit une telle loi, comme
elle ne pourroit être découverte que par les lumières
de la raifon, il faudroit qu’elle fut bien clairement
révélée à tous les peuples. O r , un grand nombre
de peuples n’ont encore eu aucune connoiffance
de la révélation. Si l’on répliqué que les lois dont il
s’agir, n’obligent que ceux à la connoiffance def-
quels elles font parvenues, on détruit par-là l’idée
d'univerfalité, fans nous apprendre pourquoi elles
ne font pas publiées à tous les peuples,, puifqu’elles
font faites pour tous. Aufti M. Thomafius qui avoit
d’abord admis ce fyftème de lois divines, pofiti ves &
univerfelles, a reconnu depuis qu’il s’étoit trompé,
& a lui-même renverfé fon édifice , le trouvant bâti
fur de trop foibles fondemens. ( D .J . )
L o i d o r é e , lex aurea. : on a donné ce furnom
à une dilpofition de la novelle 149 de Juftinien,
chap. cxliij. où cet empereur veut que le falut du
peuple foit la première lo i, falus populi fuprema lex
efio. I ,
L o i d u e l l i a ; il y en eut deux de ce nom : l’une
appellée aufti duellia-moenia, fut la première loi que
l’on fit pour réprimer les ufures excelfives. Cette
loi fut ainfi nommée de M. Duellio, d’autres difent
Duellius, & de Menenius ou Mænius tribuns du
peuple, qui en furent les auteurs ; elle défendoit
d’exiger plus d’une once ou douzième partie de la
fomme à titre d’ufure, c’eft-àdire un pour cent;
cela arriva l’an 398 de Rome. Foye^ Tite-Live ,
lib. F I I . .
L’autre loi appellée auffi duellia, fut faite 1 an
306 de Rome par le tribun M. Duellius : elle or-
donnoit que celui qui laifferoit le peuple fans tribuns,
ou qui créeroit des magiftrats fans convoquer le
peuple, feroit frappé de verges & décapité. Foyei
Denys d’Hahcarnaffe, lib. X I I I .
Loi E b u t i a , voye^ ci-après Loi L i c i n i a 6r
E b v t i a . #
L o i e c c l é s i a s t i q u e , en general eft toute lot
quj concerne l’Eglife ou fes miniftres, & les matières
qui ont rapport à l’Eglife, telles que les bénéfices
, les dixmes. . ,,r a.
Quelquefois par le terme de lois eccléjiajtiques, on
entend fpécialement celles qui font faites par les prélats
; elles font générales pour toute 1 Egide, ou particulières
à une nation , à une province, ou à un
feul diocèfe, fuivant le pouvoir de ceux dont elles
font émanées.
Quiconque veut voir les lois ccclejiajtiques dige