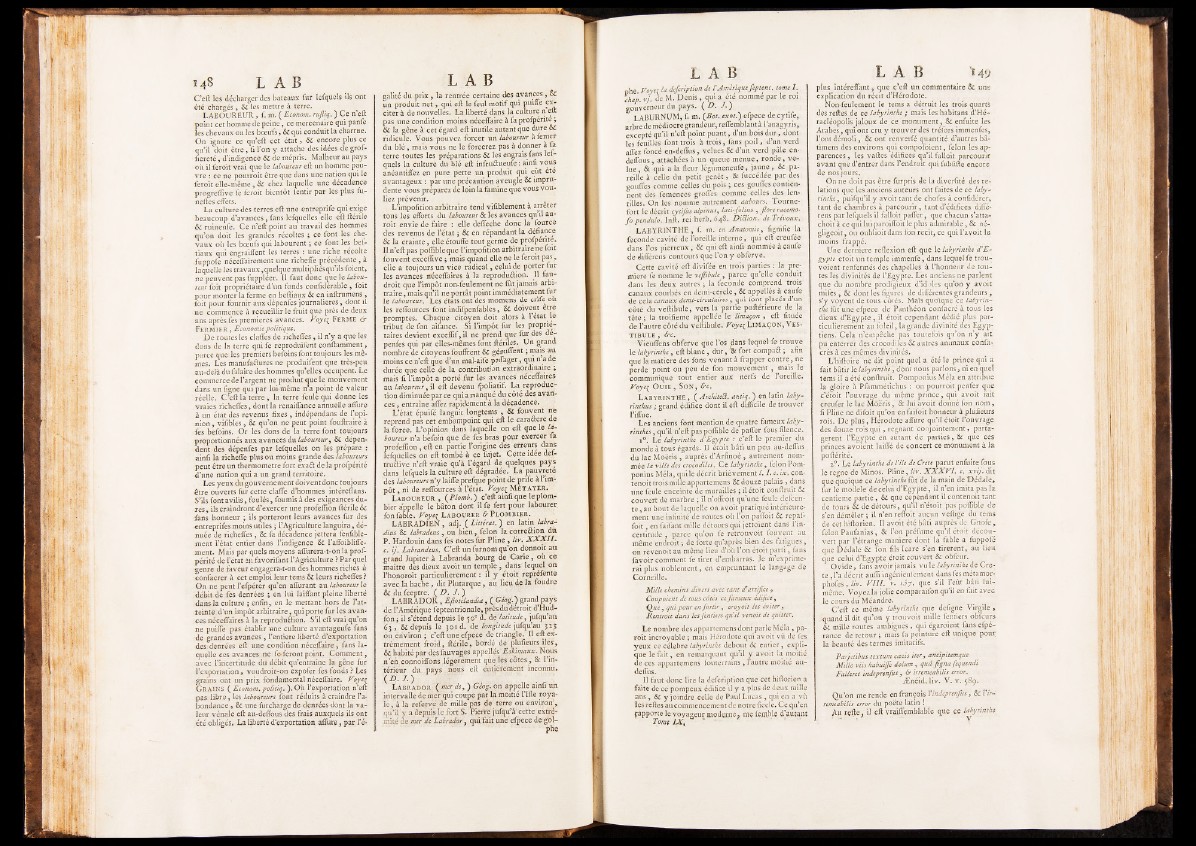
C’eft les décharger des bateaux fur lefquels ils ont
été chargés , & les mettre à terre.
LABOUREUR, f. m. ( Econom. rufiiq. ) Ce n’eft
point cet homme de peine, ce mercenaire qui panfe
les chevaux ou les boeufs , & qui conduit la charrue.
On ignore ce qu’eft cet é ta t , & encore plus ce
qu’il doit être, fi l’on y attache des idées de grof-
fiereté, d’indigence & de mépris. Malheur au pays
où il feroit vrai que le laboureur eft un homme pauvre
: ce ne pourroit être que dans une nation qui le
feroit elle-même, & chez laquelle une decadence
progreflive fe feroit bientôt fentir par les plus fu-
neftes effets.
La culture des terres eft une entreprife qui exige
beaucoup d’avances, fans lefquelles elle eft ftérile
& ruineufe. Ce n’eft point au travail des hommes
qu’on doit les grandes récoltes ; ce font les chevaux
oîi les boeufs qui labourent ; ce font les bef-
tiaux qui engraiffent les terres : une riche récolté
fuppofe néceffairement une richeffe précédente , à
laquelle les travaux , quelque multipliés qu’ils foient,
ne peuvent pas fuppléer. Il faut donc que le laboureur
foit propriétaire d’un fonds confidérable , foit
pour monter la ferme en beftiaux & en inftrumens ,
foit pour fournir aux dépenfes journalières, dont il
ne commence à recueillir le fruit que près de deux
ans après fes premières avances. Voyeç Ferme &
FERMIER, Economie politique.
D e toutes les claffes de richeffes , il n’y a que les
dons de la terre qui fe reproduifent conftamment ,
parce que les premiers befoins font toujours les mêmes.
Les manufactures ne produifent que très-peu
au-delà du falaire des hommes qu’elles occupent. Le
commerce de l’argent ne produit que le mouvement
dans un figne qui par lui-même n a point de valeur
réelle. C ’eft la terre, la terre feule qui donne les
vraies richeffes, dont la renaiffance annuelle affure
à un état des revenus fixes , indépendans de l’opinion
, vifibles, & qu’on ne peut point fouftraire à
fes befoins. Or les dons de la terre font toujours
proportionnés aux avances du laboureur^ & dépendent
des dépenfes par lefquelles on les prépare :
ainfi la richeffe plus ou moins grande des laboureurs
peut être un thermomètre fort exa£t de la profpérité
d’une nation qui a un grand territoire.
Les yeux du gouvernement doivent donc toujours
être ouverts fur cette claffe d’hommes intérefîans.
S’ils font avilis, foulés, fournis à des exigeances dures
, ils craindront d’exercer une profeflion ftérile &
fans honneur ; ils porteront leurs avances fur des
entreprises moins utiles ; l’Agriculture languira, dénuée
de richeffes, &. fa décadence jettera fenfible-
ment l’état entier dans l’indigence & l’affoibliffe-
ment. Mais par quels moyens affurera-t-on la profpérité
de l’état enfavorifant l’Agriculture ? Par quel
genre de faveur engagera-t-on des hommes riches à
confacrer à cet emploi leur tems & leurs richeffes ?
On ne peut l’efpérer qu’en affurant au laboureur le
débit de fes denrées ; en lui laiffant pleine liberté
dans la culture ; enfin, en le mettant hors de l’atteinte
d’un impôt arbitraire, qui porte fur les avances
néceffaires à la reproduction. S’il eft vrai qu’on
ne puiffe pas établir une culture avantageufe fans
de grandes avances , l’entiere liberté d’exportation
des denrées eft une condition néceffaire, fans laquelle
ces avances ne fe-feront point. Comment,
avec l’incertitude du débit qu’entraîne la gêne fur
l ’exportation , voudroit-on expofer fes fonds ? Les
grains ont un prix fondamental néceffaire. Voye^
G rains ( Econom. politiq. ) .O ù l’exportation n’eft
pas libre, les laboureurs font réduits à craindre l’abondance
, & une furchàrge de denrées dont la v aleur
vénale eft au-deffous des frais auxquels ils ont
été obligés, La liberté d’exportation affure, par l’égalité
du prix , la rentrée certaine des avances, &
un produit net , qui eft le feul motif qui puiffe exciter
à de nouvelles. La liberté dans, la culture n eft
pas une condition moins néceffaire à fa profpérité ;
& la gêne à cet égard eft inutile autant que dure oC
ridicule. Vous pouvez forcer un laboureur à femer
du b lé , mais vous ne le forcerez pas à donner à la
terre toutes les préparations & les engrais fans leiquels
la culture du blé eft infruCtueufe : ainfi vous
anéantiffez en pure perte im produit qui eut ete
avantageux : par une précaution aveugle & imprudente
vous préparez de loin la famine que vous vouliez
prévenir. . a
L’impofition arbitraire tend vifiblement à arrêter
tous les efforts du laboureur & les avances qu il au-
roit envie de faire : elle deffeche donc la fourcè
des revenus de l’état ; & en répandant la défiance
& la crainte, elle étouffe tout germe de profpérité.
Il n’eft pas poflibleque l ’impofition arbitraire ne foit
fouvent excelîive ; mais quand elle ne le feroit pas,
elie a toujours un vice radical, celui de porter fur
les avances néceffaires à la reproduction. Il fau-
droit que l’impôt non-feulement ne fût.jamais arbitraire
, mais qu’il ne portât point immédiatement fur
le laboureur. Les états ont des momens de crife où
les reffources font indifpenfables, & doivent etre
promptes. Chaque citoyen doit alors à l’état lè
tribut de fon aifance. Si l’impôt fur les proprietaires
devient exceflïf, il ne prend que fur des de-
penfes qui par elles-mêmes font ftériles. Un grand
nombre de citoyens fouffrent & gémiffent ; mais au
moins ce n’eft que d’un mal-aife psffager, qui n a de
durée que celle de la contribution extraordinaire ;
mais fi l’impôt a porté .fur les avances neceffaires
au laboureur, il eft devenu Ipoliatif. La reproduction
diminuée par ce qui a manqué du côte des avari-,
c e s , entraîne affez rapidement à la decadence.
L’état épuifé languit longtems , & fouvent ne
reprend pas cet embompoint qui eft le caraCtere de
la force. L’opinion dans laquelle on eft que le laboureur
n’a befoin que de fes bras pour exercer fa
profeflion, eft en partie l’origine dés erreurs dans
lefquelles on eft tombé à ce fujet. Cette idée def-
tru&ive n’eft vraie qu’à l’égard de quelques pays
dans lefquels la culture eft dégradée. La pauvreté
des laboureurs n’y laiffe prefque point de prife à 1 impôt
, ni de reffources à l’état. Voye{ Métayer.
Laboureur , ( Plomb. ) c’eft ainfi que le plombier
appelle le bâton dont il fe fert pour labourer,
fon fable, Voye^ LÂBOURER & PLOMBIER.
LABRADIEN, adj. ( Littéral. ) en latin labra-
Mus & labradeus , ou bien, félon la correction du
P. Hardouin dans fes notes fur Pline , liv. X X X I I .
c. ij. Labrandeus. C’eft un furnom qu on donnoit au.
grand Jupiter à Labranda bourg de C a rie, où ce
maître des dieux avoit un temple ? dans lequel on
l’honoroit particulièrement : il y étoit repréfente
avec la hache, dit Plutarque, au lieu de la foudre
&,du fceptre. { D . J .') , : :
LABRADOR, Eflotilandia, (Géog. ) grand pays
de l’Amérique feptentrionale, près du détroit d’Hud-
fon; il s’étend depuis le 50e d. de latitude, jufqu’aù
<$3 , & depuis le 301 d. de longitude jufqu’au 325
ou, environ; c’eft une efpece de triangle. Il eft extrêmement
froid, ftérile, bordé dé plüfieurs îles,
& habité par des fauvages appelles' Eskirnaux. Nous
n’en . connoiffons légèrement que les cotes , & 1 intérieur
du pays nous eft entièrement inconnu.
( D . J. ) : ... V T '
Labrador ( mer de, ) Géog.on appelle ainfi un
intervalle de mer qui coupe par la moitié l’Ifle royale
, à la refervé de mille pas de terre ou environ ,
qu’il y a depuis le fort S. Pierre jufqu’à' cette extrémité
de mer de 'Labrador, qui fait une efpece de gblphç
phe. Voyt{la defeription de V Amérique feptent, tome î .
cha 'p. vj. de M. Den is , qui a été nommé par le roi
gouverneur du pays. ( D . J.')
LABURNUM, f. m. {Bot. exot.) efpece de cytife,
arbre de médiocre grandeur, reffemblant à l ’anagyris,
excepté qu’il n’eft point puant, d’un bois dur, dont
les feuilles font trois à trois, fans p o il, d’un verd
affez foncé en-deffus, velues & d’un verd pâle en-
deffous, attachées à un queue menue, ronde, velue
, & qui a la fleur légumeneufe, jaune, & pareille
à celle du petit genêt, & fuccédée par des
gouffes comme celles du pois ; ces gonfles contiennent
des femences groffes comme celles des lentilles.
On les nomme autrement aubours. Tourne-
fort le décrit cytifus alpinus^ lati-folius , fiore racemo-
fo pendulo. Inft. rei herb. 648. Diction, de Trévoux.
LABYRINTHE, f. m. en Anatomie, fignifie la
fécondé cavité de l’oreille interne, qui eft creufée
dans l’os pierreux, & qui eft ainfi nommée à caufe
de éifférens contours que l’on y obferve.
Cette cavité eft divifée en trois parties : la première
fe nomme le vejlibulc', parce qu’elle conduit
dans les deux autres ; la fécondé comprend trois
canaux courbés en demi-cercle, &c appelles à caufe
de cela canaux demi-circulaires, qui font places d un
côté du veftibule, vers la partie poftérieure de la
tê te ; la troifieme appellée le limaçon , eft fituée
de l’autre côté du veftibule. Voye[Limaçon, Vestibule
, &c.
Vièuffens obferve que l ’oS dans lequel fe trouve
le labyrinthe, eft blanc, dur, & fort compaft ; afin
qtre la matière des fons venant à frappèr contre , ne
perde point ou peu de fon mouvement , mais le
communique tout entier aux nerfs de 1 oreille.
P o y e i O u ï e , S o n , & c.
Labyrinthe , ( Architecl. antiq. ) en latin laby-
rinthus ; grand édifice dont il eft difficile de trouver
l’iffue.
Les anciens font mention de quatre fameux labyrinthes
, qu’il n’eft pas poflible de paffer fous filence.
i° . Le labyrinthe d'Egypte : c’eft le premier du
monde à tous égards. Il étoit bâti un peu au-deffus
du lac Moëris , auprès d’Arfinoé , autrement nommée
la ville des crocodiles. Ce labyrinthe, félon Pom-
ponius Mêla, qui le décrit brièvement 1. 1. c. ix. con-
tenoit trois mille appartemens & douze palais , dans
une feule enceinte de murailles ; il étoit conftruit &
couvert de marbre ; il n’offroit qu’une feule defeen-
t e , au bout de laquelle on avoit pratiqué intérieurement
une infinité de routes où l’on paffoit & repaf-
fo i t , en faifant mille détours qui jettoient dans l’incertitude
, parce qu’on fc retrouvoit fouvent au
même endroit ; de forte qu’aptes bien des fatigues,
on revenoit au même lieu d’où l’on étoit parti, fans
favoir comment fe tirer d’embarras. Je m’exprimerai
plus noblement, en empruntant le langage de
Corneille.
Mille chemins divers avec tant M artifice ,
Coupoient de tous côtés ce fameux édifice,
Q u e ,- qui pour en for tir , croyait les éviter ,
Rentroit dans les fenùtrs qu il venoit de quitter.
Le nombre des appartemens dont parle Mêla, pa-
roît incroyable ; mais Hérodote qui avoit vû de fes
yeux ce célébré labyrinthe debout & entier, explique
le fa it , en remarquant qu’il y avoit la moitié
de ces appartemens fouterrains , l’autre moitié au-
deffus.
Il faut donc lire la defeription que cet hiftorien a
faite de ce pompeux édifice il y a plus de deux mille
ans , & y joindre celle de Paul Lucas , qui en a vû
les reftes au commencement de notre fiecle. C e qu’en
^apporte le voyageur modçrne, ni? feiubU d’autant
Tome m ” ~
plus intéreftant, que c’eft un commentaire 8t une
explication du récit d’Hérodote.
Non-feulement le tems a détruit les trois quarts
des reftes de ce labyrinthe ; mais les habitans d’Hé-
racléopolis jaloux de ce monument, Sc enfuite les
Arabes, qui ont cru y trouver des tréfors immenfes,
i’ont démoli, & ont renverfé quantité d’autres bâ-
timens des environs qui compofoient, félon les apparences
, les vaftes édifices qu’il falloit parcourir
avant que d’entrer dans l’endroit qui fubfifte encore
de nos jours.
On ne doit pas être furpris de la diverfité des relations
que les anciens auteurs ont faites de ce laby-
rinthe, puifqu’il y avoit tant de chofes à confidérer,
tant de chambres à parcourir, tant d’édifices diffé-
rens par lefquels il falloit paffer, que chacun s’ atta*
choit à ce qui lui paroiffoit le plus admirable, & né-,
gligeoit, ou oublioit dans fon récit, ce qui l’avoit le
moins frappé.
Une derniere reflexion eft que le labyrinthe d'Egypte
etoit un temple immenfe, dans lequel fe trou-
voient renfermés des chapelles à l’honneur de toutes
les divinités de l’Egypte. Les anciens ne parlent
que du nombre prodigieux d’idoles qu’on y avoit
mifes , & dont les figures de différentes grandeurs ,
s’y voyent de tous côtés. Mais quoique ce labyrinthe
fut une efpece de Panthéon confacré à tous les
dieux d’Egypte , il étoit cependant dédié plus particulièrement
au foleil, la grande divinité des Egyptiens.
Cela n’empêche pas toutefois qu’on n’y ait
pu enterrer des crocodiles & autres animaux confa-,
crês à ces mêmes divinités.
L’hiftoire ne dit point quel a été le prince qui a
fait bâtir le labyrinthe, dont nous parlons, ni en quel
tems il a été conftruit. Pomponius Mêla en attribue
la gloire à Pfammétichus : on pourroit penfer que
c’étoit l’ouvrage du même prince, qui avoit fait
creufer le lac Moëris, & lui avoit donné fon nom ,
fi Pline ne difoit qu’on en faifoit honneur à plufieurs
rois. De plus, Hérodote affure qu’il étoit l’ouvrage
des douze rois q u i, régnant conjointement, partagèrent
l’Egypte en autant de parties, & que ces
princes avoient laiffé de concert ce monument à la
poftérité.
2°. Le labyrinthe de Vile de Crete parut enfuite fous
le régné de Minos. Pline, liv. X X X V l. c. xvij. dit
que quoique ce labyrinthe fut de la main de D edale,
fur le modèle de celui d’Egypte, il n’en imita pas la
centième partie, & que cependant il contenoit tant
de tours & de détours, qu’il nétoit pas poflible de
s’en démêler ; il n’en reftoit aucun veftige du tems
de cet hiftorien. Il avoit été bâti auprès de Gnofe,
félon Paufanias, & l’on préfume qu’il étoit découvert
par l’étrange maniéré dont la fable a fuppofé
que Dédale & fon fils Icare s’en tirèrent, au lieu
que celui d’Egypte étoit coùvert & obfcur. ,
Ovid e, fans avoir jamais vu le labyrinike de Crete
, l’a décrit aufli ingénieulement dans fes metamor*
phofes, liv. VIII. v. /J7 . que s’il l’eut bâti lui-
même. Voyez la jolie comparaifon qu’il en fait avec
le cours du Méandre.
C ’eft ce même labyrinthe qité defigne Virgile ,
quand il dit qu’on y trouvoit mille fentiers obfcurs
& mille routes ambiguës , qui égaroient fans efpe-
rance de retour ; mais fa peinture eft unique pour
la beauté des termes imitatifs.
Par jetibus textum ciccis iter, ancipitemque
Mille viis habuijfe dolum , quâ figna fequendi
Falleret indeprenfus , 6* irremeabilis error. ,
Ænéid. liv. V. v. 589,
Qu’on me rende en français Vindeprenfus, & l’/r-'
remeabilis error du poëte latin !
Au refte, il eft yraiffemblable que ce labyrinthe