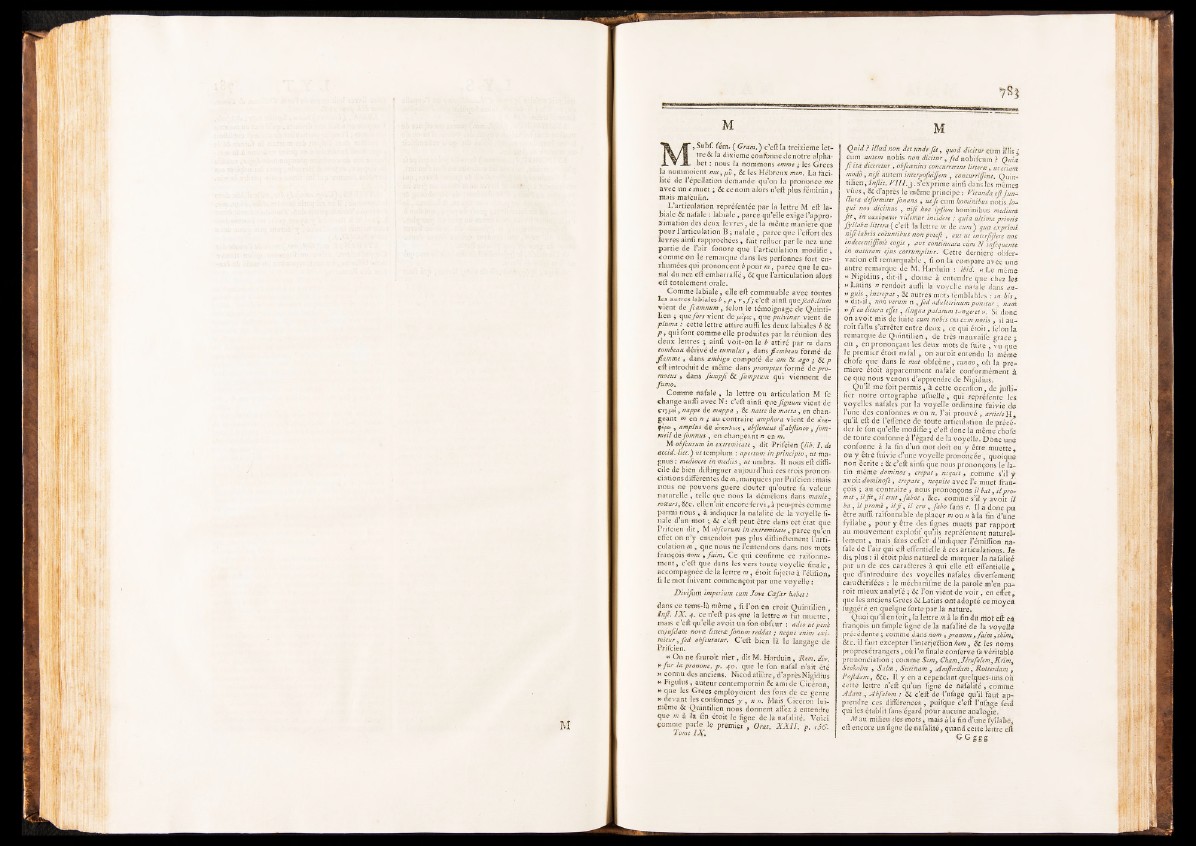
M, Subf. feni. ( Gram. ) c’eft la treizième lettre
& la dixième conforme de notre alphabet
: nous la nommons tmmt ; les Grecs
la nommoient m u y pu y 6c les Hébreux mcn. La facilité
de l’épellation demande qu’on la prononce me
avec un e muet ; & ce nom alors n’eft plus féminin ,
mais mafculin.
L’articulation repréfentée par là lettre M eft labiale
6c natale c labiale, parce qu’elle exige l’approximation
des deux levres , de la même maniéré que
pour l'articulation B ; nafale , parce que l’effort des
îevres ainfi rapprochées , fait refluer par le nez une
partie de l’air fonore que l ’articulation modifie »
comme on le remarque dans les perfonnes fort enrhumées
qui prononcent b pour/«, parce que le canal
du nez eft embarraffé, 6c que l’articulation alors
eft totalement orale.
Comme labiale, elle eft commuable avec toutes
les autres labiales b , p , v , f - c’eft ainfi quefcàbtllum
vient de feamnum , félon le témoignage de Quinti-
lien ; quefors vient de pepoç, que pulvinar vient de
pluma : cette lettre attire aufli les deux labiales b 6c
p 9 qui font comme elle produites par la réunion des
deux lettres ; ainfi voit-on le b attiré par m dans
tombeau dérivé de tumulus »dans flambeau formé de
flamme , dans ambigo compofé de am & a go ; 6c p
eft introduit de même dans promptus formé de pro-
motus , dans fumpjî 6c fumptum qui viennent de
fumo.
Comme nafalè , la lettre où articulation M fe
change aufli avec N : c’eft ainfi que Jignum vient de
, nappe de mappa , 6c natte de matta, en changeant
m en n ; au contraire amphora vient de àva-
Jptjlj » amplus de àvctwteoc , abjlemius d’abftineo y fôm-
meil de fomnus , en changeant n en m.
M obfcurum in extremitate , dit Prifcien (lib. I. de
ttccid. lut.) ut templum : apertum in principio, ut ma-
gnus : médiocre in mediis, m umbra. Il nous eft difficile
de bien diftinguer aujourd’hui ces trois pronon-
cia lions différentes de m, marquées par Prifcien : mais
nous ne pouvons guere douter qu’outre fa valeur
naturelle , telle que nous la démêlons dans manie,
moeurs, & c. ellen’ait encore fe rvi, à peu-près comme
parmi nous , à indiquer la nafalité de la voyelle finale
d’un mot ; & c’eft peut être dans cet état que
Prifcien dit, M objcurum in extremitate, parce qu’en
effet on n’y entendoit pas plus diftinâement l’articulation
m , que nous ne l’entendons dans nos mots
françois nom , faim. Ce qui confirme ce raifonne-
ment » c’eft que dans les vers toute voyelle Anale
accompagnée de la lettre m, étoit fin jette à l’élifion,
fi le mot fuivant commençoit par une voyelle :
Divifiim imperium cum Jove Coefar habet i
dans ce tems-là même , fi l’on en croit Quintilren ,
injl. IX . 4. ce n’eft pas que la lettre m fût muette ,
mais c ’eft qu’elle avoit-un fon obfcur : adèo ut penè
vu/ufdam novoe litterà fonum reddat ■; neque enim exi-
mitur,fed obfcuratur. C ’eft bien là le langage de
Prifcien.
« On ne fauroit nier, dit M. Harduin, Rein. âiv.
y, fur la prononc. p. 40. que le fon nafa'l n’ait été
» connu des anciens. Nicod afïtire, d’après Nigidius
» Figulus, auteur contemporain & ami de Cicéron»
♦> que les Grecs employoient des fons de ce genre
» devant les confonnes y , x ». Mais Cicéron lui-
meme & Quintilièn nous donnent affez à entendre
que m à la fin étoit le ligne de la nafalité. Voici
Comme parle le premier , Orat. X X I I , p, i5 Ç.
Tome IX ,
Quid ? illud noii àeï unde f i t , quod dicilur cllrti îllis 2
cum aiitem nobis non dicitnr, Jid nobifeum ? Quid
j i ita diceretut , obfcoenius concurrerent litterce, ut etiant
modb, niji autem inïerpojuijjem , concurrifent. Quin-
tilien, Infiit. F III. 3. s’exprime ainfi dans les mêmes
vûes, & d’après le même principe : Vitanda eft iun~
clura deformiter fonans , tufi cum kominibus notis /<?-
qui nos dicimus , niji hoc ipfum hominibus mediurrl
f it y in KetxoïpetTOv videmur incidere : quia ultimà prions
fyllabæ litterafc’eft la lettre m de cum) quæ exprime
niji la bris coèurtdbus noti potefl , aiu ut interfiftere nos
indecemijfîmh cogit , aut continuata ciim N infequentc
in naturam ejus corrunipitùr. Cette derniere obfer-
vation eft remarquable , fi on la compare avec une
autre remarque de M. Harduin : ibid. « Le même
» Nigidius, dit-il , donne à entendre que chez les
» Latins n réndoit aufli la voyelle nafale dans an-
» guis y increpat, 6c autres mots femblables : m his ,
»> dit-il » non verum n , fed adulurinum ponitur ; nani
»Jiea litttra effet, lingua palatum tungeret >>. Si donc
on avoit mis de fuite cum nobis ou cum notis , il au-
roit fallu s’arrêter entre deux , ce qui étoit, félon la
remarque de Quifttiiien de très mauvaife grâce ÿ
ou , en prononçant les deüx mots de fuite * vu .que
le premier étoit nafal y on auroit entendu la même
chofe que dans le mot obfcène, cunno y oît la pre-
miere étoit apparemment nafale conformément ,à
ce que nous venons d’apprendre de Nigidius.
Qu’il me foit permis, à cette occafion, de jufti-
fier notre ortographe ufüelie, qui repréfente les
voyelles nafàles par la voyelle ordinaire fuivie de
l’une des confonnes m ou n. f a i prouvé , article H ,
qu’il eft de l’effence de toute articulation de précéder
le fon qu’elle modifie ; c’eft donc la même chofe
de tonre conforme à l’égard de la voyelle. Donc une
confonne à la fin d’un mot doit ou y être muette y
ou yjêtre fuivie d’une voyelle prononcée, quoique
non écrite : & c’ eft ainfi que nous prononçons le latin
meme dominos y crêpât, n e q u i t.comme s’il y
avoit domi/iofe, crepate , nequite avec Ve muet françois
; au contraire , nous prononçons il bat, .ilpromet
, il fit y U crut y faboi, &c. comme s’il y avoit il
ba y il prome y il fi y il cru , fabo fartsr. Il a donc pu
être aufli raifonnable dé placer m ou n à la fin d’une
fyllabe , pour y être des Agnes muets par rapport
au mouvement explofif qu’ils repréfentent naturellement
, mais fans ceffer d’indiquer l’émiflion nafale
de l’air qui eft eflentielle à ces articulations. Je
dis plus : il étoit plus naturel de marquer la nafalité
par un de ces carafteres à qui elle eft eflentielle *
que d’introduire des voyelles natales diverfement
carattérifées : le méchanifme de la parole m’en paraît
mieux analyfé ; & l’on viént de v o ir , en effet,
que les anciens Grecs 6c Latins „ont adopté ce moyen
fuggérë en quelque forte parla nature.
Quoi qu ’il en loir, la lettré m à la fin dii rtiôt ëft ert
françois un fimp'le ligné de la nafalité de la voyelle
précédente ; comme.dans nom » pronom, faim ,,thimÿ
6tc. 'û faut excepter l’interjeéfion hem , 6c les noms
propres étrangers, oit Ym finale conferve fa véritable
prononciation ; comme Serti, Cham, jèrufaienty Kfimy
Stokolm , Salm , Surinam , Àmftirdam, Rotterdam ,
Poftdam y 6cc. Il y en a cependant quelques-uns oit
cette lettre n’eft qu’un ligne de nafalité y comme
AdamAbfalorri : 6c c’éft de 'l’ufàge qu’il 'faut apprendre
ces différences , püifque c’eft l ’ufage feui
qui les établit fans égard pour aucune analogie.
M au milieu des mots y mais àla fin d’unè fyllabëi
eft encore unfigne de-nafalité, quand cette lettre eft
C G g g g