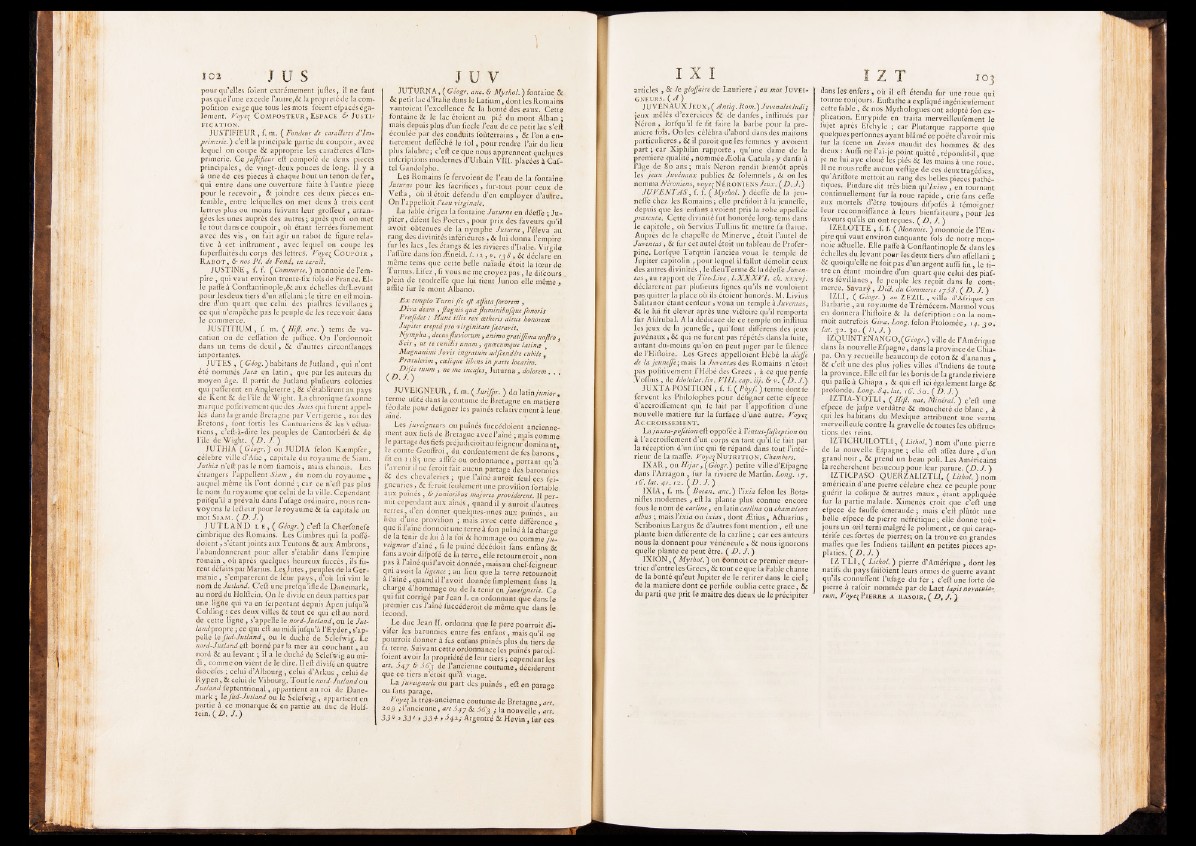
toi J U s
pour qu’elles foient extrêmement juftes, il ne faut
pas que l’une excede l’autre,& la propreté de la com-
pofuion exige que tous les mots foient efpacés également.
Voyt^ C om po s t e u r , Espace 6* Ju st i-1
FICATION.
JUSTIFIEUR , f. m. ( Fondeur de caractères d'imprimerie.)
c’eft la principale partie du coupoir, avec
lequel on coupe 6c approprie les caraéleres d’imprimerie.
Ce juftifieur eft compofé de deux pièces
principales, de vingt-deux pouces de long. Il y a
à une de ces pièces à chaque bout un tenon de fer,
qui entre dans une ouverture faite à l’autre piece
pour le recevoir, & joindre ces deux pièces ensemble,
entre lefquelles on met deux à trois cent
lettres plus ou moins fuivant leur groffeur , arrangées
les unes auprès des autres; après quoi on met
le tout dans ce coupoir, oit étant ferrées fortement
avec des vis , on Fait agir un rabot de figure relative
à cet infiniment, avec lequel on coupe les
Superfluités du corps des lettres. Voye^ C oupoir ,
R a b o t , & nos PI. de Fond. en caracl.
JUSTINE, f. f. ( Commerce. ) monnoie de l’empire
, qui vaut environ trente-fix lois de France. Elle
pafle à Conftantinople,& aux échelles dujLevant
pour les deux tiers d’un affelani ; le titre en eft moindre
d’un quart que celui des piaftres févillanes ;
ce qui n’empêche pas le peuple de les recevoir dans
le commerce.
JUSTITIUM , f. m. (Hifl, anc. ) tems de vacation
ou de ceffation de juftice. On l’ordonnoit
dans un tems de deuil, 6c d’autres circonftances
importantes.
JUTES , ( Géog. ) habitans de Jutland , qui n’ont
été nommés Jutai en latin , que par les auteurs du
moyen âge. Il partit de Jutland plufieurs colonies
qui pafferent en Angleterre ; 6l s’établirent au pays
de Kent 6c de l’île de Wight. La chronique faxonne
marque pofitivement que des Jutes qui furent appelles
dans la grande Bretagne par Vertigerne, roi des
Bretons , font fortis les Cantuariens & les V eélua-
riens, c’eft-à-dire les peuples de Cantorbéri 6c de
l'île de "Wight. (JD. J. )
JUTHIA ( Géogr. j ou JUDIA félon Kæmpfer,
célébré ville d’Afie , capitale du royaume de Siam.
Juthia n’eft pas le nom fiamois, mais chinois. Les
étrangers l’appellent Siam , du nom du royaume ,
auquel même ils l’ont donné ; car ce n’eft pas plus
le nom du royaume que celui de la ville. Cependant
puifqu’il a prévalu dans l’ufage ordinaire, nous renvoyons
le le&eur pour le royaume & fa capitale au
mot S i a m . ( D . J .)
J U T L A N D l e , ( Géogr. ) c’eft la Cherfonefe
cimbrique des Romains. Les Cimbres qui la poffé-
doient, s’étant joints auxTeutons 6c aux Ambrons,
l’abandonnèrent pour aller s’établir dans l’empire
romain , oit après quelques heureux fuccès, ils furent
défaits par Marius. LesJutès, peuples de la G ermanie
, s’empareront de leur pays, croît lui vint le
nom de Jutland. C’eft une prefqu’iflede Danemark,
au nord du Holftein. On le divile en deux parties par
une ligne qui va en ferpentant depuis Apen jufqu’à
Colding : ces deux villes 6c tout ce qui eft au nord
de cette ligne, s’appelle le nord- Jutland, ou le Jutland
propre ; ce qui eft au midi jufqu’à l’Ey der, s’appelle
lefud-Jutland, ou le duché de Sclefwig. Le
nord-Jutland eft borné par la mer au couchant, au
nord 6c au levant ; il a le duché de Sclefwig au midi
, comme on vient de le dire. Il eft divifé en quatre
diocèfes ; celui d’Albourg , celui d’Arkus , celui de
Rypen, & celui de Vibourg. Tout le nord- Jutland ou
Jutland feptentrional, appartient au roi de Danemark
; lefud-Jutland ou le Sclefwig , appartient en
partie à ce monarque 6c en partie au duc de Holftein.
( D . J. )
J U V
JÜTURNA, (Géogr. anc. & Mythol. ) fontaine &
& petit lac d’Italie dans le Latium, dont les Romains
vantoient l’excellence & la bonté des eaux. Cette
fontaine & le lac étoient au pié du mont Alban ;
mais depuis plus d’un fiecle l’eau de ce petit lac s’eft
écoulée par des conduits foûterrains , 6c l ’on a entièrement
defféché le f o l , pour rendre l’air du lieu
plus falubre; c’eft ce que nous apprennent quelques
inferiptions modernes d’Urbain VIII. placées à C af-
tel Gandolpho.
Les Romains fc fervoient de l’eau de la fontaine
Juturne pour les facnfices, fur-tout pour ceux de
Vefta, oit ilétoit défendu d’en employer d’airtre.
On l’appelloit l'eau virginale.
I La table érigea la fontaine Jututne en déefle ; Jupiter
, difent les Poètes, pour prix des faveurs qu’il
avoit obtenues de la nymphe Juturne, l’éleva au
rang des divinités inférieures, & lui donna l’empire
lj,r 1®S lacs, les étangs & les rivières d’Italie. Virgile
l ’aflure dans fon Æneid. /. 12, v. 13 8 , 6c déclare en
même tems que cette belle naïade étoit la foeur de
Turnus. L iiez, fi vous ne me croyez pas, le difeours
plein de tendreffe que lui tient Junon elle même >
affile fur le mont Albano.
E x templo Turni Jtc eft affata fàrorèm ÿ
Diva deam , ftagnis quoejhtminibufque fonoris
Præfidet : Hune illis rex cetheris dltus honorent
Jupiter ereptâpro virginitate facravit.
Nympha, decus fluviorum , animo gratïfjima noftro ,
Scis , ut te cunctis unam , queecumque latince
Magnanimi Jovis ingratuki adfcendêre cubile \
Proetulerim , coelique libens in parte locarim.
Difce tuum , ne me ineufes Juturna , dolorem. . \
( D . J . )
JUVEIGNEUR, f. m.(Jurifpr. ) du latin/Wor,
terme ulité dans la coutume de Bretagne en matière
féodale pour debgner les puînés relativement à leuf
amé.
Les juveigneurs ou puînés fuccédoient ancienne-*
ment aux fiefs de Bretagne avec l’aîné ; mais comme'
le partage des fiefs préjudicioit au feigneur dominant,
le comte Geolfroi, du confentement de fes barons
fit en 1185 l,ne aftîfe ou ordonnance, portant qu’à
l’avenir il ne feroit fait aucun partage des baronnies
& des chevaleries ; que l’aîné auroit feul ces fei-
gneuries, & feroit feulement une provifion fortable
aux puînés , & junioribus majores providerent. Il permit
cependant aux aînés, quand il y auroit d’autres
terres, d’en donner quelques-unes aux puînés, au
lieu d une provifion ; mais avec cette différence „
que fi l’aîné donnoit une terre à fon puîné à la charge
de la tenir de lui à la foi & hommage ou comme ju+
veigneur d’aîné , û le puîné décédoit fans enfans &
fans avoir difpofé de la terre, elle retourneroit, non
pas à l’aîné qui l’a voit donnée, mais au chef-feigneur
qui avoit la ligence ; au lieu que la terre retournoit
à 1 amé , quand il 1 avoit donnée Amplement fans la
charge d hommage ou de la tenir en juveignerie. Ce
qui fut corrigé par Jean I. en ordonnant que dans le
premier cas l’ainé fuccéderoit de même que dans le
fécond.
Le duc Jean II. ordonna que le pere pourroit di-
vifer les baronnies entre fes enfans, mais qu’il ne
pourroit donner à fes enfans puînés plus du tiers de
fa terre. Suivant cette ordonnance les puînés paroif-
foient avoir la propriété de leur tiers ; cependant les
art. Sqy & JGj de l’ancienne coutume, décidèrent
que ce tiers n’étoit qu’à viage.
Lajuveignerlt ou part des puînés , eft en parage
ou fans parage.
Foyei la très-ancienne coutume de Bretagne art.
xo9 ; l’ancienne, are 54y & JGj ; la nouvelle, art.
3 3 ° >3 3 ‘ » 3 3 4 » ^42-i Argentré & Hevin, fnr ces
I X I
articles , & te glojfairt de Laurîere au mot Jüvéî-
gneurs. ( A )
JUVÉNAUX Jeu x, ( Antiq. Rom.') Juvenales ludij
jeux mêlés d ’exercices 6c de danfes, inftitués par
Néron, lorfqu’il fe fit faire la barbe pour la première
foîs. On les célébra d’abord dans des maiions
particulières, 6c il paroît que les femmes y avoient
part ; car Xiphilin rapporte, qu’une dame de la
première qualité, nomméeÆolia Catula, y danfa à
l’âge de 80 ans ; mais Néron rendit bientôt après
les jeux Juvénaux publics 6c folemnfels, & on les
nomma Néroniens, voj^ N éroniens Jeux. (D .J . )
JU V EN T A S , f. f. (Mythol. ) déeffe de la jeu-
neffe chez les Romains ; elle préfidoit à la jeuneffe,
depuis que les enfans avoient pris la robe appellée
proetexta. Cette divinité fut honorée long-tems dans
le capitole, oii Servius Tullius fit mettre fa ftatue.
Auprès de la chapelle de Minerve, étoit l’autel de
Juventas, & fur cet autel étoit un tableau de Profer-
pine. Lorfque Tarqtiin l’ancien voua le temple de
Jupiter capitolin , pour lequel il fallut démolir ceux
des autres divinités, le dicuTerme & la déefle Juventas
, au rapport de Tite-Live, /.X X X V I . ch. xxxvj.
déclarèrent par plufieurs fignes qu’ils ne vouloient
pas quitter la place oii ils étoient honorés. M. Livius
Salitanor étant cenleur, voua un temple à Juventas,
& le lui fit élever après une viéloire qu’il remporta
fur Afdrubal. A la dédicace de ce temple on inftitua
les jeux de la jeunefle, qui'font différens des jeux
juvénaux, & qui ne furent pas répétés dans la fuite,
autant du-moins qu’on en peut juger par le filence
de PHiftoire. Les Grecs appelloient Hébé la déejje
de la jeunejfe\mais la Juventas des Romains n’étoit
pas pofitivement l'Hébé des Grecs , à ce que penfe
Voflius , de Idololat. liv. VIII. cap. iij. & v. (D . J.)
JUXTA-POSITION , f. f. ( Phyf. ) terme dont le
fervent les Philofophes pour défigner cette efpece
d ’accroiflement qui le fait par l ’appofition d’une
nouvelle matière fur la furface d ’une autre. Voye1
A ccroissement.
La juxta-pofttion eft oppofée à Vintus-fufception ou
à l ’accroiflement d’un corps en tant qu’il fe fait par
la réception d’un fuc qui fe répand dans tout l’intérieur
de la malle. Voye^ Nutrition. Ckambers.
IX A R , ou Hijar y (Géogr.) petite ville d’Efpagne
dans l’Arragon , fur la riviere de Marfin. Long. iy.
jG .la t .4 1 .12. ( D . J . )
IX IA , f. m. ( Botan. anc. ) i'ixia félon les Bota-
niftes modernes , eft la plante plus connue encore
fous le nom de carline, en latin carlina ou chamoelton
albus ; mais Vixia ou ixias, dont Ætius, Aétuarius ,
Scribonius Largus & d’autres font mention , eft une
plante bien différente de la carline ; car ces auteurs
nous la donnent pour vénéneufe, 6c nous ignorons
quelle plante ce peut être. ( D . J . )
IXION, ( Mythol. ) on Connoit ce premier meurtrier
d’entre les Grecs, & tout ce que la Fable chante
de la bonté qu’eut Jupiter de le retirer dans le ciel ;
de la maniéré dont ce perfide oublia cette grâce, 6c
du parti que prit le maître des dieux de le précipiter
ï Z T 103
dans les enfers , oît il eft étendu fur une roue qui
tourne toujours. Euftathe a expliqué ingénieufement
cette fable, & nos Mythologues ont adopté fon explication.
Eurypide en traita merveilleufement le
Fujet apres Efchyle ; car Plutarque rapporte que
quelques perfonnes ayant blâmé ce poète d’avoir mis
lur la lcene un Ixion maudit des hommes 6c des
dieux : Aufli ne l’ai-je point quitté, répondit-il, que
je ne lui aye cloué les piés 6c les mains à une roue.
Il ne nous refte aucun veftige de ces deux tragédies,
qu’Ariftote mettoit au rang des belles pièces pathétiques.
Pindare dit très-bien qu'Ixion , en tournant
continuellement fur la roue rapide, crie fans ceffe
aux mortels d’être toujours difpofés à témoigner
leur reconnoiffance à leurs bienfaiteurs, pour les
faveurs qu’ils en ont reçues. ( D . J . )
IZELOTTE , f. f. (Monnoie. ) monnoie de l ’Em*
pire qui vaut environ cinquante fols de notre monnoie
attuelle. Elle paffe à Conftantinople 6c dans les
échelles du levant pour les deux tiers d’un affellani ;
6c quoiqu’elle ne foit pas d’un argent aufli fin, le titre
en étant moindre d’un quart que celui des piaftres
fevillanes, le peuple les reçoit dans le commerce.
Savarÿ, Dicl. du Commerce tyS8. ( D . J . )
IZLI , ( Géogr. ) ou ZEZIL , ville d’Afrique en
Barbarie , au royaume de Trémécem. Marmol vous
en donnera l’hiftoire & la defeription : on la nom-
moit autrefois Giva. Long, félon Ptolomée, 14. 30.
lat.32. jo . ( D .J . )
IZ QUINTEN A NG O, (Géogr.) ville de l’Amérique
dans la nouvelle Efpagne, dans la province de Chia-
pa. On y recueille beaucoup de coton 6c d’ananas ,
6c c eft une des plus jolies villes d’indiens de toute
la province. Elle eft fur les bords de la grande rivière
qui pafle à Chiapa , & qui eft ici également large 6c
profonde. Long. 84. lat. iG. So. (D .J . )
IZ T IA -YO T L I, ( Hiß. nat. Minéral. ) c ’eft une
efpece de jafpe verdâtre & moucheté de blanc , à
qui les habitans du Mexique attribuent une vertu
merveilleufe contre la gravelle 6c toutes les obftruc-
tions des reins.
IZTICHUILOTLI, (Lith ol.) nom d’une pierre
de la nouvelle Efpagne ; elle eft allez dure , d’un
grand noir, 6c prend un beau poli. Les Américains
la recherchent beaucoup pour leur parure. (D .J . )
IZTICPASO - QUERZALIZTLI, ( Lithol. ) nom
américain d’une pierre célébré chez ce peuple pour
guérir la colique & autres maux, étant appliquée
lur la partie malade. Ximenès croit que c’eft une
efpece de fauffe émeraude ; mais c’eft plutôt une
belle efpece de pierre néfrétique ; elle donne toû-
jours un oeil terni malgré le poliment, ce qui carac-
térife ces fortes de pierres; on la trouve en grandes
maffes que les Indiens taillent en petites pièces ap-
platies. ( D . J . ) r
I Z T L I , ( Lithol. ) pierre d’Amérique , dont les
natifs du pays faifoient leurs armes de guerre avant
qu’ils connuffent l’ufage du fer ; c’eft une forte de
pierre à rafoir nommée par de Laet lapis noyacula-
rum, VoycçPierre a rasoir. ( D , J . )