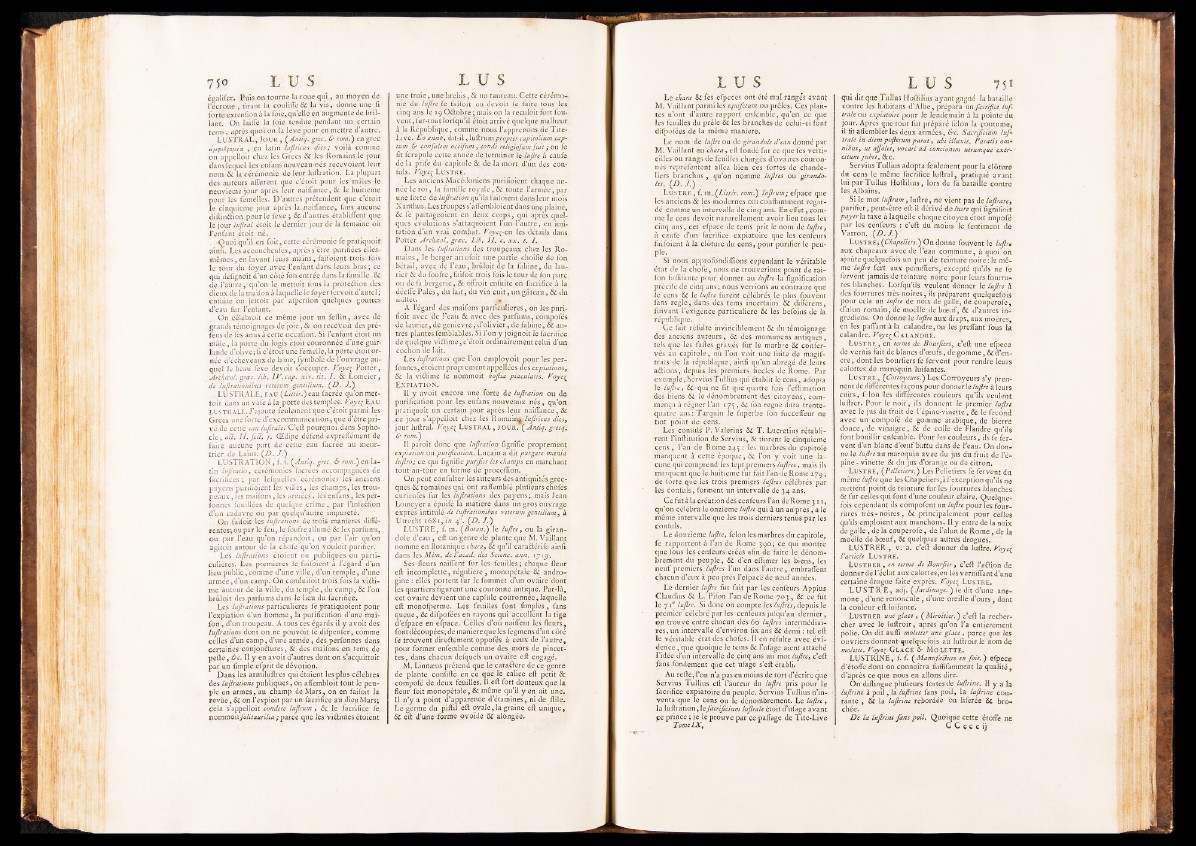
égalifer. Puis on tourne la roue q u i, au tfioyen de
l’ecroue , tirant la eouliffe 8c la vis, donne une fi
forte extenfion à la foie, qu’elle en augmente de brillant.
On laiffe la foie tendue pendant un certain
tems, après quoi on la leve pour en mettre d’autre.
LUSTRAL, JOUR , (Antiq. grec. & rom.) en grec
tt/MpiS'po/Ai'a -, en latin lufiricus dits s voi là comme
on appelloit chez les Grecs 8c les Romains le jour
dans lequel les enfans nouveau-nés recevoient leur
nom 8c la cérémonie de leur luftration. La plupart
des auteurs affurent que c ’étoit pour les mâles le
neuvième jour après leur naifiance, & le huitième
pour les femelles. D ’autres prétendent que c’étoit
le cinquième jour après la naifiance, fans aucune
diftinttion pour le fexe ; 8c d’autres établirent que
le jour lujlral étoit le dernier jour de la femaine où
l’enfant étoit né.
Quoi qu’il en foit, cette cérémonie fe pratiquoit
ainfi. Les accoucheufes, après s’être purifiées elles-
mêmes , en lavant leurs mains, faifoient trois fois
le tour du foyer avec l’enfant dans leurs bras ; ce
qui défignoit d’un côté fon entrée dans la famille, 8c
de l’autre, qu’on le mettoit fous la proteftion des
dieux de la maifon à laquelle le foyer fervoit d’autel ;
enfuite on jettoit par afperfion quelques gouttes
d’eau ,fur l’enfant.
On célébroit ce même jour un fefiin, avec de
grands témoignages de joie, & on recevoit des pre-
fens de fes amis à cette occafion. Si l’enfant étoit un
mâle, la porte du logis étoit couronnée d’une guirlande
d’olive; fi c’étoit une femelle, la porte étoit ornée
d’écheveaux de laine, fymbole de l’ouvrage auquel
le beau fexe devoit s’occuper. Foye^ Potter,
Archoeol. groec. lib. I F . cap. x iv . tu. I. & Lomeier,
de luflradonibus veterum gcntilium. (D . J )
LUSTRALE, e a u (Litcér) eau facrée qu’on mettoit
dans un v a f e à la porte des temples. Foyeç E a u
l u s t r a l e . J’ajoute feulement que c’étoit parmi les
Grecs une forte d’excommunication, que d’être priv
é de cette eau luflrale. C’eft pourquoi dans Sophocle
, a&. I I . fect. j . (Edipe défend expreflément de
faire aucune part de cette eau facrée au meurtrier
de Laïus- ( D . J )
LUSTRATION, f. f. (Antlq. grec. & rom) en latin
lujlrado, cérémonies facrées accompagnées de
facrifices ; par lefquelles cérémonies les anciens'
payens purifioienf les villes, Jes champs, les troupeaux
, les maifons, les armées, les enfans, les per-
fonnes fouillées de quelque crime, par l’infeétion
d’un cadavre ou par quelqu’autre impureté.
On faifoit les luflrations de trois maniérés diffé-
rentes;ou par le feu, le foufre allumé 8c les parfums,
ou par l’eau qu’on répandoit, ou par l’air qu’on
agitoit autour de la chofe qu’on vouloit purifier.
Les luflrations étoient ou publiques ou particulières.
Les premières fe faifoient à l’égard d’un
lieu public,comme d’une ville, d’un temple, d’une
armée, d’un camp. On conduifoit trois fois la vi&i-
me autour de la ville , du temple, du camp, & l’on
bruloit des parfums dans le lieu du facrifice.
Les lujlrations particulières fe pratiquoient pour
l’expiation d’un homme, la purification d’une maifon
, d’un troupeau. A tous ces égards il y avoit des
lujlrations dont on ne pou voit fe difpenfer, comme
celles d’un camp, d’une armée, des perfonnes dans
certaines conjonctures, & des maifons en tems de
pefle, &c. Il y en avoit d’autres dont on s’acquittoit
par un fimple efprit de dévotion.
Dans les armiluftres qui étoient les plus célébrés
des luflrations publiques, on aflembioit tout le peuple
en armes, au champ de Mars, on en faifoit la
revue, 8c on l’expioit par un facrifice au dieu Mars;
cela s’appelloit condere lüjlrum, 8c le facrifice fe
uommoii folitaurilia ; parce que les victimes étoient
une truie, une brebis, & un taureau. Cette cérémo--
nie du luflre fe faifoit ou devoit fe faire tous les
cinq ans le 19 Octobre ; mais on la reculoit fort fou-
vent, fur-tout lorfqu’il étoit arrivé quelque malheur
à la République, comme nous l’apprenons de Tite-
Live. Eo ann o , dit-il, luftrumpropter capitolium cap-
tum & confulem occifum, condi religiôjum fuit ; on fe
fit fcrupule cette année de terminer le lujlre à caufe
de la prife du capitole & de la mort d’un des con-
l’uls. Foye^ L u s t r e ,
Les anciens Macédoniens purifioient chaque année
le ro i, la famille royale, 8c toute l’armée, par
une forte de lujlration qu’ils faifoient dans leur mois
Xanthus. Les troupes s’afifembloient dans une plaine,
8c fe partageoient en deux corps, qui après quelques
évolutions s’attaquoient l’un-l’autre, en imi-
tation.d’un vrai combat. Foye^-en les détails dans
Potter Archoeol. groec. Lib. 11. c. x x . t. I.
Dans les luflrations des troupeaux chez les Romains
, le berger arrofoit une partie choifie de fon
bétail, avec de l’eau, brîdoit de la fabine, du laurier
& du foufre, faifoit trois fois le tour de fon parc
ou de fa bergerie, & offroit enfuite en facrifice à la
dé elle Palès, du lait, du'vin cuit, un gâteau, & du
millet. •
A l’égard des maifons particulières, on les puri-
fioit avec de l’eau & avec des parfums, compofés
de laurier, de genievre, d’olivier, de fabine, 8c autres
plantes femblables. Si l’on y joignoit le facrifice
de quelque viCtime, c’étoit ordinairement celui d’un
cochon de lait.
Les lujlrations que l’on employoit pour les perfonnes,
étoient proprement appellées des expiations,
8c la viClime fe nommoit hoflia piacularis. Foyeç
E x p i a t i o n .
Il y avoit encore une forte de lujlration ou de
purification pour les enfans nouveaux nés, qu’on
pratiquoit un certain jour après leur naifiance, &
ce jour s’appelloit chez les Romains lujlricus dits,
jour luftral. Foye£ Lustral , JOUR. (Antiq. grecq.
& rom) r>,
Il paroît donc que lujlration fignifie proprement
expiation ou purification. Lucain a dit purgare moenia
luflro; ce qui fignifie purifier les champs en marchant
tout-au-tour en forme de proceflion.
On peut confulter les auteurs des antiquités grecques
8c romaines qui ont raffemblé plufieurs chofes
curieufes fur les lujlrations des payens; mais Jean
Lomeyer a épuifé la matière dans un gros ouvrage
exprès intitulé de luflradonibus veterum gentilium, à
Utrecht 1681, in 4°. (JD. J )
LUSTRE, f. m. (Botan) le luflre y ou la girandole
d’eau, eft un genre de plante que M. Vaillant
nomme en Botanique chara, 8c qu’il cara&érife ainfi
dans les Mim. de l'acad. des Scienc. ann. iy iÿ .
Ses fleurs naiflent fur les feuilles; chaque fleur
eft incomplette, régulière , monopétale 8c andro-
gine : elles portent fur le fommet d’un ovaire dont
les quartiers figurent une couronne antique. Par-là,
cet ovaire devient une capfule couronnée, laquelle
eft monofperme. Les feuilles font Amples, fans
queue, 8c difpofées en rayons qui accollent la tige
d’efpace en efpace. Celles1 d’où naiflent les fleurs,
font découpées; de maniéré que les fegmens d’un côté
fe trouvent directement oppofés à ceux de l’autre,
pour former enfemble comme des mors de pincettes
, dans chacun defquels un ovaire eft engagé.'
M. Linnæus prétend que le caraCtere de ce genre
de plante confifte en ce que le calice eft petit &
compofé de deux feuilles. Il eft fort douteux que la
fleur foit monopétale, 8c même qu’il y en ait une.
Il n’y a point d’apparence d’étamines, ni de ftile.
Le germe du piftil eft ovale, la graine eft unique,
8c eft d’une forme ovoïde 8c alongée.
Le chara 8c fes efpecës ont été mal rangés avant
M. Vaillant parmi les equifetum ou prêles» Ces plantes
n’ont d’autre rapport enfemble, qu’en ce que
les feuilles du prêle 8c les branches de celui-ci font
difpofées de la même maniéré»
Le nom de lujlre ou de girandole d'eau donrté par
M . Vaillant au chara, eft fondé fur ce que fes verti*
cilles ou rangs de feuilles chargés d’ovaires couronnés
repréfentent a fiez bien ces fortes de chandeliers
branchas, qu’on nomme luflres ou girando*
les. (.D . J )
L u s t r e , f. m. (Littér. rom) luflruth; efpace que
les anciens & lès modernes ont conftamment regardé
comme un intervalle de cinq ans. En effet, comme
le cens devoit naturellement avoir lieu tous les
cinq ans, cet efpace de tems'prit le nom de lujlre,
à caufe d’un facrifice expiatoire que les cenfeurs
faifoient à la clôture du cens, pour purifier le peu*
pie-.
Si nous approfondiflions cependant le véritable
état de la chofe, nous ne trouverions point de rai-
fon fn/filante pour donner au lujlre la lignification
précife de cinq ans ; nous verrions au contraire que
le cens & le lujlre furent célébrés le plus fouvent
fans réglé, dans des tems incertains 8C différens,
fuivant l’eiigence particulière 8c les befoins de la
république.
Ce fait réfulte invinciblement 8c du témoignage
des anciens auteurs, 8c des monumens antiques,
tels que les faites gravés fur le marbre 8c confer-
vés au capitole, où l’on voit une fuite de magif-
trats de la république v ainfi qu’un abrégé de leurs
a étions, depuis les premiers necles de Rome. Par
exemple,ServiusTullius qui établit le cens, adopta
le lujlre, 8c qui ne fit que quatre fois l’eftimation
des biens 8c le dénombrement des citoyens, commença
à régner l’an 1 7 5 ,8c fon régné dura trente-
quatre ans: Tarquin le fuperbe fon fucèeffeur ne
tint point de cens.
Les confuls P. Valerius 8c T. Lucretius rétablirent
l’inftitution de Servius, & tinrent le cinquième
cens , l’an de Rome 245 : les marbres du capitole
manquent à cette époque, 8c l’on y voit une lacune
qui comprend les lept premiers luflres, mais ils
marquent que le huitième fut fait l’an de Rome 279 ;
de forte que les trois premiers Luflres célébrés par
les confins, forment un intervalle de 34 ans,
Ce fut à la création des cenfeurs l’an de Rome 311,
qu’on célébra le onzième lujlre qui à un an près, a le
même intervalle que les trois derniers tenus par les
confuls.
Le douzième luflret félon les marbres du capitole,
fe rapportent à l’an de Rome 390; ce qui montre
que lous les cenfeurs créés afin de faire le dénombrement
du peuple, 8c d’en eftimer les biens, les
neuf premiers lujlres l’un dans l’autre, embraffent
chacun d’eux à peu près l’efpace de neuf années.
Le dernier lujlre fut fait par lès cenfeurs Appius
Claudius 8c L. Pilon l’an de Rome 703 , 8c ce fut
le 71e lujlre. Si donc on compte les lujlres, depuis le
premier célébré par les cenfeurs julqu’au dernier,
pn trouve entre chacun des 60 lujlres intermédiaires,
un intervalle d’environ fix ans 8c demi : tel eft
le véritable état des chofes. Il en réfulte avec évidence
, que quoique le tems 8c l’ufage aient attaché
l’idée d’un intervalle de cinq ans au mot lujlre, c’eft
fans fondement que cet ufage s’eft établi.
Au refte, l’on n’a pas eu moins de tort d’écrire que
Servius Tullius eft l’auteur du lujlre pris pour le
facrifice expiaroire du peuple. Servius Tullius n’inventa
que le cens ou le dénombrement. Le Lujlre,
la luftration, lefacrijicium lujlrale étoit d’ufage avant
£e prince ; je le prouve par ce paffage de Tite-Live
Tome IX ,
qui dit que Tullus Hoftilius ayant gagné la bataille
contre les habitans d’Albe, prépara un facrifice lu f
traie ou expiatoire pour le lendemain à la pointe du
jour» Après que tout fut préparé félon la çoutume,
il fit affembler les deux armées, &c. Sacrijicïum luf*
traie in diem pojhrum parat, ubi illdxit. Paratis om*
ni b us f ut ajfolet, vocari ad concionem utr unique extf-
citurn jubety &c.
Servius Tullius adopta feulement pour la clôturé
du cens le même facrifice luftral, pratiqué avant
lui par Tullus Hoftilius, lors de fa bataille contre
les Albains»
Si le mot lujlrum , luftre, ne vient pâs de lu f rare i
purifier, peut-être eft-il dérivé de luere qui fignifioit
payer la taxe à laquelle chaque citoyen étoit impofé
par les cenfeurs : c’eft du moins le fentiment de
Varron. (D . J )
L u s t r e * (Chapeliers) On donrte foüvent le luflre
aux chapeaux avec de l’eau commune, à quoi oit
ajoute quelquefois un peu de teinture noire : le même
luflre fert aux peaufliers, excepté qu’ils rte fe
fervent jamais de teinture noire pour leurs fourni*
res blanches. Lorfqu’ils veulent donner \a luftre à
des fourrures très-noires, ils préparent quelquefois
pour cela un lufite de noix de galle, de couperofe,
d’alun romain, de moelle de boeuf, 8c d’autres in*
grédiens. On donne le luflre aux draps, aux moëres,
en les paffant à là calandre, ou les preffant fous là
calandre. Foyes^ C a l a n d r e .
L u s t r e , en terme de Bourfters, c’eft une efpece
de vernis fait de blancs d’oeufs, de gomme, & d ’en*
cre, dont les bourfiers fe fervent pour rendre leurs
calottes de maroquin luifantes.
L u s t r e , (Corroyeurs) Les Côrrbyeurs s’y prennent
de différentes façons pour donner le luflre à leurs
cuirs, félon les différentes couleurs qu’ils Veulent
luftrer. Pour le noir, ils donnent le premier lufiri
avec le jus du fruit de l’épine-vinette, & le fécond
avec un compofé de gomme arabique, de bierrô
douce, de vinaigre, 8c de colle de Flandre qu’ils
font bouillir enfemble. Pour Jes couleurs, ils fe fervent
d’un blanc d’oeuf battu dans de l’eau. On donne
le luflre au maroquin avec du jus du fruit de l’épine
- vinette 8c du jus d’orange ou de citron.
L u s t r e , (Pelletiers) Les Pelletiers fe fervent du
même luflre que les Chapeliers,à l’exception qu’ils ne
mettent point de teinture fur les fourrures blanches
8c fur celles qui font d’une Gouleur claire. Quelque*
fois cependant ils compofent un lujlre pour les fourrures
très - noires, 8c principalement pour celles
qu’ils emploient aux manchons. Il y entre de la noix*
de galle, de la couperofe, de l’alun de Rome, de la
moelle de boeuf, 8c quelques autres drogués.
LUSTRER , v. a. c’eft donner du luftre. Foyeç
l'article LU STR E .
L u s t r e r , en terme de Bourfler , c’eft I’a&ion de
donner de l ’éclat aux Calottes,en les verniflant d’une
certaine drogue faite exprès.. Foye%_ L u s t r e »
L U S T R É , adj. ( Jardinage. ) fe dit d’une anémone
, d’une renoncule , d’une oreille d’ourS. dont
la couleur eft luifante.
L u s t r e r une glace, ( Miroitier. ) c’eft la recher*
cher avec le luftroir, après qu’on l’a entièrement
polie. On dit auffi moletter une glace, parce que les
ouvriers donnent quelquefois au luftroir le nom de
molette. Foyt{ G l a c e & M o l e t t e .
LUSTRINE, f. f. (Manufacture en foie. ) efpece
d’étoffe dont on connoîtra fuffifamment la qualité,
d’après ce que nous en allons dire.
On diftingue plufieurs fortes de luflrine. Il y a là
luflrine à poil, la luflrine fans poil, la luflrine courante
, & la luflrine rebordée ou liferée 8c bro-»
chée.
De la luflrine fans poil. Quoique cette étoffe nç
C C ç c c ïj