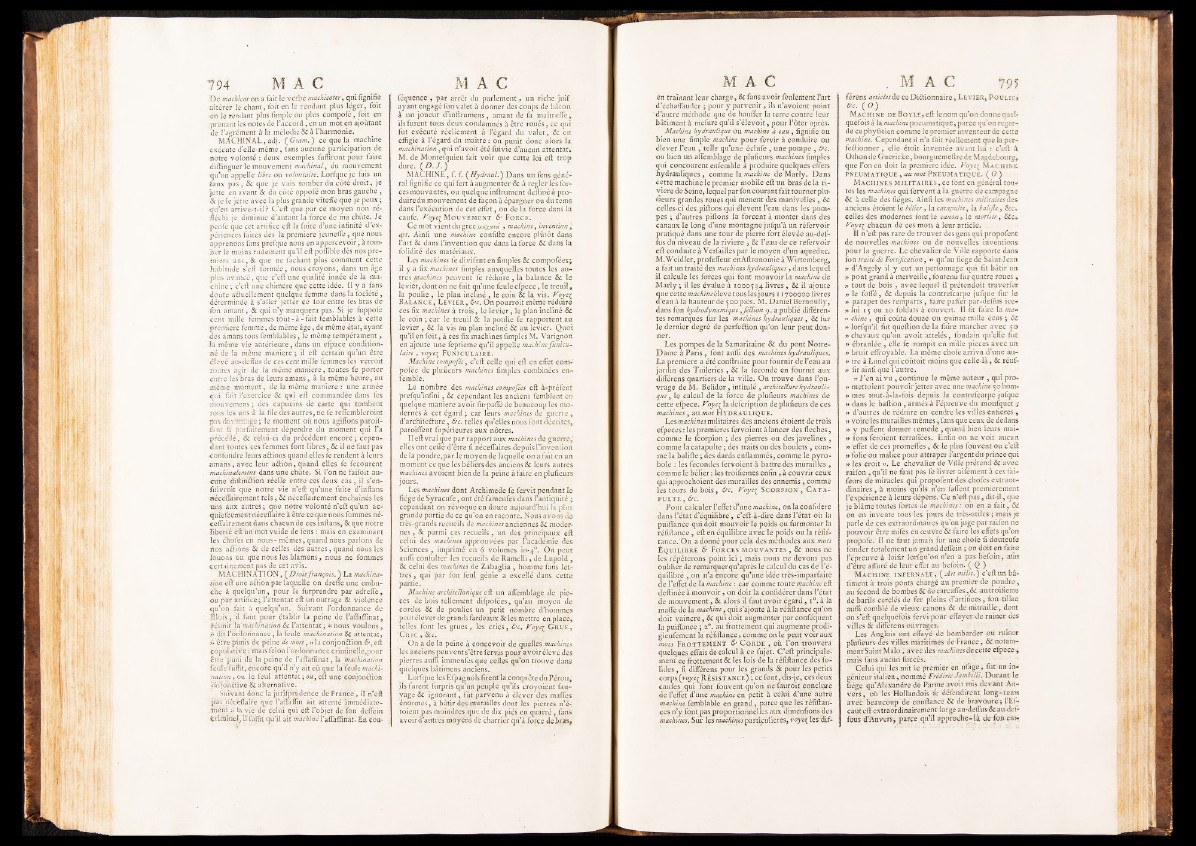
D e machicoi on a fait le verbe mackicoter, qui fignifie
altérer le chant, foit en le fendant plus léger, foit
en lè rendant plus limplè ou plus compofé, foit en
prenant les notes de l’accord, en un mot en ajoutant
dé l’agrément à la mélodie & à l’harmonie.
MACHINAL,adj. {Gram.') ce que la machine
exécute d’elle-même, lans aucune participation de
notre volonté : deux exemples luffiront pour faire
diftinguer le mouvement machinal ^ du mouvement
qu’on appelle libre ou volontaire. Lorfqlie je fais un
faux pas , & que je vais tomber du côté droit, je
jette en avant & du côté oppofé mon bras gauche ,
& je le jette avec la plus grande vîteffe que je peux ;
•q'u’èn arrive-t-il? C’eft que par ce moyen non réfléchi
je diminue d’autant la force de ma chute. Je
perife que cet artifice eft la fuite d’une infinité d’expériences
faites dès la première jeunelfe, que nous
apprenons fans prcfque nous en appercevoir, à tomber
le moins rudement qii’il eft poflible dès nos premiers.
ans , & que ne faehant plus comment cette
habitude s’eft formée, nous croyons, dans un âge
plus ava'ncë, que c’eft une qualité innée de la machine
; c’eft une chimere que cette idée. 11 y a fans
doute actuellement quelque femme dans la fociété,
déterminée à s’aller jetter ce foir entre les bras de
ibn amant, & qui n’y manquera pas. Si je fuppofe
cent mille femmes tou t-à - fa it lemblables à cette
première femme, de même âge, de même état, ayant
des amans tous femblables, le même tempérament ,
là même vie antérieure, dans un efpace conditionné
de la même maniéré ; il eft certain qu’un être
élevé au-deflus de ces cent mille femmes les verroit
foutes agir de la même maniéré, toutes fe porter
entre les bras de leurs amans, à la même heure, au
même moment, dè la même maniéré : une armée
qui fait l’exercice & qui eft commandée dans fes
mouvemens ; des capucins de carte qui tombent
rous les uns à la file des autres, ne fe reffembleroint
pas davantage ; le moment où nous agiflbns paroif-
îànt fl parfaitement dépendre du moment qui l’a
précédé, & celui-ci du précédent encore ; cependant
'toutes ces femmes font libres, 8c il ne faut pas
confondre leurs aûions quand elles fe rendent à leurs
amans, avec leur aûion, quand elles fe fecourent
machinalement dans une chute. Si l’on ne fâifoit aucune
diftin&ion réellé entre ces deux ca s , il s’en-
fuivrôit que notre vie n’eft qu’une fuite d’inftans
néceflairement tels , & néceflairement enchaînés les
nhS dtix autres; que notre volonté n’ëft qu’un ac-
qüiefèë'mérit'neceffairé à être Ce que noüs fo'mmeS rté-
ceffairement dans chacun de ces inftans, & que notre
liberte eft un mo’t vuide de fens : mais en examinant
les chofes en nous-mêmes, quand nous parlons de
flos aéïions & de celles des autres, quand nous les
lôuons ou qtîë iioüs les blâmons, nous ne fommes
certainement pas de cet avis.
MACHINATION, ( Droit"frahçois. ) La machinationeu
une aftion par laquelle on drefle une embûche
à quelqu’un, pour le fürprendre par adreffe,
ou par 'artifice ; l’attentat eft un outrage & violence
qu’on fait à quelqu'un. ( Suivant l’ordonnance de
Blbia, il faivt pour établir la peine de l’aflaflinat,
féiiriir 1 & machination & l’attentat ; « nous voulons,
i> dit l'Ordonnance, la feulé machination & attentat,
» être punis de peine de mortÿ»la conjoriélion & ,eft
Çbptilanvé : mais'félon l’ordonnance criminelle,pour
être‘puni de la peine de l’aflaflinât, la machination
fcüle'fuffit, ëncore qu’irh’y ait ëû que la feule machination
, ou le féül attentat ; ôut eft une conjonction
dVsjônôiv.e & alternative.
• Suivant donc la jurifprudence de France , il n’eft
pas ncceflaire que l’afîaflïn ait attenté immédiatement
à là V je'de cfeiuî qui éft l’objet de fon deflein
triffifiheL'ïïfuffit qu’il ait machiné l’aflaffinat.- En conféquence
, par arrêt du parlement, un riche juif
ayant engagé fon valet à donner des coups de bâton
à un joueur d’inftrumens, amant de fa maîtrefle,
ils furent tous deux condamnés à être roués, ce qui
fut exécuté réellement à l’égard du v alet, & en
effigie à l’égard du maître : on punit donc alors la
machination, qui n’avoit été fuivie d’aucun attentat.
M. de Montefquieu fait voir que cette loi eft trop
dure, (£>.ƒ.)
MACHINE, f. f. ( Hydraul.) Dans un fens général
fignifie ce qui fert à augmenter 8c à regler les forcés
mouvantes, ou quelque infiniment deftinéà produire
du mouvement de façon à épargner ou du tems
dans l’exécution de cet effet, ou de la force dans la
caufe. Voyt{ Mo u v e m e n t 6* Fo r c e .
Ce mot vient du grec p-nya-vn , machine, invention 2
<{rt. Ainfi une machine confifte encore plûtôt dans
l’art & dans l’invention que dans la force 8c dans la
folidité des matériaux.
Les machines fe divifent en fimples 8c compofées;
il y a fix machines fimples auxquelles toutes les autres
machines peuvent fe réduire , la balance 8c le
levier, dont on ne fait qu’une feule efpece, le treuil,
la poulie , le plan incliné , le coin & la vis. Voye^
Ba l a n c e , L e v i e r , & c. On pourroit même réduire
ces (ne machines à trois, le levier, le plan incliné 8c
le coin ; car le treuil & la poulie fe rapportent au
levier , 8c la vis au plan incliné & au levier. Quoi
qu’il en fo it , à ces fix machines fimples M. Varignon
en ajoute une feptieme qu’il appelle machine funiculaire
, voye^ FUNICULAIRE.
Machine cornpofée, c’eft celle qui eft en effet com-
pofée de plufieurs machines fimples combinées en-
femble.
Le nombre des machines compofées eft à-préfent
prefqu’infini, 8c cependant les anciens femblent en
quelque maniéré avoir furpaffé de beaucoup les modernes
à cet égard ; car leurs machines de guerre,
d’archïteéhire, &c. telles qu’elles nous font décrites,,
paroiffent fùpérieures aux nôtres.
Il eft vrai que par rapport aux machines de guerre,’
elles ont ceffé d’être fi néceflaires depuis l’invention
de la poudre,par le moyen de laquelle on a fait en un
moment ce que les béliers des anciens & leurs autres
machines avoient bien de la peine à faire en plufieurs
jours. • ;
Les machines dont Archimede fe fervit pendant le
liège de Syractïfe, ont été fameufes dans l’antiquité ;
cependant on révoque en doute aujourd’hui la plus
grande partie de ce qu’on en raconte. Nous avons de
très-grands recueils de machines anciennes 8c modernes
, & parmi ces recueils, un des principaux eft
celui des machines approuvées par l’académie des
Sciences , imprimé en 6 volumes in-40. On peut
aufli confulter les recueils de Ramelli, de Lupold ,
8c celui des machines de Zâbaglia , homme fans lettres,
qui par fon feul génie a excellé dans cette
partie.
Machine architectonique eft un aflemblage de pièces
de bois tellement difpofées, qu’au moyen de
cordes 8c de poulies un petit nombre d’hommes
peut élever de grands fardeaux & les mettre en place,
telles font les grues, les crics, &c. Voye^ G r u e ,
C r ic , ‘& c.
On a de la peine à concevoir de quelles machines
les anciens peuvent s’être fervjs pour avoir élevé des
pierres aufîi immenfes que celles qu’on trouve dans
quelques bâtimcns anciens.
Lorfque les Efpagnols firent la conquête du Pérou,'
ils furent furpris qu’un peuple qu’ils cfoyoient fau-
vage 8c ignorant , fut parvenu à élever des maffes
énormes, à bâtir des murailles dont les pierres n’é-
toient pas moindres que de dix pies en quarré, fans
avoir d'autres moyens dé charrier qu’à force de bras,;
ên traînant leur charge, & fans avoir feulement Part
d’échaffauder ; pour y parvenir , ils n’avoient point
d’autre méthode que de haufler la terre contre leur
bâtiment à mefure qu’il s’élevoit, pour l’ôter après.
Machine hydraulique ou machine à eau, fignifie ou
bien une fimple machine pour fervir à conduire ou
élever l’eau , telle qu’une éçlufe , une pompe , <S*c.
ou bien un aflemblage de plufieurs machines fimples
qui concourent enfemble à produire quelques effets
hydrauliques , comme la machine de Marly. Dans
cette machine le premier mobile eft un bras delà rivière
de Seine, lequel par fon courant fait tourner plusieurs
grandes roues qui mènent des manivelles, &
celles-ci des piftons qui élevent l’eau dans les pompes
; d’autrës piftons la forcent à monter dans des
canaux le long d’unè montagne jufqu’à un réfervoir
pratiqué dans une tour de pierre fort élevée au-def-
fus du niveau de la riviere , 8c l’eau de ce refervoir
eft conduite à Verfaillespar le moyen d’un aqueduc.
MAVeidler, profeffeur enAftronomie à Wirtemberg,
a fait un traité des machines hydrauliques , dans lequel
il calcule les forces qui font mouvoir la machine de
Marly; il les évalue à 1000594 livres , 8c il ajoute
que cette machine éleve tous les jours 11700000 livres
d’eau à la hauteur de çoo piés. M. Daniel Bernoully,
dans fon hydrodynamique ,feclion g . a publié différentes
remarques fur les machines hydrauliques , & fur
le dernier degré de perfection qu’on leur peut donner.
Les pompes de la Samaritaine & du pont Notre-
Dame à Paris , font aüfli des machines hydrauliques.
La première a été conftruite pour fournir de l’eau au
jardin des Tuileries , & la fécondé en fournit aux
différens quartiers de la ville. On trouve dans l’ouvrage
de M. Belidor, intitulé , architecture hydraulique
, le calcul de la force de plufieurs machines de
cette efpece. Voye^ la defcription de plufieurs de ces
machines, au mot Hy d r a u l iq u e .
Les machines militaires des anciens étoient de trois
efpeces : les premières fervoient à lancer des fléchés,
comme le fcorpion ; des pierres ou des javelines , '
comme la catapulte ; des traits ou des boulets ', comme
la balifte ; des dards enflammés, comme le pyro-
bole : les fécondés fervoient à battre des murailles ,
comme le bélier : les troifiemes enfin, à couvrir ceux
qui approchoient des murailles des ennemis , comme
les tours de bois, &c. Voye%_ S c o r p io n , C a t a p
u l t e ; ,
Pour calculer l’effet d’une machine, on la confidere
dans l’état d’équilibre', c’eft-à-dire dans l ’état où la
puiffance qui doit mouvoir lé poids ou furmonter la
refiftance, eft en équilibre avec le poids ou la réfif-
tance.'On a donné pour cela des méthodes aux mots
É q u i l ib r e 6* F o r c e s m o u v a n t e s , & nous ne
les répéterons point ici ; mais nous ne devons pas
oublier.de remarquerqu’après le calcul du cas de l ’équilibre
., on n’a encore qu’une idée très-imparfaite
de l’effet de là machine : çàr comme toute machine eft
deftinée à mouvoir, on doit la confidérer dans l’état
de mouvement, & alors il faut avoir égard, i° . à la
inafîe de la machine, quis’ajoiite à la réfiftance qit’on
doit vaincre, & qui doit augmenter par cônféque'nt
la puiffance ; i° . au frottement qui augmente prodi-
gieufement la réfiftance, comme on le peut voir aux
mots Fr o t t e m e n t & C o r d e , où l’on Trouvera
quelques effais de calcul à ce fujet. C ’eft principalement
ce frottement & les lois de la réfiftance. desffo-
lidès , fi différens pour les grands & pour les petits
corps (yoye{R é s is t an c e ) ; ce font, dis-je, ces deux
caufes qui font fouverit qu’on, ne fauroit conclure
dé l’effet d’une machine en pëfi't à célui d’unè âtrtr’é
machine, femblable en grand, parce que lèS réfiftan-
çcs n’y font pas proportionnelles aux dime'nfiorts des
machines. Sur IçsmachinespartkuliereSj^oyf^les‘differens
articles de ce Di&ionnâire, L e v ie r , P o u l i e * MB . , ■ Ma c h in e d e Bo y l e , eft lenom qu’on donne quelquefois
à la machine pneumatique, parce qu’on regarde
ce phyficien comme le premier inventeur de cette
machine. Cependant il n’a fait réellement que la perfectionner
, elle étoit inventée avant lui : c’eft à
Othon de Guericke, bourguemcftre de Magdebourg,
que l’on en doit la première idée. Voye^ M a c h in e
PNEUMATIQUE , au mot PNEUMATIQUE. ( O )
Ma c h in e s m i l i t a ir e s , ce font en général tou*
tes les machines qui fervent à la guerre de campagne
& à celle des fiéges. Ainfi les machines militaires des
anciens étoient le bélier, la catapulte, la balifte, &c.
celles des modernes font le canon, le mortier, & c .
Vyyeç chacun de ces mots à leur article.
Il n’eft pas rare de trouver des gens qui propofenfc
de nouvelles machines ou de nouvelles inventions
pour la guerre. Le chevalier de Ville rapporte dans
fon traité de Fortification, « qu’au fiége de Saint-Jean
» d’Angely il y eut un perfonnage qui fit bâtir un
» pont grand à merveille, foutenu fur quatre roues y
» tout de bois , avec lequel il prétendoit traverfer
» le fofle, & depuis la contreîcarpe jufque fur le
» parapet des remparts , faire pafl’er par-deffus ice-
» lui 15 ou 20 foldats à couvert. Il fit faire la ma-
» chine, qui coûta douze ou quinze mille écus ; 8c
» lorfqu’il fut queftion de la faire marcher avec 50
»chevaux qu’on avoit attelés, foudain qu’elle fut
» ébranlée , elle fe rompit en mille pièces avec un
» bruit effroyable. La même chofe arriva d’une au-
» tre à Lunel qui coûtoit moins que celle-là, & réuf-
» fit ainfi que l ’autre.
» J’en ai v u , continue le même auteur , qui pro*
» mettoient pouvoir jetter avec une machine 50 hom-
» mes tout-à-la-fois depuis la contrefcarpe jufque
» dans le baftion , armés à l’épreuve du moufquet ;
» d’autres de réduire en cendre les villes entières 4
» voire les murailles mêmes -, fans que ceux de dedans
» y puffent donner remede , quand bien leurs mai-
» fons feroient terraffées. Enfin on ne voit aucun
» effet de ces promefles, & -le plus fou vent ou c ’eft
» folie ou malice pour attraper l’argent du prince qui
» les croit ». Le chevalier de Ville prétend & avec
raifon , qu’il ne faut pas fe livrer aifément à ces fai-
feurs dè miracles qui propôfent des chofes extraordinaires
, à moins qu’ils n’en faflent premièrement
l’expérience à leurs dépens. Ce n’eft pas, dit-il, que
je blâme toutes fortes de machines: on en a fait, 8c
on en invente tous les jours de très-utiles ornais je
parie de ces extraordinaires qu’on juge par raifon ne
pouvoir être mifes en ceüVre & faire les effets qu’on
propofe. Il ne faut jamais fur une chofe fi douteufe
fonder totalement un grand deflein ;■ on doit en faire
l’épreuve à Joifir •lorfqù’on n’en a pas-befoin, afin
d’être aflùré de leur effet au -béfoin. ( Q )
M a c h in e in f e r n a l e , '{Art milit. ) c’eft un bâtiment
à trois ponts chargé au premier de poudre ,
au fécond de bombes & de'càrcaffes, 8c autroifieme
de barils cerclés de fer pleins d’artifices, fon tillae
aufli coniblé de vieux canons 8c de mitraille , dont
on s’èft quelquefois ‘fêrvi pour effayer.de ruiner des
villes & différens ouvrages.
Les Anglbis ont ëffayé de bombarder pu ruiner
plufieurs: des'villes mafitimés deTrance, & notamment
Saint Malo , avec dès 'machines de cette efpece *
mais faits aucun fuëcès. - ; - _ '•
Celui qui les mit le prëmier en ufàgë, fut un ingénieur
italien ; nommé Frédéric Jàmbelli. Durant' le
fiége qu’Aiexandre de Parme avoit mis devant Anv
ers, où' les Hollandois fe défendirent long-tems
avec beaucoup de confiance & dè' bravoure ; 1?Ë1<-
cauteft extraordinairement-large au-déffus &au-def-
fous d’Anvers, parce qu’il approche-là de fon-em