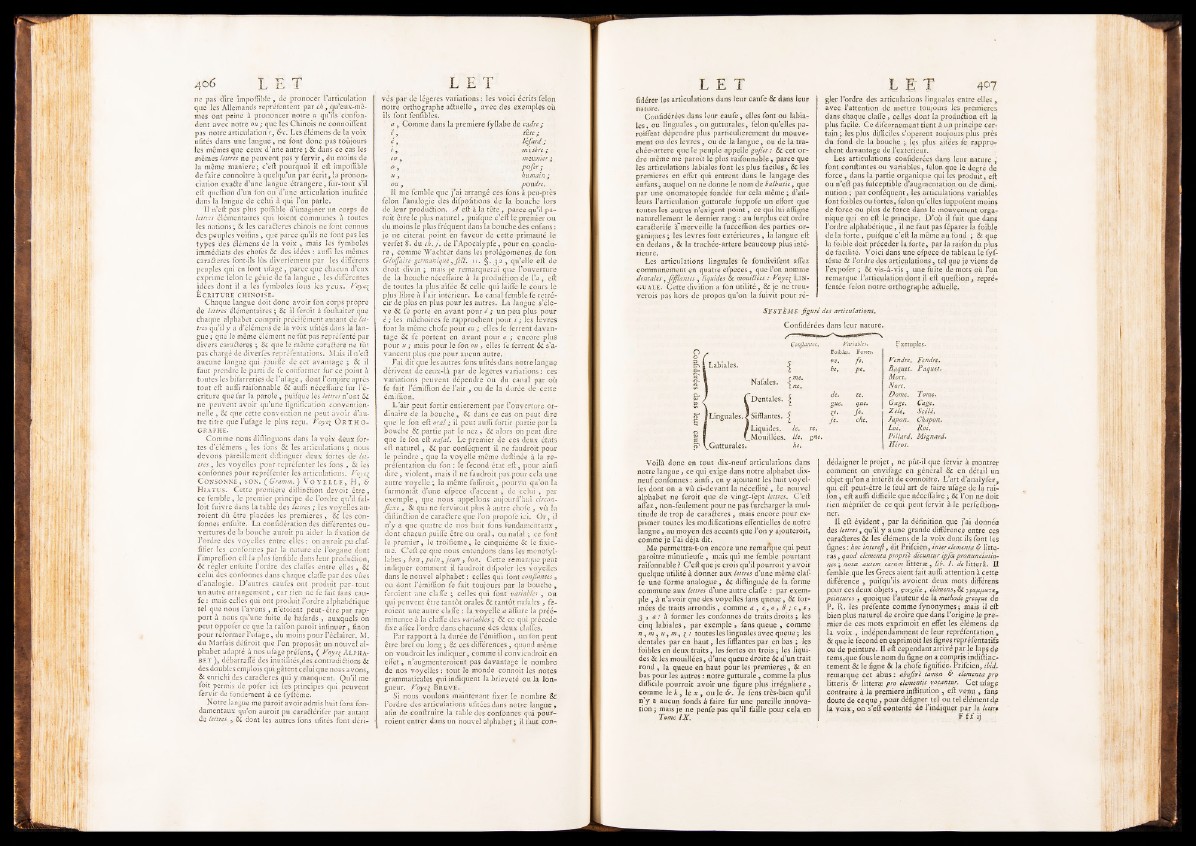
4 o6 L E T
ne pas dire impoffible, de pronocer l’articulation
que les Allemands repréfentent par ch, qu’eux-mêmes
ont peine à prononcer notre u qu’ils confondent
avec notre ou; que les Chinois ne connoîflent
pas notre articulation r , &c. Les élémens de la voix
ufités dans Une langue, ne font donc pas toujours
les mêmes que ceux d’une autre ; & dans ce cas les
mêmes lettres ne peuvent pas y fervir, du moins de
la même maniéré; c’eft pourquoi il eft impoffible
de faire connoître à quelquhin par écrit, la prononciation
exaéle d’une langue étrangère, fur-tout s’il
eft queftion d’un fon ou d’une articulation inufitée
dans la langue de celui à qui l’on parle.
Il n’eft pas plus poffible d’imaginer un corps de
lettres élémentaires qui foient communes à toutes
les nations ; 6c les caraÛëres chinois ne font connus
des peuples voifins, que parce qu’ils ne font pas les
types des élémens de la voix , mais les fymboles
immédiats des chofes 6c des idées : auffi les mêmes
cara&eres font-ils lus diverfement par les dïfferens
peuples qui en font ufage, parce que chacun d’eux
exprime félon le génie de fa langue , les différentes
idées dont il a les fymboles fous les yeiix. Voye^
É cr itu re 'ch ino ise.
Chaque langue doit donc avoir fon corps propre
de lettres élémentaires ; 6c il feroit à fouhaiter que
chaque alphabet comprît précifément autant de lettres
qu’il y a d’élémens de la voix ufités dans la langue
; que le même élément ne fut pas reprëfenté par
divers caraûeres ; 6c que le même caraclere ne fut
pas chargé de diverfes repré'fentàtions. Mais il n’eft
aucune langue qui jouifte de cet avantage ; & il
faut prendre le parti de fe conformer fur ce point à
toutes les bifarreries de l’ufage, dont l’empire après
tout eft auffi raifonnable 6c auffi néceftaire fur l’écriture
que fur la parole, puifque les lettres n’ont 6c
ne peuvent avoir qu’une lignification conventionnelle
, 6c que cette convention ne peut avoir d’autre
titre que l’ufage le plus reçu. Voyez Or t h o graphe.
Comme nous diftinguons dans la voix deux fortes
d’élémens , les fons 6c les articulations ; nous
devons pareillement diftinguer deux fortes de lettres
, les voyelles pour repréfenter les fons , & les
confonnes poiir repréfenter les articulations. Voyez
C onsonne, son. ( Gramm.) V o y e l l e , H , &
Hiatus. Cette première diftinélion devoit ê tre,
ce femble, le premier principe de l’ordre qu’il fal-
loit fuivre dans la table des lettres ; les voyelles au-
roient dû être placées les premières, 6c les confonnes
enfuite. La confidération des différentes ouvertures
de la bouche auroit pu aider la fixation de
l’ordre des voyelles entre elles : on auroit pu claf-
lifier les confonnes par la nature de l’organe dont
l’i'mpreffion eft la plus fenfible dans leur produ&ion,
& régler enfuite l’ordre des claffes entre elles , 6c
celui des confonnes dans chaque claffe par des vues
d’analogie. D ’autres caufes ont produit par-tout
un autre arrangement, car rien ne fe fait fans cau-
fe : mais celles qui ont produit l’ordre alphabétique
tel que nous l’avons , n’étoient peut-être par rapport
à nous qu’une fuite de hafards , auxquels on
peut oppofer ce que la raifon paroît infinuer, finon
pour réformer l’ufage, du moins pour l’éclairer, M.
du Mariais défiroit que l’on proposât un nouvel alphabet
adapté à nos ufage préfens, ( Voye^ Alphabet
), débarrafie des inutilités,des contradiâions &
des doubles emplois qui gâtent celui que nous avons,
& enrichi des caractères qui y manquent. Qu’il me
foit permis de pofer ici les principes qui peuvent
fer vir de fondement à ce fyftème.
Notre langue me paroit avoir admis huit fons fondamentaux
qu’on auroit pu caraélérifer par autant
de lettres , 6c dont les autres fons ufités font déri-
L E T
vés par de légères variations : les Voici écrits félon
notre orthographe aéluelle, avec des exemples où
ils font fenfibles.
a , Comme dans la première fyllabe de cadre ;
« , tê te;
c , lèfard ; ■
i , misère;
eu , meunier ;
,o, pofer ;
u , humain;
ou., poudre. .
Il me femble que j’ai arrangé ces fons à -peu-près
félon l’analogie des difpofitions de la bouche lors
de leur production. A eft à la tête , parce qu’il paroît
être le .plus naturel, puifque c’eft le premier ou
du moins le plus fréquent dans la bouche des enfans :
je ne citerai point en faveur de cette primauté le
verfet 8. du ch .j. de l’Apocalypfe, pour en, çonclu-
re , comme "Wachter dans les prolégomènes,-,de fon
Gloffaire germanique yfecl. //. § . 3 2 , qu’elle eft de
droit divin ; mais je remarquerai que l’ouverture
de la bouche néceftaire à la production de l’a , eft
de toutes la plus aifée 6c celle qui laifle le cours le
plus libre à l’ air intérieur. Le canal femble fe rétrécir
de plus en plus pour les autres. La langue s’élève
6c fe porte en avant pour ê ; un peu plus pour
é ; les mâchoires fe rapprochent pour i ; les levres
font la même chofe pour eu ; elles fe ferrent davantage
6c fe portent en avant pour o ; encore plus
pour u ; mais pour le fon ou , elles fe ferrent 6c s’avancent
plus que pour aucun autre.
J’ai dit que les autres fons ufités dans notre langue
dérivent de ceux-là par de legeres variations : ces
variations peuvent dépendre ou du canal par oit
fe fait l’émiffion de l’air , ou de la durée de cette
émiffion.
L ’air peut fortir entièrement par l’ouverture ordinaire
de la bouche, 6c dans ce cas on peut dire
que le fon eft oral ; il peut auffi fortir partie par la
bouche 6c partie pat le nez , 6c alors on peut dire
que le fon eft nafal. Le premier de ces deux états
eft naturel, 6c par conféquent il ne faudroit pour
le peindre , que la voyelle même deftinée à la re-
préfentation du fon : le fécond état eft, pour ainfi
dire, violent, mais il ne faudroit pas pour cela une
autre voyelle ; la même fuffiroit, pourvu qu’on la
furmontât d’une èfpece d’accent 9 de celui , par
exemple, que nous appelions aujourd’hui circonflexe
y & qui ne ferviroit plus à autre chofe , vû la
diftinCtion de caraClere que l’on propofe ici. O r , il
n’y a que quatre de nos huit fons fondamentaux ,
dont chacun puifle être ou oral, ou nafaï$ ce font
le premier, le troifieme, le cinquième & le fixie-
me. C ’eft ce que nous entendons dans les monofyl-
labes , ban 9 pain 9 jeun , bon. Cette remarque peut
indiquer comment il faudroit difpofer les voyelles
dans le nouvel alphabet : celles qui font confiantes ,
ou dont l’émiffion fe fait toujours par la bouche,
feroient une clafte ; celles qui font variable* , ou
qui peuvent être tantôt orales 6c tantôt nafales , feroient
une autre clafte : la voyelle a afliire la prééminence
à la clafte des variables ; & ce qui précédé
fixe allez l’ordre dans chacune des deux claftes.
Par rapport à la durée de l’émiffion , un fon peut
être bref ou long ; 6c ces différences , quand même
on voudroit les indiquer, comme il conviendroit en
effet, n’augmenteroient pas davantage le nombre
de nos voyelles : tout le monde connoît les notes
grammaticales qui indiquent la brièveté ou la longueur.
Voye[ Br e v e .
Si nous voulons maintenant fixer le nombre 6c
l’ordre des articulations ufitées dans notre langue ,
afin de conftruire la table des confonnes qui pour-
roient entrer dans un nouvel alphabet ; il faut con-.
L E T
fidérer les articulations dans leur caufe 6c dans leur
nature.
Confidérées dans leur caufe, elles font 0,11 labiales
, ou linguales, ou gutturales, félon qu’elles pa-
roifîent dépendre plus particulièrement du mouvement
pu des levres , ou de la langue, ou de la tra-
chée-artere que le peuple appelle gojîer : 6c cet ordre
même me paroît le plus raifonnable, parce que
les articulations labiales font les plus faciles, 6c les
premières en effet qui entrent dans le langage des
enfans, auquel on ne donne le nom de balbutie, que
par une onomatopée fondée fur cela même ; d?a i lleurs
l’articulation gutturale fuppofe un effort que
toutes les autres n’exigent point, ce qui lui affigne
naturellement le dernier rang : au furplus cet ordre
caraêlerife à*merveille la fucceffion des parties organiques
; les levres font extérieures, la langue eft
en dedans, & la trachée-artere beaucoup plus inté?
rieure.
Les articulations linguales fe foudivifent afîez
communément en quatre efpeces, que l’on nomme
dentales, fifflantes , liquides & mouillées : Voye[ Linguale.
Cette divifion a fon utilité, 6c je ne trouv
e ra s pas hors de propos qu’on la fuivît pour ré-
L I T 407
gler l ’ordre des artiçulations linguales entre elles ,
avec l’attention de mettre toujours les premières
dan.s, chaque clafte, ccllps dont la production eft la
plus facile. Ce difçernement tient à un principe certain
; les plus difficiles s’opèrent toujours plus près
du fond de la bouche ; les plus aifées fe rappfOr
çhçnt davantage de l’pxteripur.
Les articulations confidérées dans leur nature •
font confiantes ou variables, félon que le degré de
force, dans la partie organique qui les produit, eft
ou n’eft pas fufceptiblp çl’aijgmentation ou de diminution
; par conféquent, les articulations variables
font faibles ou fortes, félon qu’elles fuppofent moins
de forçe ou plus de force dans le mouvement organique
qui en eft le principe. D ’où il fuit que dans
l’ordre alphabétique, il ne faut pas féparer la foible
de la forte, puifque ç ’eft la même ag fond » 6c que
la foible doit précéder la forte, par la raifon du plus
de facilité. Voici dans iipe efpeçe de tableau le fyf-
tême 6c l’prdrç des articulations, tel qqp je viens de
l’expofer ; & vis-à-vis , une fuite de niot$ oùTon
remarque l'articulationdoptil eft queftion, repré?
fentée félon notre orthographe actuelle.
SYSTÈME figuré des articulations.
Confidérées dans leur nature.
Confiantes, Variables, Exemples.
0 Foibles. Fprtes.
0
ve.
S- 1 Labiales. ^
f i -
be.
P * .
Vendre, Fendre.
Baquet. Paquet.
0' i Nafales. 4in RcI.
Mort.
fi?o.rt.
»de. te. S J C Dentales.
Dôme. Tonie. gue. que. C m - , :
I e.-
C 1 Linguales. Sifflantes. f i che.
Zélé. Scélé.
0 je .
Japon. Çhapon, ƒ Liquides. le, re. Loi. Foi.
S« (_Mouillées. Ile. gne. Pillard. Mignprd.
<T* ^Gutturales* Ae. Héros.
Voilà donc en tout dix-neuf articulations dans
notre langue > ce qui exige dans notre alphabet dix-
neuf confonnes : ainfi, en y ajoutant les huit voyelles
dont pn a vû ci-deyant la néeeffité , le nouvel
alphabet ne feroit que de vingt-fept lettres. Ç ’eft
affez, non-feulement pour ne pas furcharger la multitude
de trop de caraéleres , mais encore pour ex?-
primer toutes les modifications eftientielles de notre
langue, au moyen des accents que l’on y ajouteroit,
comme je l’ai déjà dit.
Me permettra-t-on encore une remarque qui peut
paroître minutieufe, mais qui me femble pourtant
raifonnable ? C’eft que je crois qu’il pourrait y avoir
quelque utilité à donner aux lettres d’une même claffe
une forme analogue , 6c diftinguée de la fprme
commune aux lettres d’une autre clafte : par exemple
, à n’avoir que des voyelles fans queue, formées
de traits arrondis , comme a , e, 0, 8 ; c , s ,
j , a : à former les confonnes de traits droits ; les
cinq labiales , par exemple , fans queue , comme
n 9m y u , m y £.* toutes les linguales avec queue ; les
dentales par en haut, les fiftlantes par en bas ; les
foibles en deux traits, les fortes en trois ; les
des & les mouillées, d’une queue droite 6c d’un trait
rond , la queue en haut pour les premières, & en
bas pour les autres : notre gutturale, comme la plus
difficile pourroit avoir une figure plus irréguliere ,
comme le k , le x , ou le &. Je feus très-bien qu’il
n’y a aucun fonds à faire fur une pareille innovation
; mais je ne penfe pas qu’il faille pour cela en
Tome IX.
dédaigner le projet, ne pût-il que fervir à montrer
comment on envifage en général 6c en détail un
objet qu’on a intérêt de connoître. L’art d’analyfer,
qui eft peut-être le feul art de faire ufage de la ration
, eft auffi difficile que néceftaire ; 6c l’on ne doit
rien méprifer de ce qui peut fervir à le perfeélion,-
ner.
Il eft évident, par la définition que j’ai donnée
des lettres y qu’il y aune grande différence entre ces
caraûeres 6c les élémens de la vpix dont ils font les
lignes: hoc interefiy dit Prifcien, interelementq & lutteras
, quod elementa proprié dicuntur ipfcq pronunciatio-
nes ; notez autem earum litteræ, lib. I. de Jitterâ. Il
femble que les Grecs aient fait apffi attention à cette
différence , puifqu’ils avpient deux mots différens
pour ces deux objets, » élémens, 6c ypu.fj./j.ut«*
peintures , quoique l’auteur de la méthode grecque dp
P. R. les préfente compte fynonymes ; mais il eft
bien plus naturel de croire que dans l’origine le premier
de ces mots exprimait en effet les élémens dp
la voix , indépendamment de leur reprëfentation ,
& que le fécond en exprimoit les ftgnes repréfentatifs
ou de peinture. Il eft cependant arriyé par je laps dp
tems.quc fous le nom du ligne on a compris ipdiftinp-
temept & le figne & la chofe figiftfipe. Prifcien, ibij.
remarque cet abus : abufivé tamtn & elemçnta prq
litteris 6* litterpe pro démentis voçpqtyr. Çet pfagp
contraire à la première mftifution , eft venu > fans
doute de ce que, pour défigper tel ou tel éjément dp
la v o ix , on s ’eft çpn tenté dp l’ipçücmçr par la l,et(r*
' F f £ ij