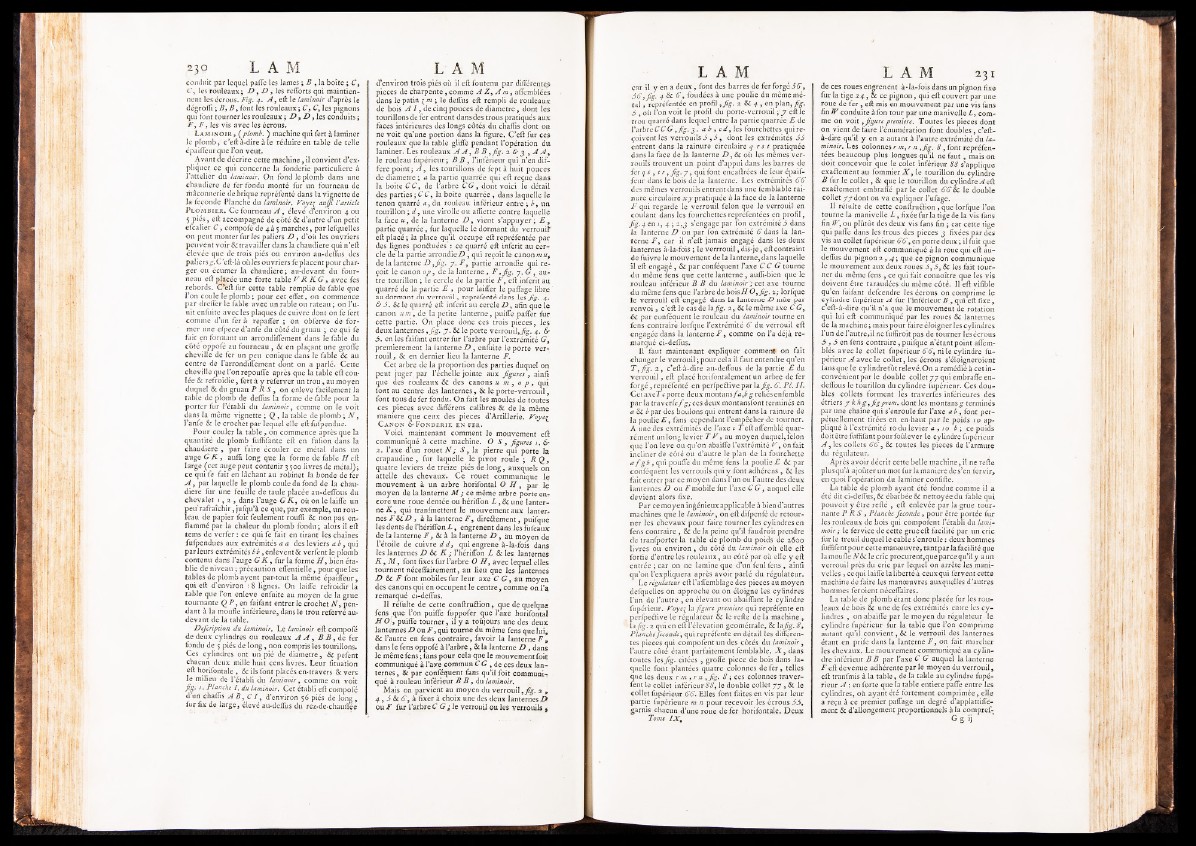
conduit par lequel paffe les lames ; B , la boîte ; C>
€ , les rouleaux ; £>, D , les refforts qui maintiennent
les écrous. Fig. 4. A , eft le laminoir d’après le
dégrofli ; B ,B , font les rouleaux ; C , C, les pignons
qui font tourner les rouleaux ; D , D , les conduits ;
F y F , les vis avec les écrous.
Laminoir , ( plomb. ) machine qui fert à laminer
le plomb y c'eft à-dire à le réduire en table de telle
épaiffeur que l’on veut.
Avant de décrire cette machine, il convient d’expliquer
ce qui concerne la fonderie particulière à
l’attelier du laminoir. On fond le plomb dans une
chaudière de fer fondu monté fur un fourneau de
ihâconnerie de brique repréfenté dans la vignette de
la fécondé Planche du laminoir. Voyt{ aujji Varticle
Plombier. Ce fourneau A , élevé d’environ 4 ou
5 piés, eft accompagné de côté 6c d’autre d’un petit
efcalier C , compofé de 4 à 5 marches, par lefquelles
on peut monter fur les paliers D , d’où les ouvriers
peuvent voir &c travailler dans la chaudière qui n ’eft
élevée que de trois piés ou environ au-dellus des
paliers g’.C ’eft-là oùles ouvriers fe placent pour charger
ou écumer la chaudière; au-devant du fourneau
eft placée une forte table V R K G , avec fes
rebords. C’eft fur cette table remplie de fable que
l’on coule le plomb ; pour cet effet, on commence
par dreffer le fable avec un rable ou rateau ; on l’unit
enfuite avec les plaques de cuivre dont on fe fert
comme d’un fer à repaffer ; on obferve de former
une efpece d’anfe du côté du gruau ; ce qui fe
fait en formant un arrondiffement dans le fable du
côté oppofé au fourneau, & en plaçant une groffe
cheville de fer un peu conique dans le fable 6c au
centre de l’arrondiffement dont on a parlé. Cette
cheville que l’on repouffe après que la table eft coulée
& refroidie, fert à y referver un trou, au moyen
duquel & du gruau P R S , on enleve facilement la
table de plomb de deffus la forme de fable pour la
porter fur l’établi du laminoir, comme on le voit
dans la même vignette ; Q , la table de plomb ; N ,
l ’anfe & le crochet par lequel elle eft fufpendue.
Pour couler la table, on commence après que la
quantité de plomb fuffifante eft en fùfion dans la
chaudière , par faire écouler ce métal dans un
auge G K y aufli long que la forme de fable H eft
large (cet auge peut contenir 3 500 livres de métal);
ce qui fe fait en lâchant au robinet la bonde de fer
A , par laquelle le plomb coule du fond de la chaudière
fur une feuille de taule placée au-deffous du
chevalet / , 2 , dans l’auge G K , où on le laiffe un
peu rafraîchir, jufqu’ à ce que, par exemple, un rouleau
de papier foit feulement rouffi 6c non pas enflammé
par la chaleur du plomb fondu ; alors il eft
îems de verfer : ce qui fe fait en tirant les chaînes
fufpendues aux extrémités a a des leviers a b , qui
parleurs extrémités ££ ,enlevent& verfent le plomb
contenu dans l’auge G K , fur la forme H , bien établie
de niveau ; précaution effentielle, pour que les
tables de plomb ayent par-tout la même épaiffeur ,
qui eft d’environ : 8 lignes. On laiffe refroidir la
table que l’on enleve enfuite au moyen de la grue
tournante Q P ,e n faifant entrer le crochet N , pendant
à la moufle inférieure, dans le trou refervé au-
devant de la table.
Difcription du laminoir. Le laminoir eft compofé
de deux cylindres ou rouleaux A A , B B , de fer
fondu de 5 piés de long, non compris les tourillons.
Ces cylindres ont un pié de diamètre, & pefent
chacun deux mille huit cens livres. Leur fituation
eft horifontale , 6c ils font placés en-travers & vers
le milieu de l’établi du laminoir, comme on voit
fig- '• Planche I. du laminoir. Cet établi eft compofé
d’un chaflis A B , C I , d’environ ç6 piés de long ,
fur fix de large, élevé au-deffus du rez-de-chauffée
d'environ trois piés où il eft foutenu par difterentç.s
pièces de charpente , comme A Z 9 A tn9 affemblées
dans le patin { m ; le deffus eft rempli de rouleaux
de bois A I , de cinq pouces de diàmetre, dont les
tourillons de fer entrent dans des trous pratiqués aux
faces intérieures des longs côtés du chaflis dont on
ne voit qu’une portion dans la figure. C ’eft fur ces
rouleaux que la table gliffe pendant l’opération du
laminer. Les rouleaux A A , B B 9fig. 2 & 3 , A A 9
le rouleau fupérieur ; B B , l’inférieur qui n’en différé
point ; A , les tourillons de fept à huit pouces
de diamètre ; a la partie quârrée qui eft reçue dans
la boîte C C , de l’arbre C G , dont voici le détail
des parties ; C C 9 la boîte quarrée, dans laquelle le
tenon quarré a 9 du rouleau inférieur entre ; b 9 un
tourillon ; d , une virolle ou afliette contre laquelle
la face m, de la lanterne D , vient s’appuyer; E 9
partie quarrée, fur laquelle le dormant du verrouit
eft placé ; la place qu’il occupe eft repréfentée par
des lignes ponéluées : ce quarré eft inferit au cercle
de la partie arrondie Z ) , qui reçoit le canon mu+
de la lanterne D 9fig. 7 . F , partie arrondie qui reçoit
le canon op, de la lanterne , F y fig. y. G , autre
tourillon ; le cercle de la partie F , eft inferit au
quarré de la partie E , pour laiffer le paffage libr£
au dormant du verrouil, reprefenté dans les fig. 4*
& 5 . & le quarré eft inferit au cercle Z ), afin que le
canon u m , de la petite lanterne, puiffe pâffer fur
cette partie. On place donc ces trois pièces, les
deux lanternes 9fig. y . 6c le porte verrouil, ƒ#. 4. &
S. en les faifant entrer fur l’arbre par l’extrémité G,
premièrement la lanterne D , enfuite le porte verrouil
, & en dernier lieu la lanterne F.
Cet arbre de la proportion des parties duquel on
peut juger par l’échelle jointe aux figures, ainff
que des rouleaux 6c des canons u m , o p , qui
font au centre des lanternes, & le porte-verrouil,
font tous de fer fondu. On fait les moules de toutes
ces pièces avec différens calibres & de la même
maniéré que ceux des pièces d’Artillerie. Voyeç
Canon g* Fonderie en fer.
Voici maintenant comment le mouvement eft
communiqué à cette machine. O S 9 figures 1. 6*
2. l’axe d’un rouet N ; S 9 la pierre qui porte la
crapaudine , fur laquelle le pivot roule ; R Q ,
quatre leviers de treize piés de long, auxquels on
attelle des chevaux. Ce rouet communique lq
mouvement à un arbre horifontal O H , par le
moyen de la lanterne M ; ce même arbre porte encore
une roue dentée ou hériffon L , 6c une lanterne
K , qui tranfmettent le mouvement aux lanter*
nés F 6 c D , à la lanterne F , dire&ement, puifque
les dents de l’hériffon L , engrenent dans les fufeaux
de la lanterne F , & à la lanterne D , àu moyen de
l’étoile de cuivre d d , qui engrene à-la-fois dans
les lanternes D 6c K ; l’hériffon L & les lanternes
K , M , font fixes fur l’arbre O H , avec lequel elles
tournent néceffairement, au lieu que les lanternes
D 6c F font mobiles fur leur axe C G , au moyen
des canons qui en occupent le centre, comme on 1’^
remarqué ci-deffus.
Il réfulte de cette conftruftion, que de quelque
fens que l’on puiffe fuppofer que l’axe horifontal
H Oi, puiffe tourner, il y a toûjoürs une des deux
lanternes D ou F , qui tourne du même fens que lui^
& l’autre en fens contraire, favoir la lanterne F ,
dans le fens oppofé à l’arbre, 8c la lanterne D , dans
le même fens ; fans pour cela que le mouvement foit
communiqué à l’axe commun C G , de ces deux lanternes
, 8c par conféquent fans qu’il foit communiqué
à rouleau inférieur B B , du laminoir.
Mais on parvient au moyen du verrouil ,fig. 2 ,
4 , S 8c 6 , à fixer à choix une des deux lanternes D.
ou F fur l’arbre C G ; le verrouil ou les verrouils ,
car il y en a deux, font des barres de fer forgé SC ,
SC y fig. 4 àc G , foudées à une poulie du même métal
, repréfentée en profil ,fig. 2 6c 4 , en plan, fig.
S où l’on voit le profil du porte-verrouil y eft le
trou quarré dans lequel entre la partie quarrée E de
l’arbre CC G ,fig. 3 . a b , c d , les fourchettes qui reçoivent
les verrouils S , S , dont les extrémités SS
entrent dans la rainure circulaire q r s t pratiquée
dans la face de la lanterne D , 6c où les mêmes verrouils
trouvent un point d’appui dans les barres de
fer q s , t r , fig. y , qui font encaftrées de leur épaiffeur
dans le bois de la lanterne. Les extrémités CC
des mêmes verrouils entrent dans une femblable rainure
circulaire x y pratiquée à la face de la lanterne
F qui regarde le verrouil félon que le verrouil en
coulant dans les fourchettes repréfentées en profil,
fig.4 en 1 ,4 ; 2.3 s’engage par fon extrémité 3 dans
la lanterne D ou par fon extrémité C dans la lanterne
F , car il n’eft jamais engagé dans les deux
lanternes à-la-fois ; le verrrouil, dis-je, eft contraint
de fuivre le mouvement de la lanterne, dans laquelle
il eft engagé, 6c par conféquent l’axe C C G tourne
du même fens que cette lanterne , aufli-bien que le
rouleau inférieur B B du laminoir';cet axe tourne
du même fens que l’arbre de bois H O, fig. 2; lorfque
le verrouil eft engagé dans la lanterne D mue par
ren vo i, c ’eft le cas de la fig. 2, 6c le même axe C G,
6c par conféquent le rouleau du laminoir tourne en
fens contraire lorfque l’extrémité C du verrouil eft
engagée dans la lanterne F , comme on l’a déjà remarqué
ci-deffus.
Il faut maintenant expliquer comment on fait
changer le verrouil; pour cela il faut entendre qu’en
T , fig. 2 , c’eft à-dire au-deffous de la partie E du
verrouil, eft placé horifontalement un arbre de fer
forg é, repréfenté en perfpefrive par la fig. C. PI. II.
Cet axeTc porte deux montans/<z,£ g reliés enfemble
par la traverfe ƒ g; ces deux montansfont terminés en
a 6c b par des boulons qui entrent dans la rainure de
la poulie E , fans cependant l’empêeher de tourner.
A une des extrémités de l’axe c T eftaffemblé qiiar-
rément un long levier T F y au moyen duquel, lelon
que l’on leve ou qu’on abaiffe l’extrémité F , on fait
incliner de côté ou d’autre le plan de la fourchette
a f g b , qui poulie du même fens la poulie E 6c par
conféquent les verrouils qui y font adhérens , 6c les
fait entrer par ce moyen dans l’un ou l’autre des deux
lanternes D ou F mobile fur l’axe C G , auquel elle
devient alors fixe.
Par ce moyen ingénieux applicable à bien d’autres
machines que le laminoir, on eft difpenfé de retourner
les chevaux pour faire tourner les cylindres en
fens contraire , & de la peine qu’il faudroit prendre
de tranfporter la table de plomb du poids de 2600
livres ou environ, du côté du laminoir où elle eft
fortie d’entre les rouleaux, au côté par où elle y eft
entrée ; car on ne lamine que d’un feul fens , ainfi
qu’on l’expliquera après avoir parlé du régulateur.
Le régulateur eft l’affemblage des pièces au moyen
defquclles on approche ou on éloigne les cylindres
l ’un de l’autre , en élevant ou abaiffant le cylindre
fupérieur. Voye{ la figure première qui repréfente en
perfpefrive le régulateur & le refte de la machine ,
la fig. 2 qui en eft l’élévation geométrale, 6c la fig. S ,
Planche Jèconde, qui repréfente en détail les différentes
pièces qui compofent un des côtés du laminoir,
l’autre côté étant parfaitement femblable. X , dans
toutes les fig. citées , groffe piece de bois dans laquelle
font plantées quatre colonnes de f e r , telles
que les deux r m , r n ,fig. 8 ; ces colonnes îraver-
fent le collet inférieur 88, le double collet 7 7 , 8t le
collet fupérieur CC. Elles font faites en vis par leur
partie fupérieure m n pour recevoir les écrous SS,
garnis chacun d’une roue de fer horifontale. Deux
Tome IX\
de ces roues engrenent à-la-fois dans un pignon fixe
fur la tige 2 4 ,6 c ce pignon, qui eft couvert par une
roue de f e r , eft mis en mouvement par une vis fans
fin JF conduite à fon tour par une manivelle L, comme
on v o it , figure première. Toutes les pièces dont
on vient de faire l’énumération font doubles , c’eftà
dire qu’il y en a autant à l’autre extrémité du laminoir.
Les colonnes r m,r n ,fig. 8 , font repréfentées
beaucoup plus longues qu’il ne fau t , mais on
doit concevoir que le colet inférieur 88 s’applique
exaâementau fommier^T, le tourillon du cylindre
B fur le collet, 8c que le tourillon du cylindre^eft
exafrement embraffé par le collet CC êc le double
collet 7 7 dont on va expliquer l’ufage.
Il rélulte de cette conftruflion, que lorfque l’on
tourne la manivelle L , fixée fur la tige de la vis fans
fin ÏF, ou plutôt des deux vis fans fin ; car cette tige
qui pafle dans les trous des pièces 3 fixées par des
vis au collet fupérieur CC, en porte deux ; il fuit que
le mouvement eft communiqué à la roue qui eft au-
deffus du pignon2 , 4-, que ce pignon communique
le mouvement aux deux roues S ,S , 6c les fait tourner
du même fens , ce qui fait connoître que les vis
doivent être taraudées du même côté. Il eft vifible
qu’en faifant defeendre les écrous on comprime le
cylindre fupérieur A fur l’inférieur B , qui eft fixe,
c’eft-à-dire qu’il n’a que le mouvement de rotation
qui lui eft communiqué par les roues 6c lanternes
de la machine ; mais pour faire éloigner les cy lindres
l’un de l’autre,il ne fuffiroit pas de tourner les écrous
S y S en fens contraire, puifque n’étant point affem-
blés avec le collet fupérieur CC, ni le cylindre fupérieur
A avec le collet, les écrous s’éloigneroient
fans que le cylindre fût relevé.On a remédié à cet inconvénient
par le double collet 7 7 qui embraffe en-
deffous le tourillon du cylindre fupérieur. Ces doubles
collets forment les traverfes inférieures des
étriers 7 k h g , fig prem. dont les montansg- terminés
par une chaîne qui s’enroule fur l’axe a b , font perpétuellement
tirées en en-haut par le poids 10 appliqué
à l’extrémité 10 du levier a , 10 b ; ce poids
doit être fuflifant pour foûlever le cylindre fupérieur
A , les collets CC , 6c toutes les pièces de l’armure
du régulateur.
Après avoir décrit cette belle machine, il ne refte
plusqu’à ajouter un mot fur la maniéré de s’en fervir,
en quoi l’opération du laminer confifte.
La table de plomb ayant été fondue comme il a
été dit ci-deffus, & ébarbée& nettoyée du fable qui
pouvoit y être refté , eft enlevée par la grue tournante
P R S , Planche fécondé, pour être portée fur
les rouleaux de bois qui compofent l’établi du lami-
moir ; le fervice de cette grue eft facilité par un cri,c
furie treuil duquel le cable s’enroule : deux hommes
fuflifent pour cette manoeuvre, tant par la facilité que
la moufle N6c le cric procurent,que parce qu’il y a un
verrouil près du cric par lequel on arrête les manivelles
, ce qui laiffe la liberté à ceux qui fervent cette
machine de faire les manoeuvres auxquelles d’autres
hommes feroient néceffaires.
La table de plomb étant donc placée fur les rouleaux
de bois 6ç une de fes extrémités entre les cy lindres
, on abaiffe par le moyen du régulateur le
cylindre fupérieur fur la table que l’on comprime
autant qu’il convient, & le verrouil des lanternes
étant en prife dans la lanterne F , on fait marcher
les chevaux. Le mouvement communiqué au cylindre
inférieur B B par l’axe C G auquel la lanterne
F eft devenue adhérente par le moyen du verrouil,
eft tranfmis à la table, de la table au cylindre fupérieur
A : en forte que la table entière paffe entre les
cylindres, où ayant été fortement comprimée, elle
a reçu à ce premier paffage un degré d’applattiffé-
ment & d’allongement proportionnels à la compref