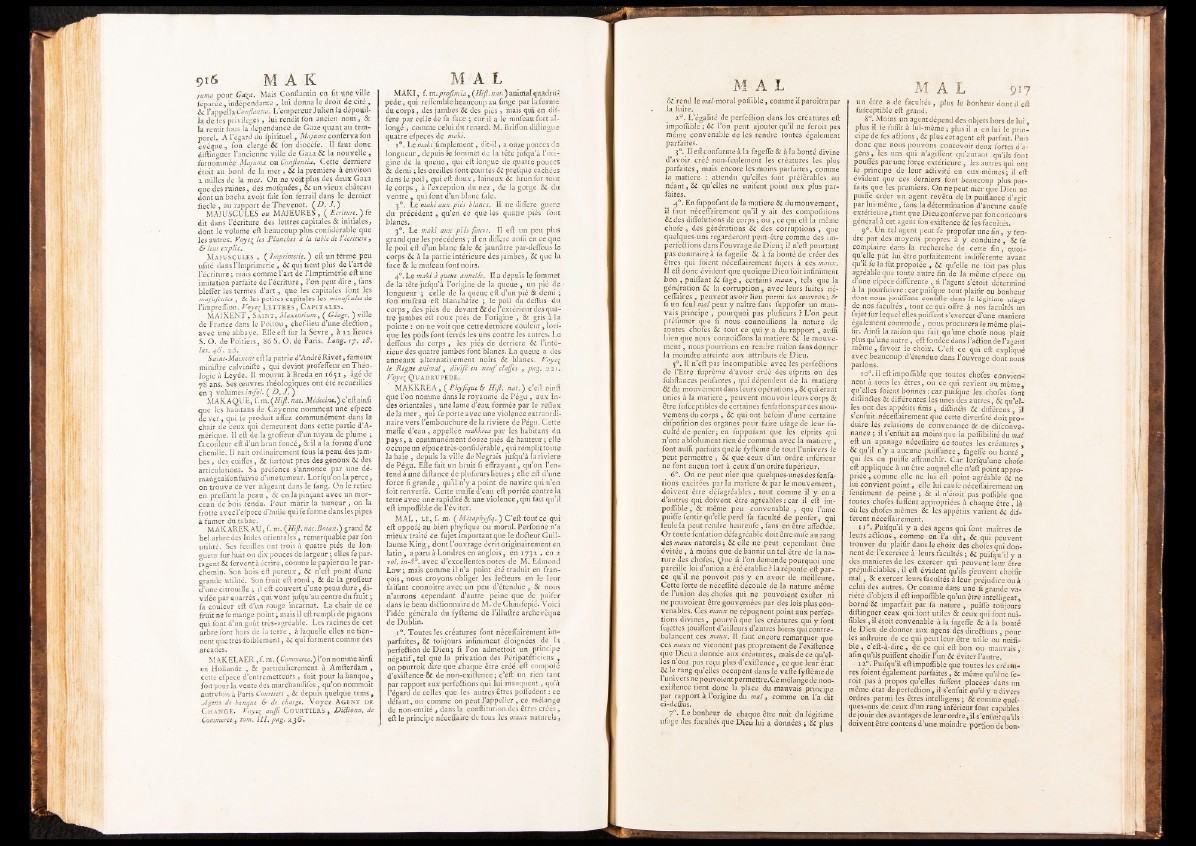
juma pour Gtqa. Mais Conftantin en fit une ville
féparée, indépendante , lui donna le droit de cite ,
6c l’appeila Conßanäa. L’empereur Julien la dépouilla
de fes privilèges , lui rendit fon ancien nom, &
la remit fous la dépendance de Gaze quant au temporel.
A l’égard du fpirituel, Majume conferva fon
cvêque, fon clergé & fon diocèfe. Il faut donc
diftinguer l’ancienne ville de Gaza & la nouvelle ,
furnommée Majuma ou Conßantia. Cette derniere
étoit au bord de la mer, 6c la première à environ
i milles de la mer. On ne voit plus des deux Gaza
que des ruines, des mofquées, 6c un vieux château
dont un bacha avoit fait fon ferrail dans le dernier
fiecle , au rapport de Thevenot. {D . / .)
MAJUSCULES ou MAJEURES, ( Ecriture. ) fe
dit dans l’écriture des lettres capitales & initiales,
dont le volume eft beaucoup plus conlidérable que
les autres. Voye^ les Planches à la table de l'écriture ,
& leur explic. ' .
Majuscules , ( Imprimerie. ) eft un terme peu
ufité dans l’Imprimerie , 6c qui tient plus de l’art de
l’écriture ; mais comme l’art de l’Imprimerie eft une
imitation parfaite de l’écriture, l’on peut dire , fans
bleffer les termes d’a r t , que les capitales font les
majuscules , & les petites capitales les minufcules de
l’impreffion. Voyc?^ Let tre s , C a p ita le s .
MA1X EN T , Sa in t , Maxentium, ( Géogr, ) ville
de France dans le Poitou , chef-lieu d’une élection,
avec une abbaye. Elle eft fur la Sevre , à i z lieues
S. O. de Poitiers, 86 S. O. de Paris. Long. ty. 18.
lat. 46'. a i .
Saint-Maixent eft la patrie d’André Rivet, fameux
miniftre calvinifte , qui devint profeffeur en Théologie
à Leyde. Il mourut à Breda en 16 5 1 , âgé de
78 ans. Ses oeuvres théologiques ont été recueillies
en 3 volumes in-fol. ( D . J. )
MAKAQUE, f. m. {Hiß. nat. Médecine.) c’ eftainfi
que les habitans de. Cayenne nomment une efpece
de v e r , qui fe produit allez communément dans la
chair de ceux qui demeurent dans cette partie d’Amérique.
11 eft de la groffeur d’un tuyau de plume ;
fa couleur eft d’un brun foncé, & il a la forme d’une
chenille. Il naît ordinairement fous la peau des jambes
, des çuiffes, 6c furtout près des genoux & des
articulations. Sa préfence s’annonce par une dé-
mangeaifonfuivie d’une tumeur. Lorfqu’on la perce,
on trouve ce ver nageant dans le fang. On le retire
en preffant la peau , & en la pinçant avec un morceau
de bois fendu. Pour mûrir la tumeur, on la
frotte avec l’efpece d’huile qui fe forme dans les pipes
à fumer du tabac.
MAK.AREKAU, f. m. {Hiß.nat.Botan.’) grand 6c
bel arbre des Indes orientales , remarquable par fon
utilité. Ses feuilles ont trois à quatre piés de longueur
fur huit ou dix pouces de largeur ; elles fe partagent
6c fervent à écrire, comme le papier ou le parchemin.
Son bois eft poreux , & n’eft point d’une
grande utilité. Son fruit eft rond , & de la groffeur
d’une citrouille ; il eft couvert d’une peau dure, di-
vifée par quarrés, qui vont jufqu’au centre du fruit ;
fa couleur eft d’un rouge incarnat. La chair de ce
fruit ne fe mange point ; mais il eft rempli de pignons
qui font d’un goût très-agréable. Les racines de cet
arbre font hors de la terre, à laquelle elles ne tiennent
quetrès-foiblement, 6c qui forment comme des
arcades.
MAKELA E R , f. m. ( Commerce.) l’on nomme ainfi
en Hollande , & particulièrement à Amfterdam ,
cette efpece d’entremetteurs, foit pour la banque,
foit pour la vente des marchandifes, qu’on nommoit
autrefois à Paris Courtiers , & depuis quelque tems,
Jigtns de banque & de charge. Voyez AGENT DE
C h an g e . Voye^ aujji C ourtiers , Diclionn. de
Commerce, tom, ƒƒƒ, pag. 6 .
MAKI, f. m.profirnia, {Hiß- nat J) animal quadru-,
pede, qui reffemble beaucoup au finge par la forme
du corps, des jambes 6c des piés , mais qui en différé
par celle de fa face ; car il a le mufeau fort allongé
, comme celui du renard. M. Briffon diftingue
quatre efpeces de maki.
i° . Le w/î/ci Amplement, dit-il, a onze pouces de
longueur, depuis le fommet de la tête jufqu’à L’origine
de la queue, qui eft longue de quatre pouces
& demi ; les oreilles font courtes 6c prefque cachées
dans le poil, qui eft doux, laineux 6c brun fur tout
le corps, à l’exception du nez , de la gorge 6c du
ventre, qui font d’un blanc fale.
30. Le maki aux piés blancs. Il ne différé guere
du précédent, qu’en ce que les quatre piés font
blancs.
30. Le maki aux piés fauve. Il eft un peu plus
grand que les précédens ; il en différé aufli en ce que
le poil eft d’un blanc fale 6c jaunâtre par-deffous le
corps & à la partie intérieure des jambes, 6c que la
face & le mufeau font noirs.
40. Le maki à queue annelèe. Il a depuis le fommet
de la tête jufqu’à l’origine de la queue, un pié de >
longueur ; celle de la queue eft d’un pié & demi ;
fon mufeau eft blanchâtre ; le poil du deflits du
corps, des piés de devant & de l’extérieur des quatre
jambes eft roux près de l’origine , & gris à la
pointe : on ne voit que cette derniere couleur, lorf-
que les poils font ferrés les uns contre les autres. Le
deffous du corps , les piés de derrière 6c l’intérieur
des quatre jambes font blancs. La queue- a des
anneaux alternativement noirs 6c blancs. Hoye^
le Regne animal, divifè en neuf clajfes , pag. z z t .
Voye1 QUADRUPEDE.
MAKK REA, ( Phyßque & Hiß. nat. ) c’eft ainfi
que l’on nomme dans le royaume de Pégu , aux Indes
orientales, une lame d’eau formée par le reflux
de la m er, qui fe porte avec une violence extraordinaire
vers l’embouchure de la rivière de Pégu. Cette
maffe d’eau , appellée makkrea par les habitans du
pa ys , a communément douze piés de hauteur ; elle
occupe un efpacetrès-confidérable, qui remplit toute
la baie , depuis la ville de Negraïs jufqu’à la riviere
de Pégu. Elle fait un bruit fi effrayant, qu’on l’entend
à une diftance de plufieurs lieues ; elle eft d’une
force fi grande , qu’il n’y a point de navire qui n’en
foit renverfé. Cette maffe d’eau eft portée contre la
terre avec une rapidité & une violence, qui fait qu’il
eft impoflible de l’éviter.
MAL , le, f. m. ( Métaphyfiq. ) C ’eft tout ce qui
eft oppofé au bien phyfique ou moral. Perfonne n’a
mieux traité ce fujet important que le dofteur Guillaume
K in g , dont l ’ouvrage écrit originairement en
latin, a paru à Londres en anglois, en 173 z , e n z
vol. in-8 °. avec d’excellentes notes de M. Edmond
Law ; mais comme il n’a point été traduit en fran-
çois, nous croyons obliger les lefteurs en le leur
faifant connoître avec un peu d’étendue , & nous
n’aurons cependant d’autre peine que de puifer
dans le beau dictionnaire de M. de Chaufepié. Voici
l’idée générale du fyftème de l’illuftre archevêque
de Dublin.
i° . Toutes les créatures font néceffairement imparfaites,
6c toûjours infiniment éloignées de la .
perfeftion de Dieu ; fi l’on admettoit un principe
négatif, tel que la privation des Péripatéticiens ,
on pourroit dire que chaque être créé eft compofé
d’exiftence & de non-exiftence ; c’eft un rien tant
par rapport aux perfections qui lui manquent, qu'à
l’égard de celles que les autres êtres poffedent : ce
défaut, ou comme on peut l’appeller , c e mélange
de non-'entité , dans la conftitution des êtres créés,
eft le principe néceffaire de tous les maux naturels,
6c rend le mal-moral pofîible, comme il paroîtra par
la fuite.
z ° . L ’égalité de perfection dans les créatures eft
impoflible ; 6c l’on peut ajouter qu’il ne feroit pas
même convenable de les rendre toutes également
parfaites.
30. Il eft conforme à la fageffe & à la bonté divine
d’avoir créé non-feulement les créatures les plus
parfaites, mais encore les moins parfaites, comme
la matière- : attendu qu’elles font préférables au
néant, & qu’elles ne nuifent point aux plus parfaites.
40. En fuppofant de la matière 6c du mouvement,
il faut néceffairement qu’il y ait des compofitions
& d e s diffolutionsde corps ; ou , ce qui eft la même
chofe , des générations 6c des corruptions , que
quelques-uns regarderont peut-être comme des imperfections
dans l’ouvrage de Dieu ; il n’eft pourtant
pas contraire à fa fageffe & à fa bonté de créer des
êtres qui foient néceffairement fujets à ces maux.
Il eft donc évident que quoique Dieu foit infiniment
bon , puiffant 6c fage , certains maux, tels que la
génération 6c la corruption , avec leurs fuites né-
ceffaires , peuvent avoir lieu parmi fes oeuvres ; &
fi un feul mal peut y naître fans fuppofer un mauvais
principe , pourquoi pas plufieurs ? L’on peut
préfumer que fi nous connoiflions la nature de
toutes chofes 6c tout ce qui y a du rapport , aufli
bien que nous connoiffons La matière 6c le mouvement
, nous pourrions en rendre raifon fans donner
la moindre atteinte aux attributs de Dieu.
ç°. Il n’eft pas incompatible avec les perfections
de l’Etre fuprème d’avoir créé des efprits ou des
fubftances penfantes, qui dépendent de la matière
6 c du mouvement dans leurs opérations, 6c qui étant
unies à la matière , peuvent mouvoir leurs corps &
être fufceptibles de certaines fenfationspar ces mou-
vemens du corps , 6c qui ont befoin d’une certaine
difpofition des organes pour faire ufage de leur faculté
de penfer; en fuppofant que les efprits qui
n’ont abfol ument rien de commun avec la matière ,
font aufli parfaits que le fyftème de tout l’univers le
peut permettre, 6c que ceux d’un ordre inférieur
ne font aucun tort à ceux d’un ordre fupérieur.
6°. On ne peut nier que quelques-unes des fenfa-
tions excitées par la matière & par le mouvement,
doivent être défagréables, tout comme il y en a
d’autres qui doivent être agréables : car iLeft im-
pofîible, & même peu convenable , que l’ame
puiffe fentir qu’elle perd fa faculté de penfer , qui
feule la peut rendre heureufe , fans en être affe&ée. I
Or toute fenfation défagréable doit êtrenufe au rang
des maux naturels ; 6c elle ne peut cependant être
évitée , à moins que de bannir un tel être de lanâ-'.
ture des chofes. Que fi l’on demande pourquoi une
pareille loi d’union a été établie ? laréponfe eft parce
qu’il ne pouvoit pas y en avoir de meilleure.
Gette forte de nécefîité découle de la nature même
de T union des chofes qui ne pouvoient exifter ni
ne pouvoient être gouvernées par des lois plus convenables.
Ces maux ne répugnent point aux perfections
divines , pourvû que les créatures qui y font
fujettes jouiffent d’ailleurs d’autres biens quicontre-
balancent ces maux. Il faut encore remarquer que
ces maux ne viennent pas proprement de l’exiftence,
que Dieu a donnée aux créatures , mais de Ce qu’elles
n’ont pas reçu plus d’exiftence, ce que leur état
6c le rang qu’elles occupent dans le vafte fyftème de
l ’univers ne pouvoient permettre.Ce mélange de non-
exiftence tient donc la place du mauvais principe
par rapport à l’origine du mal, comme on l’a dit
ci-deffus.
-, 70. Le bonheur de chaque être naît du.légitime
ufage des. façultés que Dieu lui a données ; & plus
un être a de facultés , plus le bonheur dont il eft
fufceptible eft grand.
8°. Moins un agent dépend des objets hors de lui,
plus il fe fuffit à lui-même ; plus il a en lui le principe
de fes a étions, 6c plus cet agent eft parfait. Puis
donc que nous pouvons concevoir deux fortes d’a-
gens, les uns qui n’agiffent qu’autant qu’ils font
pouffes par une force extérieure , les autres qui ont
le principe de leur activité en eux-mêmes; il eft
évident que ces derniers font beaucoup plus parfaits
que les premiers. On ne peut nier que D ieu ne
puiffe créer un agent revêtu de la puiflance d’agir
par lui-même, fans la détermination d’aucune caufe
extérieure, tant que Dieu conferve par fon concours
général à cet agent fon exiftence 6c fes facultés.
90. Un tel agent peut fe propofer une fin, y tendre
par des moyens propres à y conduire, 6c fe
complaire dans la recherche de cette fin, quoiqu’elle
pût lui être parfaitement indifférente avant
qu’il fe la fût propoiée , 6c qu’elle ne foit pas plus
agréable que toute autre fin de la même efpece ou
d une efpece differente , fi l’agent s’étoit déterminé
à la pourfuivre : car puifque tout plaifir ou bonheur
dont nous jouiffons confifte dans le légitime ufage
de nos facultés , tout ce qui offre à nos facultés un
fujet fur lequel elles puiffent s’exercer d’une maniéré
également commode , nous procurera le même plaifir.
Ainfi la raifon qui fait qii’une chofe nous plaît
plus qu’une autre , eft fondée dans I’aétion de l’aoent
même, favoir le choix. C’eft ce qui eft expliqué
avec beaucoup d’étendue dans l’ouvrage dont nous
parlons.
10^. Il eft impoflible que toutes chofes convient
nent à .tous les êtres, ou ce qui revient au même,-
quelles foient bonnes : car puifque les chofes font
diftinfîes & différentes les unes des autres, 6c qu’elles
ont des appétits finis , diftinûs 6c différens , il
s’enfuit .néceffairement que cette diverfité doit produire
les relations de convenance & de difeonve-
nance ; il s’enfuit au moins que la poflibilité du mal
eft un apanage néceffaire de toutes les créatures ,
& qu’il n’y a aucune puiflance, fageffe ou bonté ,
qui les en puiffe affranchir. Car Iorfqu’une chofe^
eft appliquée à un être auquel elle n’eft point appropriée
, comme elle ne lui. eft point agréable 6c ne
lui convient point, elle lui caufe néceffairement un
fentiment de peine ; & il n’étoit pas.poflible que
toutes chofes fuffent appropriées à chaque être , là
où les chofes mêmes & les appétits varient 6c different
néceffairement.
11°. Puifqu’il y a des agens qui font maîtres de
leurs aétions , comme on l’a dit, 6c qui peuvent
trouver du plaifir dans le choix des chofes qui donnent
de l’exercice à leurs facultés ; & puifqu’il y a
des.manieres de les exercer qui peuvent leur être
préjudiciables, il eft évident qu’ils peuvent choifir
mal, & exercer leurs facultés à leur préjudice ou à
celui des autres. Or comme dans une fi grande variété
d’objets, il eft impoflible qu’un être intelligent,
borné & imparfait par fa nature , puiffe toûjours
diftinguer ceux qui font utiles & ceux^qui font nui-
fibles , il étoit convenable à la fageffe & à la bonté
de Dieu de donner aux agens des direétions , pour
les inftruire de ce qui peut leur être utile ou nuifi-
ble , c’eft-à-dire, de ce qui eft bon ou mauvais ,’
afin qu’ils puiffent choifir.l’un 6c éviter l’autre.
ïz °. Puifqu’il eft impoflible que toutes les créatures
foient également parfaites, & même qu’il ne feroit
pas à propos qu’elles fuffent placées dans un
même état de perfection, il s’enfuit qu’il y a divers
ordres parmi les êtres intelligens ; & comme quelques
uns de ceux d’un rang inférieur font capables
de jouir des avantages de leur ordre, il s’enfuit qu’ils
doivent être contens d’une, moindre portion de bon