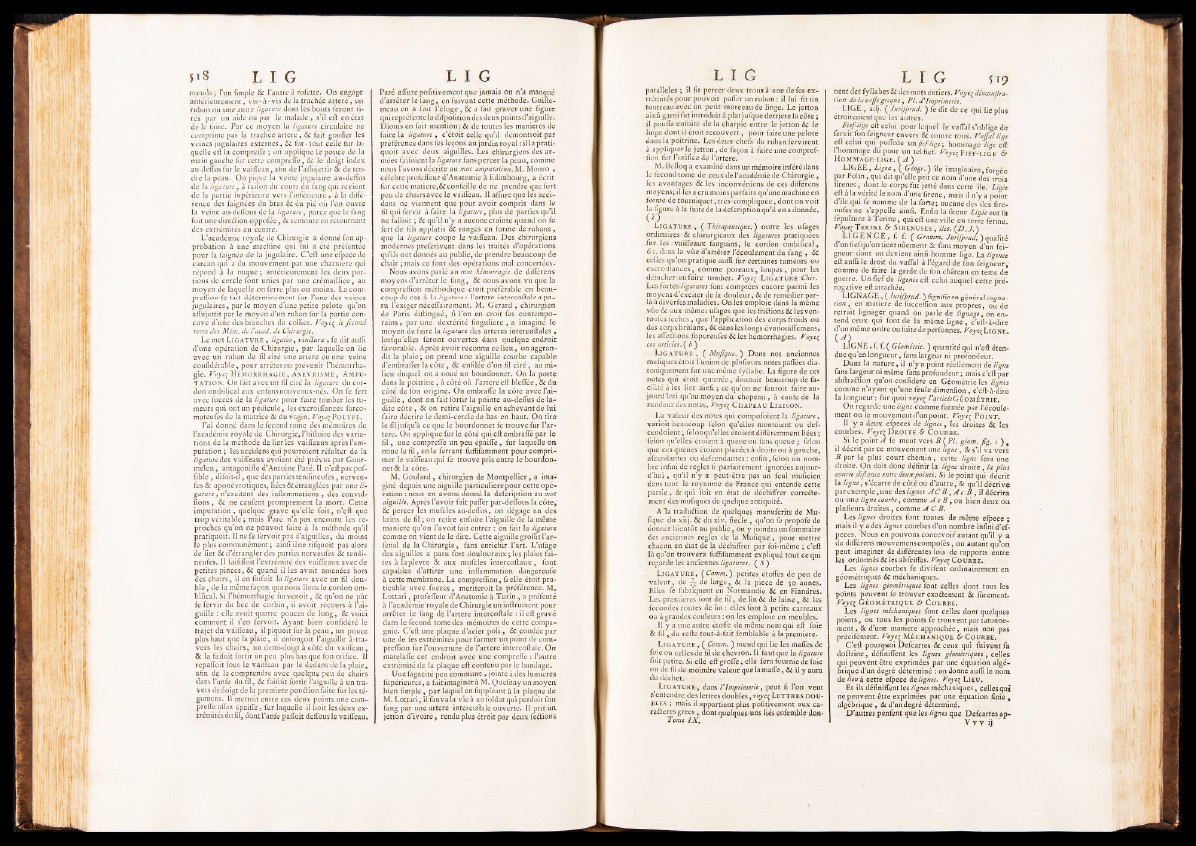
noeuds ; l’un {impie 6c l’autre à rofette. On engage
antérieurement, v.is-à-vis de la tIrachéte artere, un
ruban ou une autre ligature dont les bouts feront tirés
par un aide ou par le malade , s’il eft en état
de Je faire. Par ce mpye.n la ligature circulaire ne
comprime pas la trachée artere , ,6c fait gonfler les
veines jugulaires externes, 6c fur-tout celle fur laquelle
eft la comprefle ; on applique le pouce de la
main gauche fur cette comprefle, 6c le doigt index
au-deffus fur le vaiffeau, afin de l’affujettir & de tendre
la peau. On piqu,e la veine jugulaire au-deffus
de la ligature, à raiion du cours du fang qui revient
de la partie fupérieure vers l’inférieure , à la différence
des faignées du bras & du .pié où l’on ouvre
la veine au-deffous de la ligature, parce que le fang
fuit une direction oppofée, & remonte en retournant
des extrémités au centre.
L ’académie royale de Chirurgie a donné fon approbation
à une machine qui lui a été préfentée
pour la faignée de la jugulaire. C ’eft une efpece de
carcan qui a du mouvement par une charnière qui
répond à la nuque ; antérieurement les deux portions
de cercle font unies par une crémaillièe, au
moyen de laquelle on ferre plus ou moins. La com-
preflion fe fait déterminémènt fur l’une des veines
jugulaires, par le moyen d’une petite pelote qu’on
àflujettit par le moyen d’un ruban fur la partie concave
d’une des branches du collier. Voye^ le fécond
tomé des Mém. de l'acad. de Chirurgie.
Le mot Ligature , ligatio, vinclura , fe dit aufli
d’une opération de Chirurgie, par laquelle on lie
avec un ruban de fil ciré une artere ou une veine
confidérable, pour arrêter ou prévenir l’hémorrhagie.
Voye{ Hémorrhagie, ànevrisme, Amputation.
On fait avec un fil ciré la ligature du cordon
ombilical aux enfansnouveaux-nés. On fe fert
avec fuccès de la ligature pour faire tomber les tumeurs
qui ont un pédicule, les excroiffances farco-
mateufes de la matrice & du vagin. Voyc^ Polype.
J’ai donné dans le fécond tome des mémoires de
l’académie royale de Chirurgie, l’hiftoire des variations
de la méthode de lier les vaiffeaux après l’amputation
; les accidens qui pourroient réfulter de la
liga.ture des vaiffeaux avoient été prévus par Gour-
meien, antagonifte d’Antoine Paré. Il n’eft pas pof-
iib le , difoit-il, que des parties tendineufes, nerveu-
fes & aponévrotiques, liées & étranglées par une ligature
, n’excitent des inflammations , des convul-
fions, 6c ne caufent promptement la mort. Cette
imputation, quelque grave qu’elle fo it , n’eft que
trop véritable ; mais Paré n’a pas encouru les reproches
qu’on ne pouvoit faire à la méthode qu’il
pratiquoit. II ne fe fervoit pas d’aiguilles, du moins
le plus communément ; ainfi il ne rifquoit pas alors
de lier & d’étrangler des parties nerveufes 6c tendineufes.
Il faififfoit l’extrémité des vaiffeaux avec de
petites pinces, & quand il les avoit amenées hors
des chairs, il en faifoit la ligature avec un fil double
, de la même façon que nous lions le cordon ombilical.
Si l’hémorrhagie furvenoit, & qu’on ne pût
fe fervir du bec de corbin, il avoit recours à l’aiguille
: elle avoit quatre pouces de long, & voici
comment il s’en fervoit. Ayant bien confidéré le
trajet du vaiffeau, il piquoit fur la peau, un pouce
plus haut que la plaie, il enfonçoit l’aiguille à-travers
les chairs, un demi-doigt à côté du vaiffeau,
& la faifoit fortir un peu plus bas que foi? orifice. 11
repaffoit fous le vaiffeau par le dedans de la. p laie,
afin de le comprendre avec quelque peu de chairs
dans l’anfe du fil, & faifoit fortir l’aiguille à un travers
de doigt de la première ponction faite furies té-
gumens. Il mettoit entre ces deux points une com-
preffe affez épaiffe, fur laquelle il lioit les deux extrémités
du fil, dont l’anfe paffoit deffous le vaiffeau.
Paré affure pofitivement que jamais on n ’a manqué
d’arrêter le fang, en fuivant cette méthode. Guille-
meau en a fait l’é lo g e , & a fait graver une figure
qui repréfentela difpofition des deuxpoints.d’aiguille.
Pioijis en fait mention : & de toutes les maniérés de
faire la ligature , ç’étoit celle qu’il démontroit par
préférence dans fes leçons au jardin royal : ilia prati-
quoit avec deux aiguilles. Les chirurgiens des armées
faifoient la ligature fans percer la peau, comme
nous l’avons décrite au mot amputation. M. Monro ,
célébré profeffeur d’Anatomie à Edimbourg, a écrit
fur cette matière,& confeille de ne prendre que fort
peu de chairs avec le vaiffeau. II affure que les accidens
ne viennent que pour avoir compris dans le
fil qui fervir à faire la ligature, plus de parties qu’il
ne falloit ; 6c qu’il n’y a aucune crainte quand on fe
fert de fils applatis 6c rangés en forme de rubans ,
que la ligature coupe le vaiffeau. Des chirurgiens
modernes prefcriyent dans les traités d’opérations
qu’ils ont donnés au public, de prendre beaucoup de
chair ; mais ce font des opérations mal concertées.
Nous avons parlé au mot hémorragie de différens
moyens d’arrêter le fang, 6c nous avons vu que la
compreflion méthodique étoit préférable en beaucoup
de cas à la ligature : l’artere intercoftale a paru
l’exiger néceffairement. M. Gérard , chirurgien
de Paris diftingué, fi l’on en croit fes contemporains
, par une dextérité finguliere , a imaginé le
moyen de faire la ligature des arteres intercoftales ,
lorfqu’elles feront ouvertes dans quelque endroit
favorable. Après avoir reconnu ce lieu , on aggran-
dit la plaie > on prend une aiguille courbe capable
d’embraffer la c ô te , & enfilée d’un fil c iré , au milieu
duquel on a noué un bourdonnet. On la porte
dans la poitrine, à côté où l’artere eft bleffée, 6c du
côté de fon origine. On embraffe la côte avec l’aiguille
, dont on fait fortir la pointe au-deffus de ladite
cô te , & on retire l’aiguille en achevant de lui
faire décrire le demi-cercle de bas en haut. On tire
le filjufqu’à ce que le bourdonnet fe trouve fur l’ar-
tere. On applique furie côté qui eft embraffé par le
f il, une comprefle un peu épaiffe, fur laquelle on
noue le f il, en le ferrant fuflifamment pour comprimer
le vaiffeau qui fe trouve pris entre le bourdonnet
& la côte.
M. Goulard, chirurgien de Montpellier, a imaginé
depuis une aiguille particulière pour cette opération
: nous en avons donné la defeription au mot
aiguille. Après l’avoir fait paffer par-deffous la côte,'
6c percer les mufcles au-deffus, on dégage un des
brins de fil ; on retire enfuite l’aiguille de la même
maniéré qu’on l’avoit fait entrer : on fait la ligature
comme on vient de le dire. Cette aiguille groflit l’ar-
fenal de la Chirurgie, fans enrichir l’art. L’ufage
des aiguilles a paru fort douloureux ; les plaies faites
à laplevre & aux mufcles intercoftaux, font
capables d’attirer une inflammation dangereufe
à cette membrane. La compreflion , fi elle étoit praticable
ayeç fuccès, meriteroit la préférence. M.
Lottari, profeffeur d’Anatomie à Turin , a préfenté
à l’académie royale de Chirurgie un infiniment pour
arrêter le fang de l’artere intercoftale : il eft gravé
dans le fécond tome des mémoires de cette compagnie.
C ’eft une plaque d’acier p o li, & coudée par
une de fes extrémités pour former un point de compreflion
fur l’ouverture de l’artere intercoftale. On
matelaffe cet endroit avec une comprefle : l’autre
extrémité de la plaque eft contenu par le bandage.
Une fagaçité peu commune , jointe à des lumières
fupérieures, a faitimaginerà M. Quefnay un moyen
bien fimple , par lequel en fuppléant à la plaque de
M. Lottari, il fauvala vie à unfoldat qui perdoit fon
fang par une artere intercoftale ouverte. Il prit un
jetton d’ivoire, rendu plus étroit par deux ferions
parallèles ; il fit percer deux trous à une de fes extrémités
pour pouvoir paffer un ruban : il lui fit un
fourreau avec'un petit morceau de linge. Le jetton
ainfi garni fut introduit à plat jufque derrière la côte ;
il pouffa enfuite de la charpie entre le jetton 6c le
linge dont.il étoit recouvert,, pour faire une pelote
dans la poitrine. Les deux chefs du ruban fervirent.
à appliquer le jetton, de façon à faire une compref-
fion fur l’orifice de l’arterë.
M. Belloq a examiné dans un mémoire inféré dans
le fécond tome de ceux de l’académie de Chirurgie ,
les avantages & les inconvéniens de ces différens
moyens; il les a cru moins parfaits qu’une machine en
forme de tourniquet, très-compliquée, dont on voit
la figure à la fuite de la defeription qu’il en a donnée.
■
Ligature, ( Thérapeutique. ) outre les ufages
ordinaires & chirurgicaux des ligatures pratiquées
fur les:vaiffeaux fanguins, le cordon ombilical,
&c. dans la vue d’arrêter l’écoulement du fang , 6c
celles qu’on pratique aufli fur certaines tumeurs ou
excroiffances, comme poreaux, loupes, pour les
détachen où faire tomber. Voye^ Ligature Chir.
Les iottés.ligatures font,comptées encore parmi les
moyens d’exciter de la douleur, & de remédier parla
à divèrfes maladies. On les emploie dans la même
.vue 6c aux. mêmes ufages: que les friûions & les ven-
toufes feches , que l’application des corps froids ou
•des corpsbrûlans, 6c dans les longs évanouiffemens,
les affe&ions foporeufes & les hémorrhagies. Voye^
.ces artitlès: ( b )
Ligature , ( Mufîque. ) Dans nos anciennes
mufiques.étoit l’iinionde plufieurs notes paffées diatoniquement
fur une même fyllabe. La figure de ces
notes qui étoit quarrée, donnoit beaucoup de facilité
à les lier ainfi ; ce qu’on ne fauroit faire au-
-jourd’hui qu’au moyen du chapeau, à caufe de la
rondeur des notes. Voye^ Chapeau Liaison.
La Valeur des notes qui compofoient la ligature,
varîoit beaucoup félon qu’elles montoient ou def-
cendoient ; félon qu’elles étoient différemment liées ;
félon qu’elles étoient à queue ou fans queue ; félon
que ces queues étoient placées à droite ou à gauche,
afcéndantes ou defeendantes.: enfin,félon un nombre
infini de réglés fi parfaitement ignorées aujourd’hui
, qu’il n’y a peut-être pas un feul muficien
dans tout le royaume de France qui entende cette
partie, & qui foit en état de déchiffrer corre&e-
ment des mufiques de quelque antiquité.
A la traduftion de quelques manuferits de Mu-
fique du xiij. 6c du x iv. fiecle , qu’on fe propofe de
donner bientôt au public, on y joindra un fômmaire
des anciennes réglés de la Mufique, pour mettre
chacun en état de la déchiffrer par foi-même ; c’eft
là qu’on trouvera fuflifamment expliqué tout ce qui
regarde les anciennes ligatures. ( S )
Ligature, (Comm.) petites étoffes de peu de
valeur, de de large, & la piece de jô aunes.
Elles fe fabriquent en Normandie Sc en Flandres.
Les premières font de fil, de lin 6c de laine, 6c les
fécondés toutes de lin : elles font à petits carreaux
ou à grandes couleurs : on les emploie en meubles.
II y a une autre étoffe de même nom qui eft foie
& fil ,jdu refte tout-à-fait femblable à la première.
Ligature , ( Comm. ) noeud qui lie les. maffes de
foie ou celles de fil de chevron. Il faut que la ligature
foit petite. Si elle eft grofle, elle fera fournie de foie
ou de fil de moindre valeur que la maffe, 6c il y aura
du déchet.
Ligature, dans l'Imprimerie, peut fi l’on veut
s’entendre des lettres doubles, voye^ Lettres doubles
; mais il appartient plus pofitivement aux caractères
grecs,. dont quelques-uns liés enfemble don-
Tome IX ,
nent des fyllabes & des mots entiers. Voye^démonllra-
tion de la cafje greque, PL d'imprimerie.
LIGE , adj. ( Jurifpfud. ) fedit de ce qui lié plus
etroitementque les autres.
Fief-lige eft celui pour lequel le vaffal s’oblige de
fervir fon feigneur envers & contre tous. Vaffal lige
eft celui qui poffede un fie f lige; hommage lige eft 1 hommage dû pour un telfief. Voyer Fief-lige &
Hommage-lige. ( A )
LIGÉE, Ligea , ( Géogr. ) île imaginaire,forgée
par Folin, qui dit qu’elle prit ce nom d’une des trois
firenes, dont le corps fut jetté dans cette île. Ligée-
eft à la vérité le nom d’une firene , mais il n’y a point
d’îlequi fe nomme de la forte; aucune des îles Are-
nufesne s’appelle ainfi. Enfin la firene Ligée eut fa
fépulture à Terine, qui eft une ville en terre ferme.
Voyei T erine & SlRENUSES , îles. (Z>. ƒ.)
} L IG E N C E , f. f. ( Gramm. Jurifprud. ) qualité
d’un fiefqu’on tient nûement & fans moyen d’un fei--
gneur dont on devient ainfi homme lige. La ligence
eft aufli le droit du vaffal à l’égard de fon feigneur,1
comme de faire la garde de fon château en tems de
guerre. Un fief de ligence eft celui auquel cette prérogative
eft attachée.
LIGNAGE » ( Jurifprud. ) fignifieen général cognation
, en matière de fuceeffion aux propres, ou de
retrait lignager quand on parle de lignage, on entend
ceux qui font de la même ligne, c’eft-à-dire
d’un même ordre oufuite deperfonnes. Voyc{Ligne.
LIGNE, f. f. ( Géométrie. ) quantité qui n’eft étendue
qu’en longueur, fans largeur ni profondeur.
Dans la nature, il n’y a point réellement de ligne
fans largeur ni même fans profondeur ; mais c’eft par
abftraûion qu’on confidere en Géométrie les lianes
comme n’ayant qu’une feule dimenfion, c’eft-à-dire
la longueur: fur quoi voye^ l'article GÉOMÉTRIE.
On regarde une ligne comme formée par l’écoulement
ou le mouvement d’un point. Voye1 Point.
Il y a deux efpecès'de lignes, les droites 6c les
courbes. Voye^ Droite & C ourbe.
Si le point A fe meut vers B ( PI. géom. fig, 1 ) p
il décrit par ce mouvement une ligne, & s’il va verà
B par le plus1 court chemin , cette ligne fera ùne
i droite. On doit donc définir la ligne droite , la-plus
courte difiance entre deux points. Si le point qui décrit
la ligne, s ’écarte de côté ou d’autre, & qu’il décrive
par exemple ,une des lignes A C B t A c B , i l décrira
ou une ligne courbe, comme A c B , ou bien deux ou
plufieurs droites, comme A C B.
Les lignes droites font toutes de même efpece ;
mais il y a des lignes courbes d’un nombre infini d’ef-
peces. Nous en pouvons concevoir autant qu’il y a
de différens mouvemenscompofés , ou autant qu’on
peut imaginer de différentes lois de rapports entre
les ordonnés & les abfciffes. Yoye^ Courbe.
Les lignes courbes fe divifent ordinairement en
géométriques 6c méchaniques.
Les lignes géométriques font celles dont tous les
points peuvent fe trouver exattement & fûrement.
Voye^ Géométrique & Courbe,
Les lignes méchaniques font celles dont quelques
points, ou tous les points fe trouvent par tâtonnement
, & d’une maniéré approchée, mais non pas
précifément. Voye{ Méchanique & Courbe.
C ’eft pourquoi Defcartes 6c ceux qui fuivent fa
doftrine, définiffent les lignes géométriques ; celles
qui peuvent être exprimées par une équation algébrique
d’un degré déterminé : on donne aufli le nom
de lieu à cette efpece de lignes. Voye{ Lieu.
Et ils définiffent les lignes méchaniques, celles qui
ne peuvent être exprimées par une équation finie ,
algébrique , & d’un degré déterminé.
D ’autres penfent que les lignes que Defcartes ap- ‘ y Y-Y ij