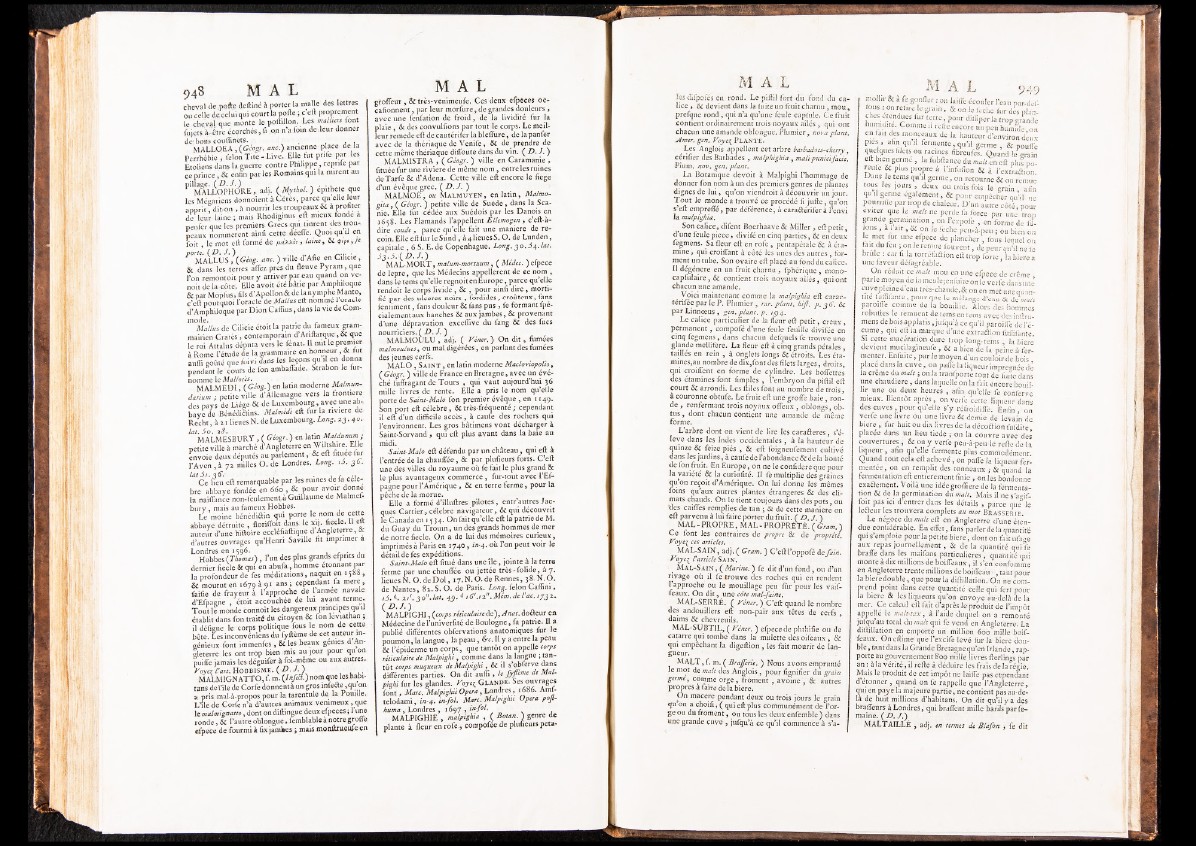
cheval de .pofte deftiné à porter la malle des lettres
ou celle de celui qui court la pofte ; c’eft proprement
le cheval que monte le poftillon. Les mallurs font
fujets ànètre écorchés, fi :Qn n’a foin de .leur donner
de'bons couflinets. " .
MALLOEA, (Gcogr. <z/2C.), ancienne place de là
Perrhébie, fé lo n T ite -L ive . Elle fut pnfe par.les
EtoUens dans la guerre contre Philippe, repriie par
ce prince, &: enfin par les Romains qui la mirent au
pillage. ( 2 ? ./ . ) ,
MALLOPHORE, adj. ( Mythol. ) epithe e que
les Mégariens donnoient à C érès, parce qu elle leur
apprit, dit-on , à nourrir les troupeaux & a profiter
de leur laine ; mais Rhodiginus eft mieux fonde à.
penfer.que les premiers Grecs qui tinrent des trou-,
peaux nommèrent ainfi cette déeffe. Quoi qu il en
f o i t , le mot eft formé de yA?vXov, laine, oC tptpo, je
M ALXUS Géog. anc. ) ville d’Afie en Cilic ie,
& dans les terres affez près du fleuve Pyram, que
l’on remontoit pour y arriver par eau quand on ve-
noit de là côte. Elle avoit été bâtie par Amphiloque
& par Mopfus, fils d’Apollon & de la nymphe Manto,
c ’eft pourquoi l’oracle de Mallus eft nomme 1 oracle
d’Amphiloque par Dion Caflius, dans la vie deCommode.
JH . . »
Mallus de Cilicie étoitla patrie du fameux grammairien
Cratès j contemporain d’Ariftarque, & que
le roi Attalus députa vers le fenat. Il mit le Pr|mV*
à Rome l’ étude de la grammaire en honneur, & fut
auffi goûté que fu i* dans les. leçons*}« .1 en donna
p e n d it le' i u f s de.fon amhàflàde« Strabon le fur-
nomme le MaUotès.
MALMÉDI ( Géog. ) en latin moderne Malmun-
darium ; petite’ville d'Allemagne, vers la frontière
des pays de Liège &.de Luxembourg , avec une ab-,
baye de M Malmidi eft fur la nvtere de
Recht, à z;i lieues N. de Luxembourg. Lang. * 3 .40..
lat. So, 28. S I . , . ,
MALMESBURY, ( Géogr. ) en latin Maldunum,
petite ville û marche d’Angleterre en Wütshire. Elle
envoie deux députés au parlement , •& eft fituee fur
l'A v e n ,à 7 1 milles O. de Londres. Long. l i . 36 .
t o cé'Ueu eft remarquable par les ruines de fa cèle-
bre abbaye fondée en 660 , & pour avoir donne
la nâiffance non-feulement/à Guillaume de Malmei*
burv mais au fameux Hobbes.
Le moine bénédiftin qui porte le nom .de cette
abbaye détruite , floriffoit dans le M ûecle. Il elt
auteur d’une hiftoire eccléfiaftique d’Angleterre, &
d’autres.ouvrages qu’Henri Saville fit. imprimer à
Londres en 1596. 1 c . A
Hobbes (Thomas), l’un des plus grands efpnts du
dernier fiecle & qui en abufa, homme étonnant par
la profondeur de fes méditations , naquit en 158S,
& mourut eh 1679 à 9 1 ans i cependant fa mere,
faifie de frayeur à l ’approche de 1 armee navale
d’Efpagne , étoit accouchée de lui avant terme.
Tout le monde connoît les dangereux principes qu il
établit dans fon traité du citoyen & fon leviathan ;
il défigne le corps politique fous le nom de cette
bête. Les inconvéniens du fyftème de cet auteur ingénieux
font immenfes , & les beaux gemes d Angleterre
les ont trop bien mis au jour pour qu on
puiffe jamais les déguifer à foi-meme ou aux autres.
Voyez Part. HOBBISME. (-2?. / . ) , , .
MALMIGNATTO, f. m. (Infect.') nom que les habi-
tans deHle de Corfe donnentà un gros înfede ,qu on
a pris mal-à-propos pour la tarentule de la rouille.
L’ile de Corfe n’a d’autres animaux venimeux , que
le malmignatto, dont on diftingue deux efpec.es ; 1 une
ronde, & l’autre oblongue, femblable à notre groffe
efpece de fourmi à fix jambes ; mais monfttueufo en
groffeur , & très-venimeufe. Ces deux efpèces oc-
cafionnent, par leur morfure, de grandes douleurs >
avec une fenfation de fro id , de la lividité fur la
plaie, & des convulfions par tout le corps. Le meilleur
remede eft de cautérifer la bleflure, de la panfer
avec de la thériaque de Venife, & de prendre de
cette même thériaque diflbute dans du vin. (D . J . )
MALMISTRA , ( Géogr. ) ville en Caramanie ,
fituée fur une riviere de même nom, entre les ruines
deTarfe & d’Adena. Cette ville èft encore le fiege
d’un évêque grec. (D . J . )
MALMOÉ, ou Malmuyen, en latin , Malmo-
gita 9 ( Géogr. ) petite ville de Suede, dans la Sca-
nie. Elle fut cédée aux Suédois par les Danois en
1658. Les Flamands l’appellent Ellemogen, c’eft-à-
dire coude , parce qu’elle fait une maniéré de re-
coin.-Elle eft fur le Sund, à 4 lieues S. O. de Lunden,
capitale , 6 S. E. de Copenhague. Long. 3 0 .6 4 . lat.
6 3 .6 . (D . J . )
MAL-MORT, malum-mortuum, ( Médec. ) efpece
de lepre, que les Médecins appellerent de ee nom ,
dans le tems qu’elle regnoit en Europe, parce qu’elle
rendoit le corps livide, & , pour ainfi dire, mortifié
par des ulcérés noirs , fordides, croûteux, fans
fentiment, fans douleur & fans pus , fe formant fpé-
cialementaux hanches & aux jambes, & provenant
d’une dépravation exceflive du fang & des fucs
nourriciers. (D . J . ) /
MALMOULU , adj. ( Vlner. ) On d i t , fumees
malmoulues, ou mal.digérées, en parlant des fumées
des jeunes cerfs.
MALO, Saint , en latin moderne Macloviopolis,
( Géogr. ) ville de France en Bretagne, avec un évé-
ché fuffragant de Tours , qui vaut aujourd’hui 36
mille livres de rente. Elle a pris le nom qu’elle
porte de Saint-Malo fon premier évêque , en 1149.
Son port eft célébré, &C très-fréquenté ; cependant
il eft d’un difficile accès, à caufe des rochers qui
l’environnent. Les gros bâtimens vont décharger à
Saint-Sorvand , qui eft plus avant dans la baie au
midi.
Saint-Malo eft défendu par un château, qui eft à
l’entrée de la chauffée, & par plufieurs forts. C’eft
une des villes du royaume où fe fait le plus grand &
le plus avantageux commerce, fur-tout avec l’Efi*
pagne pour l’Amérique, & en terre ferme, pour la
I pêche de la morue.
Elle a formé d’illuftres pilotes, entr’autres Jacques
Cartier, célébré navigateur, & qui découvrit
le Canada en 1534. On fait quelle eft la patrie de M.
du Guay du Trouin, ün des grands hommes de mer
de notre fiecle. On a de lui des mémoires curieux,
imprimés à Paris en 1740, in-4. où l’on peut voir le
détail de fes expéditions.
Saint-Malo eft fitué dans une île , jointe à la terre
ferme par une chauffée ou jettee tres-folide, à 7*
lieues N. O. de D o l, 17. N. O. de Rennes, 38. N. O.
de Nantes, 8z. S. O. de Paris. Long, félon Caffini,
16. d. z i'. 3 0 " .lat. 49. d i6 'jz".Mém.dcl'ac . 1732»
( D . J . )
MALPIGHI, (corps réticulaire àe)9Jnat. dofteur en
Médecine de l’univerfité de Boulogne, fa patrie. Il a
publié différentes obfervations anatomiques fur le
poumon, la langue, la p eau, &c. Il y a entre la peau
& l’épiderme un corps, que tantôt on appelle corps
réticulaire de Malpighi, comme dans la langue ; tantôt
corps muqueux de Malpighi, & il s’obferve dans
différentes parties. On dit auffi , le Jypme de Malpighi
fur les glandes. Voye{ G l a n d e . Ses ouvrages
fo n t, Marc. Malpighii Opéra, Londres, 1686. Amf-
telodami, in-4. in-foL Marc. Malpighi Opéra poji-
huma, Londres , 1697 , in-fol. ,
MALP1GHIE , malpighia , ( Bot an. ) genre de
plante à fleur enrofe., compoféede plufieurs petales
difpofés en rond. Le piftil fort du fond du calice
, ôc devient dans la fuite un fruit charnu , mou,
prefque rond , qui n’a qu’tine feule capfuie. Ce fruit
contient ordinairement trois noyaux aîlés , qui ont
chacun une amande oblongue. Plumier, nova plant.
Amer. gen. Voyc{ PLANTE.
Les Anglois appellent cet arbr0 barbadoes-cherry y
cérifier des Barbades , malphighia , malipunici fade.
Pium. nov. gen. plant.
La Botanique devoit à Malpighi l’hommage, de
donner fon nom à un des premiers genres de plantes
dignes de lu i, qu’on viendroit à découvrir un jour.
Tout le monde a trouvé ce procédé fi jufte, qu’on
s’eft emprefle, par déférence, à caraôérifer à l’envi
la malpighia.
Son calice, difent Boerhaave & Miller , eft petit,
d’une feule piece , divifé en cinq parties, & en deux
fegmens. Sa fleur eft en rofe, pentapétale & à étamine
; qui croiffant à côté les unes des autres , forment
un tube. Son ovaire eft placé au fond du calice.
Il dégénéré en un fruit charnu , fphérique , mono-
capfulaire, & contient trois noyaux aîlés, qui ont
chacun une amande.
I ybici maintenant comme la malpighia eft carac-
-terifee par le P. Plumier , rar. plant, hiß. p. 3 6", &
par Linnoeus , gen. plant, p. 10)4.
Le calice particulier de la fleur eft p e tit, creux,
permanent, compofè d’une feule feuille divifée en
cinq fegmens, dans chacun defquels fe trouve une
glande mellifere. La fleur eft à cinq grands pétales ,
taillés en rein , à onglets longs & étroits. Les étamines,
au nombre de dix,font des filets larges, droits,
qui croiffent en forme de Cylindre. Les boflettes
des étamines font Amples , l’embryon du piftil eft
court & arrondi. Les ftilesfont au nombre de trois,
à couronne obtufe. Le fruit eft une groffe baie, ronde
, renfermant trois noyaux offeux , oblongs, obtus
, dont chacun contient une amande de même
forme.
L’arbre dont on vient de lire les caraéteres, s’élève
dans les Indes occidentales , à la hauteur de
quinze & feize pies , & eft foigneufement cultivé
dans les jardins, à caufe de l’abondance & de la bonté
de fon fruit. En Europe, on ne le confidere que pour
la variété & la curiofité. Il fe multiplie des graines j
qu’on reçoit d’Amérique. On lui donne les mêmes i
foins qu’aux autres plantes étrangères & des cli- j
mats chauds. On le tient toujours dans des pots, ou
'des caiffes remplies de tan ; & de cette maniéré on
eft parvenu à lui faire porter du fruit. (D . J . )
MAL - PROPRE, M AL - PROPRÉTÉ. ( Gram. )
Ce font les contraires de propre & de proprété.
Voye^ ces articles.
MAL-SAIN, adj. ( Gram. ) C’eft l’oppofé de fain.
Voye[ P article Sain.
- ^ Mal-Sain , ( Marine. ) fe dit d’un fond, ou d’un
rivage où il fe trouve des roches qui en rendent
l’approche ou le mouillage peu fur pour les vaif-
feaux. On d it, une côte mal-faine.
MAL-SERRÉ. ( Véner. ) C’eft quand le nombre
des andouillers eft non-pair aux têtes de cerfs ,
daims & chevreuils.
MAL-SUBTIL, ( Véner. ) efpece de phthifie ou de
catarre qui tombe dans la mulette des oifeaux, &
qui empêchant la digeftion, les fait mourir de langueur.
MALT, f. m. ( Brafferie. ) Nous avons emprunté
le mot de malt des Anglois, pour lignifier du grain
germe, comme orge, froment , avoine , & autres
propres à faire de la biere.
On macéré pendant deux ou trois jours le grain
qu on a choifi, ( qui eft plus communément de l’orge
ou du froment, ou tous les deux enfemble ) dans
une grande cuvé , jufqu’à ce qu’il commence à s’amollir
& a re gonfler • pB iaiffe écouler l’eau par-def-
, :.on r,eUre} e Srain . & on le lèche fur des plan-
ches etendues fur te r te ^ o u r diffiper.la trop grande
humidité. Comme il relie encore un.pet. humide,on
en fait des monceaux de la hauteur d’environ deux
■ B n B B B | germe, & pouffe
.quelques filets ou racines fibrenfes. Quand le grain
eft bien germe , la iubftance du malien eft plu? po-
reufe & plus propre à l’mM o n & à l’extraffiSn.
JJans fctetnsqu il germe, on retourne & on remue
tous les jo u rs, deux ou trois fois le .grain , afin
tju il germe egalement, & pour empêcher qu’il ne
poumflè par trop de chaleur. D ’un autre côté nom-
'éviter que le malt ne perde fa force par une trop
grande germination., on l’expofe , en fermé de liions
, à 1 air , & on le feche peu-à-peu ; ou bien on
le met fur une efpece de plancher , feus lequel on
.fait du feu ; on le remue fouvent, de peur qu’il ne fe
brûle : car fi la torrctaélion eft trop forte , la biere a
une laveur dé&gréable. «mere a
On réduit ce malt mou en une efpece de crème
-parie moyen de la meulejenfuite on le verfe dans une
cuyepkined eau très-chaude,& on en met une quan-
tite fuffifante, pour que le mélange d’eau & de malt
paroiffe comme de la bouillie. AlôA des Sommes
robuftes le remuent de temson tems avec des inftru-
rnens de bois applatis, jufqu’à ce qu’il .paroiffe de l’écume
i * t i eft la marque d’une extraffion fuffifante.
Si cette macération dure trop long-tems la biere
devient mucilagineufe, & a bien de 1* peine à fermenter.
Enfume, parlemdyen d’un coiiloirtde bois
placé dans là cuve j on palfe la liqueur imprégnée de
Ba crème du malt ; on la tranfporrè toi» de fume dans
une chaudière, dans laquelle On la fait encore bouillir
uhé ou deux heures j afin qtt’cile fe îonferve
mieux. Bientôt après, on verfe c e tte fia ié iif 'dWs
des cuves ,tpmvr qu’elle, s’y réfroidiffe: Enfin on
verfe une livre ou une livre & demie de levain de
biere , fur huit ou dix livres de la cécociion fuid-ite
-placée dans- un lieu tied'é r- on la couvrê avec des
Couvertures q & on y verfe peu-à-petnlé refte de là
liqueur , afin qu elle fermente plus commodément.
Quand l&kfcela eft achevé j oh pàffe la liqueur fermentée,
on en remplit des BSnneaux ; & quand là
fermentation eft entièrement finie , on les boMbnne
exaSèment. Voilà Une .idée gtoflîére dê la fermentation
& dt la germination du malt. Mais 11 ne s’a"if-
foit pàs Ici d’entrer dans lès -détails , iparce que te
lefleur les trouvera complets au mot Brasserie.
Le négocè du mait eft en Angleterre d’unè-éten-
due confidérable. En effet, fans parlerdelàqûantite
qùîskmpltae pour la petite biere j dont on-fàihifage
aux repas jti.irneilenwnt, & de.la quantité qui ii:
hralfe dans lés incitons particulières quantité qui
monteâdix millionsdëbôiffeaux, il Sfttt cMfomme
en Angleterre trentemillidns deboiffeàu < ,iaktpour
la bieredonble, quepouf la diftillation. On lie com-
iretid point dans cette quantité êeüe qui fert pour
a bie’re & lés liqueurs qu’on envOyeau-ilêlà-de la
mer. Ce calcul éftfait d ’aprèS le produit de l’imjiôf
appelle lé nu/t rax, à l aide duquel on a remonté
jùYqu’aii total du malt qui fc vend en Angleterre. La
diftillation en emporte un million 6ôo mille boii-
feàux. On eftime'què rèxcifè léVé fur'la bieré doiu'
hle, tant dans là Grande Bretagne qu’en Irlande, rapporte
au gouvernement Soo mille livres fterlin»s par
an : à la vérité, i! refte à déduire les frais de la régie.
Mais le produit-de èef-impôt ne làiffepas cependant
d’étonner , quand or. fe rappelle que l’Angleterre,
qui en paye la majeure partie, ne contient pas au-delà
dé huit millions d’habitalis. On dit qu’il y ;a dés
braffeurs à Londres,' qui bràffent mille barils par fe-
maine. ( D. A
MALTAILLÉ , adj. en-termes de Blafon , fe dit