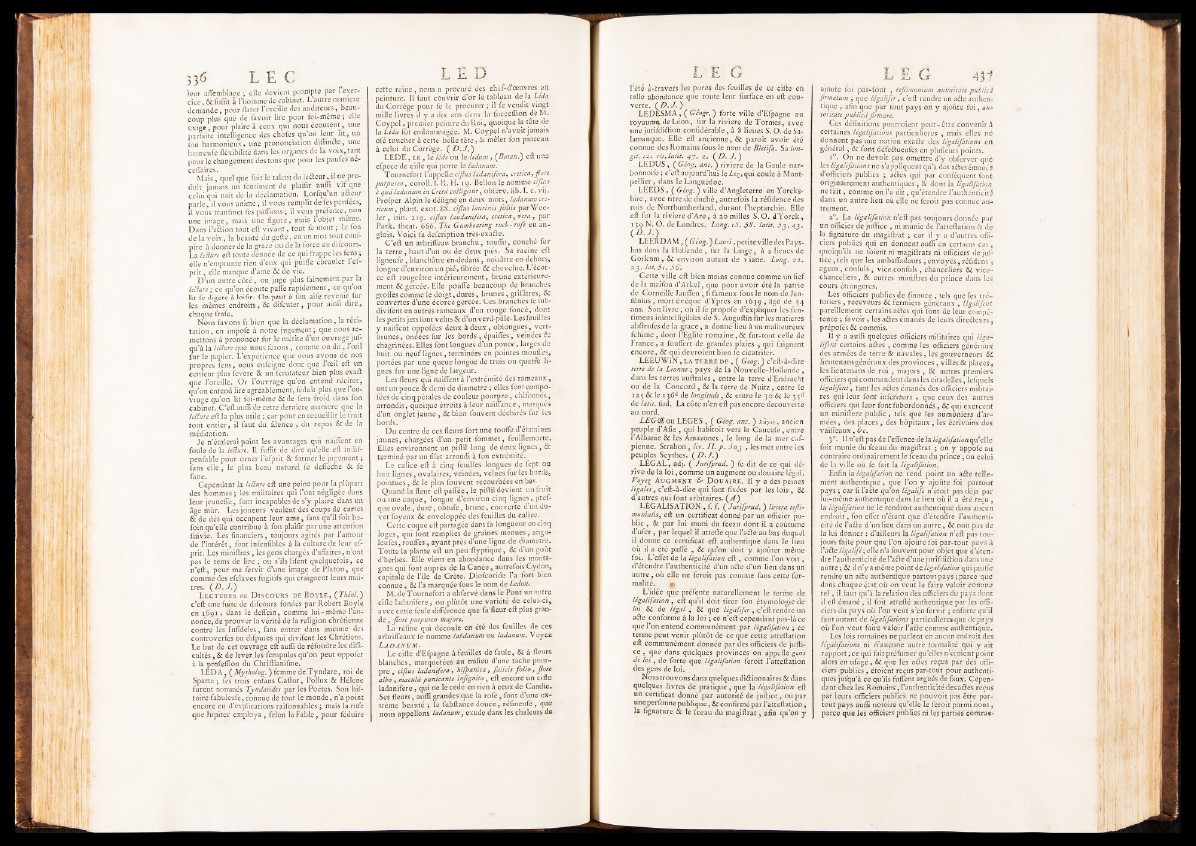
336 L E C
leur affemblage ; elle devient prompte par 1 exercice,
à l’homme de cabinet. L’autre maniéré
demande, pour dater l’oreille des auditeurs, beaucoup
plus que de lavoir lire pour foi-même ; elle
exige, pour plaire à ceux qui nous écoutent, une
parfaite intelligence des chofes qu’on leur lit, un
fon harmonieux, une prononciation diftinde, une
heureufe flexibilité dans les organes de la voix, tant
pour le changement des tons que pour les paufes ne-
ceffaires.
Mais, quel que foit le talent du ledeur, il ne produit
jamais un fentiment de plaifir aufli v if qne
celui qui naît de la déclamation. Lorfqu’un adeur
parle, il vous anime, il vous remplit de fes penfees,
il vous tranfmet fes paliions ; il vous préfente ,^non
une image, mais une figure, mais l’objet même.
Dans l’ action tout eft v iv an t, tout fe meut ; le fon
de la v o ix , la beauté du gelte, en un mot tout conf-
pire à donner de la grâce ou de la force au difcours.
La lecture eft toute dénuée de ce qui frappe les fens ;
elle n’emprunte rien d’eux qui puiffe ébranler l’ef-
p rit, elle manque d’ame & de vie.
D ’un autre cô té, on juge plus fainement par la
lecture; ce qu’on écoute pafle rapidement, ce qu’on
lit fe digéré à loifir. On peut à fon aife revenir fur
les mêmes endroits, & difeuter, pour ainfi dire,
chaque frafe. _ ; .
Nous favons fi bien que la déclamation, la récitation
, en impofe à notre jugement ; que nous remettons
à prono'ncer fur le mérite d’un ouvrage juf-
qu’à la lecture que nous ferons, comme on dit, l’oéil
fiir le papier. L ’expérience que nous avons de nos
propres leris, nous enfeigne donc que l’oeil eft un
cenfeur plus fevère & un ferutateur bien plus exad
que l’oreille. Or l’ouvrage qu’on entend réciter,
qu’on entend lire agréablement, féduit plus que l’ouvrage
qu’on lit foi-même & d e fens froid dans fon
cabinet. C ’eft aufli de cette derniere maniéré que la
lecture eft la plus utile ; car pour en recueillir le fruit
tout entier, il faut du filence, du repos & de la
méditation.
Je n’étalerai point les avantages qui naiffent en
foule de la lecture. Il fuffit de dire qu’elle eft indif-
penfable pour orner l’efprit & former le jugement ;
fans e lle , le plus beau naturel fe defféche & fe
fane.
Cependant la lecture eft une peine pour la plupart
des hommes ; les militaires qui l’ont négligée dans
leur jeuneffe, font incapables de s’y plaire dans un
âge mûr. Les joueurs veulent des coups de cartes,
& de dés qui Occupent leur ame, fans qu’il foit be-
foin qu’elle contribue à fon plaifir par une attention
fuivie. Les financiers, toujours agités par l’amour
de l’intérêt, font infenfibles à la culture de leur ef-
prit. Les miniftres , les gens chargés d’affaires, n’ont
pas le tems de lire ; ou s’ils lifent quelquefois, ce
n’eft, pour me fervir d’une image de Platon, que
comme des efclaves fugitifs qui craignent leurs maîtres.
(JD. J .)
Lectures ou D iscours d e Boyle, (Tkéol.)
c’eft une fuite de difcours fondés par Robert Boyle
en 16 91 , dans le deffein, comme lui-même l’annoncé,
de prouver la vérité de la religion chrétienne
contre les Infidèles, fans entrer dans aucune des
controverfes ou difputes qui divifent les Chrétiens.
Le but de cet ouvrage eft aufli de réfoudre les difficultés
, & de lever les fcrupules qu’on peut oppofer
à la profeflion du Chriftianifme.
LEDA , ( Mytholog. ) femme de Tyndare, roi de
Sparte ; fes trois enfans Caftor, Pollux & Hélene
furent nommés Tyndarides par les Poètes. Son hif-
toire fabuleufe, connue de tout le monde, n’a point
encore eu d’explications raifonnables ; mais la rufe
que Jupiter employa, félon la Fable, pour féduire
cette reine, nous a procuré des chef-d^cettvrès èrt
peinture. Il faut couvrir d’or le tableau de la Leda
du Corrège pour fe le procurer ; il fe vendit vingt
mille livres il y a dix ans dans la fucceflîon de Mi
C oype l, premier peintre du Roi, quoique la tete fié
la Leda fût endommagée. M. Coypel n’avoit jamais
ofé toucher à cette belle tête, & mêler fon pinceau
à celui du Corrège. ( D . J. )
LED E , le , le Ude ou le ledum, (Botan.) eft une
efpece de cifte qui porte le ladanum.
Tournefort l’appelle ciflus ladanifera, cretica, flore
purpureo, coroll. 1. R. H. 19. Bellon le nomme ciflus
è quâ ladanum in Cretâ colligitur, obferv. lib. I. c. vij.
Profper Alpin le défigne en deux mots, ladanum cre-
ticum, plant, exot. 88. ciflus Laurinis foliis p a rV e e -
le r , itin. 219. ciflus laudanifera, cretica, verat par
Park. theat. 666. The Gumbearing rock-rofe en an-
glois. Voici fa defeription très-exade<
C ’eft un arbriffeau branchu, touffu, couche fut
la terre, haut d’un ou de deux pies. Sa racine eft
ligneufe , blanchâtre en-dedans, noirâtre en-dehors,
longue d’environ un pié, fibrée & chevelue. L’ecor-
ce eft rougeâtre intérieurement, brune,extérieurement
& gercée. Elle pouffe beaucoup de branches
groffes comme le doigt, dures, brunes, grifâtres, &
couvertes d’une écorce gercée. Ces branches fe fub-
divifent en autres rameaux d’un rouge foncé, dont
les petits jets font velus & d’un verd-pâle. Les feuilles
y naiffent oppofées deux à d eux, oblongües, vert-
brunes , ondées fur les bords , épaiffes, veinées 6c
chagrinées. Elles font longues d’un pouce, larges de
huit ou neuf lignes, terminées en pointes moufles,
portées par une queue longue de trois ou quatrb lignes
fur une ligne de largeur.
Les fleurs qui naiffent à l’extrémité des rameaux,
ont un pouce & demi de diamètre ; elles font compo-
fées de cinq pétales de couleur pourpre, chifonnés,
arrondis, quoique étroits à leur naiuance, marques
d’un onglet jaune, Scbien fouvent déchires fur les
bordsi1
Du centre de ces fleurs fort une touffe d’étamines
jaunes, chargées d’un petit fommet, feuillemorte.
Elles environnent un piftil long de deux lignes, &
terminé par un filet arrondi à fon extrémité.
Le calice eft à cinq feuilles longues de fept ou
huit lignes, ovalaires, veinées, velues fur les bords,
pointues, & le plus fouvent recourbées en bas.
Quand la fleur eft paffée, le piftil devient un fruit
ou une coque, longue d’environ cinq lignes, pref-
que o vale, dure, obtufe, brune, couverte d’un duvet
foyeux &c enveloppée des feuilles du calice.
Cette coque eft partagée dans fa longueur en cinq
loges, qui font remplies de graines menues, angu-,
leufes, rouffes, ayant près d’une ligne de diamètre.
Toute la plante eft un peu ftyptique, & d’un goût
d’herbes. Elle vient en abondance dans les montagnes
qui font auprès de la C anée, autrefois Cydon,
capitale de l’île de Crète. Diofcoride l’a fort bien
connue, & l’a marquée fous le nom de Ledon.
M. de Tournefort a obfervé dans le Pont un autre
cifte ladanifere, ou plûtôt une variété de celui-ci,
avec cette feule différence que fa fleur eft plus grande
, flore purpureo majore.
La réfine qui découle en été des feuilles de ces
arbriffeaux fe nomme labdanum ou ladanum. Voyez
L a d a n u m .
Le cifte d’Efpagne à feuilles de faille, & à fleurs
blanches, marquetées au milieu d’une tache pourpre
, ciflus ladanifera , hifpanica , falicis folio, flore
albo , macula punicante inflgnito , eft encore un cifte
ladanifere, qui ne le cede en rien à ceux de Candie.
Ses fleurs, aufli grandes que là rofe, font d’une extrême
beauté ; la fubftance douce, réfineufe, que
nous appelions ladanum, exude dans les chaleurs de
L E O
l’été â-tràvéi's lés porës des feuilles de te cifte eft
telle abondance que toute leur furface en eft couverte.
( D .J . )
LEDESMA, ( Géogr. ) forte ville d’ Efpagrie au
royaume de Léon, fur la riviere de Tormés, avec
une jurïfdidion confidérable, à 8 lieues S. O. de Salamanque.
Elle eft ancienne, & paroît avoir été
connue des Romains fous le nom de Bletifa. Sa Ion-
git. 12. lo.latie. 47. 2. (D .J . ')
LEDUS, ( Géog. anc,) riviere de la Gaule nar-
bonnoife ; c’eft aujourd’hui Iele{ ,qu i coule à Montpellier
, dans le Languedoc.
LEEDS, ( Géog. ) ville d’Angleterre en Yorcks-
hire, avec titre de duché, autrefois la réfidence des
rois de Northumberland, durant l’heptarchie. Elle
eft fur la riviere d’A re , à 20 milles S. O. d’Y orck ,
139 N. O. de Londres. Long. i5 . 58. latit. 5 •?. 43.
( D . J . ) J
LEERDAM, ( Géog. ) Lauri, petite ville des Pays-
bas dans la Hollande , fur la Linge, à 2 lieues de
Gorkum, & environ autant de V iane. Long. 22*
23. lat. 5i . 5 6 .
Cette ville eft bien moins connue comme un fief
de la maifon d’Arkel, que pour avoir été la patrie
de Corneille Janffen , fi fameux fous le nom de Jan-
fenius , mort évêque d’Ypres en 1639 » âgé de 54
ans. Son livre, où il fe propofe d’expliquer les fen-
timens inintelligibles de S. Auguftin fur les matières
abftrufes de la grâce, a donné lieu à un malheureux
fehime , dont l’Eglife romaine, & fur-tout celle de
France, a fouffert de grandes plaies , qui faignent
encore, & qui devroient bien fe cicatrifer.
LEEUW1N , la terre de , ( Geog. ) c’eft-à-dire
terre de la Lionne ; pays de la Nouvelle-Hollande ,
dans les terres auftrales , entre la terre d’Endracht
ou de la Concord , 6c la terre de Nuitz, entre le
125 & le 136d de longitude, &c entre le 30 & le 3 ^
de latit. fud. La côte n’en eft pas encore decouverte
au nord.
LEGüEou LEGES , ( Géog. anc. ) tâytt, ancien
peuple d’Afie , qui habitoit vers le Caucafe, entre
l ’Albanie & les Amazones , le long de la mer caf-
pienne. Strabon , liv. I I . p. 5 o3 , les met entre les
peuples Scythes. (D .J . )
LÉG A L , adj. ( Jurifprud. ) fe dit de ce qui dérive
de la lo i, comme un augment ou douaire légal!
Voyc^ Augment 6* Douaire. Il y a des peines
legales, c’eft-à-dirc qui font fixées par les lo is , 6c
d’autres qui font arbitaires. (A )
LÉGALISATION , f. f. ( Jurifprud.X^era tefli-
monialis, eft un certificat donné par un officier public
, & par lui muni du fceau dont il a coûtume
d’ufer, par lequel il attefte que l’ade au bas duquel
il donne ce certificat eft authentique dans le lieu
où il a, été pafle , 6c qu’on doit y ajoûter même
foi. L’effet de la légalifation eft , comme l’on v o it ,
d’étendre l’authenticité d’un a de d’un lieu dans un
autre, où elle ne feroit pas connue fans cette formalité.
«.
L’idée que préfente naturellement le terme de
légalifation, eft qu’il doit tirer fon étymologie de
loi 6c de légal , & que légalifer , c’eft rendre un
ade conforme à la loi ; ce n’eft cependant pas-là ce
que l’on entend communément par légalifation ; ce
terme peut venir plûtôt de ce que cette atteftation
eft communément donnée par des officiers de jufti-
c e , que dans quelques provinces on appelle gens
de lo i , de forte que légalifation feroit l’atteftation
des gens de loi.
Nous trouvons dans quelques didionnaires & dans
quelques livres de pratique, que la légalifation eft
un certificat donné par autorité de juftiee_, ou par
une perfonne publique, & confirmé par l’atteftation,
la fignature & le fceau du magiftrat, afin cpi’on y
L Ë G 4 M
ajoute foi pâf-tÔut , ieflitnônium dut’órita'tè publicà
firmatum ; que légalifer, c’eft rendre un ade authentique
, afin que par tout pays on y ajoûte fo i, au*
toritate publicâ firmare.
Ges définitions pourrôient peut-être convertit à
certaines légalifadohs particulières , mais elles né
donnent pas une notion exade des légalifations en
général, & font défedueufes en plufieurs points.
1°. On ne devoit pas Omettre d’y obferver qué
les légalifations ne s’appliquent qu’à des âdesémanes
d’officiers publics ; a des qui par conféquent font
originairement authentiques * & dont la Légalifation
ne fa it , comme on l’a d it , qu’étendre l’authenticité
dans un autre lieu où elle ne feroit pas connue autrement.
20. La légalifation n’eft pas toujours donnée par
un officier de juftice , ni munie de l’atteftation & dé
la fignature du magiftrat ; car il y a d’autres officiers
publics qui en donnent aufli en certains cas,
quoiqu’ils ne foient ni magiftrats ni officiers de juft
tice ,tels que les ambâfladeurs, envoyés, réfidens ,
agens , confuls , vice-confuls , chanceliers & vice-
chanceliers , & autres miniftres du prince dans les
cours étrangères. '
Les officiers publics de finance , tels que les tré-
foriers , receveurs & fermiers généraux , légalifent
pareillement certains ades qui font de leur compétence
; favoir, les ades émanés de leurs difedeurs,
prépofés & commis.
Il y a aufli quelques Officiers militaires qui iéga-
lifent certains ades , comme les officiers généraux
des armées de terre & navales, les gouverneurs &C
lieutenansgénéraux des provinces, villes & places,
les lieutenans de roi , majors , & autres premiers
officiers qui commandent dans les citadelles, lefquels
légalifent, tant les ades émanés des officiers militaires
qui leur font inférieurs , que ceux des autres
officiers qui leur font fubordonnés, & qui exercent
un miniftére public, tels que les aumôniers d ’ar*
mées, des placés , des hôpitaux, les écrivains des
vaiffeaux, &c.
30. Il n’eft pas de l’èffence de la légalifationqu’elle
foit munie du fceau du magiftrat ; on y appofe au
contraire ordinairement le fceau du prince, ou celui
de la ville où fe fait la légalifation.
Enfin la légalifation ne rènd point un ade tellement
authentique , que l’on y ajoûte foi partout
pays ; car fi l’ade qu’on légalife n’étoit.pâs déjà par
lui-même authentique dans le lieu où il a été reçu,
la légalifation ne le rendroit authentique dans aucun
endroit, fon effet n’étant que d’étendre l’authenticité
de l’afte d’un lieu dans un autre, & non pas de
la lui donner : d’ailleurs là légalifation n’eft pas toujours
faite pour que l’on ajoûte foi par-totit pays à
l’ade légalifé ; elle n’a fouvent pour objet que d’étendre
l’authenticité de l’ade d’une jurifdidiori dans une
autre ; & il n’y a même point de légalifation qui puiffe
rehdre un ade authentique partout pays ; parce que
dans chaque état où on veut le faire valoir comme
t e l , il faut qu’à la relation dés officiers du pays dont
il eft émané , il foit attefté authentique par les officiers
du pays où l’on veut s ’en fervir ; enforte qu’il
faut autant de légalifations particulières qué de pays
où l’on veut faire valoir l’ade comme authentique.
Les lois romaines ne parlent en aucun endroit deâ
légàlifations ni d’aucune autre formalité qui y ait
rapport ; ce qui fait préfumer qu’elles n’étoient point
alors en ufage , & que lès ades reçus par des officiers
publics , étoient rèçus par-tout pour authentiqués
jufqu’à ce qu’ils fiiffent argués de faux.; Cependant
chez les Romains, l’authenticité des ades reçus
par leurs officiers publics ne pouvoit pas être partout
pays aufli notoire qu’elle le feroit parmi nous,
parce que les officiers publics ni les parties contra*-