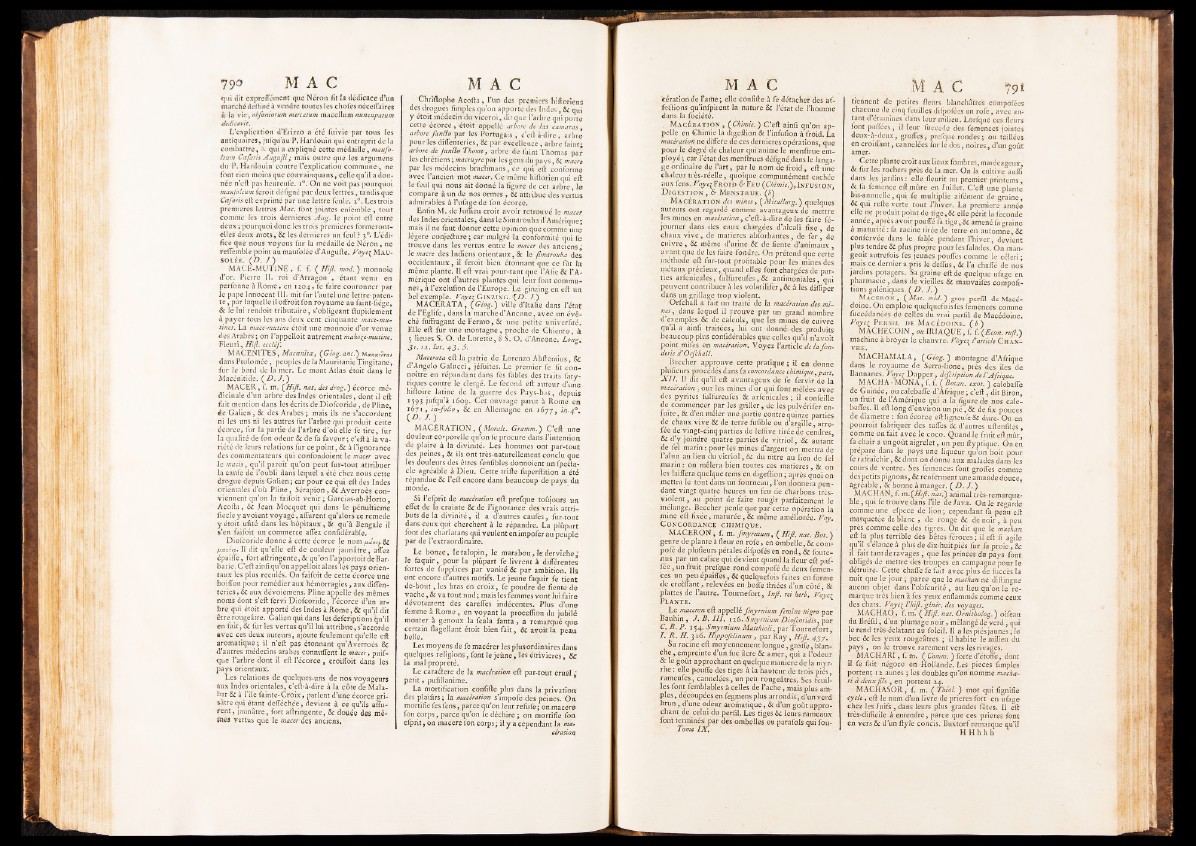
tfiii dit expreffément que Néron fit la dédicace d’un
marché deftiné à vendre toutes les chofes néceffaires
à la vie, obfoniorum mercatum macellum nuncupatum
dtdicavit.
L’explication d’Erizzo a été fui vie par tous les
antiquaires, jufqu’au P. Hardouin qui entreprit de la
combattre, & qui a expliqué cette médaille, maufo-
Itutn Coefaris A ugußi; mais outre que les argumens
du P. Hardouin contre l’explication commune , ne
font rien moins que convainquans, celle qu’il a donnée
n’eft pas heureufe. i°. On ne voit pas pourquoi
m au foie um feroit défigné par deux lettres, tandis que
Goefaris eft exprimé par une lettre feule. i° . Les trois
premières lettres Maà. font jointes enfemble , tout
comme les trois dernieres Aug. le point eft entre
deux ; pourquoi donc les trois premières formeront-
elles deux mots, 6c les dernieres un feul? 30. L’édifice
que nous voyons fur la médaille de Néron, ne
reffemble point au maufolée d’Augufte. Voye{ M a u s
o l é e . (d . j y
MACE-MUTINE, f. f. ( Hiß. mod. ) monnoie
d’or. Pierre If. roi d’Arragon , étant venu en
perfonne à R ome, en 1104, fe faire couronner par
le pape Innocent III. mit fur l’autel une lettre-patente
, par laquelle il offroit fon royaume au faint-fiége,
& le lui rendoit tributaire, s’obligeant ftupidement
à payer tous les ans deux cent cinquante mace-mu-
tines. La mace mutine étoit une monnoie d’or venue
des Arabes; on l’appelloit autrement maho^e-mutine.
Fleuri, Hiß. ecclêf.
MACÉN1T E S , Macoenitoe, (Géog.anc.) 1/laKa.nrai
dans Ptolomée, peuples de la Mauritanie Tingitane,
fur le bord de la mer. Le mont Atlas étoit dans le
Macénitide. ( D . J. )
MACER, f. m. (Hiß. nat, des drog.') écorce médicinale
d’un arbre des Indes orientales, dont il eft
fait mention dans les écrits de D iofcoride, de Pline,
de Galien, & des Arabes ; mais ils ne s’accordent
ni les uns ni les autres fur l’arbre qui produit cette
écorce, fur la partie de l’arbre d’oit elle fe tire, fur
la qualité de fon odeur 6c de fa faveur ; c’eft à la variété
de leurs relations fur ce point, 6c à l’ignorance
des commentateurs qui confondoient le macer avec
le macis, qu’il paroît qu’on peut fur-tout attribuer
la caufe de l’oubli dans lequel a été chez nous cette
drogue depuis Galien ; car pour ce qui eft des Indes
orientales d’où Pline, Sérapion, & Averroès conviennent
qu’on la faifoit venir ; Garcias-ab-Horto,
Acofta, & Jean Mocquet qui dans le pénultième
fiecle y avoient voyagé, affurent qu’alors ce remede
y étoit ufité dans les hôpitaux, & qu’à Bengale il
s’en faifoit un commerce affez confidérable.
Diofcoride donne à cette écorce le nom pari*} 6c
PayJip. II dit qu’elle eft de couleur jaunâtre, affez
épaiffe, fort aftringente, & qu’on l’apportoit de Barbarie.
C ’eft ainfi qu’on appelloit alors les pays orientaux
les plus reculés. On faifoit de cette écorce une
boiffon pour remédier aux hémorragies , aux diffen-
teries, 6c aux dévoiemens. Pline appelle des mêmes
noms dont s’eft fervi Diofcoride, l’écorce d’un arbre
qui étoit apporté des Indes à Rome, 6c qu’il dit
être rougeâtre. Galien qui dans les deferiptions fyu’il
en fait, & fur les vertus qu’il lui attribue, s’accorde
avec ces deux auteurs, ajoute feulement qu’elle eft
aromatique; il n’eft pas étonnant qu’Averroès &
d’autres médecins arabes connuffent le macer, puif-
que l’arbre dont il eft l’écorce, croiffoit dans les
pays Orientaux.
Les relations de quelques-uns de nos voyageurs
aux Indes orientales, c’eft-à-dire à la côte de Malabar
& à Pile fainte-Croix, parlent d’une écorce grisâtre
qui étant defféchée, devient à ce qu’ils affurent,
jaunâtre, fort aftringente, 6c douée des mê-
îfnes vertus que le macer des anciens.
Chriftophe Acofta , l’un des premiers hiftoriens
des drogues fimples qu’on apporte des Indes, 6c qui
y étoit médecin du viceroi, dit que l’arbre qui porte
cette écorce, étoit appelle arbore de las camatas,
arbore fanclo par les Portugais , c’eft-à-dire, arbre
pour les diffenteries, 6c par excellence , arbre faint;
arbore de Janclo Thome, arbre de faint Thomas par
les chrétiens ; macruyre par les gens du pays, 6c macro
par les médecins brachmans, ce qui eft conforme
avec l’ancien mot macer. Ce même hiftorien qui eft
le féal qui nous ait donné la figure de cet arbre, le
compare à un de nos ormes, 6c attribue des vertus
admirables à l’ufage de fon écorce.
Enfin M. de Juflieu croit avoir retrouvé le macer
des Indes orientales, dans leSimarouba d’Amérique;
mais il ne faut donner cette opinion que comme une
légère conjeâure ; car malgré la conformité qui fe
trouve dans les vertus entre le macer des anciens,'
le macre des Indiens orientaux, & le fimarouba des
occidentaux, il feroit bien étonnant que ce fut la
même plante. Il eft vrai pour-tant que l’Afie 6c l’Amérique
ont d’autres plantes qui leur font communes
, a l’exclufion de l’Europe. Le ginzing en eft un
bel exemple. Voye^ G in z in g . \D . J.)
MACERATA, ( Géog.) ville d’Italie dans l’état
de l’Eglife, dans la marche d’Ancone, avec un évêché
fuffragant de Fermo , & une petite univerfiré.'
Elle eft fur une montagne, proche de Chiento, à
5 lieues S. O. de Lorette, 8 S. O. d’Ancone. Long;
3 i. iz . lat. 43 . 5.
Macerata eft la patrie de Lorenzo Abftemius, 6c
d’Angelo Galucci, jéfuites. Le premier fe fit con-
noître en répandant dans fes fables des traits faty-
riques contre le clergé. Le fécond eft auteur d’une
hiftoire latine de la guerre des Pays-bas, depuis
1593 jufqu’à 1609. Cet ouvrage parut à Rome en
16 7 1 , in-folio y 6c en Allemagne en 16 7 7 , in-4°.
(£ > .ƒ .) *
MACÉRATION, ( Morale. Gramm.) C ’eft une
douleur corporelle qu’on fe procure dans l’intention
de plaire à la divinité.:, Les hommes ont par-tout
des peines, & ils ont très-naturellement conclu que
les douleurs des êtres fenfibles donnoient un fpeéla-
cle agréable à Dieu. Cette trifte fuperftition a été
répandue 6c l’eft encore dans beaucoup de pays du
monde.
Si l’efprit de macération eft prefque toujours un
effet de la crainte 6c de l’ignorance des vrais attributs
de la divinité, il a d’autres caufes, fur-tout
dans ceux qui cherchent à le répandre. La plupart
font des charlatans qui veulent en impofer au peuple
par de l’extraordinaire.
Le bonze, letalopin, le marabou, le derviche ;
le faquir, pour la plûpart fe livrent à différentes
fortes de fupplices par vanité 6c par ambition. Ils
ont encore d’autres motifs. Le jeune faquir fe tient
de-bout ,les bras en croix, fe poudre de fiente de
vache, & va tout nud ; mais les femmes vont lui faire
dévotement des careffes indécentes. Plus d’une
femme à Rome , en voyant la proceflïon du jubilé
monter à genoux la fcala fanta , a remarqué que
certain flagellant étoit bien fait, 6c avoir la peau
belle.
Les moyens de fe macérer les plusordinaires dans
quelques religions, font le jeûne, les étrivieres, 6c
la mal propreté.
Le cara&ere de la macération eft par-tout cruel J
petit, pufillanime.
La mortification confifte plus dans la privation
des plaifïrs ; la macération s’impofe des peines. On
mortifie fes fens, parce qu’on leur refufe; on macéré
fon corps, parce qu’on le déchire ; on mortifie fon
efprit, on macéré fon corps ; il y a cependant la macération
C^ratioride Partie; elle cônfifte à fe détacher des af-
ferions qu’infpirent la nature 6c l’état de l’homme
dans la fociété.
. M a c é r a t i o n , {Chimie. ) C ’eft ainfi qu’on appelle
en Chimie la digeftion & l’infufion à frôid. La
macératioA ne diffefe de ces dernieres opérations, que
pour le degré de chaleur qui anime le menftrue employé
; car l’état,des menftrues défigné dans le langage
ordinaire de l’art -, par le nom de froid, eft une
chaleur très-réelle, quoique communément cachée
aux fens. VoyefpKOïTt & Fe u (Chimie.), In f u s i o n ,
D i g e s t i o n , & M e n s t r u e . (b)
M a c é r a t i o n des mines-, (Métallurg.) quelques
auteurs ont regardé comme avantageux de mettre
•les mines en macération, c’eft-à-dire de les faire fé-
jpurner dans des eaux chargées d’alcali fixe , de
chaux v iv e , de matières ablbrbantes, de f e r , de
cu ivre, 6c même d’urine 6c de fiente d’animaux,
avant que de les faire fondre. On prétend que cette
méthode eft fur-tout profitable pour lés mines des
piétaux-précieux, quand elles font chargées de parties
arfenieales, fulfureufes, 6c antimoniales, qui
peuvent contribuer à les volatilifer, & à les difliper
dans un grillage trop violent.
Orfchall a fait un traité de la macération des mines,
dans lequel il prouve par un grand nombre
d’exemples 6c de calculs, que les mines de cuivre
qu’il a ainfi traitées, lui ont donné des produits
beaucoup plus confidérables que celles qu’il n’avoit
point mifes en macération. Voyez l’article de la fonderie
d" Orfchall.
Beccher approuve cette pratique ; il en donne
plufieiirs procédés dans fa concordance chimique, part.
X I I . Il dit qu’il eft avantageux de fe fervir de la
macération pour les mines d’or qui font mêlées avec
des pyrites fulfureufes & arfenieales ; il confeille
de commencer par les griller, de les pulvérifer en-
fuite, & d’en mêler une partie contre quinze parties
de chaux vive 6c de terre fufible ou d’argille arro-
fée de vingt-cinq parties de lelfive tirée de cendres,
& d’y joindre quatre parties de vitriol, 6c autant
de fel marin : pour les mines d’argent on mettra de
l’alun au lieu du v itrio l, 6c du nitre au lieu de fel
marin : on mêlera bien toutes ces matières, & on
les laiffera quelque tems en digeftion ; après quoi on
mettra le tout dans un fourneau, l’on donnera pendant
vingt quatre heures un feu de charbons très-
violent , au point de faire rougir parfaitement le
mélange. Beccher penfe que par cette opération la
mine eft fixée, maturée, 6c même améliorée. Voy.
C o n c o r d a n c e c h i m i q u e .
M AGERON, fi m. fmyrmum, ( Hiß. nat. Bot. )
genre de plante à fleur en rofe, en ombelle, 6c com1
pofé de plufieurs pétales difpofésen rond, & foute-
«us par un calice qui devient quand la fleur eft paf-
fé e , un fruit prefque rond compofé de deux feinendes
un peu épaiffes, 6c quelquefois faites en forme
de erohîànt, relevées en boffe ftriées d’un côté, &
plattes de l’autre. Tournefort, Infi, rei herb. Voy er
P l a n t e .
Le maceron eft appellé fmyrnium femine nigro par
Èauhin , J. B. I II. 126. Smyrnium Diofcoridis, par
C. B. P. 1 54. Smyrnium Mattkioli, par Tournefort,
I . R. H.y\6. Hippofelinum , par R a y , Hiß. ,43 y.
oa racine eft moyennement longue, greffe, blanche
, empreinte d’un fuc âcre & amer, qui a l’odeur
& le goût approchant en quelque maniéré de la myrrhe
: elle pouffe des tiges à la hauteur de trois piés,
rameufes, cannelées, un peu rougeâtres. Ses feuilles
font femblables à celles de l’ache, mais plus amples,
découpées en fegmens plus arrondis, d’un verd
brun, d’une odeur aromatique, & d’un goût approchant
de celui du perfil. Les tiges 6c leurs rameaux
font termines; par des ombelles ou parafols qui fou-
' Tome I X .
tiennent de petites fleurs blanchâtres cômpofées
chacune de cinq feuilles difpofées en rofe, avec autant
d’étamines dans leur milieu. Lorfque ces fleurs
font paffées, il leur fûccede des femenceS jointes
deux-à-deux, groffes; prefque rondes; ou taillées
en crôiffant, cannelées fur le doS, noires, d’un goût
amer.
Cette plante croît aux lieux fombres, marécageux,
& fur les rochers près de la, mer. On la cultive auffi
dans les jardins : elle fleurit au premier printems ;
& fa femence eft mûre en Juillet. C ’eft une plante
bis-annuelle, qui fe multiplie aifément de graine,
6c qui refte verte tout l’hiver. La première année
elle lie produit point de t ig e ,& elle périt la fécondé
annee ,• après avoir pouffé fa tige, 6c amené fa graine
à maturité: fa racine tirée de terre en automne, 6c
confervée dans le fab/e pendant l’hiver, devient
plus tendre 6c plus propre pour les falades. On man-
geqit autrefois fes jeunes pouffes comme le céleri;
mais ce dernier a pris le deffus, & l ’a chaffé de nos
jardins potagers. Sa graine eft de quelque ufage en
pharmacie , dans de vieilles & mauvaifes comportions
galéniques.,( D . J. )
M a c e r o n , ( Mat. méd. ) gros perfil de Macédoine.
Oh emploie quelquefois fes femences comme
fuccédanées çle celles du vrai perfil de Macédoine;
Voyt{ Pe r s i l d e M a c é d o in e , ( b )
MACHÈCOIN, ou IRIAQUE, fi f. (.Econ; ruß.)
machine à broyer le chanvre. Vàye^ P article C h a n -
VRE.
MACHAMALA, ( Géog. ) montagne d’Afrique
dans le royaume de Serra-Iione, près des îles de
Bannanes. Voye{ Dapper, dfeription de P Afrique.
MACHA-MONA, f. f. (Botan. exot. ) calebaffe
de Guinée, pu calebaffe d’Afrique ; c’e f t , dit Biron,
un früit de r Amérique qui a la figure de nos cale-
baffes. Il eft long d’environ un pié, & de fix pouces
de diamètre : fon écorce eftligneufeôc dure. On en
pourroit fabriquer des taffes 6c d’autres uftenfiles,
comme on fait avec le coco. Quand le fruit eft mûr,
fa chair a un goût aigrelet, un peu ftyptique. Ôn en
prépare dans le pays une liqueur qu’on boit pour
fe rafraîchir, 6c dont on donne aux malades dans les
cours de ventre. Ses femences font groffes comme
des petits pignons, & renferment une amande douce,
agréable, & bonne à manger. ( D . J .)
MACHAN, f. m .(Hiß. nat.) animal très-remarquable
, qui fe trouve dans l’ilé de java. On le regarde
comme une efpece de lion ; cependant fa peau eft
marquetée de blanc , de rouge 6c de noir, à peu
près comme celle des tigres. On dit que le machan
eft la plus terrible des bêtes féroces ; il eft fi agile
qu’il s’élance à plus de dix-huit piés fur fa proie , &
il Fait tant de ravages , que les prinées du pays font
obligés de mettre des troupes en campagne pour le
détruire. Cette chaffe fe fait avec plus de fuccès la
nuit que le jour ; parce que le machan ne diftingüé
aucun objet dans l’ôbfcuritë , au lieu qu’on le remarque
très bien à fes yeux enflammés comme ceux
des chats. Voyeç Phiß. génér. des voyages.
MACHAO, f. m. ( Hiß. nat. Ornilkolôg. ) ôifeau
du Bréfil, d’un plumage noir, mélangé de verd, qui
le rend très-éclatant aü foleil. Il a les piés jaunes ; le
bec 6c les yeux rougeâtres ; il habite le milieu du
pays , on le trouve rarement vers les rivages.
MACHARI, fi m. ( Comm. ) fortè d’étoffe, dont
il fe fait négoce en-Hollande. Les pièces fimples
portent 12 aunes ; les doubles qu’on nomme macha-
ri à deuxfils , en portent 24;
MACHASOR, f. m. ( Tkéol. ) mot qui fignifie
cycle, eft le nom d’un livre de prières fort en ufage
chez les Juifs , dans leurs plus grandes fêtes. Il eft
très-difficile à entendre, parce que ces prières font
en vers 6c d’un ftyle concis. Buxtorf remarque qu’il
H H h h h