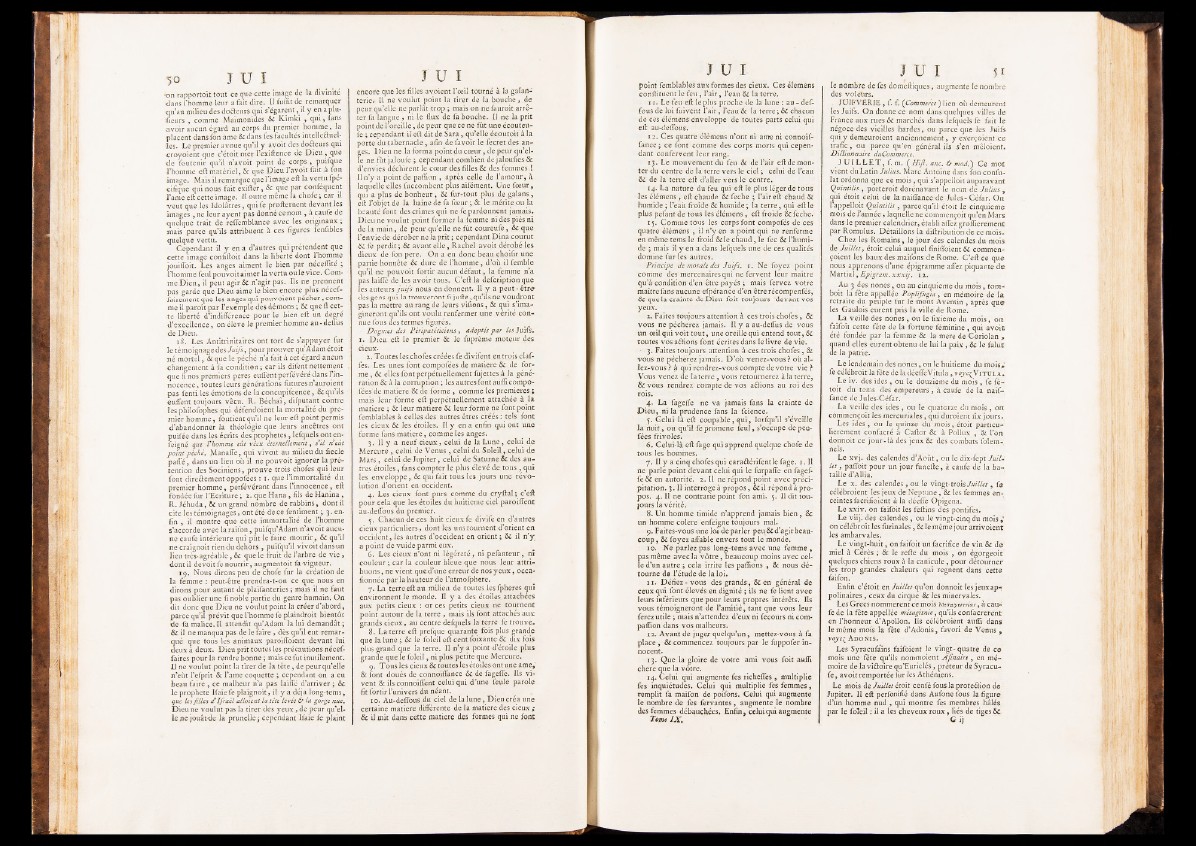
<on rapportent tout ce que cette image de la divinité
edans l’homme leur a fait dire. 11 fuffit de remarquer
qu’au milieu des dofteurs qui s’égarent, il y en a plusieurs
, comme Maïmonides & Kimki , q ui, fans
•avoir aucun égard au corps du premier homme, la
placent dans fon ame & dans fes facultés intellectuelles.
Le premier avoue qu’il y avoit des dofteurs qui
•croyoient que c’étoit nier l’exiftence de Dieu , que
de foutenir qu’il n’a voit point de corps , puifque
l’homme eft matériel, & que Dieu l’avoit fait à fon
image. Mais il remarque que l’image eft la vertu fpe-
cifique qui nous fait exifter, & que par confequent
l’ame eft cette image; Il outre même la chofe ; car il
veut que les Idolâtres, qui fe proiternent devant les
images , ne leur ayent pas donné ce nom , à caufe de
'quelque trait de reffemblance avec les originaux ;
mais parce qu’ils attribuent à ces figures fenfibles
quelque vertu.
Cependant il y en a d’autres qui prétendent que
cette image confiftoit dans la liberté dont l’homme
jouiflbit. Les anges aiment le bien par neceflite ;
l’homme feul pouvoit aimer la vertu ou le vice. Comme
Dieu, il peut agir & n’agir pas. Ils ne prennent
pas garde que Dieu aime le bien encore plus necef-
fairement que les anges qui pouvoient pécher, comme
il paroît par l’ exemple des démons ; & que fi cette
liberté d’indifférence pour le bien eft un degre
d’excellence, on éleve le premier homme au-deffus
de Dieu.
18. Les Antitrinitaires ont tort de s’appuyer fur
le témoignage des Juifs, pour prouver qu’Adam étoit
né mortel, & que le péché n’a fait à cet égard aucun
changement à fa conditi®n ; car ils difent nettement
que fi nos premiers peres euffent perfévéré dans l’innocence
, toutes leurs générations futures n’auroient
pas fenti les émotions de la concupifcence, & qu’ils
euffent toujours vécu. R. Béchaî, difputant contre
les philofophes qui défendoient la mortalité du premier
homme, foutient qu’il ne leur eft point permis
d’abandonner la théologie que leurs ancêtres ont
puifée dans les écrits des prophètes, lefquels ont en-
feiané que Ühomme eût vécu éternellement, s'il rJeût
point péché. Manaffe, qui vivoit au milieu du fiecle
paffé, dans un lieu où il ne pouvoit ignorer la prétention
des Sociniens, prouve trois chofes qui leur
font directement oppofées : i. que l’immortalité du
premier homme, perfévérant dans l’innocence , eft
fondée fur l ’Ecriture ; 1. que Hana, fils de Hanina,
R. Jéhuda, & un grand nombre de rabbins, dont il
cite les témoignages, ont été de ce fentiment ; 3. enfin
, il montre que cette immortalité de l’homme
s’accorde avec larailon, puifqu’Adam n’avoit aucune
caufe intérieure qui pût le faire mourir 9 & qu’il
ne craignoit rien du dehors , puifqu’il vivoit dans un
lieu très-agréable, & que le fruit de l’arbre de vie ,
dont il devoitfe nourrir, augmentoit fa-vigueur.
19. Nous dirons peu de chofe fur la création de
la femme : peut-être prendra-t-on ce que nous en
dirons pour autant de plaifanteries ; mais il ne faut
pas oublier une fi noble partie du genre humain. On
dit donc que Dieu ne voulut point la créer d’abord,
parce qu’il prévit que l’homme fe plaindroit bientôt
de fa malice. Il attendit qu’Adam la lui demandât ;
& il ne manqua pas de le faire, dès qu’il eut remarqué
que tous les animaux paroiffoient devant lui
deux à deux. Dieu prit toutes les précautions nécef-
faires pour la rendre bonne ; mais ce fut inutilement.
Il ne voulut point la tirer de la tête, de peur qu’elle
n’eût l’efprit & l’ame coquette ; cependant on a eu
beau faire , ce malheur n’a pas laiffé d’arriver ; &
le prophète Ifaïefe plaignoit, il y a déjà long-tems,
que les filles d’Ifraél alloient la tête levée & la gorge nue.
Dieu ne voulut pas la tirer des y e u x , de peur qu’elle
ne jouât-de la prunelle; cependant Ilaïe fe plaint
encore que les filles avoient l’oeil tourné à la galanterie*
Il ne voulut point la tirer de la bouche, de
peur qu’elle ne parlât trop ; mais on ne fauroit arrêter
fa langue , ni le flux de fa bouche. Il ne la prit
point de l’oreille, de peur que ce ne fût une écouteu-
fe ; cependant il eft dit de Sara, qu’elle écoutoit à la
porte du tabernacle, afin de favoir le fecret des anges.
Dieu ne la forma point du coeur, de peur qu’elle
ne fût jaloufe ; cependant combien de jaloufies &
d’envies déchirent le coeur des filles & des femmes,!
Il n’y a point de paffion , après celle de l’amour, à
laquelle elles fuccombent plus aifément. Une foeur,
qui a plus de bonheur, & fur-tout plus de galans,
eft l’objet de la haine de fa foeur ; & le mérite ou la
beauté font des crimes qui ne fie pardonnent jamais.
Dieu ne voulut point former la femme ni des piés ni
de la main, de peur qu’elle ne fût coureufe, & que
l’envie de dérober ne la prît ; cependant D ina courut
& fe perdit ; & avant elle , Rachel avoit dérobé les
dieux de fon pere. On a eu donc beau choifir une
partie honnête & dure de l’homme, d’où il femble
qu’il ne pouvoit fortir aucun défaut, la femme n’a
pas laiffé de les avoir tous. C ’eft la defeription que
les auteurs juifs nous en donnent. Il y a peut - être
des gens qui la trouveront fi jufte, qu’ils ne voudront
pas la mettre au rang de leurs vifions, & qui s’imagineront
qu’ils ont voulu renfermer une vérité connue
fous des termes figurés.
Dogmes des P éripatéticiens, adoptés par /«Juifs.
1. Dieu eft le premier & le fuprème moteur des
cieux.
2. Toutes les chofes créées fe divifent en trois claf-
fes. Les unes font compofées de matière & de forme
, & elles font perpétuellement fujettes à la génération
& à la corruption ; les autres font aulîi compo-
fées'de matière & de forme , comme les premières ;
mais leur forme eft perpétuellement attachée à la
matière ; & leur matière & leur forme ne font point
femblables à celles des autres êtres créés : tels font
les cieux & les étoiles. Il y en a enfin qui ont une
forme fans matière, comme les anges.
3. Il y a neuf cieux, celui de la Lune, celui de
Mercure , celui de Venus , celui du Soleil, celui de
Mars, celui de Jupiter, celui de Saturne & des autres
étoiles, fans compter le plus élevé de tous , qui
les enveloppe, & qui fait tous les jours une révolution
d’orient en occident.
4. Les cieux font purs comme du cryftal; c’eft
pour cela que les étoiles du huitième ciel paroiffent
au-deffous du premier.
5. Chacun de ces huit cieux fe divife en d’autres
cieux particuliers, dont les uns tournent d’orient en
occident, les autres d’occident en orient ; &c il n’y,
a point de vuide parmi eux.
6. Les cieux n’ont ni légéreté, ni pefanteur, ni
couleur ; car la couleur bleue que nous leur attribuons
, ne vient que d’une erreur de nos y e u x , occa-
fionnée par la hauteur de l’atmofphere.
7. La terre eft au milieu de toutes les fpheres qui
environnent le monde. Il y a des étoiles attachées
aux petits cieux : or ces petits cieux ne tournent
point autour de la terre , mais ils font attachés aux
grands cieux, au centre defquels la terre fe trouve.
8. La terre eft prefque quarante fois plus grande
que la lune ; & le foleil eft cent foixante & dix fois
plus grand que la terre. Il n’y a point d’étoile plus
grande que le foleil, ni plus petite que Mercure.
9. Tous les cieux & toutes lesétoiles ont une ame,'
& font doués de connoiffance & de fageffe. Ils vivent
& ils connoiflent celui qui d’une feule parole
fit fortir l’univers du néant.
10. Au-deffous. du ciel de la lune, Dieu créa une
certaine matière différente de la matière des cieux ;
& ü mit dans cette matière des formes qui ne font
point femblables aux formes des cieux. Ces élemens
conftituent le feu , l’a ir , l’eau & la terre.
11. Le feu eft lé plus proche de la lune : au - def-
fous de lui fuivent l’air, l’eau & la terre ; & chacun
de ces élémens enveloppe de toutes parts celui qui
eft au-deffous.
12. Ces quatre élémens n’ont ni ame ni connoiffance
; ce font comme des corps morts qui cependant
confervent leur rang.
13. Le mouvement dii feu & de l’air eft de monter
du centre de la terre vers le ciel ; celui de l’eau
& de la terre eft d’aller vers le centre.
14. La nature du feu qui eft le plus léger de tous
les élémens, eft chaude & feche ; l’air eft chaud &
humide ; l’eaii froide & humide ; la terre, qui eft le
plus pefant de tous les élémens, eft froide & feche.
15. Comme tous les corps font compofés de ces
quatre élémens , il n’y en a point qui ne renferme
en même tems le froid & le chaud, le fec & l’humide
; mais il y en a dans lefquels une de ces qualités
domine fur les autres.
Principe de morale des Juifs. 1. Ne foyez point
comme des mercenaires qui ne fervent leur maitre
qu’à condition d’en être payés ; mais fervez votre
maître fans aucune efpérance d’en être récompenfés,’
& que la crainte de Dieu foit toujours 'devant vos
yeux.
2. Faites toujours attention à ces trois chofes, &
vous ne pécherez jamais. Il y a au-deffus de vous
un oeil qui voit tout, une oreille qui entend tout, &
toutes vos actions font écrites dans le livre de vie.
3. Faites toujours attention à ces trois chofes, &
vous ne pécherez jamais. D ’où venez-vous ? où allez
vous ? à qui rendrez-vous compte de votre vie ?
Vous venez de la terre , vous retournerez à la terre,
& vous rendrez compte de vos aâions au roi des
rois.
4. La fageffe ne va jamais fans la crainte de
D ie u , ni la prudence fans la fcience.
5. Celui là eft coupable, q ui, lorfqu’il s’éveille
la nuit, ou qu’il fe promene feul, s’occupe de peu-
fées frivoles.
6. Celui-là eft fage qui apprend quelque chofe de
tous les hommes.
7 . Il y a cinq chofes qui cara&érifentle fage. 1. Il
ne parle point devant celui qui le furpaffe en fageffe
& en autorité. 2. Il ne répond point avec précipitation.
3. Il interroge à propos, & i l répond à propos.
4. Il ne contrarie point fon ami. 5. Il dit toujours
la vérité.
8. Un homme timide n’apprend jamais bien, &
un homme colere enfeigne toujours mal.
9. Faites-vous une loi de parler peu & d’agir beaucoup
, & foyez affable envers tout le monde.
10. Né parlez pas long-tems avec une femme ,
pas même avec la v ô tre , beaucoup moins avec celle
d’un autre ; cela irrite les pallions , & nous détourne
de l’étude de la loi.
1 1. D éfiez -vous des grands, & en général de
ceux qui font élevés en dignité ; ils ne fe lient avec
leurs inférieurs que pour leurs propres intérêts. Ils
vous témoigneront de l’amitié, tant que vous leur
ferez utile ; mais n’attendez d’eux ni fecours ni com-
pafiion dans vos malheurs.
12. Avant de juger quelqu’un, mettez-vous à fa
p la c e , & commencez toujours par le fuppofer innocent.
13. Que la gloire de votre ami vous foit aulfi
chere que la vôtre.
14. Celui qui augmente fes richeffes , multiplie
fes inquiétudes. Celui qui multiplie fes femmes,
remplit fa maifon de poifons. Celui qui augmente
le nombre de fes fervantes, augmente le nombre
des femmes débauchées. Enfin, celui qui augmente
Tome IX ,
le nombre de fes doineftiques, augmente le nombre
des volehrs.
JUIFVERIE, f. f. (Commerce) lieu où demeurent
les Juifs. On donne ce nom dans quelques villes de
France aux rues & marchés dans lefquels fe fait le
, négoce des vieilles hardes, ou parce que les Juifs
qui y demeuroient anciennement, y exerçoient ce
trafic, ou parce qu’en général ils s’en mêloient.
Dictionnaire duÇommerce.
J U I L L E T , f. m. ( Hifi. anc. & modj) Ce mot
vient du Latin Julius. Marc Antoine dans fort confu-
lat ordonna que ce mois, qui s’appelloit auparavant
Quintilis , porteroit dorénavant le nom de Julius ,
qui étoit celui de la naiffance de Jules-Céfar. On
l’appelloit Quintilis , parce qu’il étoit le cinquième
mois de l’année, laquelle ne commençoit qu’en Mars
dans le premier calendrier, établi affez groffierement
par Romulus. Détaillons la diftribution de ce mois.
Chez les Romains, le jour des calendes du mois
de Juillet, étoit celui auquel finiffoient & commen-
çoient les baux des maifons de Rome. C ’eft ce que
nous apprenons d’une épigramme affez piquante de
Martial, Epigram. x x x ij. 12.
Au 3 des nones, ou au cinquième du mois, tom*
boit la fête appellée Poplifugia, en mémoire de la
retraite du peuple fur le mont Aventin , après que
les Gaulois eurent pris la ville de Rome.
La veille des nones , ou le fixieme du mois, ott
faifoit cette fête de la fortune féminine , qui avoic
été fondée par la femme & la mere de Coriolan ,
quand elles eurent obtenu de lui la paix , & le falut
de la patrie.
Le lendemain des nones, ou le huitième du mois,'
fe célébroit la fête de la déeffeVitula, voye^ V it u l a .
Le iv. des ides , ou le douzième du mois , fe fè-
toit du temS des empereurs, à caufe de la naiffance
de Jules-Céfar.
La veille des ides , ou le quatorze du mois , on
commençoit les mercuriales, qui duroient fix jours.
Les ides, ou le quinze du mois, étoit particulièrement
confacré à Gaftor & à Pollux , & l’on
donnoit ce jour-là des jeux & des combats folem-
nels.
Le xvj. des calendes d’Aou t, ou le dix-fept Juillet
, paffoit pour un jour funefte, à caufe de la bataille
d’Allia.
Le x. des calendes, ou le vingt-trois Juillet, f«
célébroient les jeux de Neptune, & les femmes enceintes
fa crifioient à la déeffe Opigena.
Le xxiv. on faifoit les feftins des pontifes.
Le viij. des calendes , ou le vingt-cinq du mois
on célébroit les furinales, & le même jour arrivoient
les ambarvales.
Le vingt-huit, on faifoit un facrifice de vin & de
miel à Cérès ; & le refte du mois , on égorgeoic
quelques chiens roux à la canicule, pour détourner
les trop grandes chaleurs qui régnent dans cette
faifon.
Enfin c’étoit en Juillet qu’on donnoit les jeuxap-
polinaires, ceux du cirque & les mineryales.
Les Grecs nommèrent ce mois Mvrttytnvicùv, à eau-'
fe de la fête appellée métagitnie, qu’ils confacrereftt
en l’honneur d’Apollon. Ils célébroient aufti dans
le même mois la fête d’Adonis, favori de Venus ,
voye^ Adon is.
Les Syracufâins faifoient le vingt-quatre de ce
mois une fête qu’ils nommoient Afinaire , en mémoire
de la victoire qu’Euriclés, préteur de Syracu-
f e , avoit remportée fur les Athéniens.
Le mois de Juillet étoit cenfé fous la protection de
Jupiter. Il eft perfonifié dans Aufone fous la figure
d’un homme nud , qui montre fes membres hâlés
par le fôîeil ; il a les cheveux roux, liés de tiges 8c
G i j