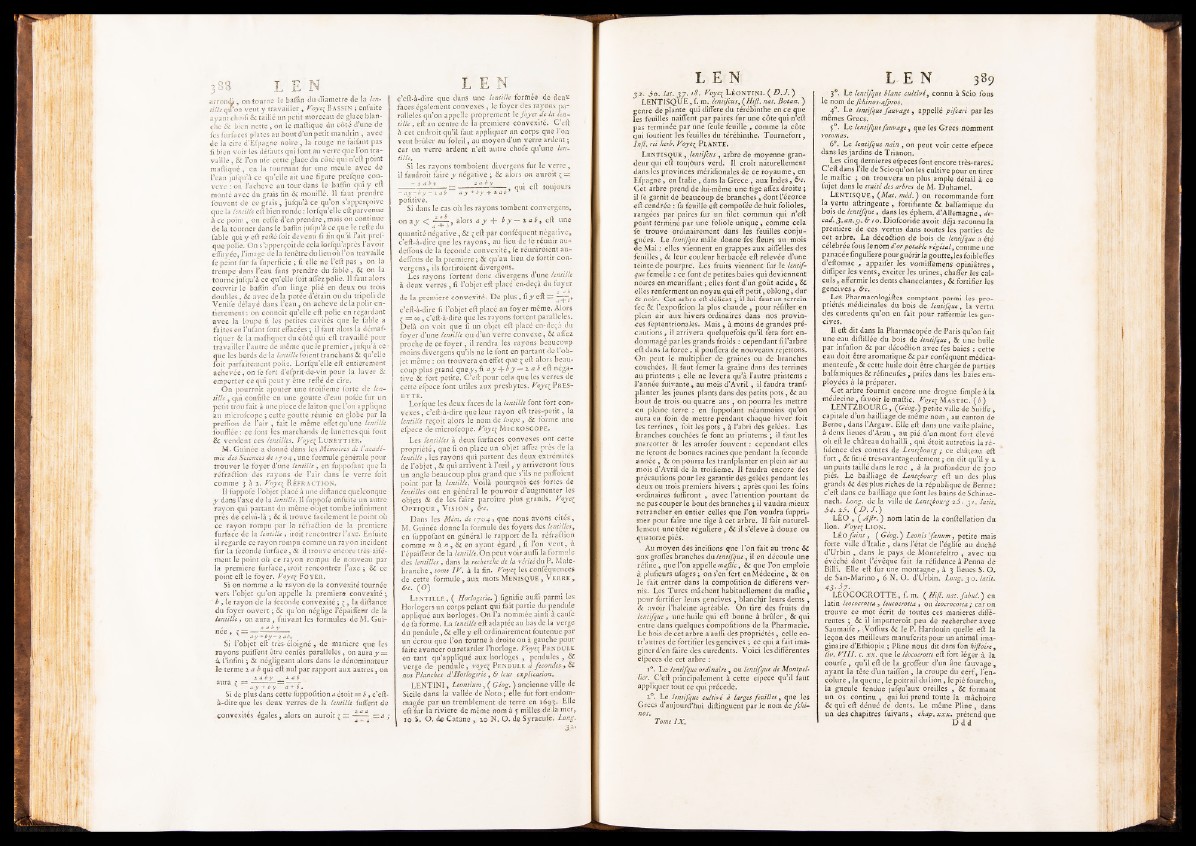
388 L E N
arrondi, on tourne le baflin du diamètre de la lentille
qu’on veut y travailler , Voye{ Bassin ; enfuite
ayant choifi & taillé un petit morceau de glace blanche
& bien nette , on le maftique du côté d’une de
tes furfaces plates au bout d’un petit mandrin , avec
de la cire d’Efpagne noire , la rouge ne faifant pas
fi bien voir les défauts qui font au verre que l’on travaille
, & l’on ufe cette glace du côté qui n’eft point
maftiqné , en la tournant fur une meule avec de
l’eau jufqu’à ce qu’elle ait une figure prefque convexe
: on l’acheve au tour dans le baflin qui y eft
monté avec du grais fin & mouillé. Il faut prendre
fouvent de ce grais, jufqu’à ce qu’on s’apperçoive
que la lentille eft bien ronde : lorfqu’elle eft parvenue
à ce point, on cefl'e d’en prendre, mais on continue
de la tourner dans le baflin jufqu’à ce que le refte du
fable qui y eft refté foit devenu fi fin qu’il l’ait prefque
polie. On s’apperçoit de celalorfqu’après l’avoir
eflùyée, l’image delà fenêtre du lieu où l’on travaille
fe peint fur fa fuperficie ; fi elle ne l’eft pas , on la
trempe dans l’eau fans prendre du fable, & on la
tourne jufqu’à ce qu’elle foit allez polie. Il faut alors
couvrir le baflin d’un linge plié en deux ou trois
doubles, & avec de la potée d’étain ou du tripoli de
Venife délayé dans l’eau , on achevé de la polir entièrement
: on connoît qu’elle eft polie en regardant
avec la loupe fi les petites cavités que le fable à
faites en l’ufant font effacées ; il faut alors la démaf-
tiquer & la maftiquer du côté qui eft travaillé pour
travailler l’autre de même que le premier, jufqu’à ce •
que les bords de la lentille foient tranchans & qu’elle
foit parfaitement polie. Lorfqu’elle eft entièrement
achevée, on fe fert d’efprit-de-vin pour la laver &
emporter ce qui peut y être refté de cire.
On pourroit ajouter une troifieme forte de lentille
, qui eonfifte en une goutte d’eau pofée fur un
petit trou fait à unepiece de laiton que l’on applique
au microfcope ; cette goutte réunie en globe par la
preflion de l’air , fait le même effet qu’une lentille
foufflée : ce font les marchands de lunettes qui font
& vendent ces lentilles. Voyc{ Lu net tier.
M. Guinée a donné dans les Mémoires de l'académie
des Sciénces de 1704, une formule générale pour
trouver le foyer d’une lentille , en fuppofant que la
réfraftion des rayons de l’air dans le verre foit
comme 3 à z. Voyei Ré fr a c t io n .
Il fu p p o fe l ’o b je t p la c é à u n e d ifta n c e q u e lc o n q u e
y d an s l’ a x e d e la lentille. I l fu p p o fe e n fu ite u n a u t r e
r a y o n q u i p a r ta n t du m êm e o b je t tom b e in fin im en t
p r è s d e c e lu i- là ; & il t r o u v e fa c ilem e n t le p o in t o ù
c e r a y o n rom p u p a r la r é f r a d io n d e la p rem iè r e
fu r fa c e de la lentille, ir o i t r en c o n t r e r l ’ a x e . E n fu ite
i l r e g a rd e c e r a y o n r om p u com m e u n r a y o n in c id e n t
fu r la fé c o n d é fu r f a c e , & il t r o u v e e n c o r e trè s -a ifé -
m e n t le p o in t o ù c e r a y o n r om p u d e n o u v e a u p a r
la p r em iè r e fu r f a c e , ir o i t r e n c o n t r e r l ’a x e ; & c e
point- e ft le f o y e r . Voye^ F o y e r .
Si on nomme a le rayon de la convexité tournée
vers l’objet qu’on appelle la première convexité ;
' b , le rayon de la fécondé convexité ; ç , la diftance
du foyer ouvert ; & qu’on néglige l’épaiffeur de la
lentille , on aura , fuivant les formules de M. Gui-
/ 2 a b y nee , z = --------- -—
ay + b y - za b .
Si 1 objet eft très-éloigné , de mamere que les
rayons puiflent être cenfés parallèles, on aura y =
à l’infini ; & négligeant alors dans le dénominateur
le terme z a b qui eft nul par rapport aux autres, on
2 a b y 1 a b .
aura { = '
Si de plus dans cette fuppofition a étoit = b, c’eft-
à-dire que les deux verres de la lentille fuffent de
convexités égales, alors on auroit { = ------ ,== a ;
L E N
c’eft-à-dire que dans une lentille formée de deux
faces également convexes , le foyer des rayons parallèles
qu’on appelle proprement le foyer de là Un-
tille , eft au centre de la première convexité. C’efl
à cet endroit qu’il faut appliquer un corps que l’on
veut brûler au foleil, au moyen d’un verre ardent.;
car un verre ardent n’eft autre chofe qu’une lentille.
Si les rayons tomboient divergens fur le verre ,
il faudroit faire y négative ; & alors on auroit ç =
-------- -— - , qui eft toujours
— a y — b y — 1 a b a y + b
pofitive.
Si dans le cas où les rayons tombent convergens,
on a j , alors a y b y — z a b , eft une
quantité négative, & ^eft par conféquent négative,
c’eft-à-dire que les rayons, au lieu de fe réunir au-
deffous de la fécondé convexité, fe réuniroient au-
deflous de la première ; & qu’au lieu de fortir convergens
, ils fortiroient divergens.
Les rayons fortent donc divergens d’une lentille
à deux verres , fi l’objet eft placé en-deçà du foyer
de la première convexité. De p l u s , f i j e f t = f f b 7
c’eft-à-dire fi l’objet eft placé au foyer même. Alors
^ = 00, c’eft-à-dire que les rayons fortent parallèles.
Delà on voit que fi un objet eft placé en-deçà du
foyer d’une lentille ou d’un verre convexe, & allez
proche de ce fo y e r , il rendra les rayons beaucoup
moins divergens qu’ils ne le font en partant de l’obr-
jet même : on trouvera en effet que [ eft alors beaucoup
plus grand quey, fi uy-\- b y — z a b eft négative
& fort petite. C ’eft pour cela que les verres de
cette efpece font utiles aux presbytes. Voye{ Pres-
b y t e .
Lorfque les deux faces de la lentille font fort convexes
, c’eft-à-dire que leur rayon eft très-petit, .la
lentille reçoit alors le nom de loupe, & forme une
efpece de microfcope. Voye[ Microscope.
Les lentilles à deux furfaces convexes ont cette
propriété, que fi on place un objet allez près de la
lentille , les rayons qui partent des deux extrémités
de l’o bjet, & qui arrivent à l’oe il, y arriveront fous
un angle beaucoup plus grand que s’ils ne paffoient
point par la lentille. Voilà pourquoi ces fortes de
lentilles ont en général le pouvoir d’augmenter les
objets & de les faire paroître plus grands. Voy»{
Optique , Vision , &c.
Dans les Mém. de 1704, que nous avons cités,
M. Guinée donne la formule des foyers des lentillesy
en fuppofant en général le rapport de la réfraction
comme m à n , & en ayant égard , fi l’on v eu t, à
l’épaiffeur de la lentille. On peut voir aufli la formule
des lentilles, dans la recherche de la vérité du P. Maie-
branche , tome IV. à la fin. Voye£ les conféquences
de cette formule, aux mots Ménisque , Verre ,
bc- ( ° ) ■ v- .
L entille , ( Horlogerie. ) lignifie aufli parmi les
Horlogers un corps pefant qui fait partie du pendule
appliqué aux horloges. On l’a nommée ainfi à caufe
de fa forme. La lentille eft adaptée au bas de la verge
du pendule, & elle y eft ordinairement foutenue par
un écrou que l’on tourne à droite ou à gauche pour
faire avancer ou retarder l’horloge. Voye^ Pendule
en tant qu’appliqué aux horloges , pendules , &
verge de pendule, voye^ Pendule à fécondés, &
. nos Planches d'Horlogerie , & leur explication.
LENTINI, Leontium, ( Géog. ) ancienne v ille de
Sicile dans la vallée de Noto ; elle fut fort endommagée
par un tremblement de terre en 1693- Elle
eft fur la riviere de même nom à 5 milles de la mer,
10 S. O. de Catane ,, zo N. O. de Syracufe. Long.
JJ1'
L E N
3 o. la t.3 7 . 18. Voye{ LÉONTINI. ( D .J .)
LENTISQUE, f. m. lenifcusy (Hijl. nat. Botan. )
genre de plante qui différé du térébinthe en ce que
les feuilles naiflent par paires fur une côte qui n’eft
pas terminée par une feule feuille , comme la côte
qui foutient les feuilles du térébinthe. Tournefort,
In fl. rei herb.Voyeç P LANTE.
Lentisque , lentifcus , arbre de moyenne grandeur
qui eft toujôurs verd. Il croît naturellement
dans les provinces méridionales de ce royaume, en
Efpagne, en Italie, dans la Grece , aux Indes, &c.
Cet arbre prend de lui-même une tige allez droite ;
il fe garnit de beaucoup de branches, dont l’écorce
eft cendrée : fa feuille eft compofée de huit folioles,
rangées par paires fur un filet commun qui n’eft
point terminé par une foliole unique, comme cela
fe trouve ordinairement dans les feuilles conjuguées.
Le lentifque mâle donne fes fleurs au mois
de Mai : elles viennent en grappes aux aiffelles des
feuilles, & leur couleur herbacée eft relevée d’une
teinte de pourpre. Les fruits viennent fur le lentifque
femelle : ce font de petites baies qui deviennent
noires en meuriflant ; elles font d’un goût acide, &
elles renferment un noyau qui eft petit, oblong, dur
& noir. Cet arbre eft délicat ; il lui faut un terrein
fec Si. l’expofition la plus chaude , pour réfifter en
plein air aux hivers ordinaires dans nos provinces
feptentrionales. Mais , à moins de grandes précautions
, il arrivera quelquefois qu’il fera fort endommagé
par les grands froids : cependant fi l’arbre
eft dans fa force, il pouffera de nouveaux rejettons.
On peut le multiplier de graines ou de branches
couchées. Il faut femer la graine dans des terrines
au printems ; elle ne lèvera qu’à l’autre printems :
l ’année fuivante, au mois d’Avril , il faudra tranf-
planter les jeunes plants dans des petits pots, & au
bout de trois ou quatre ans , on.pourra les mettre
en pleine terre : en fuppofant néanmoins qu’on
aura eu foin de mettre pendant chaque hiver foit
les terrines, foit les pots , à l’abri des gelées. Les
branches couchées fe font au printems ; il faut les
marcotter & les arrofer fouvent : cependant elles
ne feront de bonnes racines que pendant la fécondé
année , & on pourra les traniplanter en plein air au
mois d’Avril de la troifieme. Il faudra encore des
précautions pour les garantir des gelées pendant les
deux ou trois premiers hivers ; après quoi les foins
ordinaires fuffiront , avec l’attention pourtant de
ne pas couper le bout des branches ; il vaudra mieux
retrancher en entier celles que l’on voudra fuppri-
mer pour faire une tige à cet arbre. Il fait naturellement
une tête régulière, & il s’élève à douze ou
quatorze piés.
Au moyen des incifions que l ’on fait au tronc &
aux grofîes branches du lentifque, il en découle une
réfine, que l’on appelle majlic, & que l’on emploie
à plufieurs ufages ; on s’en fert en Médecine, & on
le fait entrer dans la compofition de différens vernis.
Les Tur.cs mâchent habituellement du maftic,
pour fortifier leurs gencives , blanchjr leurs dents ,
& avoir l’haleine agréable. On tire des fruits du
lentifque , une huile qui eft bonne à brûler, & qui
entre dans quelques compofitions de la Pharmacie.
Le bois de cet arbre a aufli des propriétés, celle en-
tr’autres de fortifier les gencives ; ce qui a fait imaginer
d’en faire des curedents. Voici les différentes
efpeces de cet arbre :
i°. Le lentifque ordinaire, ou lentifque de Montpellier.
C’eft principalement à cette elpece qu’il faut
appliquer tout ce qui précédé.
20. Le lentifque cultivé à larges feuilles, que les
Grecs d’aujourd’hui diftinguent par le nom de fehi-
nos.
Tome IX.
L E N 389
3®. Le lentifque blatte cultivé, connu à Scio fous
le nom de fehinos-afpros.
40. Le lentifque fauvage , appellé pifeari par les
mêmes Grecs.
5 . Le lentifque fauvage j que les Grecs nomment
votomas.
6°. Le lentifque nain, on peut voir cette efpece
dans les jardins de Trianon.
Les cinq dernieres efpeces font encore très-rares;
C ’eft dans l’île de Scio qu’on les cultive pour en tirer
le maftic ; on trouvera un plus.ample détail à ce
fujet dans le traité des arbres de M. Duhamel.
Lentisque, {Mat. méd.~) on recommande fort
la vertu aftringente , fortifiante & balfamique du
bois de lentifque, dans les épliem. d’Allemagne, de-
cad.s.an.cf . &10. Diofcoride avoit déjà reconnu la
première de ces vertus dans toutes les parties de
cet arbre. La décoftion de bois de lentifque a été
célébrée fous le nom d'or potable végétal, comme une
panacée finguliere pour guérir la goutte, les foiblefles
d^eftomac , appaifer les vomiffemens opiniâtres,
difliper les vents, exciter les urines, chafler les calculs
, affermir les dents chancelantes, & fortifier les
gencives, &c.
Les Pharmacologiftes comptent parmi les propriétés
médicinales du bois de lentifque, la vertu
des curedents qu’on en fait pour raffermir les gencives.
Il eft dit dans la Pharmacopée de Paris qu’on fait
une eau diftillée du bois de Lentifque, & une huile
par infufion & par décoâion avec fes baies : cette
eau doit être aromatique & par conféquent médica-
menteufe, & cette huile doit être chargée de parties
balfamiques & réfineufes , prifes dans les baies employées
à la préparer.
Cet arbre fournit encore une drogue firtiple à la
médecine, favoir le maftic. Voyeï Mastic, (b )
LENTZBOURG, ( Géog.) petite ville de Suilfe,
capitale d’un bailliage de même nom, au canton de
Berne, dans l’Argaw. Elle eft dans une vafte plaine,
à deux lieues d’Arau , au pié d’un mont fort élevé
où eft le château du bailli, qui étoit autrefois la ré-
fidence des comtes de Lentftourg ; ce château eft
fo r t , & fitué très-avantageufement ; on dit qu’il y a
un puits taillé dans le roc , à la profondeur de 300
piés. Le bailliage de Lentçbourg eft un des plus
grands & des plus riches de la république de Berne:
c’eft dans ce bailliage que font les bains de Schinze-
nach. Long, de la ville de Lent^bourg xS. 21. latit.
64. z 5 . {D . J.')
LÉO , ( Aflr, ) nom latin de la conftellation du
lion. Voye[ Lion.
LÉO faint t ( Géog. ) Leonis 'fanum , petite mais
forte ville d’Italie , dans l’état de l’églife au duché
d’Urbin , dans le pays de Montefeltro , avec un
évcché dont l’évêque fait fa réfidence à Penna de
Billi. Elle eft fur une montagne, à 3 lieues S. O.
de San-Marino, 6 N. O. d’Urbin. Long. 7 o. latit.
4 3 -£ 7 -
LÉO CO CRO TTE , f. m. ( Hijl. nat.fabu(.') en
latin leococrotta , leucocrotta, ou leocrocotta; car on
trouve ce mot écrit de toutes ces maniérés différentes
; & il importeroit peu de rechercher avec
Saumaife, •Voflius & le P. Hardouin quelle eft la
leçon des meilleurs manuferits pour un animal imaginaire
d’Ethiopie ; Pline nous dit dansfon hifloire9
liv. VIII. c. x x . que le léococrotte eft fort léger à la
courfe , qu’il eft de la groffeur d’un âne fauvage ,
ayant la tête d’un taiffon , la croupe du cerf, l'encolure
, la queue, le poitrail du lion, le pié fourchu,
la gueule fendue jufqu’aux oreilles , & formant
un os continu , qui lui prend toute la mâchoire
& qui eft dénué de dents. Le même Pline , dans
un des chapitres fuivans, chap. x x x . prétend que
D d d