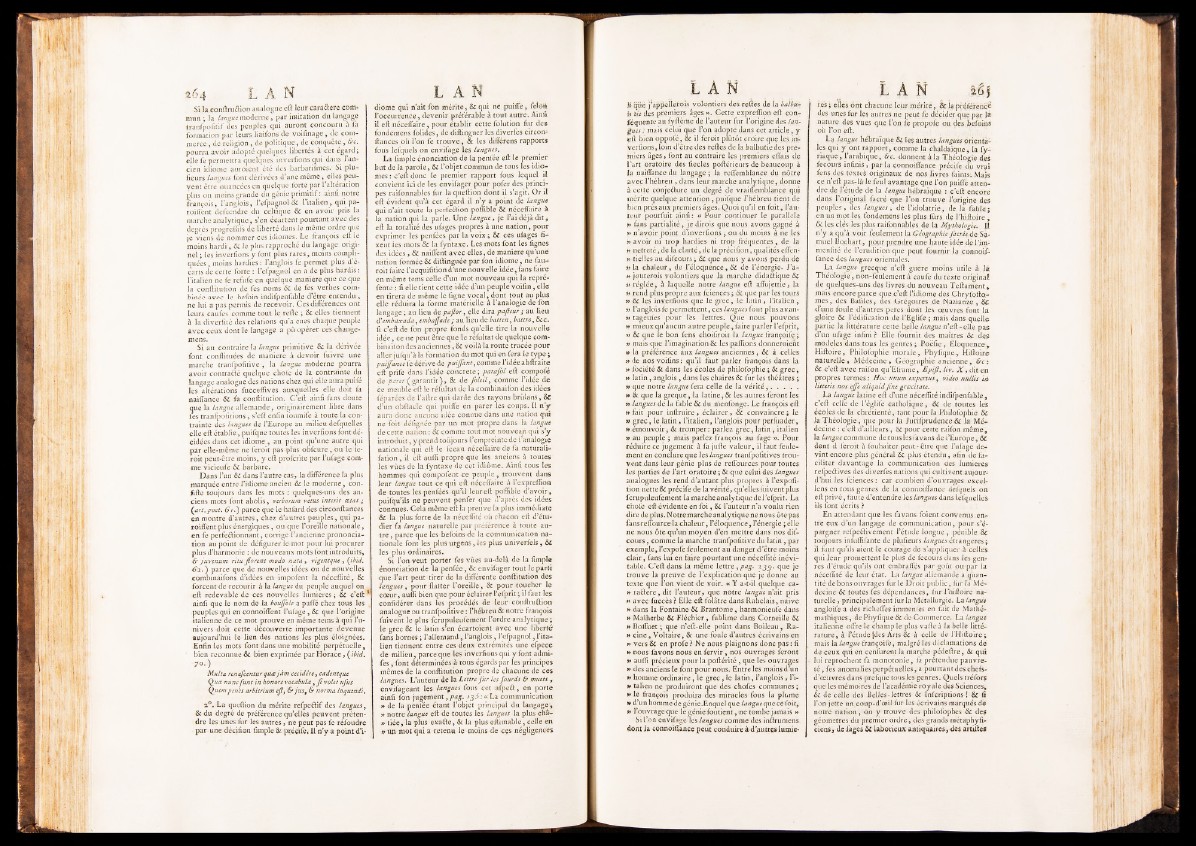
Si la conftruélion analogue eft leur caraftere Coiti*
rnun ; la langue moderne, par imitation du langage
tranfpofitif des peuples qui auront concouru à fa
formation par leurs liaifons de voifinage, de commerce
, de religion, de politique, de conquête, &c.
pourra avoir adopté quelques libertés à cet egard;
elle fe permettra quelques inverfions qui dans l’ancien
idiome auroient été des barbariimes. Si plu-
lieurs langues font dérivées d’une meme, elles peuvent
être nuancées en quelque forte par l’alteration
plus ou moins grande du génie primitif : ainli notre
françois, l’anglois, l’efpagnol & l’italien, qui pa-
roifl'ent defeendre du celtique 6c en avoir pris la
marche analytique, s’en écartent pourtant avec des
degrés progreflifs de liberté dans le même ordre que
je viens de nommer ces idiomes. Le françois eft le
moins hardi, 6c le plus rapproché du langage originel
; les inverfions y font plus rares, moins compliquées,
moins hardies : l’anglois fe permet plus cl e-
carts de cette forte : l’efpagnol en a de plus hardis :
l’italien ne fe refufe en quelque maniéré que ce que
la conftitution de fes noms 6c de fes verbes combinée
avec le befoin indifpenfable d’être entendu,
ne lui a pas permis de recevoir. Ces différences ont
leurs caufes comme tout le refte ; 6c elles tiennent
à la diverfité clés relations qu’a eues chaque peuple
avec ceux dont le langage a pu opérer ces change-
mens.
Si au contraire la langue primitive 6c la dérivée
font conftituées de maniéré à devoir fuivre une
marche tranfpofitive , la langue moderne pourra
avoir contrarié quelque choie de la contrainte du
langage analogue des nations chez qui elle aurapuifé
les altérations fucceffives auxquelles elle doit fa j
naiffance 6c fa conftitution. C ’eft ainfi fans doute I
que la langue allemande, originairement libre dans
les tranfpofitions, s’eft enfin foumife à toute la contrainte
des langues de l’Europe au milieu defquelles
elle eft établie, puifque toutes les inverfions font décidées
dans cet idiome , au point qu’une autre qui
pâr elle-même ne feroit pas plus obfcure, ou le le-
roit peut-être moins, y eft proferite par l’ufage comme
vicieufe & barbare.
Dans l’un 6c dans l’autre cas, la différence la plus
marquée entre l’idiome ancien 6c le moderne, concilie
toujours dans les mots : quelques-uns des anciens
mots font abolis, verborum vêtus interit oetas ;
(art.poet. 6 1.) parce que le hafard des circonftarices
en montre d’autres, chez d’autres peuples, qui pa-
roiffent plus énergiques, ou que l’oreille nationale,
en fe perfectionnant, corrige l’ancienne prononciation
au point de défigurer le mot pour lui procurer
plus d’harmonie : de nouveaux mots font introduits,
& juvenum ritu jlorent modo nata, vigentque , (ibid.
6 a .) parce que de nouvelles idées ou de nouvelles
combinaifons d’idées en impofent la nécefîité, &
forcent de recourir à la langue du peuple auquel on
eft redevable de ces nouvelles lumières; 6c c’e ft1
ainfi que le nom de la boujfole a pafl'c chez tous les
peuples qui en connoiffent l’ufage, 6c que l ’origine
italienne de ce mot prouve en même tems à qui l’univers
doit cette découverte importante devenue
aujourd’hui le lien des nations les plus éloignées.
Enfin les mots font dans une mobilité perpétuelle,
bien reconnue 6c bien exprimée par Horace , {Jibid.
7 ° * )
Multa renafeentur qute jàm cecidêre, cadentque
Qjmz nunefunt in honorevocabula, Ji volet ufus
Qiiem pénis arbitrium cjl, &just & norma loquendi.
i ° . La queftion du mérite refpeftif des langues,
& du degré de préférence qu’elles peuvent prétendre
les unes fur les autres, ne peut pas fe refoudre
par une décifion fimple & précife, Il n’y a point d’idiomc
qui n’ait fon mérite, 6c qui hé puifle, feldti
l’occurrence, devenir préférable à tout autre. Ainfi
il eft néceflaire, pour établir cette folution fur des
fondemens folides, de diftinguer les diverfes circom
ftances où l’on fe trouve, & les différens rapports
fous lefquels on envifage les langues.
La fimple énonciation de la penfée eft le premier
but de la parole, 6c l’objet commun de tous les idiomes
: c’eft donc le premier rapport fous lequel il
convient ici de les envifager pour pofer des principes
raifonnables fur la queftion dont il s’agit. Or il
eft évident qu’à cet égard il n’y a point de langue
qui n’ait toute la perfe&ion poflible 6c néceflaire à
la nation qui la parle. Une langue, je l’ai déjà dit *
eft la totalité des ufages propres à une nation, pour
exprimer les penfées par la voix ; 6c ces ufages fixent
les mots 6c la fyntaxe. Les mots font les lignes
des idées, 6c naiffent avec elles, de maniéré qu’unô
nation formée 6c diftinguée par fon idiome, ne fau-
roit faire l’aequifition d’une nouvelle idée, fans faire
en même tems celle d’un mot nouveau qui la repréfente
: fi elle tient cette idée d’un peuple voifin, elle
en tirera de même le ligne vocal, dont tout au plus
elle réduira la forme matérielle à l ’analogie de fon
langage; au lieu depaftor, elle dira pajleur ; au lieu
d'embaxada, embajjade ; au lieu de batteny battre, &e.
fi c’eft de fon propre fonds qu’elle tire la nouvelle
idée, ce ne peut être que le réfultat de quelque çom-
binailondes anciennes ,& voilà la route tracée pour
aller jufqu’à la formation du mot qui en fera le type ;
puijfance fe dérive de puijfant, comme l’idée abftraite
eft prife dans l’idée concrète; parafol eft compofé
de parer ( garantir), & de foleil, comme l’idée de
ce meuble eft le rélultat de la combinaifon des idées
féparées de l’aftre qui darde des rayons briilans, &
d’un obftacle qui puiffe en parer les coups. Il n’y
aura donc aucune idée connue dans une nation qui
ne foit délignée par un mot propre dans la langue
de cette nation : 6c comme tout mot nouveau qui s’y
introduit, y prend toûjours l’empreinte de r analogie
nationale qui eft le fceau néceflaire de fa nantrali-
fation , il eft aufli propre que les anciens à toutes
les vues de la,fyntaxe de cet idiome. Ainfi tous les
hommes qui compofent ce peuple , trouvent dans
leur langue tout ce qui eft néceflaire à l’expreflion
de toutes les penfées qu’il leur eft poflible d’avoir,
puifqu’ils ne peuvent penfer que d’après des idées
connues. Cela même eft la preuve la plus immédiate
& la plus forte de la néceflité où chacun eft d’étudier
fa langue naturelle par préférence à toute autre
, parce que les befoins de la communication nationale
font les plus urgens, les plus univerfels, 6c
les plus ordinaires.
Si l’on veut porter fes vues au-delà de la fimple
énonciation de la penfée, -6c envifager tout le parti
que l’art peut tirer de la différente conftitution des
langues, pour flatter l’oreille, & pour toucher le
coeur, aufli bien que pour éclairer l’efprit ; il faut les
considérer dans les procédés de leur copftru$ion
analogue ou tranfpofitive : l’hébreu & notre françois
fuivent le plus fcrupuleufement l’ordre analytique ;
le grec 6c le latin s’en écartoient avec une liberté
fans bornes ; l’allemand, l’anglois, l’efpagnol, l’italien
tiennent entre ces deux extrémités une efpece
de milieu, parce que les inverfions qui y font admi-
fes, font déterminées à tous égards par les principes
mêmes de la conftitution propre de chacune de ces
langues. L’auteur de la Lettre fur les fourds & muets ,
envifageant les langues fous cet afpeél, en porte
ainfi fon jugement, pag. 13S:« La communication
» de la penfée étant l’objet principal du langage ,
» notre langue eft de toutes les langues la plus châ-
» tiée, la plus exaéle, & la plus eftiinable, celle en
» un mot qui a retenu le moins de ces négligences
b mie j’appelléfois volontiers des reftes de la balbu-
b tie des premiers âges ». Cette expreflïon eft con-
féquehte au fyftèrhe de l’auteur fur l’origine des langues
: mais celui que l’on adopte dans cet article, y
eft bien oppofé, 6c il feroit plutôt croire que les inverfions
, loin d’être des reftes de la balbutie des pre-
iniers âges, font ait contraire les premiers effais dç
l ’art oratoire des fiecles poftéricurs de beaucoup à
la naiffance du langage ; la reflemblance du nôtre
avec l’hébreu, dans leur marche analytique, donne
à cette conjedure un degré de vraiflçmblanç.e qui
mérite quelque attention, puifque l’hébreu tient de
bien près aux premiers âges. Quoi qu’il en foit, l ’auteur
pourfuit ainfi: « Pour .continuer lé parallèle
>> fans partialité, je dirais que nous avons gagné à
» n’avoir point d’inverfions ; pu du moins à ne les
» avoir ni trop hardies ni trop fréquentes, de la
» netteté, de la clarté, de la précifion, qualités çflen-
» tiellps au difeours ; 6c que nous y avons perdu de
>> la ehaleur , de l’élpquence, 6c de l’énergie. J’a-
» joüterois volontiers que la marche didactique 6c
i> réglée ; à laquelle notre langue eft aflujettie > la
» rend plus propre aux fciences ; &. qiie par les tours
» 6c les inverfions que le grec, le latin, l ’italien ,
» P a rfo is fe permettent, ces langues font plus avan-
» tageufes pour les lettres. Que nous pouvons
» mieux qu’aucun autre peuple , faire parler l’efprit,
» 6c que le bon fens choifiroit la langue françoife ;
» mais que l ’imagination 6c les pallions donneraient
» la préférence aux langues anciennes, 6c à celles
» de nos voifins : qu’il faut parler françois dans la
» fociété Sc dans les .écoles .de philofophie ; & grec,
» latin, anglois, dans les chaires & fur les théâtres ;
» que notre langue fera celle de la vérité, ...............
» & que la greque, la latine, & les autres feront les
i> langues de la fable 6c du menfonge. Le françois eft
» fait pour inftruire, éclairer, 6c convaincre ; le
» grec , le latin, l’italien, l’anglPis pour perfuader,
».émouvoir j & tromper: parlez grec, latin , italien
» au peuple ; mais parlez françois au fage ». Pour
réduire ce jugement à fa jufte valeur, il faut feulement
en conclure que les langues tranfpofitives trouvent
dans leur génie plus de reffources pour toutes
les parties de l’art oratoire ; & que celui des langues
analogues les rend d’autant plus propres à l’expofi-
tion nette & précife de la vérité, qu’elles fuivent plus
fcrupuleufement la marche analy tique de l ’efprit. La
choie eft évidente en fo i , 6c l’auteur n’a voulu rien
dire de plus. Notre marche analytique ne nous ôte pas
fansreffource la chaleur, l’éloquence, l’énergie ; elle
ne nous ôte qu’un moyen d’en mettre dans nos difeours
, comme la marche tranfpofitive du latin, par
exemple, l’expofe feulement au danger d ’être moins
clair, fans lui en faire pourtant une néceflité inévitable.
C ’eft dans la même lettre, pag. 23$. que je
trouve la preuve de l ’explication que je donne au
texte que Fon vient de voir. « Y a-t-il quelque ca-
» raftere, dit l’auteur, que notre langue n’ait pris
» avec fuccès ? Elle eft folâtre dans Rabelais, naïve
» dans la Fontaine 6c Brantôme, harmonieufe dans
» Malherbe 6c Fléchier, fublime dans Corneille 6c
» Bofliiet ; que n’eft-elle point dans Boileau, Ra-
» cine, Voltaire, & une foule d’autres écrivains en
» vers 6c en profe ? Ne nous plaignons donc pas : fi
» nous favons nous en fervir, nos ouvrages feront
» aufli précieux pour la poftérité, que les ouvrages
» des anciens le font pour nous. Entre les mains d\m
» homme ordinaire, le grec, le latin, l’an g lo is l’i-
» talien ne produiront que des chofes communes ;
» le françois produira des miracles fous la plume
» d’un homme de génie.Enquel que langue que ce foit,’
» l’ouvrage que lé génie foutient, ne tombe jamais »
Si l’on envifage les langues comme des inftrumens.
dont ia connoifianee peut conduire à d ’autres lumie*
fes ; eilés ônt chacune leur m érité, & la préférence
des unes fur les autres ne peut fe décider que par là
nature des vues que Fon fç propofe ou des befoins
où l’on eft.
La langue hébraïque 6c lès autres langues orientales
qui y ont rapport, comme la chaldaïque, la fy-
riaque, 1 arabique, &c. donnent à la Théologie des
fecours infinis, par la connoiflançe pré.cife dp vrai
fens dps textefc originaux de nos livres faints; Mais
ce n’eft pas-là le feul avantage que l’on puiffe attendre
de .l’étude de la langue hébraïque : c ’eft encore
dans l’original façré que l ’on trouve l’origine des
peuples, des langues, de l’idolat.rie, de la fable;;
en un mot les fondemens les plus ffirs dé l ’hiftoire ,
6c les clés les plus raifohnables de la Mythologie. Il
n’y a qu’à voir feulement la Çèographie Jacrée ùe Samuel
Bochart, pour prendre une haute idé,e d e l’ira-
menfitë de l’érudition que peut fournir la connoif-
fance des langues orientales.
La langue grecque n’ eft guere moins utile à Ji
Théologie, non-feulement à' caufe du texte original
de quelques-uns des livres du nouveau Teftament,
mais encore parce que e’eft l’idiome des Chryfofto-
mes, des Baffles, des Grégoires de Nazianze , 6c
d’une foule d’autres peres dont les oeuvres font là
gloire 6c l’édification de l’Eglife ; mais dans quelle
partie la littérature cette belle langue n’eft-elle pas
d’un ufage infini ? Elle fournit des maîtres 6c de$
modèles dans tous les genres ; Poëfie, Eloquence ,
Hiftoire, Philofophie morale, Phyfique, Hiftoire
naturelle* Médecine, Géographie ancienne, &cz
6c c’eft avec raifon qu’Eframe, i ipijl. liv. X , dit en
propres termes : Hoc unum expertus, video nullis in
litteris nos ejfe aliquidfine gracitate.
La langue latine eft d’une, néceflité indifpenfable;
c’eft celle de l ’églife catholique, 6c de toutes les
écoles de la chrétienté; tant pour la Philofophie &
la Théologie, que pour la Jurifprudence 6c la Médecine
: c’eft d’ailleurs, 6c pour cette raifon même;
la langue commune de tous les favans de l’Europe, 6c
dont il feroit à fouhaiter peut- être que l’ufage devînt
encore plus général 6c plus étendu, afin de faciliter
davantage la communication des lumières
refpeûives des diverfes nations qui cultivent aujourd
’hui les fciences : car combien d’ouvrages excel-
lens en tous genres de la connoiffance delquels on
eft privé, faute d’entendre les langues dans lesquelles
ils font écrits ?
En attendant que les favans foient convenus entre
eux d’un langage de communication, pour s’épargner
refpeélivement l’étude longue , pénible 6c
toujours infuftifante de plufieurs langues étrangères;
il faut qu’ils aient le courage de s’appliquer à celles
qui leur promettent le plus de fecours dans les gem
res d’étude qu’ils ont embrafles par goût ou par la
néceflité de leur état. La langue allemande a quantité
de bons ouvrages fur le Droit public, fur Ia'Mé-
decine 6c toutes fes dépendances, fur l ’hiftoire naturelle,
principalement fur la Métallurgie. La langue
angloife a des riche fies immenfes en fait de Mathématiques
, de Phyfique 6c de-Commerce. La langue
italienne offre le champ le plus vafte à la belle littérature,
à l’étude Jdes Arts 6c à celle de l’Hiftoire;
mais la langue françoife, malgré les déclamations de
de ceux qui en cehfurent la marçhe pédeftre, & qui
lui reprochent fa monotonie, fa prétendue pauvreté
, fes anomalies perpétuelles, a pourtant des chefs-
d’oeuvres dans prefque tous les genres. Quels tréfor$
que les mémoires de l’académie royale des Sciences,
6c de celle des Belles-lettres & Infcriptions ! & fi
l’on jette un coup-d’oeil fur les écrivains marqués de
notre nation, on y trouve des philofophes & des
géomètres du premier ordre, des grands métaphyfi-
eieos^ de Pages 6c laborieux antiquaires, des artilles