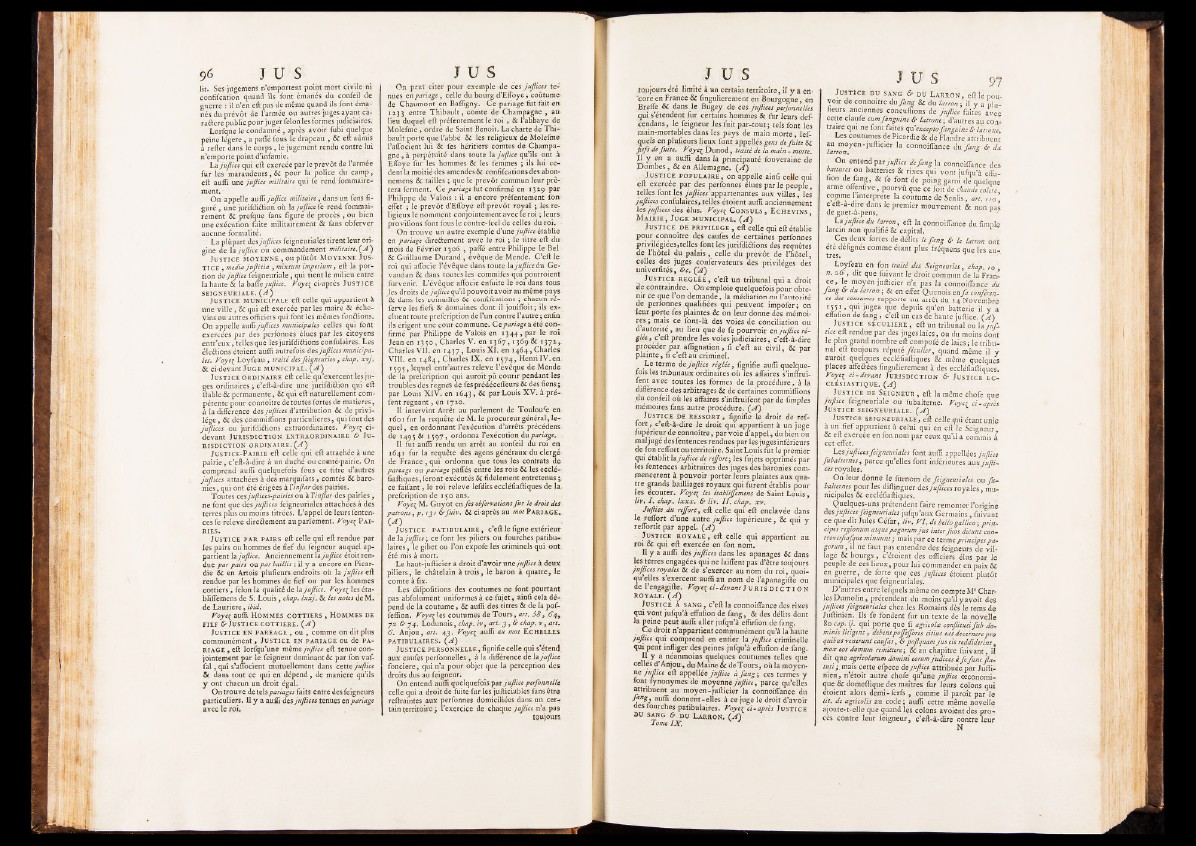
lit. Ses jugemens n’emportent point mort civile ni
confifcation quand ils font émanés du confeil de
guerre : il n’en eft pas de même quand ils font émanés
du prévôt de l’armée ou autres juges ayant ca-
rafrere public pour juger felon les formes judiciaires,
Lorfque le condamné , après avoir fubi quelque
peine legere, a paffé fous le drapeau , & eft admis
à refter dans le corps, le jugement rendu contre lui
n’emporte point d’infamie.
La jufticc qui eft exercée par le prévôt de l’armée
fur les maraudeurs, & pour la police du camp,
eft aufli une jujlice militaire qui fe rend fommaire-
ment.
On appelle aufli jujlice militaire, dans un fens figuré
, une jurifdifrion où la jujlice le rend fommai-
rement & prefque fans figure de procès , ou bien
une exécution faite militairement & fans obferver
aucune formalité.
La plupart des jujlices feigneuriales tirent leur origine
de la jujlice ou commandement militaire.{A')
Ju st ice moyen ne , ou plûtôt Moyenne Just
ic e , media jujlitia , mixtum imperium, eft la portion
de jujlice feigneuriale, qui tient le milieu entre
la haute & la bafîe jujlice. Voye[ ci-après Ju st ic e
seign eu r ial e. (A )
Ju st ic e mu nicipale eft celle qui appartient à
une ville , & qui eft exercée par les maire & éche-
vins ou autres officiers qui font les mêmes fondions.
On appelle aufli jujlices municipales Celles qui font
exercées par des perfonnes élues par les citoyens
entr’eu x , telles que les jurifdifrions confulaires. Les
élefrions étoient aufli autrefois des jujlicts municipales.
Foye{ Loyfeau , traité des feigneuries , chap. xvj.
& ci-devant Juge m u n ic ipal . (A )
Ju st ice ordinaire eft celle qu’exercent les juges
ordinaires ; c’ eft-à-dire une jurifdifrion qui eft
liable & permanente, & qui eft naturellement compétente
pour connoître detoutes fortes de matières,
à la différence des jujlices d’attribution 8c de privilège
, & des commiflions particulières, qui font des
jujlices ou jurifdifrions extraordinaires. Voye^ ci-
devant Ju r isd ic t io n ex traordin aire & Jur
isd ic t io n ORDINAIRE. {A')
Just ice-Pairie eft celle qui eft attachée à une
pairie, c ’eft-à-dire à un duché cru comté-pairie. On
comprend aufli quelquefois fous ce titre d’autres
jujlices attachées à des marquifats, comtés & baronies
, qui ont été érigées à Yinjlar des pairies.
Toutes cesjuflices-pairies ou à Yinjlar des pairies,
ne font que des jujlices feigneuriales attachées à des
terres plus ou moins titrées. L’appel de leurs fenten-
ces fe releve direfrement au parlement. Voyeç Pairie
s .
Ju st ice p a r pairs eft celle qui eft rendue par
les pairs ou hommes de fief du feigneur auquel appartient
la jujlice. Anciennement la jujlice étoit rendue
par pairs ou par baillis : il y a encore en Picardie
8c en Artois plufieurs endroits où la jujlice eft
rendue par les hommes de fief ou par les hommes
cottiers, felon la qualité de la jujlice. Voye^ les éta-
bliffemens de S. Louis, chap. Ixxj. & les notes de M.
de Lauriere, ibid.
Voye^ aufli Hommes co t t ie r s , Hommes de
fief & Ju st ic e co t t ier e . (A )
Ju st ice en pareage , ou , comme on dit plus
communément. Just ice en par iage ou de pa-
r iag e , eft lorfqu’une même jujlice eft tenue conjointement
par le feigneur dominant & par fon vaf-
f a l , qui s’aflbeient mutuellement dans cette jujlice
8c dans tout ce qui en dépend, de maniéré qu’ils
y ont chacun un droit égal.
On trouve de tels partages faits entre des feigneurs
particuliers. Il y a aufli des jujlices tenues en partage
avec le roi.
On peut citer pour exemple de ces jujlices tenues
en pariage, celle du bourg d’Effoye , coûtume<
de Chaumont en Bafligny. Ce pariage fut fait en
1133 entre Thibault, comte de Champagne , au-
lieu duquel eft préfentement le roi , & l’abbaye de
Molefme, ordre de Saint Benoît. La charte de Thi-'
bault porte que l’abbé 8c les religieux de Molefme
l’affocient lui & fes héritiers comtes de Champagne
, à perpétuité dans toute la jujlice qu’ils ont à
Effoye fur les hommes & les femmes ; ils lui cèdent
la moitié des amendes 8c confifcations des abon-
nemens & tailles ; que le prévôt commun leur prêtera
ferment. Ce pariage fut confirmé en 1319 par
Philippe de Valois : il a encore préfentement fon
effet ; le prévôt d’Effoye eft prévôt royal ; les religieux
le nomment conjointement avec le roi ; leurs.
provifions font fous le contre-fcel de celles du roi.
On trouve un autre exemple d’une jujlice établie
en partage direfrement avec le roi ; le titre eft du
mois de Février 1306 , paffé entre Philippe le Bel
8c Guillaume Durand, évêque de Mende. C ’eft le
roi qui affocie l’évêque dans toute la jujlice du Ge-
vaudan 8c dans toutes les commifes qui pourroient
furvenir. L’évêque affocie enfuite le roi dans tous
les droits de jujlice qu’il pouvoit avoir au même pays
& dans les commifes 8c confifcations ; chacun ré-
ferve les fiefs & domaines dont il jouiffoit ; ils ex-
cluent toute prefeription de l’un contre l’autre ; enfin
ils érigent une cour commune. Ce pariage a été con*- ■
firmé par Philippe de Valois en 1344, par le roi
Jean en 1350, Charles V. en 1367,1369 & 1371»
Charles VII. en 1437, LouisXI. en 14 6 4 ,Charles.
VIII. en 1484, Charles IX. en 1574, HenriIV.en.
1595, lequel entr’autres releve l ’évêque de Mende
de la prefeription qui auroit pu courir pendant les
troubles des regneS de fesprédéceffeurs 8c des fiens;
par Louis XIV. en 1643 » & Par Louis X V . à présent
régnant, en 17x0.
Il intervint Arrêt au parlement de Toulouse en
1601 fur la requête de M. le procureur général, lequel
, en ordonnant l’exécution d’arrêts précédens
de 1495 & 1597 , ordonna l’exécution du pariage. ,
Il fut aufli rendu un arrêt au confeil du roi en
1641 fur la requête des agens généraux du clergé
de France, qui ordonna que tous les contrats de
parcage ou pariage paffés entre les rois 8c les ecclé-
fiaftiques, feront exécutés & fidèlement entretenus ;
ce faifant, le roi releve lefdits eccléfiaftiques de la
prefeription de 150 ans.
Voye^ M. Guyot en fes obfervations fur le droit des
patrons, p. 131 &fuiv. 8c ci-après au mot Pa r ia g e ..
(A ) i .
Ju st ic e p a t ib u l a ir e , c’eft le ligne extérieur
de la jujlice ; ce font les piliers ou fourches patibulaires
, le gibet ou l’on expofe les criminels qui ont.
été mis à mort.
Le haut-jufticier a droit d’avoir une jujlice à deux
piliers, le châtelain à trois, le baron à quatre, le
comte à fix.
Les difpofitions des coutumes ne font pourtant
pas abfolument uniformes à ce fujet, ainfi cela dé-,
pend de la coutume , 8c aufli des titres & de la pof*
feflion. Voye^les coutumes de Tours, art. 6 8 , 64,.
yx & y 4. Lodunois, chap. iv, are. 3 , & chap. v , art.
6'. Anjou, art. 43. Voye£ aufli au mot ECHELLES
PATIBULAIRES. (A ) -
Ju st ice personnelle, fignifiecelle qui s’étend,
aux caufes perfonnelles , à la différence de la jujlice
foncière, qui n’a pour objet que la perception des
droits dus au feigneur.
On entend aufli quelquefois par jujlice perfonnellc,
celle qui a droit de fuite fur les jufticiables.fans être
reftraintes aux perfonnes domiciliées dans un certain
territoire y l’exercice de chaque jujlice n’a pas
toujours
toujours été limité à un certain territoire, il y a en-
wcorè èn France 8c fingulierement en Bourgogne, en
Breffe & dans le Bugey de ces jujlices perjonnelles
qui s’étendent fur certains hommes & fur leurs dèf-
cendans, le feigneur les fuit par-tout; tels font les
main-mortables dans les pays de main morte, lef-
quels en plusieurs lieux font appellés gens de fuite 8c
fiefs de fuite» Voye^ Dunod, traité de la main - morte.
Il y en a aufli dans la principauté fouveraine de
Dombes, & en Allemagne. (A )
Ju st ic e p o pu l a ir e , on appelle ainfi celle qui
eft exercée par des perfonnes élues par le peuple , :
telles font les jujlices appartenantes aux ville s, les
jujlices confulaires, telles étoient aufli anciennement
les jujlices des élus. - Voye1 C o n su l s , Ech e v in s ,
Mairie , Juge m u n ic ip a l . (A )
Ju st ic e de privilège , eft celle qui eft établie
pour connoître des caufes de certaines perfonnes
privilégiées,telles font les jurifdifrions des requêtes
de l’hôtel du palais , celle du prévôt de l’hôtel,
celles des juges confervateurs des privilèges des
univerfités, &c. (JA')
Ju s t ic e r é g l é e , c’eft un tribunal qui a droit
de contraindre. On emploie quelquefois pour obtenir
ce que l’on demande, la médiation ou l ’autorité
de perfonnes qualifiées qui peuvent impofer; on
leur porte fes plaintes & on leur donne des mémoires
; mais ce font-là des voies de conciliation ou
d’autorite, au lieu que de fe pourvoir en jujlice réglée,
c’eft prendre les voies judiciaires, c’eft-à-dire
procéder par affignation, fi c’eft au c ivil, 8c par
plainte, fi c’eft au criminel.
Le terme de jujlice réglée, fignifie aufli quelquefois
les tribunaux ordinaires où les affaires s’inftrui--
lént avec toutes les formes de la procédure, à la
.différence des arbitrages & de certaines commiflions
du confeil où les affaires s’inftruifent par de fimples
mémoires fans autre procédure. (A )
Ju st ic e de r e s so r t , fignifie le droit de ref-
*°rt , c’eft-à-dire le droit qui appartient à un juge
fupérieur de connoître, par voie d’appel, du bien ou
mal jugé des fentences rendues par les juges inférieurs
de fon reffort ou territoire. Saint Louis fut le premier
qui établit la jujlice de reffort ; les fujets opprimés par
les fentences arbitraires des juges des baronies commencèrent
à pouvoir porter leurs plaintes aux quatre
grands bailliages royaux qui furent établis pour
les écouter. Voyei les établiffemens de Saint Louis,
tiv, 1. chap. Ixxx. & liv, II. chap. xv.
Jujlice du reffort, eft celle qui eft enclavée dans
le reffort d’une autre jujlice fupérieure, & qui y
reffortit par appel. (A )
- Just ice r o y a l e , eft celle qui appartient au
roi 8c qui eft exercée en fon nom.
Il y a aufli d es jujlices dans les apanages & dans
les terres engagées qui ne laiffent pas d’être toujours '
jujlices royales & de s’exercer au nom du roi, quoiqu’elles
s ’exercent aufli au nom de l’apanagifte ou
de l’engagifte. Vjyeç ci - devant J u r i s d i c t i o n
r o y a l e . ( A )
Ju st ic e à s a n g , c’ eft la connoiffance des rixes
qui vont jufqu’à effufion de fang, & des délits dont
la peine peut aufli aller jufqu’à effufion de fang.
C e droit n’appartient communément qu’à la haute
jujlice qui comprend en entier la jujlice criminelle
qui peut infliger des peines jufqu’à effufion de fang.
Il y a néanmoins quelques coutumes telles que
celles d 'Anjou, du Maine 8c de Tours, où la moyenne
jujlice eft appellée jujlice à fang ; ces termes y
font lynonymes de moyenne jujlice, parce qu’elles
attribuent au moyen-jufticier la connoiffance du
J*nB* aufli donnent-elles à ce juge le droit d’avoir
des fourches patibulaires. Voyez ci-apr'es Ju st ic e
du sang & du Larron. (A )
Tome IX.
Ju st ic e du sang & du L a r r o n , eft le pouvoir
de connoître du fang & du larron ; il y a plufieurs
anciennes Concufîions de jujlice faites avec
cette claufe eumfnngmm & latroni ;. d’auttes au contraire
qui ne font faites qu'exceptafanguim & latroneè
Les coutumes de Picardie & de Flandre attribuent
au moyen-jufticier la connoiffance du fang & du.
larron» 0
On entend pat jufilce defàng la connoiffance des
battures ou batteries & rixes qui vont jufqu’à effufion
de fang, & fe font de poing garni de quelque
arme offeniive, pourvu que ce foit de chaude colere
comme l’interprete la coutume de Serilis, art. n o
c eft-à-dire dans le premier mouvement & non pas
de guèt-à-pens. r J
La jujlice du larron, eft la connoiffance du fimple
larcin non qualifié & capital.
, C®5 deu* fortes de déljts le fang & h larron ont
ete defignes comme étant plus fréquens que les autres
»
Loyfeaü en foli traité des Seigneuries, chap. / o «
h . x 6 , dit que fuivant le droit comipun de la Frani.
c e , le moyen jufticier n’a pas la connoiffance du
fang & du larron ; & en effet Quenois en fa conférence
des coutumes rapporte un arrêt du 14 Novembre
ïïm 1 » q«i jugea que depuis qu’en batterie il y à
effufion de fang > c’eft un cas de haute juftice. (A )
Ju st ic e s e c u l ie r e , eft un tribunal ou la ju f-
tice eft rendue par des juges laïcs , ou du moins dont
le plus grand nombre eft compofé de laïcs; le tribunal
eft toujours répu té féculier, quand même il y
auroit quelques eccléfiaftiques & même quelques
places affefrees fingulierement à des eccléfiaftiques.
Voyei ci-devant JURISDICTION & JUSTICE ECCLESIASTIQUE.
(A )
Ju st ic e de Seigneur , eft la même chofe que
jujlice feigneuriale ou fubalterne. Voyez ci-après
Ju st ic e seign eur iale. (A )
Ju st ice seign eur iale, eft celle qui étant unie
à un fief appartient à celui qui en eft le Seigneur,
& eft exercée en fon nom par ceux qu’il a commis à
cet effet.
Les jufices feigneuriales font aufli appellées jujlice
fubalternes, parce qu’elles font inférieures aux jujlices
royales»
On leur donne le furnom de feigneuriales ou fu balternes
pour les diftinguer des jujlices royales, municipales
& eccléfiaftiques.
Quelques-uns prétendent faire remonter l’origine
des jujlices feigneuriales jufqu’aux Germains, fuivant
ce que dit Jules Céfar, liv. VI. de bello gallico; principes
rcgionUm atque pagorum ju s inter fuos dicunt con-
troverjîajque minuunt ; mais par ce terme principes pagorum
, il ne faut pas entendre des feigneurs de village
& bourgs , c’etoient des officiers élus par lé
peuple de ces lieux, pour lui commander en paix 8c
en guerre, de forte que ces jujlices étoient plutôt
municipales que feigneuriales.
D autres entre lefquels même on compte Me Charles
Dumolin, prétendent du moins qu’il y avoit des
jujlices feigneuriales chez les Romains dès le tems de
Juftinien. Ils fe fondent fur un texte de la novelle
80 cap. ij. qui porte que fi agricole conflituti fub do-
minis litigent, debent poffeffores citius cas decernere pro
quibusvenerunt caufas, & pojlquam jus eis reddiderint
mox eos domum remittere ; & au chapitre fuivant, il
dit que agricolarum domini eorum judices à fe funt Jla-
tuti mais ce tte efpece de jujlice attribuée par Juftinien,
n’étoit autre chofe qu’une jujlice oeconomi-
que & domeftique des maîtres fur leurs colons qui
étoient alors demi - ferfs , comme il paroît par le
tit. de agricolis au code ; aufli cette même novelle
ajoute-t-elle que quand les colons avoient des pro-
; cès contre leur feigneur, c’eft-à-dire contre leur
N