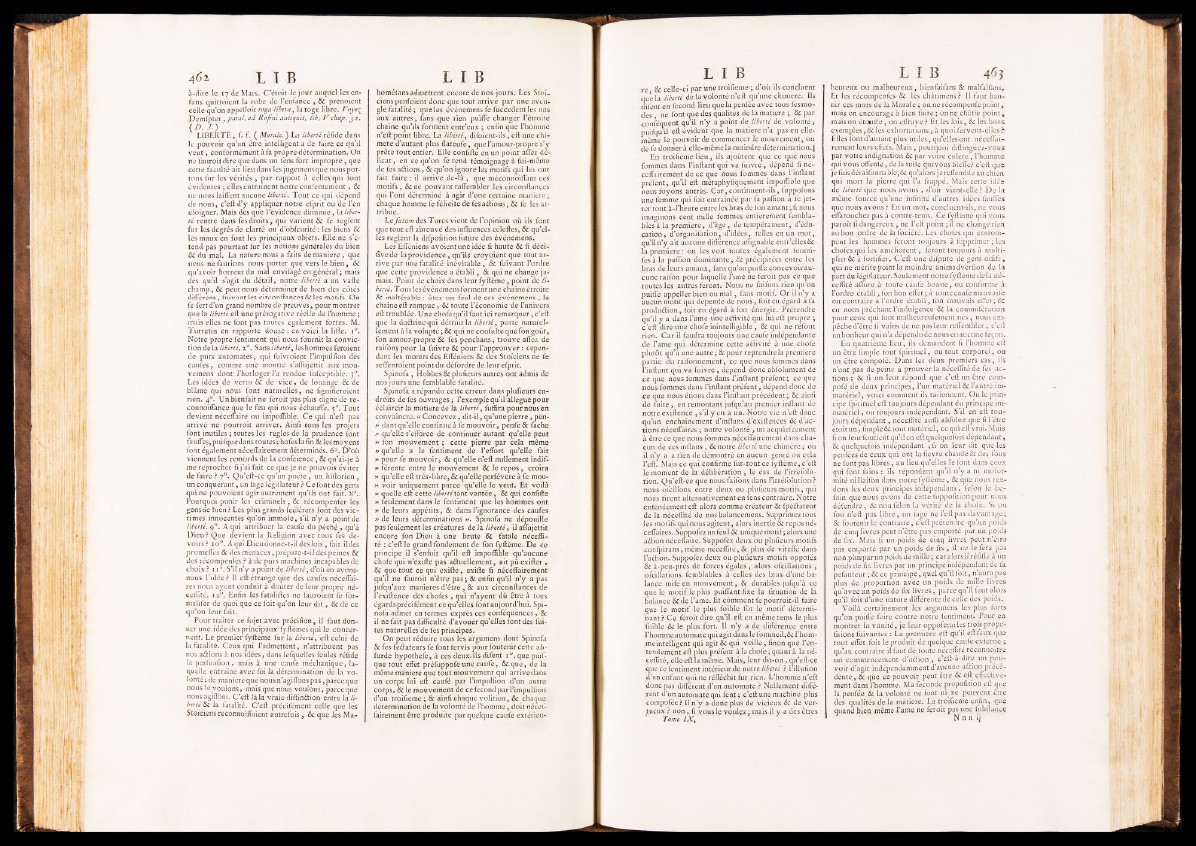
à-dire le 17 de Mars. C’étoit le jour auquel les en-
fans quittoient la robe de l’enfance , 6c prenoient
celle qu’on appelloit toga libéra, la toge libre. Voye^
Demfpter, parai, ad Rofini auùquit. lib. Vchap. 32.
\ D . J.) I
LIBERTÉ, f. f. ( Morale.') La. libertéréfide dans
le pouvoir qu’un être intelligent a de faire ce qu’il
v eu t , conformément à fa propre détermination. On
ne fauroitdire que dans un fens fort impropre, que
cette faculté ait lieu dans les jugemens que nous portons
fur les vérités , par rapport à celles qui font
évidentes ; elles entraînent notre confentement, 6c
ne nous laiffent aucune liberté. Tout ce qui dépend
de nous, c’eft d’y appliquer notre efprit ou de l’en
éloigner. Mais dès que l ’évidence diminue, la liberté
rentre dans fes droits, qui varient 6c fe règlent
fur les degrés de clarté ou d’obfcurité : les biens 6c
les maux en font les principaux objets. Elle ne s’étend
pas pourtant fur les notions générales du bien
& du mal. La nature nous a faits de maniéré, que
nous ne faurions nous porter que vers le bien, 6c
qu’avoir horreur du mal envifagé en général ; mais
dès qu’il s’agit du détail, notre liberté a un vafte
champ, & peut nous déterminer de bien des côtés
différens, fuivant les circonftances & les motifs. On
fe fertd’un grand nombre de preuves, pour montrer
que la liberté eft une prérogative réelle de l’homme ;
mais elles ne font pas toutes également fortes. M.
Turretin en rapporte douze : en voici la lifte. i°.
Notre propre fentiment qui nous fournit la conviction
delà liberté. x°. Sans liberté, les hommes feroient
de purs automates, qui fuivroient l’impulfion des
caufes, comme une montre s’affujettit aux niou-
vemens dont l’horloger l’a rendue fufceptible. 30.
Les idées de vertu 6c de v ic e , de louange 6c de
blâme qui nous font naturelles, ne fignifîeroient
rien. 40. Un bienfait ne feroit pas plus digne de re-
connoiffance que le feu qui nous échauffe. 50. Tout
devient néceffaire ou impofîible. Ce qui n’eft pas
arrivé ne pourroit arriver. Ainli tous les projets
font inutiles ; toutes les réglés de la prudence font
fauffes, puifque dans toutes chofes la fin & les moyens
font également néceffairement déterminés. 6°. D ’où
viennent les remords de la confcience, 6c qu’ai-je à
me reprocher fi j’ai fait ce que je ne pouvois éviter
de faire ? 70. Qu’eft-ce qu’un poëte, un hiftorien ,
un conquérant, un fage légiflateur ? C e font des gens
qui ne pouvoient agir autrement qu’ils ont fait. 8°.
Pourquoi punir les criminels , 6c récompenfer les
gens de bien ? Les plus grands fcélérats font des v ic times
innocentes qu’on immole, s’il n’y a point de
liberté. 90. A qui attribuer la caufe du péché , qu’à
Dieu ? Que devient la Religion avec tous fes devoirs
? io ° . A qui Dieu donne-t-il des lois, fait-ildes
promefl'es & des menaces, prépare-t-il des peines &
des récompenfes ? à de purs machines incapables de
choix ? 1 1°. S’il n’y a point de liberté, d’où en avons-
nous l’idée ? II eft étrange que des caufes néceffai-
res nous ayent conduit à douter de leur propre né-
ceflïté. iz ° . Enfin lesfataliftes ne fauroient fe for-
malifer de quoi que ce foit qu’on leur d i t , & de ce
qu’on leur fait.
Pour traiter ce fujet avec précifion, il faut donner
une idée des principaux fyftèmes qui le concernent.
Le premier fyftème fur la liberté, eft celui de
la fatalité. Ceux qui l’admettent, n’attribuent pas
nos allions à nos idées, dans lefquelles feules réfide
là perfuafion, mais à une caufe méchanique, laquelle
entraîne avec foi la détermination de la volonté
; de maniéré que nous n’agiffons pas, parce que
nous le voulons, mais que nous voulons, pareeque
nous agiffons. C’eft là la vraie diftindtion entre la liberté
6c la fatalité. C’eft précifément celle que les
Stoïciens reconnoiffoient autrefois, 6c que les Mahômétans
admettent encore de nos jours. Les Stoïciens
penfoient donc que tout arrive par une aveugle
fatalité ; que les événemens fe fuccedent les uns
aux autres, fans que rien puiffe changer l’étroite
chaîne qu’ils forment entr’euX ; enfin que l’homme
n’eft point libre. La liberté, difoient-ils, eft une chimère
d’autant plus flateufe, que l’amour-propre s’y
prête tout entier. Elle confifte en un point affez délicat
, en ce qu’on fe rend témoignage à foi-même
de fes allions, & qu’on ignore les motifs qui les ont
fait faire : il arrive de-là , que méconnoiffant ces
motifs , 6c ne pouvant raffembler les circonftances
qui l’ont déterminé à agir d’une certaine maniéré,
chaque homme fe félicite de fes allions, 6c fe les attribue.
Le fatum des Turcs vient de l’opinion où ils font
que tout eft abreuvé des influences céleftes, & qu’elles
règlent la difpofition future des événemens.
Les Efleniens avoient une idée fi haute 6c fi déci-
fivede la providence, qu’ils croyoient que tout arrive
par une fatalité inévitable , 6c fuivant l’ordre
que cette providence a établi, & qui ne change jamais.
Point de choix dans leur fyftème , point de liberté.
Tous les événemens forment une chaîne étroite
& inaltérable : ôtez un feul de ces événemens , la
chaîne eft rompue, & toute l’économie de l’univers
eft troublée. Une chofe qu’il faut ici remarquer, c ’eft
que la dodtrine qui détruit la liberté, porte naturellement
à la volupté ; 6c qui ne confulte que fon goût,
fon amour-propre 6c fes penehans, trouve affez de
raifons pour la fuivre 6c pour l’approuver : cependant
les moeurs des Efféniens & des Stoïciens ne fe
reffentoient point du défordre de leur efprit.
Spinofa, Hobbes 6c plufieurs autres ont admis de
nos jours une femblable fatalité.
Spinofa a répandu cette erreur dans plufieurs endroits
de fes ouvrages ; l’exemple qu’il allégué pour
éclaircir la matière de la liberté, fuffira pour nous en
convaincre. « Concevez, dit-il, qu’une pierre, pen-
» dant qu’elle continue à fe mouvoir, penfe & fâche
» qu’elle s’efforce de continuer autant qu’elle peut
» fon mouvement ; cette pierre par cela même
» qu’elle a le fentiment de l’effort qu’elle fait
» pour fe mouvoir, & qu’elle n’eft nullement indif-
» férente entre le mouvement & le repos, croira
» qu’elle eft très-libre, & qu’elle perfévere à fe mou-
» voir uniquement parce qu’elle le veut. Et voilà
» quelle eft cette liberté tant vantée, 6c qui confifte
» feulement dans le fentiment que les hommes ont
» de leurs appétits, & dans l’ignorance des caufes
» de leurs déterminations ». Spinofa ne dépouille
pas feulement les créatures de la liberté, il aflujettit
encore fon Dieu à une brute & fatale nécelfi-
té : c’eft le grand fondement de fon fyftème. De ce
principe il s’enfuit qu’il eft impoflible qu’aucune
chofe qui n’exifte pas aéluellement, ait pû exifter ,
& que tout ce qui exifte, exifte fi néceffairement
qu’il ne fauroit n’être pas; & enfin qu’il n’y a pas
jufqu’aux maniérés d’ê tre, & aux circonftances de
l’exiftence des chofes , qui n’ayent dû être à tous
égards précifément ce qu’elles font aujourd’hui. Spinofa
admet en termes exprès ces conféquences, &
il ne fait pas difficulté d’avouer qu’elles font des fuites
naturelles de fes principes.
On peut réduire tous les argumens dont Spinofa
& fes feôateurs fe font fervis pour foutenir cette ab-
furde hypothèfe, à ces deux. Ils difent i ° . que puifque
tout effet préfuppofeune caufe, & q u e , de la
même maniéré que tout mouvement qui arrive dans
un corps lui eft caufé par l’impulfion d’un autre
corps, & le mouvement de ce fécond par l’impulfion
d’un troifieme; & ainfi chaque volition, & chaque
détermination de la volonté de l’homme, doit nécef-
fairement être produite par quelque caufe extérieur
re & celle-ci par une troifieme ; d’où ils concluent
que la liberté de la volonté n’eft qu’une chimere. Ils
difent en fécond lieu que la penfée avec tous fes modes
ne font que des qualités de la matière ; 6c par
conséquent qu’il n’y a point de liberté de volonté,
puifqu’il eft évident que la matière n’a pas en elle-
même le pouvoir de commencer le mouvement, ou
de fe donner à elle-même la moindre détermination. J
En troifieme lieu , ils ajoutent que ce que nous
fommes dans l’inftant qui va fuivre, dépend fi né-
ceffairement de ce que nous fommes dans l’inftant
préfent, qu’il eft métaphyfiquement impoflible que
nous foyons autres. C a r , continuent-ils, fuppolons
une femme qui foit entraînée par fa paflion à fe jet—
ter tout à-l’heure entre les bras de fon amant ; fi nous
imaginons cent mille femmes entièrement fembla-
bles à la première, d’âg e , de tempérament, d’éducation,
d’organifation, d’idées, telles en un mot,
qu’il n’y ait aucune différence affignable entr’ellesôc
la première : on les voit toutes également foumi-
fes à la paflion dominante, 6c précipitées entre les
bras de leurs amans, fans qu’on puiffe concevoir aucune
raifon pour laquelle l’une ne feroit pas ce que
toutes les autres feront. Nous ne faifons rien qu’on
puiffe appeller bien ou mal, fans motif. Or il n’y a
aucun motif qui dépende de nous, foit eu égard à fa
.produdtion, foit eu égard à fon énergie. Prétendre
.qu’il y a dans l’ame une adtivité qui lui eft propre ;
c ’eft dire une chofe inintelligible , 6c qui ne réfout
rien. Car il faudra toujours une caufe indépendante
de l’ame qui détermine cette adtivité à une chofe
plutôt qü’à une autre ; & pour reprendre la première
partie du raifo.nne.ment, ce que nous fommes dans
l’inftant qui va fuivre , dépend donc abfolument de
ce que nous fommes dans l’inftant préfent; ce que
.nous fommes dans l’inftant p réfent, dépend donc de
ce que nous étions dans l’inftant précédent ; 6c ainfi
de fuite, en remontant jufqu’au premier inftànt de
notre exiftence , s’il y en a un. Notre vie n’eft donc
qu’un enchaînement d’inftans d’exiftences 6c d’actions
néceffaires ; notre volonté , un acquiefcement
à être ce que nous fommes néceffairement dans chacun
de ces inftans , 6c notre liberté une chimère ; ou
il n’y a a rien de démontré en aucun genre „ou cela
l’eft. Mais ce qui confirme fur-tout ce fyftème, c ’eft
le moment de la délibération , le cas de l’irréfolu-
.tion. Qu’eft-ce que nous faifons dans l’irréfolution ?
nous ofcillons entre deux ou plufieurs motifs, qui
nous tirent alternativement en fens contraire. Notre
entendement eft alors comme créateur & fpedtateur
.de la néceflité de nos balancemens. Supprimez tous
les motifs qui nous agitent, alors inertie 6c repos né-
ceffaires. Suppofezunfeul 6c unique motif ; alors une
adtion néceffaire. Suppofez deux ou plufieurs motifs
.confpirans, même néceflité, & plus de vîteffe dans
l’adtion. Suppofez deux ou plufieurs motifs oppofés
6c à-peu-près de forces égales, alors ofcillations ,
ofcillations femblables à celles des bras d’uné balance
mile en mouvement, & durables jufqu’à ce
que le motif le plus puiffant fixe la fituation de la
balance 6c de i’ame. Et comment fe pourroit-il faire
que le motif le plus foible fut le motif déterminant
? Ce feroit dire qu’il eft en même tems le plus
foible 6c le plus fort. Il n’y a de différence entre
l’homme automate qui agit dans le fommeil,& l’hom-
.meintelligent qui agit 6c qui v eille, finon que l’entendement
eft plus préfent à la chofe ; quant à la né7
ceflité, elle eft la même. Mais, leur dit-on, qu’eft-ce
que ce fentiment intérieur de notre liberté ? l’illufion
.d’un enfant qui ne réfléchit fur rien. L’homme n’eft
donc pas différent d’un automate ? Nullement différent
d’un automate qui fent ; c’eft une machine plus
compofée ? Il n’y a donc plus de vicieux 6c de vertueux
? non, fi vous le voulez ; mais il y a des êtres
Tome 1X\
heureux ou malheureux, bienfaifans & malfaifans.'
Et les récompenfes 6c les châtimens ? Il faut bannir
ces mots de la Morale ; on ne récompenfe point,
mais on encourage à bien faire; on ne châtie point,
mais on étouffe, on effraye ? Et les lois, 6c les bons
exemples, 6c les exhortations, à quoi fervent-ellesfe
Elles font d’autant plus utiles, qu’elles ont néceffairement
leurs effets. Mais , pourquoi diftinguez-vous
par votre indignation 6c par votre colere , l’homme
qui vous offenfe, de la tuile qui vous bleffe? c’eft que
je fuisdéraifonnable,ôc qu’alors jereffemble au chien
qui mort la pierre qui l’a frappé. Mais cette idée
de liberté que nous avons , d’où vient-elle? De la
même fource qu’une infinité d’autres idées fauffes
que nous avons ? En un mot, concluent-ils, ne vous
effarouchez pas à contre-tems. Ce fyftème qui vous
paroît fi dangereux, ne l’eft point ;il ne change rien
au bon ordre de la fociété. Les chofes qui corrompent
les hpmmes feront toujours à fupprimer ; les
chofes qui les améliorent, feront toujours à multiplier
& à fortifier. C ’eft une difpute de gens oififs,
qui ne mérite point la moindre animadverfion de la
part du légiflateur. Seulement notre fyftème delà néceflité
affure à toute caufe bonne, ou conforme à
l’ordre établi, fon bon effet; à toute caufe mauvaife
ou contraire à l ’ordre établi, fon mauvais effet ; 6c
en nous prêchant l’indulgence 6c la çommifération
pour ceux qui font malheureufement nés , nous empêche
d’être fi vains de ne pas leur reffembler ; c’eft
un bonheur qui n’a dépendu de nous en aucune façon.
En quatrième lieu, ils demandent fi l’homme eft
un être fimple tout fpirituel, ou tout corporel, ou
un être cômpofé. Dans les deux premiers cas, ils
n’ont pas de peine à prouver la néceflité de fes actions
; & fi on leur répond que c’eft un être com-
pofé de deux principes, l’un matériel & l’autre immatériel
, voici comment ils raifonnent. Ou le principe
fpirituel eft toujours dépendant du principe immatériel,
ou toujours indépendant. S’il en eft toujours
dépendant, néceflité aufli abfolue que fi 1 et re
étoit un, fimple 6c tout matériel, ce qui eft vrai. Mais
fi on leur foutient qu’il en eft quelquefois dépendant,
& quelquefois indépendant ;fi on leur dit que les
penfées de ceux qui ont la fievre chaùde 6c des fous
ne font pas libres, au lieu qu’elles le font dans ceux
qui font fains : ils répondent qu’il n’y a ni Uni'foçr
mité niliaifon dans notre fyftème , 6c que .nous rendons
les deux principes indépendans, félon ,1e. be-
foin que nous avons de cette fuppofition.pour nous
défendre, 6c non félon la vérité .de la chofe. Si un
fou n’eft pas libre, un fagé ne l’eft pas davantage;
& foutenir le.contraire,c’eft prétendre qu’un poids
de cinq livres peut n’être pas emporté par un poids
de fix. Mais fi un poids, de cinq livres peut n’être
pas emporté par un poids de f ix , il ne le fera pas
non plus par un poids de mille; car alors il réfifte à un
poids de fix livres par un principe indépendant de fa
pefanteur ; 6c ce principe., quel q.u’il foit, n’aura pas
plus de proportion avec un poids de mille livres
qu’avec un poids de fix livres, parce qu’il faut alors
qu’il foit d’une nature différente de celle des poids.;
Voilà certainement les argumens : les;pliis forts
qu’on puiffe faire contre notre fentiment. Pour eu
montrer la vanité, je leur oppoferailes trois prppp-
fivions fuivantes : La première eft qu’il eft faux .que
tout effet foit le produit de quelque caufe externe ;
qu’au contraire il faut de toute néceflité r.econnoître
un commencement d’adtion , c’èft-à-dire -Un pouvoir
d’agir indépendamment d’aucune adtion précédente
, & que ce pouvoir peut être 6c eft effectivement
dans l’homme. Ma fécondé propofitipn eft que
la penfée & la volonté ne font ni ne peuvent, être
des qualités de la matière, La troifieme enfin, que
quand bien même l’ame. ne feroit. pas une fubftance
N n h ij