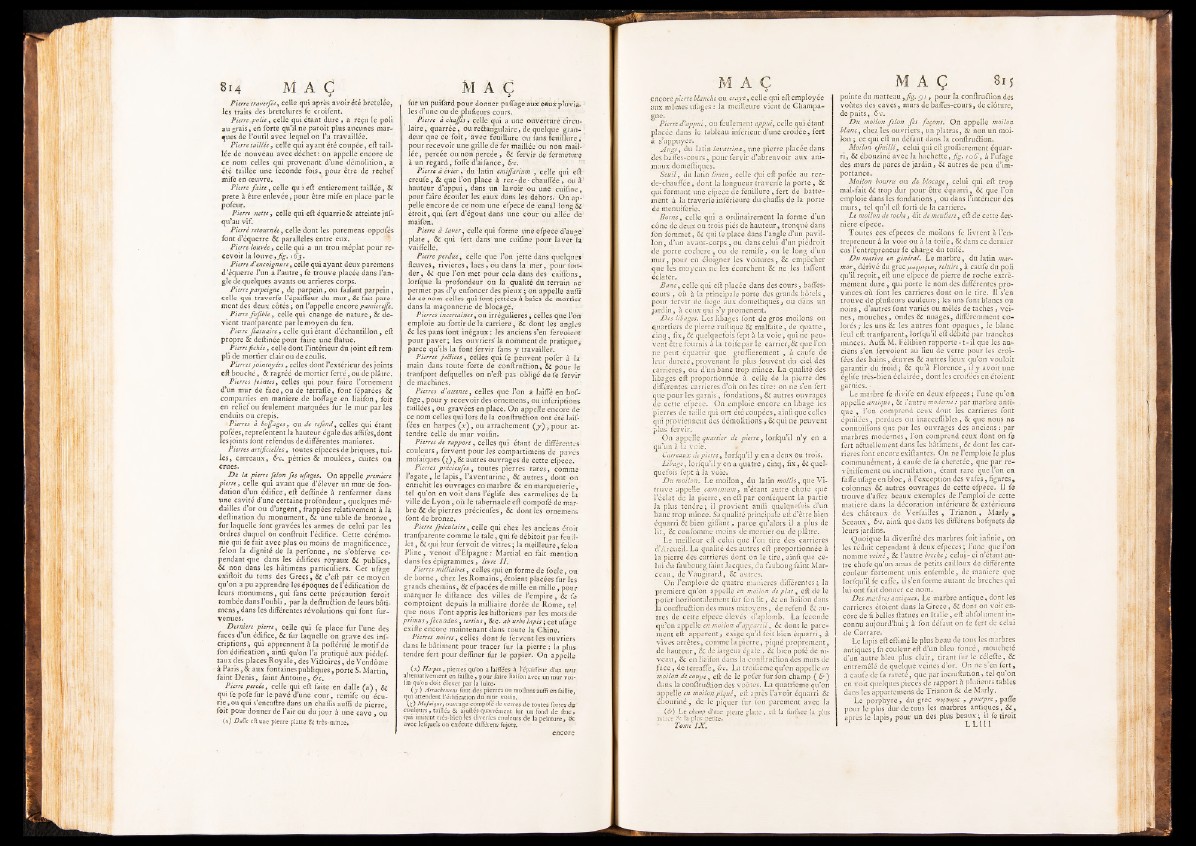
Pierre traverfée, celle qui après avoir été bretelée,
les traits des bretelures Te croifent.
Pierre,polie, celle qui étant dure, a reçu le poli
aü grais, eh forte qu’il ne paroît plus aucunes marques
de l’outil avec lequel on l’a travaillée.
Pierre taillée, celle qui ayant été coupée, eft taillée
de nouveau avec déchet i.on appelle encore de
ce nom celles qui provenant d’une démolition, a
été taillée une fécondé fois, pour être de rechef
mife en oeuvre.
Pierre faite, celle qu i eft entièrement taillée, St
prete à être enlevée, pour être mife en place par lé
pofeur.
Pierre nette, celle qui eft équarrie& atteinte jtlf-
qu’au vif.
Pierre retournée, celle dont les paremens oppcSfés
font d’équerre 8c parallèles entre eux.
Pierre louvée , celle qui a un trou méplat pour recevoir
la louve, fig. 1&3.
Pierre d?encoignure, celle qui ayant deux paremens
d ’équerre l’un à l’autre, fe trouve placée dans l’angle
de quelques avants ou arriérés corps.
Pierre parpeigne , de parpein, ou faifant parpein,
celle qui traverfe l’épaifleur du mur, 8c fait parement
des deux côtés ; on l’appelle encore pamiereffe.
Pierre fujible, celle qui change de nature, & devient
tranfparente par le moyen du feu.
Pierre Jlatuaire, celle qui étant d’échantillon, eft
propre & deftinée pour faire une ftatue.
Pierre fichée, celle dont l’intérieur du joint eft rempli
de mortier clair ou de coulis.
Pierres jointoyées, celles dont l’extérieur des joints
eft bouché, & ragréé de mortier ferré, ou de plâtre.
Pierres feintes, celles qui pour faire l’ornement
d’un mur de face, ou de terraffe, font féparées 8c
comparties en maniéré de boflage en liaifon, foit
en relief ou feulement marquées fur le mur par les
enduits ou crépis.
Pierres à boffages, ou de refend, celles qui étant
pofées, reprefentent la hauteur égale des affifes,dont
les joints font refendus de différentes maniérés.
Pierres artificielles, toutes efpeces de briques, tuiles,
carreaux, &c. pétries & moulées, cuites ou
crues.
De la pierre félon fes ufages. On appelle première
pierre, celle qui avant que d’élever un mur de fondation
d’un édifice, eft deftinée à renfermer dans
une cavité d’une certaine profondeur, quelques médailles
d’or ou d’argent, frappées relativement à la
deftination du monument, 6c une table de bronze,
fur laquelle font gravées les armes de celui par les
ordres duquel on conftruit l’édifice. Cette cérémonie
qui fe fait avec plus ou moins de magnificence,
félon la dignité de la perfonne, ne s’obferve cependant
que dans les édifices royaux & publics,
& non dans les bâtimens particuliers. Cet ufage
éxiftoit du tems des Grecs, & c’eft par ce moyen
qu’on a pu apprendre les époques de l’édification de
leurs monumens, qui fans cette précaution feroit
tombée dans l’oubli, par la deftru&ion de leurs bâtimens
, dans les différentes révolutions qui font fur-
venues.
Derniere pierre, celle qui fe place fur l’une des
faces d’un édifice, & fur laquelle on grave des inf-
criptions, qui apprennent à la poftérité le motif de
fon édification, ainfi qu’on l’a pratiqué aux piédef-
taux des places Royale, des Victoires, de Vendôme i
à Paris, & aux fontaines publiques, porte S. Martin,
faint Denis, faint Antoine, &c.
Pierre percée, celle qui eft faite en dalle (« ) , 8c
quifepofefur le pavé d’une cour, remife ou écurie
, ou qui s’encaftre dans un chafîis aufli de pierre
foit pour donner de l’air ou du jour à une cave , ou
('0 Dali* eh une pierre place & très-mince.
fur un puifard pour donner paffage aux e aui plu viales
d’une ou de plufieurs cours.
Pierre à chafjis, celle qui a une puvèrturé circulaire,
quarrée, bu re&angulaire, de quelque grandeur
que ce foit, avec feuillure ou fans feuillure ;
pour recevoir une grille de fer maillée ou non maillée,
percée ounoh percée, 8c fervir de fermeture
à un regard, foffe d’aifance, 6*c.
Pierre à évier, du latin emijfarium , celle qui eft
creufe, & que l’on place à rez-de-chauffée, ou à 1
hauteur d’appui, dans un lavoir ou une cuifine,
pouf faire écouler les eaux dans les dehors. On ap-'
pelle encore de ce nom une efpece de canal long 8c
étroit, qui fert d’égout dans une cOur ou allée de'
maifon.
Pierre à laver, celle qui forme une efpece d’auge'
plate, 8c qui fert dans une cuifine pour laver la
vai (Telle.
Pierre perdue, celle que l’on jette dans quelque*
fleuves, rivières, lacs , ou dans la mer, pour fort^
der, 8c que l’on met pour cela dans des caiflons,
Iorfque la profondeur ou la qualité du terrain ne
permet pas d’y enfoncer des pieux ; on appelle aufli
de ce nom celles qui font jettées à baies de mortier
dans la maçonnerie de blocage.
Pierres incertaines, ou irrégulières, Celles que l’on
emploie au fortir de'la carrière, 8c dont les angles
8c les pans font inégaux : les anciens s’en fervoient
pour paver; les ouvriers' la nomment de pratique,-
parce qu’ils la font fervir fans y travailler.
Pierres jeclices, celles qui fe peuvent pofer à la
main dans toute forte de conftruûion, & pour le
tranfport defquelles on n’eft pas obligé de fe fervir
de machines.
Pierres d'attente, celles que l’on a laifle en bôf-
fage, pour y recevoir des ornemens, ou inferiptions
taillées, ou gravées en place. On appelle encore de
ce nom celles qui lors de la conftruâion ont été laif-
fées en harpes ( * ) , ou arrachement (ÿ ) , pour attendre
celle du mur voifin.
Pierres de rapport, celles qui étant de différentes^
couleurs, fervent pour les compartimens de pavés
mofaïques ( ç ) , 8c autres ouvrages de cette efpece.
Pierres précieufes, toutes pierres rares, comme
l’agate, le lapis, l’aventurine, 8c autres , dont on
enrichit les ouvrages en marbre 8c en marqueterie,
tel qu’on en voit dans l’églife des carmélites de la
ville de L y on , où le tabernacle eft compofé de marbre
8c de pierres précieufes, 8c dont les ornemens
font de bronze.
Pierre fpéculaire, celle qui chez les anciens étoit
tranfparente comme.le talc, qui fe débitôit par feuillet
, 8c qui leur fervoit de vitres ; la meilleure, félon
Pline, venoit d’Efpagne : Martial en fait mention
dans fes épigrammes, livre II.
Pierres milliaires, celles qui en forme de focle, ou
de borne, chez les Romains, étoient placées fur les
grands chemins, 8c efpacées de mille en mille, pour
marquer la diftance des villes dé l’empire, 8c fe
comptoient depuis la milliaire dorée de Rome, tel
que nous l’ont appris les hiftoriens par les mots de
primus, fecundus, ternus, & c. ab urbe lapis ; cet ufage
exifte encore maintenant dans toute la Chine.
Pierres noires, celles dont fe fervent les ouvriers
dans le bâtiment pour tracer fur la pierre : la plus
tendre fert pour aefliner fur le pa'pier. On appelle
(x) Harpes, pierres qu’on a laiffées- à l ’épai fleur d’un mur
alternativement en faillie, pour faire liaifon avec un mur voi-
fin qu'on doit élever par la fuite.
■ ( y ) Arrachemens font des pierres ou moilonsàuffi en faillie,
qui attendent l’édification du mur voilin.
(?) Mofdique, ouvrage compofé de verres de toutes fortes dp/
couleurs, taillés & ajuftés quarrément fur un fond de ftuc ,
qui imitent très-bien les diverfes couleurs de la peinture, &
avec lefquels on exécute différens fujets.
encore
.encorepierre blanche ou craye, celle qui eft employée ■
aux mêmes ufages : la meilleure vient de Champagne.
. ■
Pierre d'appui, ou feulement appui, celle qui étant
placée dans le tableau inférieur d’une croifée, fert
à feppuyer- v f ' ; k , , ,
Auge, du latin lavatrina, une pierre placée dans
des bafles-cours, pour fervir d’abreuvoir aux animaux
domeftiques.
Seuil, du latin limen, celle cfui eft pofée au rez-
de-chauflée, dont la longueur traverfe la porte , &
qui formant une efpece de feuillure , fert de batte^ -
ment à la traverfe inférieure du chaflis de la pôrte
de menuiferie.
Borne, celte qui a ordinairement la forme d’un
cône de deux ou trois piés de hauteur, tronqué dans
fon fommet, 8c qui fe place dans l’angle d’un pavillon
, d’un avant-corps , ou dans celui d’un piédroit
de porte cochcre-, ou de remife, ou le long d’un
mur, pour en éloigner les voitures, 8c empêcher
que les moyeux ne les écorchent 8c ne les faffent
éclater.
Banc, celle qui eft placée dans des cours, bafles-
cours , où à la principale porte des grands hôtels ,
pour fervir de fiege aux domeftiques, ou dans un
jardin, à ceux qui s’y promènent.
Des libages. Les libages font de gros motions ou
quartiers de pierre ruftique 8c malfaite, de quatre,
cinq, flx, & quelquefois fept à la v o ie , qui ne peuvent
être fournis à la toifepar le carrier, 8c que l’on
ne peut équarrir que groflierement , à caufe de
leur durete, provenant le plus fouvent du ciel des
carrières, ou d’un banc trop mince. La qualité des
libages eft proportionnée à celle de la pierre des
différentes carrières d’oit on les tiré : on ne s’en fert
que pour les garnis, fondations, 8c autres ouvrages
de cette cfpeeê. On .emploie encore en libage les
pierres de taille qui ont été coupées, ainfi que celles
qui proviennent des démolitions , 8c qui ne peuvent
plus fervir.
On appelle quartier de pierre, lorfqu’il n’y en a
qifitn à la voie.
Carreaux de pierre, lorfqu’il y en a deux ou trois.
Libage, lorfqu’il y en a quatre, cinq, f ix , ôc quelquefois
fept à la voie.
Du moilon. Le moilon, du latin mollis, que V i-
truve appelle coementum, n’étant autre chofe que
l’éclat de la pierre, en eft par conféquent la partie
la plus tendre ; il provient aufli quelquefois d’un
hanc trop mince. Sa qualité principale eft d’être bien
équarri 8c bien giflant, parce qu’alors il a plus de
l i t , 8c confomme moins de mortier ou de plâtre.
Le meilleur eft celui que l’on tire des carrières
d’Arcueil. La qualité des autres eft proportionnée à
la pierre des carrières dent on le tire, ainfi que celui
du faubourg faint Jacques, du fauboug faint Marceau,
deVaugirard, & avitres.
On l’emploie de quatre maniérés différentes ; la
première qu’on appelle en moilon de plat, eft de le
pofer horifontalement fur fon lit, & en liaifon dans
la conftruûiondes murs mitoyens, de refend 8c autres
de cette efpece élevés d’aplomb. La fécondé
qu’on appelle en moilon d'appareil, 8c dont le parement
eft apparent, exige qu’il foit bien équarri, à
vives arrêtes, comme la pierre, piqué proprement,
de hauteur, Sc de largeur égale , 8c bien pôle de niveau,
& en liaifon dans la conftruâion des murs de
fa c e , de terraffe, &c. La troifieme qu’on appelle en
'rtioilon de coupe, eft de le pofer fur fon champ ( & )
dans la conftruâion des voûtes. La quatrième qu’on
appelle en moilon piqué, eft après l’avoir équarri &
ebouriné, de le piquer fur fon parement avec >la
(fi*) Le champ d’une pierre platte, eft la fur fa ce la plus
niince'& la plus petite.
Tome IX .
pointe du marteau, fig. cj 1 , pour la conftru&ion des
voûtes des caves, murs de bafles-cours, de clôture,
de puits, &c.
Du moilon filon fes façons. On appelle motion
blanc, chez les ouvriers, un platras, & non un moilon
; ce qui eft un défaut dans la conftru&ion.
Moilon efmillé, celui qui eft groflierement équarri,
& ébouzîné avec la hachette, fig. 10C, à l’ufage
des murs de parcs de jardin, Sc autres de peu d’importance.
Moilon bourru ou de. blocage, celui qui eft trop
mal-fait 6c trop dur pour être équarri, 6c que l’on
emploie dans les fondations, ou dans l’intérieur des
murs, tel qu’il eft forti de la carrière.
Le moilon de roche, dit de meuliere, eft de cette derniere
efpece.
Toutes ces efpeces de moilons fe livrent à l’entrepreneur
à la voie ou à la toife, 6c dans ce dernier
cas l’entrepreneur fe charge du toifé.
Du marbre en général. Le marbre, dil latin mar-
mor, dérivé du grec p.app.tpuv, reluire, à caufe du poli
qu’il reçoit, eft une efpece de pierre de roche extrêmement
dure, qui porte le nom des différentes provinces
où font les carrières dont on le tire. Il s’en
trouve de plufieurs couleurs ; les unS font blancs ou
noirs, d’autres font variés ou mêlés de taches, veines,
mouches, ondes ôc nuages, différemment colorés
; les uns 6c les autres font opaques, le blanc
feul eft tranfparent, lorfqu’il eft débité par tranches
minces. Aufli M. Félibien rapporte-t-il que les anciens
s’en fervoient aii lieu de verre pour les croi-
fées des bains , étuves 6c autres lieux qu’on vouloit
garantir du froid; 6c qu’à Florence, il y avoit une
églife très-bien éclairée, dont les croifees en étoient
garnies. -
Le marbre fe divife en deux efpeces ; l’une qu’on
appelle antique, 8c l’autre moderne : par marbre antique
, l ’on comprend ceux dont les carrières font
épuifées, perdues ou inacceflibles, 8c que nous n©
connoiffons que par lès ouvrages des anciens : par
marbres modernes, l’on comprend ceux dont on fe
fert a&uellement dans les bâtimens, 8c dont les carrières
font encore exiftantes. On ne l ’emploie le plus
communément, à caufe de fa cheretée, que par re-
vêtiflement ou incruftation, étant rare que l’on en
fafle ufage en bloc, à l’exception des vafes, figures,
colonnes 8c autres ouvrages de cette efpece. Il fe
trouve d’affez beaux exemples de l’emploi de cette
matière dans la décoration intérieure & extérieure
des châteaux de Verfailles , Trianon, Marly „
Sceaux , &c. ainfi que dans les différens bofquets de
leurs jardins.
Quoique la diverfité des marbres foit infinie, on
les réduit cependant à deux efpeces; l’une que l’on
nomme veiné, & l ’autre breche; celuj- ci n’étant autre
chofe qu’un amas de petits cailloux de différente
couleur fortement unis enfemble, de maniéré que
lorfqu’il fe caffe, il s’en forme autant de breches qui
lui ont fait donner ce nom.
Des marbres antiques. Le marbre antique, dont les
carrières étoient dans la Grece, 8c dont on voit encore
de fi belles ftatues en Italie, eft abfolument inconnu
aujourd’hui ; à fon défaut on fe fert de celui
de Carrare.
Le lapis eft eftimé le plus beau de tous les marbres
antiques; fa couleur eft d’un bleu foncé, moucheté
d’un autre bleu plus clair, tirant fur le célefte, 6c
entremêlé de quelque veines d’or. On ne s’en fert,
â caufe de fa rareté, que par incruftation, tel qu’on
en voit quelques pièces de rapport à plufieurs tables
dans les appartemens de Trianon 8c de Marly.
Le porphyre, du grec aaopipupos , pourpre, paffe
pour le plus dur de tous les marbres antiques, 6c ,
après le lapis, pour un des plus beaux; il fe droit