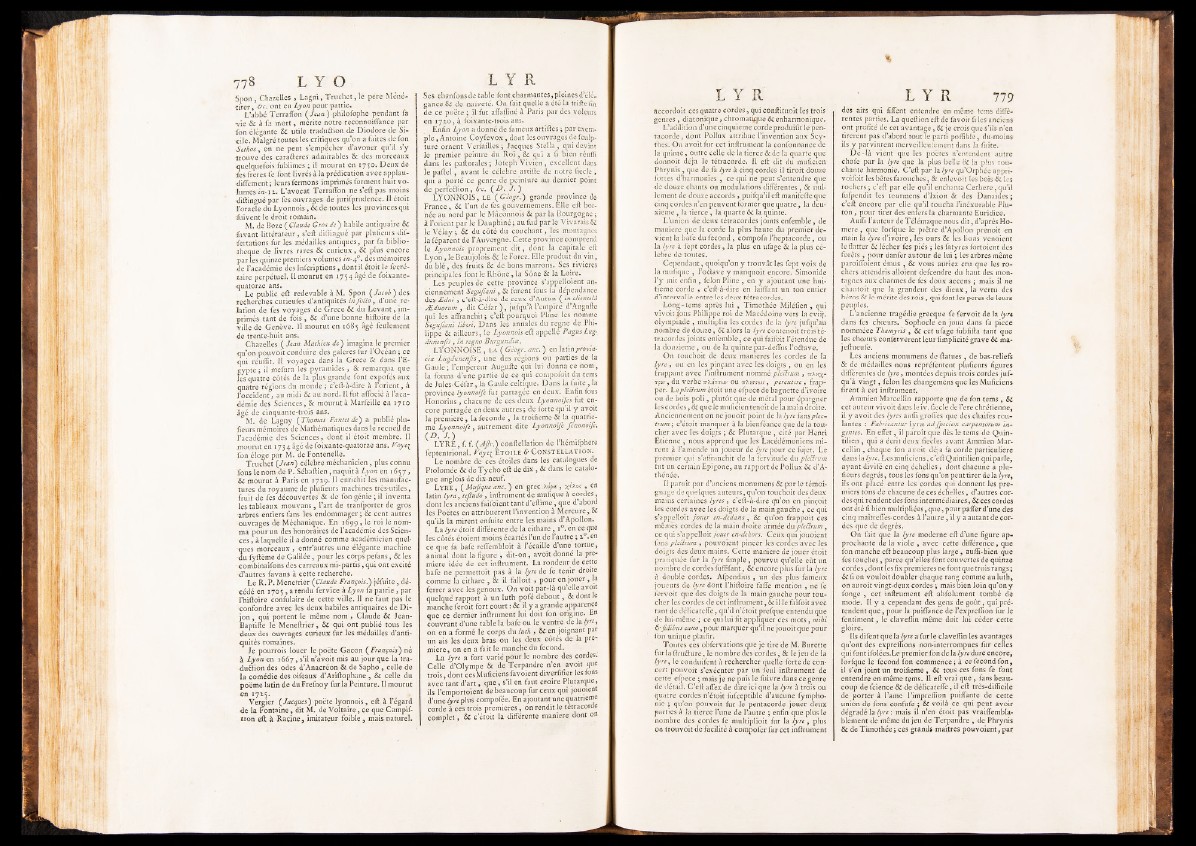
773 L Y O
Spon, Chazelles , Lagni, Truchet, le pere Méné-
'tirer, <5>c. ont eu Lyon pour patrie.
L ’abbé Terraflbn {Jeun) philofophe pendant fa
-vie & à la mort, mérite notre reconnoiffance par
fon élégante & utile tradu&ion de Diodore de Sicile
. Malgré toutes les critiques qu’on a faites de fon
Sethos, on ne peut s’empêcher d’avouer qu’il s’y
trouve des caraéleres admirables & des morceaux
-quelquefois fublimes ; il mourut en 1750. Deux de
-fes freres fe font livrés à la prédication avec applau-
diffement; leurs fermons imprimés forment huit vo-
slumes in- 12. L’avocat Terraflbn ne s’eft pas moins
diftingué par fes ouvrages de jurifprudence, Il étoit
l’oracle du Lyonnois, & d e toutes les provinces qui
Suivent le droit romain.
M. de Boze {Claude Gros de) habile antiquaire &
dfavant littérateur, s’eft diftingué par plufieùrs dif-
Tertations fur les médailles antiques, par fa bibliothèque
de livres rares & curieux, &t plus encore
par les quinze premiers volumes in-40. des mémoires
•de l’académie des Infcriptions, dont il étoit le fecré-
taire perpétuel. Il mourut en 1754 âgé de foixante-
quatorze ans.
Le public eft redevable à M. Spon ( Jacob ) des
recherches curieufes d’antiquités in folio, d’une relation
de fes voyages de Grece & du Levant, imprimés
tant de fois , &c d’une bonne hiftoire dé la
ville de Genève. 11 mourut en 1685 âgé feulement
de trente-huit ans.
Chazelles { Jean Mathieu de') imagina le premier
qu’on pouvoit conduire des galeres fur l’Océan ; ce
qui réuffit. Il voyagea dans la Grece & dans l’Egypte
; il mefura les pyramides, & remarqua que
les quatre côtés de la plqs grande font expofés aux
quatre régions du monde ; c’eft-à-dire à l’orient, à
l’occident, au midi & au nord. Il fut aflbcié à l’académie
des Sciences, & mourut à Marfeille en 1710
âgé de cinquante-trois ans.
M. de Lagny {Thomas Fantetde) a publié plu-
fieurs mémoires de Mathématiques dans le recueil de
l ’académie des Sciences, dont il étoit membre. Il
mourut en 1734 âgé de foixante-quatorze ans. Foye[
Ton éloge par M. de Fontenelle.
Truchet {Jean) célébré méchanicien, plus connu
Tous le nom de P. Sébaftien, naquit à Lyon en 1657 , ‘
& mourut à Paris en 1729. Il enrichit les manufactures
du royaume de plufxeurs machines très-utiles,
fruit de fes découvertes* & de fon génie ; il inventa
les tableaux mouvans, l’art de tranfporter de gros
•arbres entiers fans les endommager ; & cent autres
ouvrages de Méchanique. En 1699 , le roi lé nomma
pour un des honoraires de l’académie des Science
s, à laquelle il a donné comme académicien quelques
morceaux , entr’autres une élégante machine
•du fyftème de Galilée, pour les corps pefans, & les
combinaifons des carreaux mi-partis, qui ont excité
-d’autres favans à cette recherche.
Le R. P. Menetrier {Claude François.) jéfuite, décédé
en 1705,8 rendu fervice à Lyon fa patrie, par
l’hiftoire confulaire de cette ville. II ne faut pas le
confondre avec les deux habiles antiquaires de Dijon
, qui portent le même nom, Claude & Jean-
Baptifte le Meneftrier, & qui ont publié tous les
deux des ouvrages curieux fur les médailles d’antiquités
romaines.
Je pourrois louer le poète Gacon ( François) né
à Lyon en 1667, s’il n’a voit mis au jour que la traduction
des odes d’Anacréon & de Sapho , celle de
la comédie des oifeaux d’Ariftophane , & celle du
poëme latin de duFrefnoy fur la Peinture. Il mourut
en 1725.
Vergier {Jacques) poète lyonnois, eft à l’égard
d e la Fontaine, dit M. de V oltaire, ce que Campif-
tron eft à Racine, imitateur foible , mais naturel.
L Y R Ses thanfons de table font charmantes, pleines d’élégance
de naïveté. On fait quelle a été la trifte fin
de ce poète ; il fut aflafiïné à Paris par des voleurs
en 1720, à foixante-trois ans.
Enfin Lyon a donné de fameux artiftes ; par exemple
, Antoine Coyfevox , dont les ouvrages de fculp-
ture ornent Veriailles; Jacques Stella , qui devint
le premier peintre du R o i, & qui a fi bien réufli
dans les paftorales ; Jofeph Vivien , excellent dans
le paftel, avant le célébré artifte de notre fiecle,
qui a porté ce genre de peinture au dernier point
de perfe&ion, &c. . ( D . J . )
LYONNOIS, l e {Géogr.) grande province de
France, & l’un de fes gouvernemens.Elle eft bornée
au nord par le Mâconnois & par la Bourgogne ;
à l’orient par le Dauphiné ; au fud par le Vivarais &
le V élay ; &C du côté du couchant, les montagnes
la féparent de l’Auvergne. Cette province comprend
le Lyonnois proprement dit, dont la capitale eft
Ly on , le Beaujolois & le Forez. Elle produit du vin,
du blé, des fruits &: de bons marrons. Ses rivières
principales font le Rhône, la Sône & la Loire.
Les peuples de cette province s'appelaient anciennement
Segujîqni, & furent fous la dépendance
des Edui , c’eft-à-dire de ceux d’Autun ( in clientelâ
Æduorum , dit Céfar ) , jufqu’à l’empire d’Augufte
qui les affranchit ; c’eft pourquoi Pline les nomme
Segujîani liberi. Dans les annales du régné de ,Philippe
& ailleurs, le Lyonnois eft appellé Pagus Lug-
durienjîs, în regno Burgundice.
LYONNOISE, LA ( Géogr. anc. ) en latin provin-
cia Lugdunenfis'j une des régions ou parties de la
Gaule; l’empereur Augüfte qui lui donna ce nom,
la forma d’une partie de ce qui compofoit du tems
de Jules-Céfar, la Gaule celtique. Dans la fuite, la
province lyonnoife fut partagée en deux. Enfin fous
Honorius , chacune de ces deux Lyonnoijes fut encore
partagée en deux autres; de forte qu’il y avoit
la première, la fécondé , la troifieme & la quatrième
Lyonnoife , autrement dite Lyonnoife fénonoife.
{D . J .)
L Y R E , f. f. {AflrJ) conftellation de l’hémifphere
feptentrional. Vôye^ Ét o i l e & C o n s t e l l a t io n .
Le nombre de ces étoiles dans les catalogues de
Ptolomée & de Tycho eft de d ix , & dans le catalogue
anglois de dix-neuf.
L y r e , ( Mufique anc. ) en grec .xùpa'ç %iXuç , en
latin lyra, tejludo, infiniment de mufique à cordes,
dont les anciens faifoient tant d’eftime, que d’abord
les Poètes en attribuèrent l’invention à Mercure, &
qu’ils la mirent enfuite entre les mains d’Apollon.
La lyre étoit différente de la cithare, i° . en ce que
les côtés étoient moins écartés l’un de l’autre ; 20. en
ce que fa bafe reffembloit à l’écaille d’une^ tortue,
animal dont la figure , dit-on, avoit donne la première
idée de cet infiniment. La rondeur de cette
bafe ne permettoit pas à la lyre de fe tenir droite
comme la cithare , & il falloit , pour enrouer, la
ferrer avec les genoux. On voit par-là qu’elle avoit
quelque rapport à un luth pofé debout, & dont le
manche feroit fort court : & il y a grande apparence
que ce dernier infiniment lui doit fon origine. En
couvrant d’une table la bafe ou le ventre de la lyre,
on en a formé le corps du luth , & en joignant par
un ais les deux bras ou les deux cotés de la pre*.
miere, on en a fait le manche du fécond. (
La lyre a fort varié pour le nombre des cordes.’
Celle d’Olympe & de Terpandre n’en avoit que
trois, dont cesMuficiens fa voient diverfifier les fons
avec tant d’a r t , que, s’il en faut croire Plutarque,
ils l’emportoient de beaucoup fur ceux qui jouoient
d’une lyre plus compofée. En ajoutant une quatrième
corde à ces trois premières, on rendit le tétracorde
complet, & c étoit la différente maniéré dont on
%
L Y R
accordait ces quatre cordes, qui conftituoit les trois
genres , diatonique, chromatique & enharmonique.
L’addition d’une cinquième corde produifit le pen-
tacorde, dont Pollux attribue l’invention aux Scythes.
On avoit fur cet infiniment la confonnance de
la quime, Outre celle de la tierce & de la quarte que
donnoit déjà le tétracorde. Il eft dit du muficien
Phrynis , que de fa lyre à cinq cordes il droit douze
fortes d’harmonies , ce qui ne peut s’entendre que
de douze chants ou modulations différentes , & nullement
de douze accords , puifqu’il eft manifefte que
cinq cordes n’en peuvent former que quatre, la deuxieme
, la tierce , la quarte & la quinte.
L ’union de deux tétracordes joints enfemble, de
maniéré que la corde la plus haute du premier devient
la bafe du fécond , compofa l’heptacorde, ou
la lyre à fept cordes, la plus en ufage & la plus célébré
de toutes.
Cependant, quoiqu’on y trouvât les fept voix de
la mufique , l’oélave y manquoit encore. Simonide
l’y mit enfin , félon Pline , en y ajoutant une huitième
corde , c’eft-à-dire en laiffant un ton entier
d’intervalle entre les deux tétracordes.
Long-tems après lui , Timothée Miléfien , qui
vivoit^ous Philippe roi de Macédoine vers la eviij.
olympiade , multiplia les cordes de la lyre jufqu’au
nombre de douze, & alors la lyre c'ontenoit trois tétracordes
joints enfemble, ce qui faifoit l’étendue de
la douzième, ou de la quinte par-deffus l’oflave.
On touchoit de deux maniérés les cordes de la
lyre , ou en les pinçant avec les doigts , ou en les
frappant avec l’inftrument nommé pleclrum ,
T(w , du verbe'wX«TTe/»' ou ttXwcuv, percutcre, frapper.
Lepleclrum étoit une efpece de baguette d’ivoire
ou de bois poli, plutôt que de métal pour épargner
les cordes, & que le muficien tenoit de la main droite.
Anciennement on ne jouoit point de la lyre fansplec-
trum; c?étoit manquer à la bienféance que delà toucher
avec les doigts ; & Plutarque , cité par Henri
Etienne , nous apprend que les Lacédémoniens mirent
à l’amende un joueur de lyre pour ce fujet. Le
premier qui s’affranchit de la fervitude du pleclrum
fut un certain Epigone, au rapport de Pollux & d’A-
thénée.
Il paroît par d’anciens monumens & par le témoignage
de quelques auteurs,qu’on touchoit des deux
mains certaines lyres, c’eft-à-dire qu’on en pinçoit
les cordes avec les doigts de la main gauche, ce qui
s’appelloit jouer en-dedans, & qu’on frappoit ces
mêmes cordes de la main droite armée du pleclrum,
ce qui s’appelloit jouer en-dehors. Ceux qui jouoient
fans pleclrum , pouvoient pincer les cordes avec les
doigts des deux mains. Cette maniéré de jouer étoit
pratiquée fur la lyre fimple, pourvu qu’elle eût un
nombre de cordes fuffifant, & encore plus fur la lyre
à double cordes. Afpendius , un des plus fameux
joueurs.de lyre dont l’hiftoire faffe mention , ne fe
fervoit que des doigts de la main gauche pour toucher
les cordes de cet infiniment, & il le faifoit. avec
tant de délicateffe, qu’il n’étoit prefque entendu que
de lui-même ; ce qui lui fit appliquer ces mots fmihi
& fidibus cano, pour marquer qu’il ne jouoit que pour
fon unique plaifir.
Toutes ces obfervations que je tire de M. Burette
fur la ftruéture, le nombre des cordes, & le jeu de la
lyre, le conduifent à rechercher quelle forte de concert
pouvoit s’exécuter par un feul inftrument de
cette efpece ; mais je ne puis le fuivre dans ce.genre
de détail. C ’eft affez de dire ici que la lyre à trois ou
quatre cordes n’étoit fufceptible d’aucune fympho-
nie ; qu’011 pouvoit fur le pentacorde jouer deux
parties à la tierce l’une de l’autre ; enfin que plus le
nombre des cordes fe multiplioit fur la lyre, plus
on trouvoit de facilité à compofer fur cet inftrument
L Y R 779
des airs qui fiffent entendre en même tems différentes
parties. La queflion eft de favoir fi les anciens
ont profité de cet avantage, & je crois que s’ils n’en
tirèrent pas d’abord tout le parti poflible, du-moins
ils y parvinrent merveilleufement dans la fuite.
D e - là vient que les poètes n’entendent autre
chofe par la lyre que la plus belle & la plus touchante
harmonie. C ’eft par la lyre qu’Orphée appri-
voifoit les bêtes farouches, & enlevbit les bois & les
rochers ; c’eft par elle qu’il enchanta Cerbere, qu’il
fufpendit lès tourmens d’Ixion & des Danaïdes ;
c’eft encore par elle qu’il toucha l’inéxorable Plu-
ton, pour tirer des enfers la charmante Euridice.
Aufli l’auteur de Télémaque nous dit, d’après Homère
, que lorfque le prêtre d’Apollon prenoit en
main la lyre d’ivoire, les ours & les lions venoient
le flatter & lécher fes piés ; les fatyres fortoient des
forêts , pour danfer autour de lui ; les arbres même
paroiffoient émus , & vous auriez cru que les rochers
attendris alloient defeendre du haut des montagnes
aux charmes de fes doux accens ; mais il ne
chantoit que la grandeur des dieux, la vertu des
héros & le mérite des rois, qui font les peres de leurs
peuples.
L ’ancienne tragédie grecque fe fervoit de la lyr«
dans fes choeurs. Sophocle en joua dans fa piece
nomméee Thamyris , & cet ufage fubfifta tant que
les choeurs conferverent leur fimplicité grave & ma-
jeftueufe.
Les anciens monumens de ftatues , de bas-reliefs
& de médailles nous repréfentent plufieurs figures
différentes de lyre , montées depuis trois cordes jufqu’à
vingt, félon les changemens que les Muficiens
firent à cet inftrument.
Ammien Marcellin rapporte que de fon tems , &
cet auteur vivoit dans le iv. fiecle de l’ere chrétienne,
il y avoit des lyres aufli groffes que des chaifes roulantes
: Fabricantur lyræ adfpeciem carpentorum in-
gentes. En effet, il paroît que dès le tems de Quin-
tilien , qui a écrit deux fiecles avant Ammien Marcellin
, chaque fon avoit déjà fa corde particulière
dans la lyre. Les muficiens, c ’eft Quintilien qui parle,
ayant divifé en cinq échelles, dont chacune a plufieurs
degrés, tous les fons qu’on peut tirer de la lyrey
ils ont placé entre les cordes qui donnent les premiers
tons de chacune de ces échelles, d’autres cordes
qui rendent des fons intermédiaires, & ces cordes
ont été fi bien multipliées, que, pour pafferd’une des
cinq maîtreffes-cordes à l’autre, il y a autant de cordes
que de degrés.
On fait que la lyre moderne eft d’une figure approchante
de la viole , avec cette différence, que
fon manche eft beaucoup plus large, aufli-bien que
fes touches, parce qu’elles font couvertes de quinze
cordes, dont les fix premières ne font que trois rangs ;
& f i on vouloit doubler chaque rang comme au luth,
on aurôit vingt-dçux cordes ; mais bien loin qu’on y
longe , cet inftrument eft abfolument tombé de
mode. Il y a cependant des gens de goût, qui prétendent
que, pour la puiffance de I’expreflîon fur le
fentiment, le claveffin même doit lui- céder cette
gloire.
Ils difent que la lyre a furie claveffin les avantages
qu’ont des expreffions non-interrompues fur celles
qui font ifolées.Le premier fon de la lyre dure encore,
lorfque le fécond fon commence; à ce fécond fon,
il s’en joint un troifieme , & tous ces fons fe font
entendre en même tems. Il eft vrai que , fans beaucoup
de fcience & de délicateffe, il eft très-difficile
de porter à l’ame l ’impreffion puiffante de cette
union de fons confufe ; & voilà ce qui peut avoir
dégradé la lyre : mais il n’en étoit pas vraisemblablement
de même du jeu de Terpandre , de Phrynis
& de Timothée; ces grands maîtres pouvoient, par