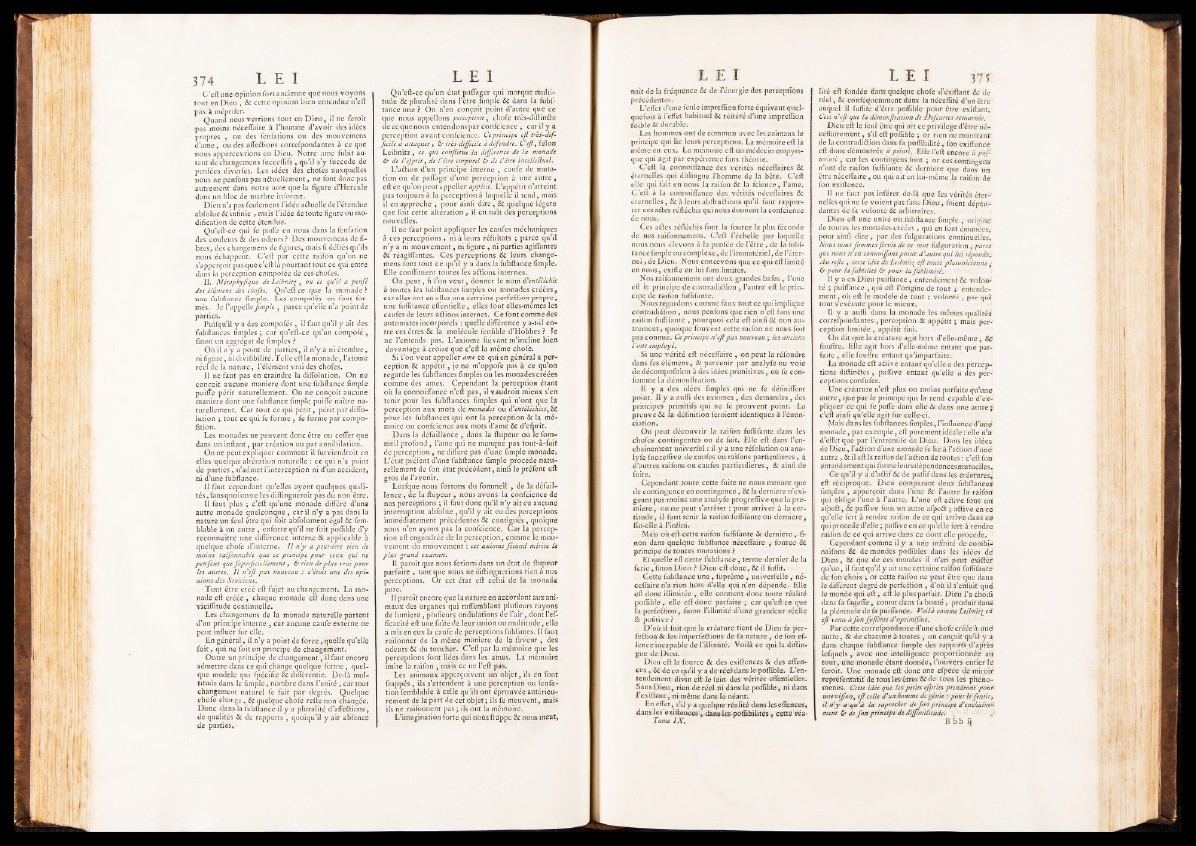
C ’eft une opinion fort ancienne que ilolis voyons
tout en Dieu , 6c cette opinion bien entendue n’eft
pas à méprifer.
Quand nous verrions tout en D ieu , il ne feroit
.pas moins néceffaire à l’homme d’avoir des idées
•propres , ou des fenfations ou des mouvemens
d’ame, ou des affeôions correfpondantes à ce que
nous appercevrions en Dieu. Notre ame fubit autant
dechangemens fucceflifs , qu’il s’y fuccede de
penfées diverfes. Les idées des chofes auxquelles
nous ne penfons pas actuellement, ne font donc pas
autrement dans notre ame que la figure d’Hercule
dans un bloc de marbre informe.
Dieu n’a pas feulement l’idée a&uelle de l’étendue
abfolue 6c infinie , mais l’idée de toute figure ou modification
de cette étendue.
Qu’eft-ce qui fe paffe en nous dans la fenfation
des couleurs & des odeurs ? Des mouvemens de fibres,
des changemens de figures, mais fi déliés qu’ils
nous échappent. C ’eft par "cette raifon qu’on ne
s’apperçoit pas que c’eft là pourtant tout ce qui entre
dans la perception compofée de ces chofes.
II. Métdphyftque de Leibnit^ , ou ce qu'il a penfé
des élémens des chofes. Qu’eft-ce qüe la monade ?
une fubftance fimple. Les compofés en font formés.
Je l’appellefimple , parce qu’elle n’a point de
parties.
Puifqu’il y a des compofés , il faut qu’il y ait des
fubftances limples ; car qu’eft-ce qu’un compofé ,
finon un aggrégat de fimples ?
Oh il n’y a point de parties, il n’y a ni étendue,
ni figure, ni divifibilité. Telle eftla monade, l’atome
réel de la nature, l’élément vrai des chofes.
Il ne faut pas en craindre la diflolution. On ne
conçoit aucune maniéré dont une fubftance fimple
puiffe périr naturellement. On ne conçoit aucune
maniéré dont une fubftance fimple puiffe naître naturellement.
Car tout ce qui périt, périt par diffo-
lution ; tout ce qui fe forme , fe forme par compo-
fition.
Les monades ne peuvent donc être ou ceffer que
dans un inftant, par création ou par annihilation.
On ne peut expliquer comment il furviendroit en
elles quelque altération naturelle : ce qui n’a point
de parties , n’admet l’interception ni d’un accidenr,
ni d’une fubftance.
Il faut cependant qu’elles ayent quelques qualités,
fans quoi on ne les diftingueroit pas du non être.
Il faut plus ; c’eft qu’une monade diffère d’ une
autre monade quelconque, car il n’y a pas dans la
natiire un feul être qui loit abfolument égal 6c fem-
blable à un autre , enforte qu’il ne foit poflible d’y
reeonnoître une différence interne & applicable à
quelque chofe d’interne. I l n'y a peut-être rien de
moins raifonnable qüe ce principe pour ceux qui ne
penfent que fuperficiellement, & rien de plus vrai pour
les autres. I l n'ejl pas nouveau : cétoit une des opi»
nions des Stoïciens.
-Tout être créé eft fujet au changement. La monade
eft créée , chaque monade eft donc dans une
viciflitude continuelle.
Les changemens de la inonade naturelle partent
d’un principe interne , car aucune caufe externe ne
peut influer fur elle.
En général, il n’y a point de force, quelle qu’elle
foit, qui ne foit un principe de changement.
Outre un principe de changement, il faut encore
admettre dans ce qui change quelque forme, quelque
modèle qui fpécffie & différentie. De-là multitude
dans le fimple, nombre dans l’unité, car tout
changement naturel fe fait par degrés. Quelque
chofe change , 6c quelque chofe refte non changée;
Donc dans la fubftance il y a pluralité d’âffe&ionS,
de qualités & de rapports , quoiqu’il y ait abfence
de parties^
Qu ’eft-ce qu’un état paflager qui marqiie multitude
6c pluralité dans l’etre fimple 6c dans la fubftance
une ? On n’en conçoit 'point d’autre que ce
que nous appelions perception', chofe très-diftinôe
de ce que nous entendonspar cohfcience * car il y a
perception avantconfcience. Ce principe eft très-dif
ftcile à attaquer , & très-difficile à défendre. C'eji, félon
Leibnitz, ce qui conftitue la différence de la monade
& de l'ejprit, de l'être corporel & de l'êtrt intellectuel.
L’attion d’un principe interne , caufe de mutation
ou de paflage d’une perception à une autre,
eft ce qu’on peut appeller appétit. L’appétit n’atteint
pas toujours à la perception à laquelle il tend, mais
il en approche , pour ainfi dire, 6c quelque légère
que foit cette altération, il en naît des perceptions
nouvelles.
11 ne faut point appliquer les caufes méchaniques
à ces perceptions, ni à leurs réftiltats ; parce qu’il
n’y a ni mouvement, ni figure , ni parties agiffantes
6c réagiffantes. Ces perceptions 6c leurs changemens
font tout ce qu’il y a dans la fubftance fimple.
Elle conftituent toutes les aérions internes.
On peut, fi l’on v eu t , donner le nom d'entélèchie
à toutes les fubftances fimples ou monades créées,
car elles ont en elles une certaine perfection propre,
une fuffilance effentielle, elles font elles-mêmes les
caufes de leurs aérions internes. Ce font comme des
automates incorporels : quelle différence y a-t-il entre
ces êtres 6c la molécule fenfible d’Hobbes ? Je
ne l ’entends pas. L ’axiome fuivant m’incline bien
davantage à croire que c’eft la même chofe.
Si l’on veut appeller ame ce qui en général a perception
& appétit, je ne m’oppofe pas à ce qu’oit
regarde les fubftances fimples ou les monades créées
comme des âmes. Cependant la perception étant
oïi la connoiflance n’eft pas, il vaudroit mieux s’en
tenir pour les fubftances fimples qui n’ont que la
perception aux mots de monades oit d'eritéléchies, 6c
pôur les fubftances qui ont la perception & la mémoire
ou confidence aux mots d’ame 6c d’efprit.
Dans la défaillance , dans la ftupeur ou le fom-
meil profond, l’ame qui ne manque pas tout-à-fait
de perception, ne diffère pas d’iine fimple monade.
L’état préfent d’une fubftance fimple procédé naturellement
de fon état précédent, âinfi le préfent eft
gros de l’avenir.
Lorfque nous fortons du fommeil , de la défaillance
, de la ftupeur, nous avons la confcience de
nos perceptions ; il faut donc qu’il n’y ait eu aucune
interruption abfohie , qu’il y ait eu des perceptions
immédiatement précédentes ÔC contiguës, quoique
nous n’en ayons pas la confcience. Car la perception
eft engendrée de la perception, comme le mouvement
du mouvement : cet axiome fécond mérite le
plits grand examen.
Il paroît que nous ferions dans un état de ftupeur
parfaite , tant que nous ne diftinguerions rien à nos
perceptions. Or cet état eft celui de la monade
pure.
Il paroît encore que la nature en accordant aux animaux
des organes qui raffeniblént plufièiirs rayons
de lumière, plufieurs ondulations de l’air, dont l’efficacité
eft une fuite de leur union ou ihultitude, elle
a mis en eux la caufe de perceptions fublimes. Il faut
raifonner de la même maniéré de là faveiir , des
odeurs 6c du toucher. C ’eft pâr la mémoire que les
perceptions font liées dans les «thjés. La mémoire
imite là raifon , mais ce ne l’eft pas.
Les animaux apperçoiveftt Un objet, ils én font
frappés , ils s’attendent à une jjëiception ou fenfation
femblable à celle qu’ils ont éprouvée antérieurement
de la part de cet objet ; ils fe meuvent, mais
ils ne raifopnent pas ; ils ont la mémoire.
L’imagination forte qui nous fïâppe 6c nous meut,
naît dë la fréquence 6c de l’énërgie des perceptions
précédentes.
L’effet d’une feule impreffion forte équivaut quelquefois
à l'effet habituel 6c réitéré d’une impremon
faible Si durable.
Les hommes ont de commun avec les animaux le
principe qui lie leurs perceptions. La mémoire eft là
même en eux. La mémoire eft un médecin empyri-
que qui agit par expérience fans théorie.
C ’eft la connoiflance des vérités nécèffaires &
éternelles qui diftingue l’homme de la bête. C’eft
elle qui fait en nous la raifon & la fcience, l’ame;
C ’eft à la connoiflance des vérités néceffaires &
éternelles, 6c à leurs abftra&ions qu’il faut rapporter
ces aCtes réfléchis qui nous donnent la confidence
de noüsv
Ces aCtes réfléchis font là fource la plus féconde
de nos raifonnemens. C ’eft l’échelle par laquelle
nous nous élevons à la penfée de l’être, de la fubfi
tance fimple ou complexe, de l’immatériel, de l’éternel
, de Dieu. Nous concevons que ce qui eft limité
en nous , exifte en lui fans limites*
Nos raifonnemens ont deux grandes bafes , l ’une
eft lé principe de contradiction, l’autre eft le principe
de raifon fuffifante.
Nous regardons comme faux tout ce qui implique
contradiction, nous penfons que rien n’eft fans une
raifon fuffifante , pourquoi cela eft ainfi 6c non autrement
, quoique fouvent cette raifon ne nous foit
pas connue. Ce principe n'ejl pas nouveau ; les anciens
l'ont employé.
Si une vérité eft, néceffaire , on peut la réfoudre
dans fes élémens, & parvenir par analyfe ou voie
de décompofition à des idées primitives, où fe con-
fomme la démonftration.
. II y a des- idées fimples qui ne fe définiffent
point. Il y a aufli des axiomes j des demandes ^ des
principes primitifs qui ne fe prouvent point. La
preuve 6c la définition- ferôient identiques à' l’énonciation.
Ort peut découvrir la raifon fuffifante dans lés
chofes contingentes ou- de fait. Elle eft dans l’en-
ehaînement univerfel : il- y a une réfolution ou analyfe
fuciseffive de caufes oü raiforts particulières , à
d’autres raifons ou caufes particulières!, & ainfi de
fuite.
Cependant .toute cette fuite ne nous menant que
de contingence en contingence ,• 6c la derniere n’exigeant
pas moins une analyfe progreflive que la première,
on.riepeut s’arrêter : pour arriver à la certitude,
il- faut tenir la raifon fuffifante ou derniere,
fût-ellé à l ’intlni.
Mais oii eft cette raifon fuffifante & derniere ,■ finon
dans- quelque fubftance néceffaire ,• fource 6c
principe de toutes mutations ?
Et quelle eft cette fubftance, terme dernier de la
ferie, finon Dieu ?' Dieu eft donc, & il fuffit.
Cette fubftance une, fuprême, univerfelle ,- néceffaire
n’a rien hors d?elle qui n’en dépende. Elle
eft donc illimitée , elle contient donc toute réalité
poflible , elle cArdonO parfaite ;■ car qu’elbee que
la perfection, finon l’illimité d’uné grandeur réelle
& pofitive ?
D ?où i i fuitique la créature-tient de Dieu fa perfection
& les) imperfections- de fa nature, de fon ef-
fence incapable de rillimitév- Voilà- ce qui la diftingue
de Dieu. .
Dieu eft la fource & des exiftences & des effetf*
c e s , & de ce qu’ il y a de'réekdans le poflible. L’èn-
tendementi divin eft- lé feift; des vérités effentielles;
Sans>Dieu,:rien deréeLrii dans le poflible,- ni danis
l ’exiftant, ni -même darrsile néant;
En effet, s’il y a quelque' réalité dans les effences,
•dans les exiftences , dansdes-poflibilités ,■ cette réa-
Tome IX ,
lire èft fondée dans quelque chofe cTexiftant &: de
réel, & conféqnemment dans la néceffité d’un être
auquel il fuffite d’être poflible pour êtfe exiftant.
Ceci n’ejl que la démonjlràiion de Dejcartts retournée.
Dieu eft le feul être qui ait ce privilège d’être né-
ceffairement, s’il eft poflible ; or rien ne montrant
de la contradiftion dans fa poffibilité, fon exiftenéë
eft donc démontrée à priori. Elle i’eft encore à p à f
teriori, caries contingéns foht ; or ces conïingens-
n’ont de raifon fuffifante 6c derniere que dans un
être néceffaire , ou qui ait en lui-même la raifon dë
fon exiftence.
Il ne faut pas inférer de-là que les vérités éternelles
qui ne fe voient pas fans Dieu , fôiént dépéri-
dantes de fa volonté & arbitraires.
Dieu eft une unité ou .fubftance fimple ,- originé'
de toutes les monades créées , qui en font émanées^
pour ainfi dire , par,des fulgurations continuelles.
Nous nous fommes fervis de ce mot fulguration -, parce’
qüe flous n'en comioiffonspoint d’autre qui lui réponde *
Au refte j cette idée de Leibnit^ èft toute platonicienne
& pouf lafübiilité & pour la fabliruitè.
II y a en D ieu puiffànce, entendemehb& volon^
té ; puiffànce , qui eft l’origine de tout f entendement,
où eft le modèle de tout ; volonté , par quï
tout s’exécute pour le mieux.
Il y a aufli dans la monade lés mêmes qualités
correfpondantes , perception & appétit ; mais perception
limitée, appétit fiHi.
On dit que la créature agit hors d’ellé-même, 6â
fouffre. Elle agit hors d’elle-même entant que parfaite
, elle fouffre entant qu’imparfaite-
La mo'nafcle eft aûive entant qu’elle à des perceptions
diftinâes , paflive entant qu’elle a des perceptions
confufes.
Ufie créature n’eft plus oü moins parfaite qu’une
autre, que par le principe qui la- rend capable d’expliquer
ce qui fe paffe dans elle & dans une autre $
c’eft ainfi qu’elle agit fur celle-ci.
Mais dans les fubftances-fimples, l’influertcé-d’iirie?
monade, par exemple, eft purement idéale r elié rira1
d’éffet que par i’entrëmife' de Dieu. Dans les idées
de D ieu , l’aftion d’une monade fe lie'à l’aêtion d’une?
autre, & il eft la raifon deraérion de toütes: : c’eft fon-
entendement qui'formieleursdépenda'ncesmufuèlles.
Gè qu’il y a d’aéHf 6c de pafîif dans les créatures,’
eft réciproque. Dieu comparant deux fubftances
fimples , apperçoit dans1 l’une & l’autre la1 râifoiï
qui oblige l’une à l’autre. L’une eft a&iVe foüs ùri
afpeft , 6c paflive fbtis ün'aiitre afpeâ: aftive en ce
qu’elle fert à rendre raifon de ce qui àrriVè dans c e
qui procédé d’elle ; paflive én ce quelle fert à ré'ndre
raifon de ce qui arrive dans ce dont elle procède.
Cependant comme il y a une infinité de combi-
naifons 6c de mondes poflîbles dans’ lës- idées dë
D ie u , 6c que de ces mondes il n’en peut èxüftei?
qu’un, il faut qu’il y ait une certaine raifon fùffifanté
de foiï c;hoix: ; or cette raifon ne peut être que dans
le différent degré de perfe&ion , d’où il s’enfuît' qüê
le monde qui e ft, èft le plus-parfait. Dieu T a cHôifi
dans fa fageffe, connu dans fa-bonte , produifdans
la plénitude de fa puiffànce. Voilà comme Leibriit£ cri
eft venu afinfyftême d'optimifme.
Paï-cette corf efpondance d’une chofe'cr'é'ée à 'iiné
autre, & de chacune à toutes,- on conçoit;qü?iÉ y a
dans chaque fùbftarice fimple dès ràppo^fS'd’àprèd
lefqüéls,- avec- une intelligence proportionnée aui
tout, une monade étant- doHnée, rurtivers- entier lé
feroit. Une monade eft donc une efpefeé dé miroié
repréfentatif de tous l e s é f r ë s d e ; tbtis lës phénomènes;
Cette idée que lest' pttvtS'ifprïts 'pfendronl-pout
une vifton, eft celle d’uf&Hornffte de getiie t'poiir l'efeniir,
ilû'y* a^qulà la raprocher de jotiprihcipe d'enchaîne^
ment & de fori-ptineipe’d&dijfittiilitudel- •„ j - - : JB
b b ij