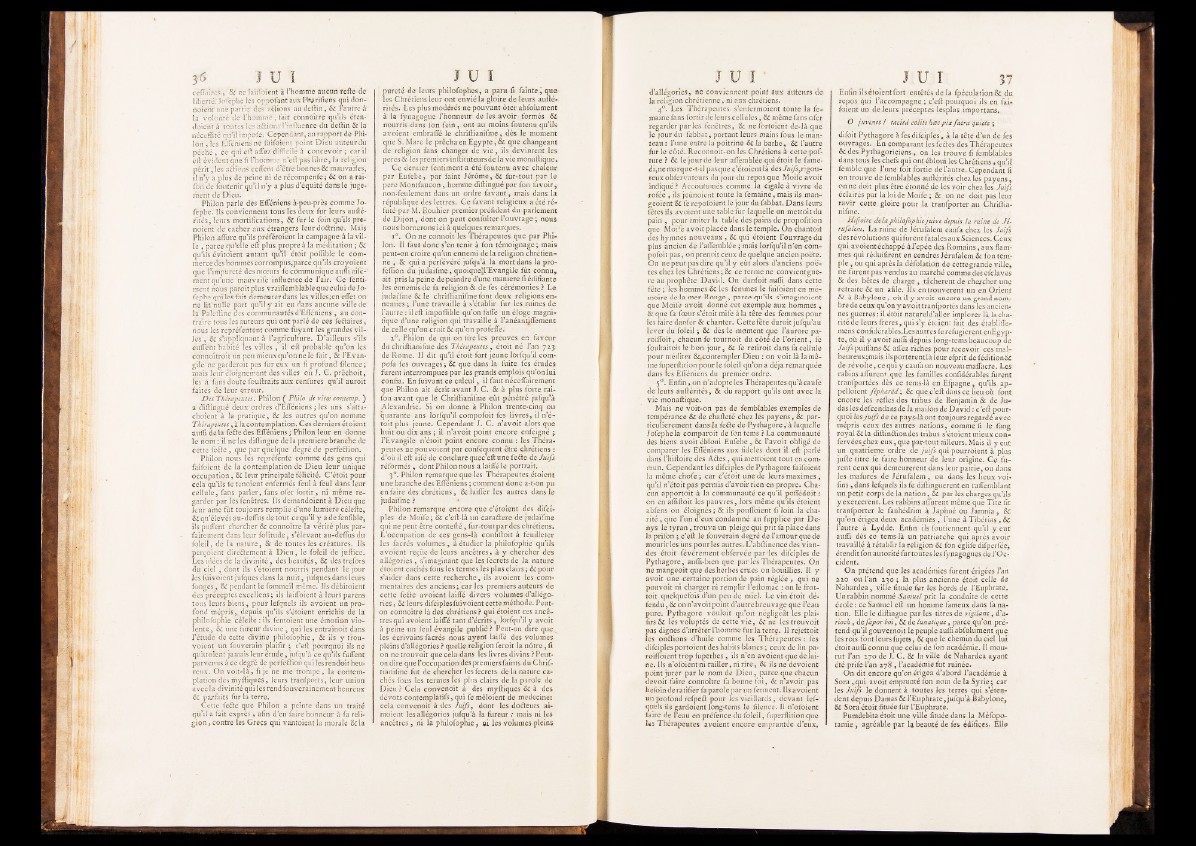
36 JUI
ceffaireè , 81 ne Iaiffoient à l’homme aucun refte de
liberté; jofephe les oppofant aux Pharifiens qui don-
rioient une partie dés-' attions au deftin, & l’autre à
la vôlontc de l’homme, fait connoître qu’ils éten-
doieht à tontes les aftions l’influence du deftin & la
neceffité qu’il impofe. Cependant, au rapport de Phi-
Ion , les Efféniens ne faifoient point Dieu auteur du
péché, ce qui eft allez difficile à concevoir; car il
ert évident que fi l’homme n’eft pas libre, la religion
périt, les a&ïons ceffent d’être bonnes &c mauvaifes,
il n’y a plus de peine ni de récompenfe ; & on a raifort
de foutenir qu’il n’y a plus d’équité dans le jugement
de Dieu-
Philon parle des Efféniens à-peu-près comme Jofephe.
Ils conviennent tous les deux fur leurs auftérités,
leurs mortifications, & fur le.foin qu’ils pr«-
noient de cacher aux étrangers leur dottrine. Mais
Philon affure qu’ils'préféraient la campagne à la ville
, parce qu’eîle eft plus propre à la méditation ; &c
qu’ils évitoient autant qu’il étoit poflible le commerce
des hommes corrompus,parce qu’ils croyoient
que l’impureté des moeurs fe cominunique aufli aifé-‘
ment qu’une mauvaife influence de l’air. Ce fenti-
ment nôûs paraît plus vraiffemblable que celui de Jofephe
qui les fait demeurer dans les villes;en effet on
ne lit nulle part qu’il y ait eu dans aucune ville de
la Paleftiné dès communautés d’Efféniens , au contraire
tous les auteurs qui ont parlé de ces feâaires,
flous les repréfentent comme fuyant les grandes v illes
, & s’appliquant à l’agriculture. D ’ailleurs s’ils
euffent habité les villes , il eft probable qu’on les
conndîtroit un peu mieux qu’on ne le fait, & l’Evangile
ne‘ garderait pas fur e,ux un fi profond filence;
mais leur éloignement des villes oii J. C. prêchoit,
les a fans doute fouftraits aux cenfures qu’il' auroit
faites de leur erreur.
Des Thérapeutes. Philon ( Philo de vitoe contemp. )
a diftingué deux"ordres d’Efféniens ; les uns s’atta-
choient à la pratique, & les autres qu’on nomme
Thérapeutes, à la contemplation. Ces derniers étoient
aufli delà fefte des Efféniens ; Philon leur en donne
le nom : il ne les diftingué delà première branche de
cette feéte , que par quelque degré de perfe&ion.
Philon nous les repréfente comme des gens qui
faifoiertt de la contemplation de Dieu leur unique
occupation, & leur principale félicité. C ’étoit pour
cela qu’ils le tenoient enfermés feul à feul dans leur
cellule, fans parler, fans ofer fortir, ni même regarder
par les fenêtres. Ils demandoient à Dieu que
leur ame fut toujours remplie d’une lumière célefte,
& qu’élevés au-deffus de tout ce qu’il y a de fenfible,
ils puffent chercher & connoître la vérité plus parfaitement
dans leur folitude, s’élevant au-deffus du
foleil, de la nature, & de toutes les créatures. Ils
perçoient dire&ement à D ieu , le foleil de juftice.
Les idées de la divinité, des beautés, & des trefors
du ciel , dont ils s’étoient nourris pendant le jour
les fuivoient jufques dans la nuit, jufques dans leurs
fonges, 6c pendant le fommeil même. Ils débitoient
des préceptes excellens; ils laiffoient à leurs parens
tous leurs biens, pour lefquels ils avoient un profond
mépris,,depuis qu’ils s’étoient enrichis de la
philofophie célefte : ils fentoient une émotion violente,
& une fureur divine, qui les entraînoit dans
l’étude de cette divine philofophie, & ils y trouvaient
un fouverain plaifir ; c’eft pourquoi ils ne
quittôîént jamais leur étude, jufqu’à ce qu’ils fuffent
parvenus à ce degré de peffeéiion quilesrendoit heureux.
On voit-là, fi je ne me trompe, la contemplation
dés myftiques, leurs tranfports, leur union
avec la divinité qui les rend fouverainement heureux
& parfaits fur la terre.
Cette fefte que Philon a peinte dans un traité
qu’ il a fait exprès, afin d’en faire honneur à fa religion
, contre les Grecs qui vantoient la morale 6c la
J U I
pureté de leurs philofophes, a paru fi fainteÿ que-
les Chrétiens leur ont envié la gloire de leurs auftérités.
Les plus modérés ne pouvant ôter abfolument
à la fynagogue l’honneur de les avoir formés &
nourris dans fon fein, ont au moins foutenu qu’ils
avoient embraffé le chriftianifme, dès le moment
que S. Marc le prêcha en E gypte, & que changeant
de religion fans changer de vie , ils devinrent les
peres& les premiers inftituteursde la vie monaftique.
Ce dernier fentiment a été foutenu avec chaleur
par Eufebe, par faint Jérôme, & fur-tout par le
pere Montfaucon, homme diftingué par fon lavoir ,<
non-feulement dans un ordre favant, mais dans la
république des lettres. Ce favant religieux a été réfuté
par M. Bouhier premier préfident du parlement
de D ijo n , dont on peut confulter l’ouvrage ; nous
nous bornerons ici à quelques remarques.
i° . On ne connoît les Thérapeutes que par Philon.
Il faut donc s’en tenir à fon témoignage ; mais
peut-on croire qu’un ennemi delà religion chrétienne
, & qui a perfévéré jufqu’à la mort dans la pro-
fefîion du judaïfme, quoiquefl’Evangile fut connu,
ait pris la peine dépeindre d’une maniéré fi édifiante
les ennemis de fa religion & de fes cérémonies ? Le
judaïfme &: le chriftianifme font deux religions ennemies
; l’une travaille à s’établir fur les ruines de
l’autre : il eft impolfible qu’on faffe un éloge magnifique
d’une religion qui travaille à l’anéantjffement
de,celle qu’on croit & qu’on profeffe.
2°. Philon de qui on tire les preuves en faveur
du chriftianifme des Thérapeutes, étoit né l’an 723
de Rome. Il dit qu’il étoit fort jeune lorfqu’il com-
pofa fes ouvrages ; & que dans la fuite fes études
furent interrompues par les grands emplois qu’on lui
confia. En fuivant ce calcul, il faut néceffairement
que Philon ait écrit avant J. C . & à plus forte rai-
fon avant que le Chriftianifme eût pénétré jufqu’à
Alexandrie. Si on donne à Philon trente-cinq ou
quarante ans lorfqu’il compofoit fes livres, il n’é-
toit plus jeune. Cependant J. C . n’avoit alors que
huit ou dix ans ; il n’avoit point encore enfeigné ;
l’Evangile n’étoit point encore connu : les Thérapeutes
ne pouvoient par conféquent être chrétiens :
d’où il eft aifé de conclure quec’eft une fe£te de Juifs
réformés , dont Philon nous a laiflé le portrait.
30. Philon remarque que les Thérapeutes étoient
une branche des Efféniens ; comment donc a-t-on pu
en faire des chrétiens, & laiffer, les autres dans le
judaïfme ? ' *
Philon remarque encore que c’étoient des difei-
ples de Moïfe ; & c’eft-là un caraâere de judaïfme
qui ne peut être contefté, fur-tout par des chrétiens.
L ’occupation de ces gens-là confiftoit à feuilleter
les facrés volumes , à étudier la philofophie qu’ils
avoient reçue de leurs ancêtres, à y chercher des
allégories., s’imaginant que les fecrets de la. nature
étoient cachés fous les termes les plus clairs ; & pour
s’aider dans cette recherche, ils avoient les commentaires
des anciens ;,car les premiers auteurs de
cette feéte avoient laiffé divers volumes d’allégories,
& leurs difciples fuivoient cette méthode. Peut-
on connoître là des chrétiens ? qui étoient ces ancêtres
qui avoient laiffé tant d’écrits , lorfqu’il y avoit
à peine un feul évangile publié ? Peut-on dire que_
les écrivains facrés nous ayent laiffé des volumes
pleins d’allégories ? quelle religion feroit la nôtre, fi
on ne trouvoit que cela dans les livres divins ? Peut-
on dire que l’occupation des premiers faints du Chriftianifme
fut de chercher les fecrets de la nature cachés
fous les termes les plus clairs de la parole de
Dieu ? Cela convenoit à des myftiques & à des
dévots contemplatifs, qui fe mêloient de medecine:
cela convenoit à des Juifs, dont les dofteurs ai-
moient les allégories jufqu’à la fureur : mais ni les
ancêtres, ni la philofophie, 91 les volumes pleins
d’allégories, ne conviennent point aux auteurs do
la religion chrétienne, ni aux chrétiens.
40. Les Thérapeutes s’enfermoient toute la fe-
maine fans fortir de leurs cellules, ôf même fans ofer
regarder par les fenêtres, & ne fôrtoient de-là que
le jour du fabbat, portant leurs mains fous le manteau:
l’une entre la poitrine & la barbe, & l’autre
fur le côté. Reconnoit-on les Chrétiens à cette pof-
ture ? & le jour de leur affemblée qui étoit le famé-
di,ne marque-t-il pas que c’étoient là des Juifs,rigoureux
obfervateurs du jour du repos que Moïfe avoit
indiqué ? Accoutumés comme la cigale à vivre de
rofée , ils jeûnoient toute la femaine, mais ils.man-
geoient & fe repofoient le jour du fabbat. Dans leurs
fêtes ils avoient une table fur laquelle on mettoit du
pain , pour imiter la table des pains de propofition
que Moïfe avoit placée dans le temple. On chantoit
des hymnes nouveaux, & qui étoient l’ouvrage du
plus ancien de l’affemblée ; mais lorfqu’il n’en compofoit
pas, onprenoit ceux de quelque ancien poëte.
On ne peut pas dire qu’il y eût alors d’anciens poètes
chez les Chrétiens; & ce terme ne convient guère
au prophète David. On danfoit aufli dans cette
fête ; les hommes & les femmes le faifoient en mémoire
de la mer Rouge , parce qu’ils s’imaginoient
que Moïfe avoit donné cet exemple aux hommes ,
& que fa foeur s’étoit mife à la tête des femmes pour
les faire danfer & chanter. Cette fête durait jufqu’au
lever du foleil ; & dès le moment que l’aurore pa-
roiffoit, chacun fe tournoit du côté de l’orient, fe
fouhaitoit le bon jour, & fe retiroit dans fa cellule
pour médites &,contempler Dieu : on voit là la même
fuperftition pour le foleil qu’on a déjà remarquée
dans les Efféniens du premier ordre.
50. Enfin, on n’adopte les Thérapeutes qu’àcaufe
de leufs auftérités, & du rapport qu’ils ont avec la
vie monaftique.
Mais ne voit-on pas de femblables exemples de
tempérance & de chafteté chez lés payens, & particulièrement
dans Ja feâe de Pythagore,* à laquelle
Jofephe la comparoit de fon tems ? La communauté
des biens avoit ébloui Eufebe , & l’avoit obligé de
comparer les Efféniens aux fideles dont il eft parlé
dans l’hiftoire des Aftes, qui mettoient tout en commun.
Cependant les difciples de Pythagore faifoient
la même chofe ; car c’étoit une de leurs maximes ,
qu’il n’étoit pas permis d’avoir rien en propre. Chacun
apportoit à la communauté ce qu’il poffédoit :
on en afliftoit les pauvres, lors même qu’ils étoient
abfens ou éloignés ; & ils pouffoient fi loin la charité
, que l ’un d’eux condamné au fupplice par De-
nys le tyran, trouva un pleige qui prit fa place dans
la prifon ; c’eft le fouverain degré de l’amour que de
mourir les uns pour les autres. L’abftinence des viandes
étoit févérement obfervée par les difciples de
Pythagore, aufli-bien que parles Thérapeutes. On
ne mangeoit que des herbes crues ou bouillies. Il y
avoit une certaine portion de pain réglée , qui ne
pouvoit ni charger ni remplir l'eftomac : on le frot-
toit quelquefois d’un peu de miel. Le vin étoit défendu
, & on n’avoit point d’autre breuvage que l’eau
pure. Pythagore vouloit qu’on négligeât les plai-
firs & les voluptés de cette v ie , & ne les trouvoit
pas dignes d’arrêter l’homme fur la terre. Il rejettoit
les onftions d’huile comme les Thérapeutes : fes
difciples portoient des habits blancs ; ceux de lin pa-
roiffoient trop fuperbes , ils n’en avoient que de laine.
Ils n’ofoient ni railler, ni rire, & ils ne dévoient
point jurer par le nom de Dieu, parce que chacun
devoit faire connoître fa bonne fo i, & n’avoir pas
befoin de ratifier fa parole par un ferment. Ils avoient
un profond refpeél pour les vieillards , devant lef-'
quels ils gardoient long-tems le filence. Il n’ofoient
faire de l’eau en préfence du foleil, fuperftition que
les Thérapeutes avoient encore empruntée d’eux.
J U I 37
Enfin ils étoient fort entêtés de la fpéculation& du
repos, qui l’accompagne ; c’eft pourquoi ils en faifoient
un de leurs préceptes lesplus importans.
O juvenes ! tacitâ colite hæcpia facra quitte ;
difoit Pythagore à fes difciples, à la tête d’un de feS
ouvrages. En comparant les feéles des Thérapeutes
& des Pythagoriciens-, on les trouve fi femblables
dans tous les chefs qui ont ébloui les Chrétiens, qu’il
femble que l’une foitfortie de l’autre. Cependant fi
on trouve de femblables auftérités chez les payens,
on ne doit plus être étonné de les voir chez les Juifs
éclairés par la loi de Moïfe ; & on ne doit pas, leur
ravir cette gloire pour la tranfporter au Chriftianifme.
Hifloire delà philofophie juive depuis la ruine de Je-
rufalem. La ruine de Jérufalem caufa chez les Juifs
des révolutions quifurent fatales aux Sciences. Ceux
qui avoient échappé à l’epée des Romains, aux flammes
qui réduifirent en cendres Jérufalem & fon temple
, ou qui après la défolation de cette grande ville,
ne furent pas vendus au marché comme des efclaves
& des bêtes de charge , tâchèrent de chercher unç
retraite & un afile. Ils en trouvèrent un en Orient
& à Babyloae, où il y avoit encore un grand nombre
de ceux qu’on y avoit tranfportés dans les anciennes
guerres : il étoit natureld’aller implorer là la charité
de leurs freres, qui s’y éteient fait des établiffer
mens confidérables.Les autres fe réfugièrent enEgyp-
te, où il y avoit aufli depuis long-tems beaucoup de
/«ï/ipuiffans & affez riches pour recevoir ces mal-
heureux;mais ilsporterentlà leur efprit de féditionôc
de révolte, ce qui y caufa un nouveau maflacre. Les
rabins affurent que les familles confidérables furent
tranfportées dès ce tems-là en Efpagne, qu’ils appelaient
flpharàd ; & que c’eft dans ce lieu où font
encore les reftes des tribus de Benjamin & de Judas
les defeendans de la maifôn de David : c ’eft pourquoi
les juifs de ce pays-Iàont toujoursregardé avec
mépris ceux des autres nations, comme fi le fang
royal & la diftinâiondes tribus s’étoient mieux con-
fervées_chez eux, que par-tout ailleurs. Mais il y eut
un quatrième ordre de juifs qui pourroient à plus
jufte titre fe faire honneur de leur origine. Ce forent
ceux qui demeurèrent dans leur patrie, ou dans
les mafures de Jérufalem, ou dans les lieux voi-
fins, dans lefquels ils fe diftinguerent en raffemblant
un petit corps de la nation, & par les charges qu’ils
y exercèrent. Les rabbins affurent même que T ite fit
tranfporter le fanhédrim à Japhné ou Jamnia,
qu’on érigea deux académies , l’une à T ibérias, &
l’autre à Lydde. Enfin ils foutiennent qu’il y eut
aufli dès ce tems-là un patriarche qui après avoir
travaillé à rétablir la religion & fon églife difperfée,
étendit fon autorité fur toutes les fynagogues de l’Occident.
On prétend que les académies furent érigées l’an
220 ou l’an 230 ; la plus ancienne étoit celle de
Nahardea, ville fituée fur les bords de l’Euphrate.
Un rabbin nommé Samuel prit la conduite de cette
école : ce Samuel eft un homme fameux dans fa nation.
Elle le diftingué par les titres de , d’<zriock,
de fapor boi, & de lunatique, parce qu’on prétend
qu’il gouvernoit le peuple aufli abfolument que
les rois font leurs fujets, & que le chemin du ciel lui
étoit aufli connu que celui de fon académie. Il mourut
l’an 270 de J. C. & la ville de Nahardea ayant
été prife l’an 278 , l’académie fut ruinée.
On dit encore qu’on érigea d’abord l’académie à
Sora , qui avoit emprunté fon nom de la Syrie ; car
1 es Juifs le donnent à toutes les terres qui s’étendent
depuis Damas & l’Euphrate, jufqu’à Babylone,
& Sora étoit fituée fur l’Euphrate.
Pumdebita étoit une ville fituée dans la Méfopo-
tamie, agréable par la beauté de fes édifices. Elle