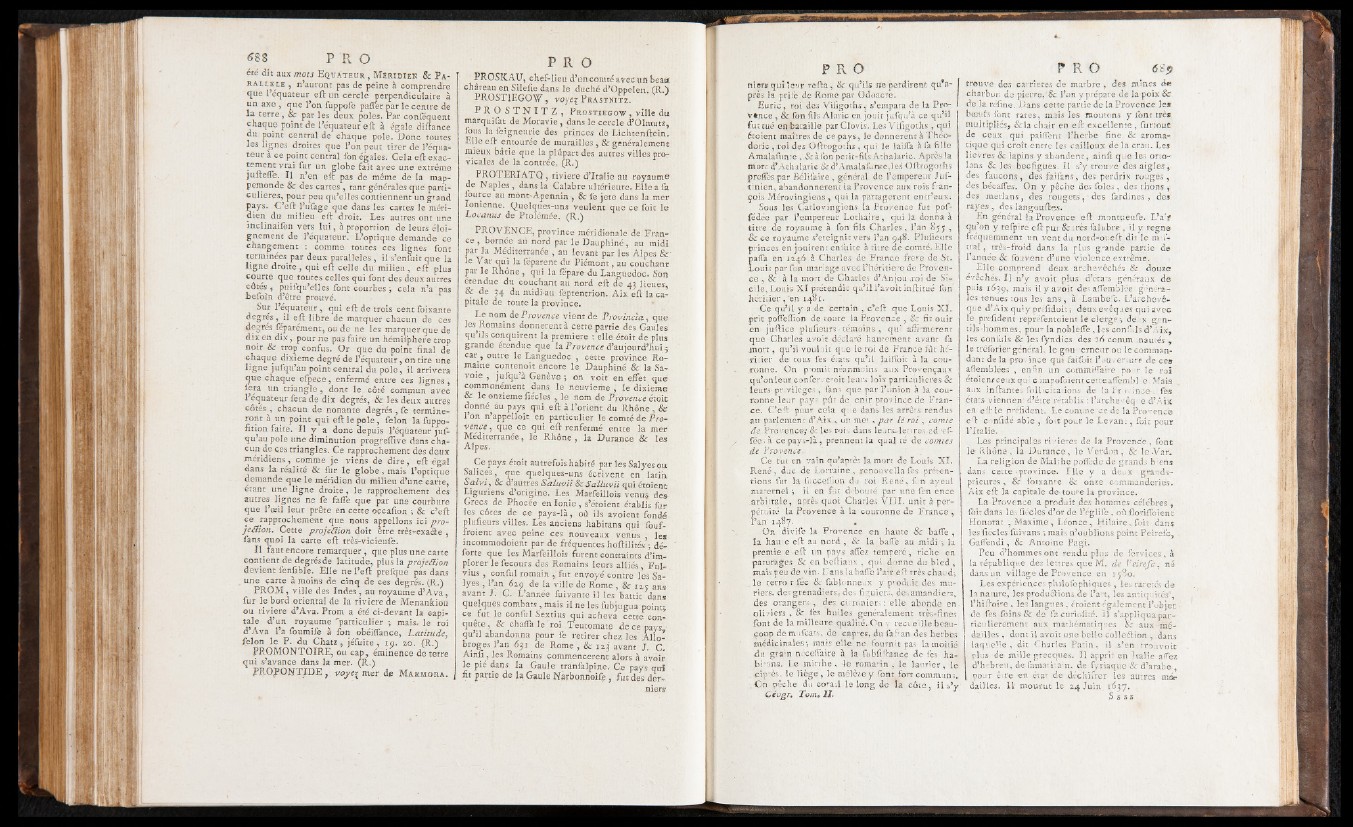
été dit aux mots Equateur, Méridien & Pa rallèle
? n’auront pas de peine à comprendre
que l’équateur eft un cercle perpendiculaire à
un axe , que l’on fuppofe palïer par le centre de
la terre, 8c par les deux pôles. Par confisquent
chaque point de l ’équateur eft à égale diftance
du point central de chaque pôle. Donc toutes
les lignes droites que l’on peut tirer de l’équateur
a ce point central fon égales. Cela eft exactement
vrai fur un globe fait avec une extrême
jufteffe. Il n’en eft pas de même de la mappemonde
8c des cartes , tant générales que particulières,
pour peu qu’elles contiennent un grand
pays. C ’eft l ’ufage que dans les cartes le méridien
du milieu eft droit. Les autres ont une
inclinaifon vers lu i , à proportion de leurs éloignement
de l’équateur. L’optique demande ce
changement : comme toutes ces lignes font
terminées par deux parallèles , il s’enfuit que la
ligne droite, qui eft celle du milieu, eft plus
courte que toutes celles qui font des deux autres
côtés j puifqu’elles font courbes ; cela n’a pas
befoîn d’être prouvé.
Sur l’équateur, qui eft de trois cent foixante
degres, il eft libre de marquer chacun de ces
degrés féparément, ou de ne les marquer que de
dix en d ix , pour ne pas faire un hémilpher e trop
noir 8c trop confus. Or que du point final de
chaque dixième degré de 1 équateur, on tire une
ligne jufqu’au point central du.pôle, il arrivera
que chaque efpeçe, enfermé entre ces lignes ,
fera un triangle, dont le côté commun avec
^?®quî^eur fera de dix degrés, & les deux autres
cotés , chacun de nonante degrés, fe termineront
à un point qui eft le pôle, félon la fuppo-
ntion faite. Il y a donc depuis l’éqûateur jus qu’au
pôle une diminution progreflive dans cha-
cun de ces triangles. Ce rapprochement des deux
méridiens, comme j’e viens de d ire, eft égal
dans la réalité & fur le g lo b e , mais l’optique
demande que le méridien du milieu d’une carte,
étant une ligne droite, le rapprochement des
autres lignes ne le faffe que par une courbure
que l’oeil leur prête en cette oçcafion ; & c’ eft
ce rapprochement que nous appelions ici projection.
Cette projection doit être très-rexade
fans quoi la carte eft très-vicieufo.
11^ faut encore remarquer , que plus une carte
contient de degrésde latitude, plus la projection
devient fenfible. Elle ne l ’eft prefque pas dans
une çarte à moins de cinq de ces degrés. (R.)
PROM, ville des Indes , au royaume d’A v a ,
fur le bord oriental de la riviere de Menankiou
ou riviere d’Ava. Prom a été ci-devant la capitale
d’un royaume 'particulier -, mais, le roi
d’Ava l’a foumilè à fon obéiffance, Latitude,
félon le P. du Chatz, jéfuite , io . 20. (R.)
PROMONTOIRE, ou cap, éminence de terre
qui s?avance dans la mer. (R.)
PROPONTIDE , voyez m e r d e M a r m a r a .
PROSKAU, chef-lieu d’un comté àved h fi beast
château en Silefie dans le duché d’Oppelen. (R.)
PROSTÎEGOW, voye% P r a s t n it z .
P R O S T N I T Z , P r o s t ie g o w , ville du
marquifat de Moravie, dans le cercle d’Olmutz,
fous la feigneurie des princes de Lichtenftein.
Elle eft entourée de murailles , & généralement
mieux bâtie que la plûpartdes autres villes pro-
vicales de la contrée. (R.)
PROTERIATQ, riviere d’Italie au royaume
de Naples, dans la Calabre ultérieure. Elle a fa
foürce au mont'Apennin , & le jete dans la.mer
Ionienne. Quelques-uns veulent que ce foit le
Locanus de Ptolémée, (R.)
PROVENCE, province méridionale de France
, bornee au nord par le Dauphiné, au midi
par la Méditerranée , au levant par les Alpes 8c'
le Var qui la féparent du Piémont, au couchant
Pai Rhône , qui la fèpare du Languedoc. Son
étendue du couchant au nord eft de 43 lieues,
& de 34 du midi-au feptentrion. A ix eft la capitale
de toute la province.
Le nom de Provence vient de Provinda, que
les Romains donnèrent à cette, partie des Gaules
qu’ils conquirent la première : elle étoit de plus
grande étendue que la Provence d’aujourd’hui-;
c a r , outre le Languedoc , cette province Romaine
contenoit encore le Dauphiné 8c la Savoie
, jufqu’a Genève ; on voit en effet que
communément dans le neuvième , le dixième
8c le onzième fiée!es , le nom de Provence étoit
donné au pays qui eft à l ’orient du Rhône , &
l’on n’appelloit en particulier le comté de Provence
, que ce qui eft renfermé entre la mer
Méditerranée, le Rhône, la Durance & les
Alpes.
Ce pays étoit autrefois habité par les Salyes ou
Salices, que quelques-uns écrivent en latin
S a lv i, 8c d’autres Saluvii 8c Salluvii qui étoient
Liguriens d’origine. Les Marfeillois venus des-
Grecs de Phocée en Ionie , s’étoient établis fur
^es cotes de ce pays-la, où ils avoiént fondé
plusieurs villes. Les anciens habitans qui fouf-
froient avec peine ces nouveaux venus , les
incommodoient par de fréquentes hoftilités ; déforte
que les Marfeillois furent contraints d’implorer
le fecours des Romains leurs alliés, Fui-
vius , conful romain , fut envoyé contre les Salyes
, l’an 629 de la v ille de Rome , & 125 ans
avant J. C. L’année fui vante il les battit dans
quelques combats, mais il ne les fubjugua point;
ce fut le conful Sextius qui. acheva cette conquête,
8c chafla le roi Teutomate de ce pays
qu’il abandonna pour fe retirer chez les Allobroges
l’an 631 de Rome, & 123' avant J. C.
Ainfi , les Romains commencèrent alors à avoir
le. pie dans la Gaule tranfalpine. Ce pays qui
| 6e J>açrie de la Gaule Narbonnoil^ , fut des derniers
P R O
nier» qui leur refta, 8c qu’ ils ne perdirent qu*a-
près la prife de Rome par Odoacre.
Euric, roi des Vifigoths, s’empara de la Provence
, 8c fon fils Al a rie en jouit jufqu’à ce qu’ il
futtué en bataille par Clovis. Les Vifigoths , qui
étoient maîtres de ce pays, le donnèrent à Théo-
doric , roi des Oftrogorhs , qui le laiffa à fa fille
Amalafunte ,.&àfon petit-fils Athalaric. Après la
more d’Athaiaric & d ’Amalafume,les Oftrogorhs
preffés par Eélifaire, général, de l’empereur Juf-
•tinien, abandonnèrent la Provence aux rois fran-
çois Mérovingiens , qui la partagèrent entr’eux-.
Sous les Carlo vin giens la Provence fut pof-
fédée par l’empereur Lothaire, qui la donna à
titre de royaume à fon fils Charles, l’an 855 ,
8c ce royaume s’eteignit vers l’an 948. Plufteurs
princes en jouirent en fuite à titre de comté. Elle
paffa en 1246 à Charles de France frere de St.
Louis par fon mariage avec l’ héritière de Provence
, & à la mort de Charles d’Anjou ,roi de Sicile,
Louis XI prétendit qu’ il i’avoit inftitué fon
héritier, ‘en 1481.
Çe qu’ il y a de certain , c’eft que Louis XI.
prit poffeiïion de toute la Provence , 8c fit ouir
en juftice plufteurs • témoins , qui affi-merent
que Charles avoit déclaré hautement avant fa
mort, qu’ il voulait que le roi dé France fût heritier
de tous fes états qu’il laiffoit à la couronne.
On p-omit néanmoins aux Provençaux
qu’onleuKconfervc'oit leurs loix particulières 8c
leurs privilège:;, fans que par l’ union à la couronne
leur pays pût de enir province de France.
C’eft pour cela que dans les arrêts-rendus
au parlement d’ Aix., on met , par lè roi , comte
de Provence; & les roi ; dans le.irs-lettres ad'ef-
fées à ce pays-là, prennent la quai té de comtes
de Provence.
Ce fut en vain qu’a près la mort de Louis XI.
René, duc de Lorraine, renouvelia fes prétentions
fur la fuccefilon du roi René, fon ayeul
.maternel; il en fut débouté par une fen ence
.arbitrale, après quoi Charles V I I I . unit à perpétuité
la Provence à la couronne de France ,
Pan 1487.
On divife la Provence en haute &: baffe ,
la haute eft au nord , & la baffe au midi ; la
prernie e eft un pays affez temperé , riche en
pâturages Sc en beftiaux , qui donne du bled ,
mais peu de vin. Dans la baffe l’air eft très chaud-,
le terro r fèc 8c fablonneux y produit des mûriers,
des grenadiers, des figuiers, des amandiers,
des orangers , des citromers: elle, abonde en
oliviers , & les huiles généralement très-fines
font de la milleure qualité..On y recueille beaucoup
dem ifeats. de câpres, du fa Iran, desherbes
médicinales; mais elle ne fournit pas la moitié
du grain ncceffaire à la fubfiftance de fes ha-
brans. Le minhe , 4è romarin , le laurier, le
cip-ès, le liège , le mélèze y font fort communs.
. On pêche du corail le long de la cô te , il s’y
Céogr. Tom, IL
P R O 6Sp
trouve des carrières de marbre , des mines de
charbon de pierre,'8c l’on y prépare de la poix &
de la réfine. Dans cette partie de la Provence les
boeufs font rares, mais les moutons y font très
multipliés, & la chair en eft excellente, furrouc
de ceux qui paiffent l’herbe fine 8c aromatique
qui croît!entre les cailloux de la crau. Les
lievres 8c lapins y abondent, ainfi que les ortolans
8c les.becfigues. Il s’y trouve des aigles ,
des faucons, desfaifans, des perdrix rouges,
des bécaffes. On y pêche des foies , des thons ,
des merlans, des rougets, des fardines , des
rayes, des langouftes.
En général la Provence eft montueufe. L’a'f
qu’on y refpiré eft pur & très falubre , il y régné
fréquemment un vent dg nord-oueft dit le m f-
tra l, très-froid dans la plus grande partie de
1 année & fbavent d’ une violence extrême.
Elle comprend deux archevêchés 8c douze
évêchés. Il n’y avoit plus d’états généraux de
puis 1639, mais il y avoit des affemblée générales
tenues tous les ans, à Lambefc. L’archevêque
d’Aix qui y prifidoit; deux evêques qui avec
le préfident repréfentoient le cierge ; de x gentils
hommes, pou»* la nobleffe , les confi.ils d’Aix,
les confuls 8c les fyndics des 76 comm .nautés ,
le tréforier général, le gouverneur ou le commandant
de la province qui faifoi: l’ ouvenure de ces
afiemblées enfin un ccmmiffaire po. r le roi
étôienrceux qiri c jmpofoientcetteaffembl e. Mais
aux inftantes follicitarions dé l.a Province-, fes
états viennen- d’être rétablis : l’arche- êq -e d’Aix
en eft le préfident. Le comme ce de la Provence
eft confidé abie , fo:t pour le Levant, foit pour
l ’Italie.
Les principales rivières de la Provence, font
le Rhône, la Durance , le Verdon, 8c le-Var.
La religion de Malthe po'ffede de grands b:ens
dans cette «province. File y a deux grands-
prieurés , 8c foixante 8c onze commanderiés.
Aix eft la capitale déroute la province.
La Provence a produit des hommes célébrés ,
foit dans les fiécles d’or de l’églife , où floriffoient
Honorât , Maxime, Léonce, Hilaire, foit dans
les fiécles fuivans ; mais n’oublions point Peirefc, -
Gaffendi, & Antoine Pagi.
Peu d’hommes ont rendu plus de fervices, à
la république des lettres que M. de Veirefc. né
dans un village de Provence en 1580.
Les expériences philofophiques , les raretés de
la nature, les produélions ae l’ a.t, les antiquités",
l’hiftoire , les langues , étoient également l’objet
de fes foins & de fa curioftté. Il s’appliqua particulièrement
aux mathématiques 8c aux médailles
, dont il avoir une belle colleétion dans
laquelle , dit Charles Patin, il s’en trouvoit
plus de mille grecques. Il apprit en Italie affez
d’hebreu, de famaritain. de fyriaque 8c d’arabe ,
I pour être en état de déchitrer les autres mér
dailles. 11' mourut le 24 Juin 163*7. .