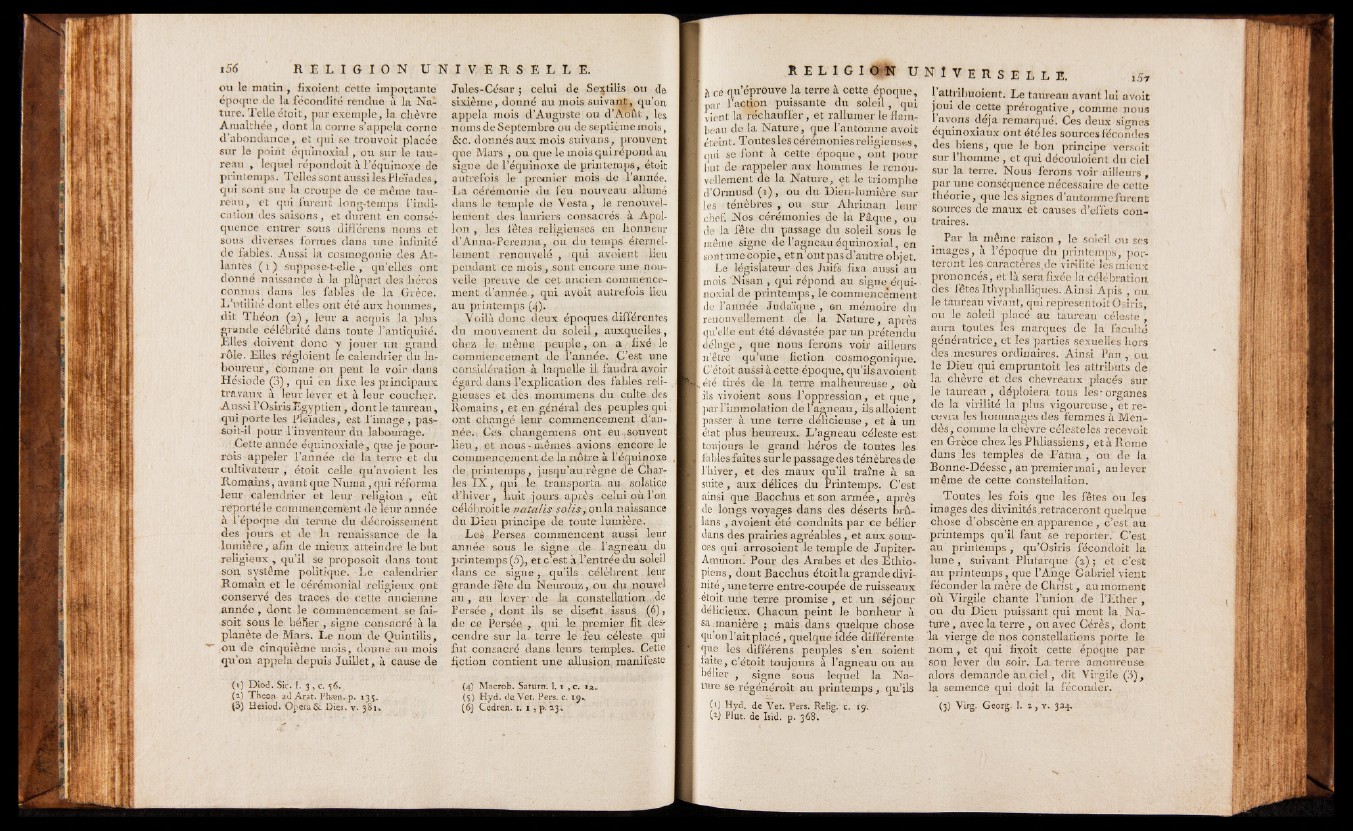
t 56
ou le matin , fixoient cette importante
époque de la fécondité rendue à la Nature.
Telleétoit., par exemple, la chèvre
Amalthéè, dont la corne s’appela corne
d’abondance, et qui se trouvoit placée
sur le point équinoxial, ou sur le taureau
, lequel répon doit à l ’équinoxe de
printemps. Telles sont aussi les Pléiades,
qui sont sur la croupe de ce meme taureau
, et qui furent long-temps l'indication
des saisons, et durent en conséquence
entrer sons différens noms et
sons diverses formes dans une infinité
de fables. Aussi la cosmogonie des Atlantes
( 1 ) suppose-t-elle , qu’elles ont
donné naissance à la plupart des héros
connus dans les fables de la Grèce.
L ’utilité dont elles ont été aux hommes,
dit Théon (a), leur a acquis la plus
grande célébrité dans toute l’antiquité.
Elles doivent donc y jouer un grand
rôle. Elles régloient le calendrier au laboureur,
comme on peut le voir dans
Hesiode (3) , qui en fixe les principaux
travaux à leur lever et à leur coucher.
Aussi l’Osiris Egyptien, dont le taureau,
qui porte les Pléiades, est l’image, pas-
soit-il pour l’inventeur du labourage.
Cette année équinoxiale, que je pour-
rois appeler l’année de la terre et du
cultivateur, étoit celle,qu’avoient les
Romains, avant que Numa, qui réforma
leur calendrier et leur religion , eût
reporté le commenceraient de leur année
à l’époque du terme du décroissement
des jours et de la renaissance de la
lumière, afin de mieux atteindre le but
religieux , qu’il se proposoît dans tout
son système politique. Le calendrier
Romain et le cérémonial religieux çnt
conservé des traces de cette ancienne
année, dont le commencement se fai-
soit sous le bélier , signe consacré à la
planète de Mars. Le nom de Quintilis,
ou de cinquième mois, donne au mois
qu’on appela depuis Juillet, à cause de
(0 Diôd. Sic. 1. 3 , c. 56.
(-) Theon- ad Arat. Phæn. p. 13.3.
(3) Hesiod. Opéra 6c Dies. v. 381.
Jules-César ; celui de Se^tilis ou de
sixième, donné au mois suivant, qu’on
appela mois cl’Augùste ou d’A oût, les
noms de Septembre ou de septième mois,
&c. donnés aux mois suivans, prouvent
que Mars , ou que le mois qui répond au
signe de l’équinoxe de printemps, étoit
autrefois le premier mois de l’année.
La cérémonie du feu nouveau allumé
dans le temple de Vesta, le renouvellement
des lauriers consacrés à Apollon
, les fêtes religieuses en honneur
d’Anna-Perenna, ou du temps éternellement
renouvelé , qui avoient lieu
pendant ce mois, sont encore une nouvelle
preuve de cet ancien com tnence-
ment d’année, qui avoit autrefois lieu
au printemps (4).
Voilà donc deux époques différentes
du mouvement du soleil, auxquelles ,
chez le même peuple, on a fixé, le
commencement de l ’année. C’est une
considération à laquelle il faudra avoir
égard dans l’explication des fables religieuses
et des monumens du culte des
Romain s , et en général des peuples qui
ont changé leur commencement d’année.,
CeS ehangemens ont eu .souvent
lieu,, et nous-mêmes avions encore le
commencement de la nôtre à l’équinoxe
de printemps, jusqu’au règne de Charles
IX , qui le transporta au solstice
d’hiver , huit jours après celui où l’on
célébroitie natalis salis, ou la naissance
du Dieu principe de toute lumière.
Les Perses commencent aussi leur
année sous le signe de l’agneau du
printemps (5)., et c’est à l’entrée du soleil
dans ce signe, qu’ils célèbrent leur
grande fête du Neurouz, ou du nouvel
an, au lever de la constellation , de
Persée , dont ils se disent issus (6),
de ce Persée , qui le premier fit descendre
sur la terre le feu céleste qui
fut consacré dans leurs temples. Cette
fjetion contient une allusion manifeste
(4) Macrob. Satuur. 1. t , c. ta.
(5) Hyd. de Vet. Pers. c. 15.
(6} Cedreir. c. 1 , p. 23,
à ce qu’éprouve la terre à cette époque,
pur l'action puissante du soleil , qui
vient la réchauffer, et rallumer le flam-
[ beau de la Nature, que l’automne avoit
éteint. Touteslescéréinoniesreligieuses
qui se font à cette époque, ont pour
but de rappeler aux hommes Je renouvellement
ae la Nature, et le triomphe
; d’Ormusd ( 1 ) , ou du Dieu-lumière sur
les ténèbres , ou sur Ahriinan leur
chef. Nos cérémonies de la Pâque, ou
: de la fête du passage du soleil sous le
même signe de l’agneau équinoxial, en
sontunecopie, et n’ontpasd’autre objet.
Le législateur des Juifs fixa aussi au
mois Nisan , qui répond au signe équinoxial
de printemps, le commencement
; de l’année Judaïque , en mémoire du
renouvellement de la Nature, après
qu’elle eut été dévastée par un prétendu
déluge , que nous ferons voir ailleurs
11’être qu’une fiction cosmogonique.
C’étoit aussi à cette époque, qu’ils avoient
, été tirés de la terre malheureuse, où
ils vivoient sous l ’oppression, et que,
par l’immolation d el’agneau, ilsalloient
passer à une terre délicieuse, et à un
état plus heureux. L ’agneau céleste est
toujours le grand héros de tontes les
fables faites sur le passage des ténèbres de
l'hiver, et des maux qu’il traîne à sa
suite , aux délices du Printemps. C’est
ainsi que Bacchus et son armée, après
de longs voyages dans des déserts brû-
lans , avoient été conduits par ce bélier
dans des prairies agréables, et aux sources
qui arrosoient le temple de Jupiter-
Aramon. Pour des Arabes et des Ethiopiens,
dont Bacchus étoitla grande divinité
, une terre entre-coupée de ruisseaux
etoit une terre promise , et un séjour
délicieux. Chacun peint Je bonheur à
sa.manière 5 mais dans quelque chose
qu on l’ait placé, quelque idée différente
que les différens peuples s’en soient
faite, c’étoit toujours à l’agneau ou au
belier , signe sous lequel la Nature
se régénéroit au printemps, qu’ils
1 attribuoient. Le taureau avant lui avoit
joui de cette prérogative, comme nous
l’avons déjà remarqué. Ces deux signes
équinoxiaux ont été les sources fécondes
des biens, que le bon principe versoit
sur l’homme , et qui découloient du ciel
sur la terre. Nous ferons voir ailleurs ,
par une conséquence nécessaire de cette
théorie, que les signes d’automne furent
sources de maux et causes d’effets contraires.
Par la même raison , le soleil ou ses
images, à l’époque du printemps, porteront
les .caractères,de virilité les mieux
prononcés, et là sera fixée là célébration
ües fêtes Ithyplialliques. Ainsi Apis , ou
le taureau vivant, qui représentait Osiris,
ou le soleil placé au taureau céleste ,
aura toutes les marques de la faculté
génératrice, et les parties sexuelles hors
des .mesures ordinaires. Ainsi Pan ,■ ou
le Dieu qui empruntoit les attributs de
la chèvre et des chevreaux placés sur
le taureau , déploiera tous les • organes
de la virilité la plus vigoureuse, et recevra
leé hommages des femmes à Men-
dès, comme la chèvre céleste les recevoit
en Grèce chez les Phliassiens, et à Rome
dans les temples de Fàtua , ou de la
Bonne-Déesse, au premier mai, au lever
même de cette constellation.
Toutes les fois que les fêtes ou Ie3
images des divinités .retraceront quelque
chose d’obscène en apparence , c’est au
printemps qu’il faut se reporter. C’est
au printemps , qu’Osiris fécondoit la
lune , suivant Plutarque (2) ; et c’est
au printemps, que l’Ange Gabriel vient
féconder la mère de Christ, au moment
où Virgile chante l’union de l'Ether ,
ou du Dieu puissant qui meut la. Nature
, avec la terre , ou avec Cérès, dont
la vierge de nos constellations porte le
nom , et qui fixoit cette époque par
son lever du soir. La terre amoureuse
alors demande au, ciel , dit Virgile (3) ,
la semence qui doit la féconder.
(') Hyd. de Vet. Pers. Relig. c. 19. (3) Virg. Georg. 1. 2 , y . 334.
(*) Plut, de Isid. p. 368.