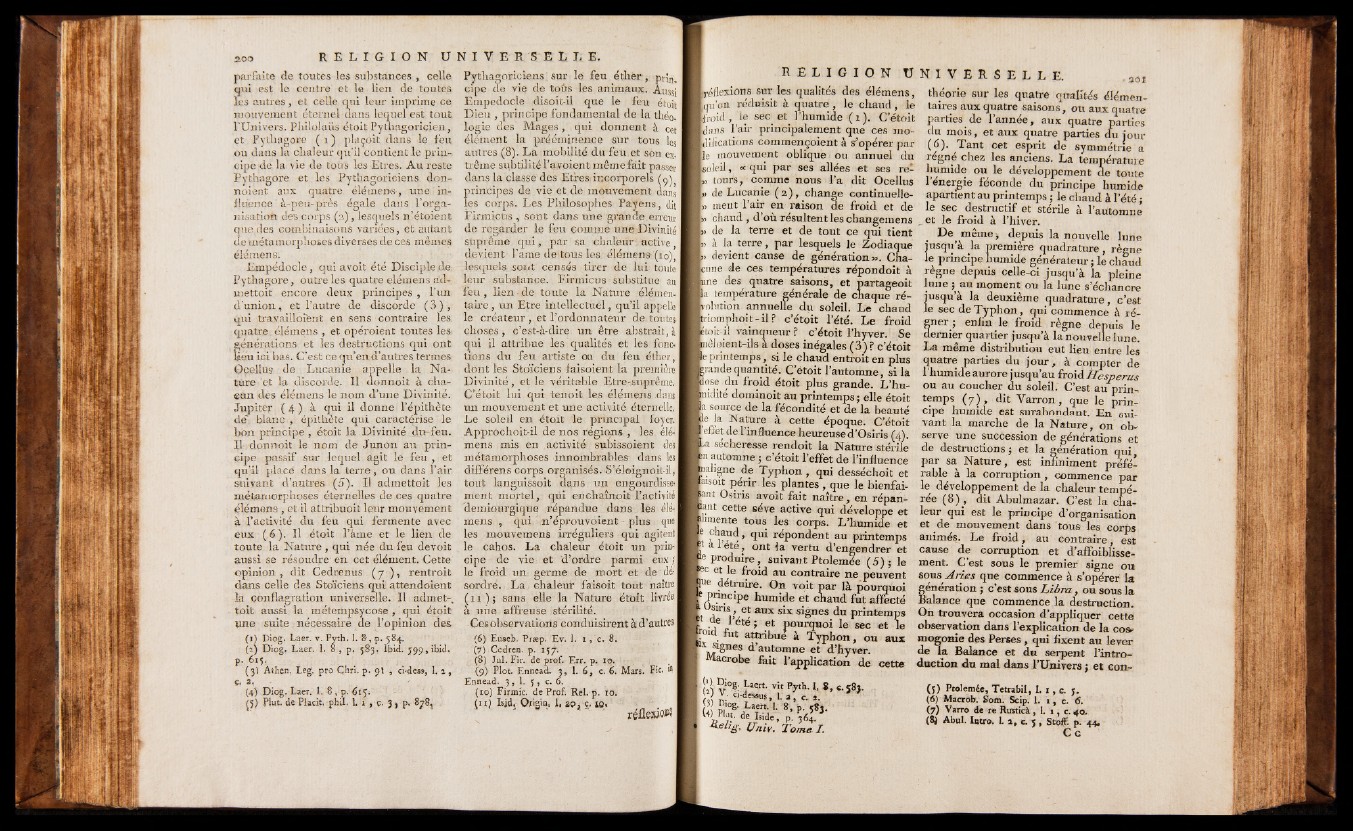
parfaite de toutes les substances , celle
qui est le centre et le lien de toutes
les autres , et celle qui leur imprime ce
mouvement éternel dans lequel est tout
l'Univers. Philolaiis étoit Pythagoricien,
et Pytliagore ( 1 ) plaçoit dans le feu
ou dans la chaleur qu’il contient le principe
de la vie de tous les Etres. Au reste
Pytliagore et les Pythagoriciens, don-
noient aux quatre élémens, une influence
à-peu-près égale dans l’ôrga-
nisation des corps (a), lesquels n’étoient
que des combinaisons variées, et autant
de métamorphoses diverses de ces mêmes
élémens.
Empédocle, qui avoit été Disciple de,
Pythagore, outre les quatre elémens ad-
mettoit encore deux principes , l’un
d union, et l’autre de discorde ( 3 ) ,
qui travailloient en sens contraire les:
quatre élémens , et opéroient toutes les-
générations et les destructions qui ont
lieu ici bas. C’est ce qu’en d’autres termes
Oçellus de Lucanie appelle la Nature
et la discorde. Il donnoit à chacun
des élémens le nom d’une Divinité.
Jupiter ( 4 ) à qui il donne l ’épithète
de* blanc , épithète qui caractérisé le
bon principe , étoit la Divinité du~feu.
Il donnoit le nom de Junon au principe
passif sur lequel agit le feu , et
qu’il place dans la terre, ou dans l’air
suivant d’autres (5). Il admettoit les
métamorphoses éternelles de ces quatre
élémens , et il attribuoit leur mouvement
à l’activité du feu qui fermente avec
eux (6). Il étoit l’àme et le lien de
toute la Nature, qui née du feu devoit
aussi se résoudre1 en cet élément. Cette
opinion, dit Cedrenus ( 7 ) , rentroit
dans celle des Stoïciens qui attendoient
la conflagration universelle. Il admet-,
toit aussi la métempsycose , qui étoit
une suite nécessaire de l’opinion des
(1) Diog. Laer. v. Pyth. I.8,.p. 584.
(?) Diog, Laer. 1. 8 , p, 583, Ibid. 599, ibul.
P- f f î j
(3) Athen, Leg. pro Çhri. p. 91 , ci-des», 1, a ,
c. 3,
(4) Diog. Laer. 1. 8 , p. 613,
£5) Plut, de Placit. phii. 1. 1 , ç. 3 , p, 878,
Pythagoriciens sur le feu éther, pr;n,
cipe cle vie de tous les animaux. Aussi
Empédocle disoit-il que le feu étoit
Dieu , principe fondamental dè la théo.
logie des Mages, qui donnent à cet
élément la prééminence sur tous les
autres (8). La mobilité du feù et son ex.
trêine subtilité l’avoient même fait passer
dans la classé des Etres incorporels
principes de vie et de mouvement dans
les corps. Les Philosophes Payens, dit
Firinicüs , sont dans une grande.erreur
de regarder le feu comme une Divinité
suprême qui, par sa chaleur active
devient Pâme dedans les. élémens (io),
lesquels, sont censés tirer de lui toute
leur substance. Firmicws substitue au
feu , lien de toute la Nature élémentaire
, un Etre intellectuèl, qu’il appelle
le créateur, et l’ordonnateur de toutes
choses , c’est-à-dire un être abstrait, à
qui il attribue les qualités et les fonctions
du feu artiste ou du feu éther,
dont les Stoïciens faisoient la première
Divinité, et le véritable Etre-suprême.
C’étoit lui qui tenoit les élémens dans
un mouvement et une activité éternelle.
Le soleil en ctoit le principal foyer.
Approchoit-il de nos régions , les, élémens
mis en activité subissoient dés
métamorphoses innombrables dans les
différens corps organisés.-S’éloignoit-il,
tout languissoit dans un engourdisse,
ment mortel, qui enchaînoit l ’activité
demiourgique répandue dans les élémens
, qui n’éprouvoient - plus ;-que
les mouvemens irréguliers qui agitent
le cahos. La chaleür étoit un principe
de vie et d’ordre parmi eux);
le froid un germe de mort et de désordre.
La . chaleur faisoit tout naître
(11).; sans elle la Nature étoit livrée
a une affreuse stérilité.
Ces observations conduisirent à d’autres
(6) Euseb. Præp. Ev. I. 1 , c. 8.
(7) Cedren. p. 1Ç7.
(8) Jul. Fir. de prof. Err. p. 10.
(9) Plot. F.nnead. 3, I. 6 , c. é. Mars. Fie. À j
Ennead. 3, 1. 3 , c. 6.
(10) Firnaic. de Prof Rel. p. 10.
ppj, Isjd. Origin, 1, 20, 9, » ,
réflexif
jréflexions sur les qualités des élémens,
(qu’on réduisit à quatre, le chaud, le
(froid , le sec et l’humide (1 ). C’étoit
Hans l’air principalement que ces mo-
idilications commençoient à s’opérer par
ni mouvement oblique ou annuel du
(soleil, « qui par ses allées et ses re-
b, tours, comme nous l’a dit Ocellus
[» de Lucanie (2 ), change continuellement
l’air en raison de froid et de
chaud , d’où résultent les changemens
j,i de la terre et de tout ce qui tient
à la terre, par lesquels le Zodiaque
devient cause de génération». Cha-
jenne de ces températures répondoit à
me des quatre saisons, et partageoit
température générale de chaque résolution
annuelle du soleil. Le chaud
riomphoit-il ? c’étoit l’été. Le froid
“toit il vainqueur ? c’étoit l’hyver. Se
îêlqient-ils à doses inégales (3)? c’étoit
p printemps, si le chaud entroit en plus
randequantité. C’étoit l’automne, si la
(ose du froid étoit plus grande. L ’hu-
bidite dominoit au printemps ; elle étoit
■a source de la fécondité et de la beauté
le la Nature à cette époque. C’étoit
l ’effet de l’influence heureused’Osiris (4).
F sécheresse rendoit la Nature stérile
p automne ; c’étoit l’effet de l’influence
f aligne de Typhon, qui desséchoit et
psoit périr les plantes , que le bienfai-
^iat Osiris avoit fait naître, en répandant
cette sève active qui développe et
.limente tous les corps. L ’iiunude et
V ÏPgjH q«i répondent au printemps
>'t a 1 été, ont la vertu d’engendrer et
N produire, suivan t Ptolemée (5 ) ; le
ec et le froid au contraire ne peuvent
F116 détruire. On voit par là pourquoi
F principe humide et chaud fut affecté
T U®ms > e* aux six signes du printemps
; ae 1 été ; et pourquoi le sec et le
f01 rut attribue à Typhon, ou aux
I \ ?§nes d’automne et d’hyver.
Macrobe fait l’application de cette
M v 0g' vit % % 1 S , «.583.
I I d, °s ’ Laert- 1 * . p. ;8j.
I P w » P- 364.
| * L e l i g . U a i v . T o m e I .
théorie sur les quatre qualités élémentaires
aux quatre saisons, ou aux quatre
parties de l ’année, aux quatre parties
du mois, et aux quatre parties du jour
(6). Tant cet esprit de symmétrie a
régné chez les anciens. La température
humide ou le développement de toute
l ’énergie féconde du principe humide
apartient au printemps ; le chaud à l’été ;
le sec destructif et stérile à l ’automne
l et le froid à l ’hiver.
De meme ; depuis la nouvelle lune
jusqu’à la première quadrature, règne
le principe humide générateur ; le chaud
règne depuis celle-ci jusqu’à la pleine
Inné ; au moment ou la lune s echancre
jusqu’à la deuxième quadrature, c’est
le sec de Typhon, qui commence à régner
; enfin le froid règne depuis le
dernier quartier jusqu’à la nouvelle lune.
La même distribution eut lieu entre les
quatre parties du jour, à compter de
1 humide aurore jusqu’au froid Hesperus
ou au coucher du soleil. C’est au printemps
( 7 ) , dit Varron, que le principe
humide est surabondant. En suivant
la marche de la Nature, on observe
une succession de générations et
de destructions; et la génération qui,
par sa Nature, est infiniment préférable
à la corruption , commence par
le développement de la chaleur tempé-
rée (8) , dit Abulmazar. C’est la chaleur
qui est le principe d’organisation
et de^ mouvement dans tous les corps
animes. Le froid, au contraire, est
cause de corruption et d’affoiblisse-
ment. C’est sous le premier signe ou
sons Arles qne commence à s’opérer la
génération ; c’est sous Libra, ou sous la
Balance que commence la destruction.
On trouvera occasion d’appliquer cette
observation dans l’explication de la cosmogonie
des Perses , qui fixent an lever
de la Balance et du serpent l’introduction
du mal dans l’Univers ; et eon-
(j) Ptolemée, Tetrabil, I. I , c. J.
(6) Macrob. Som. Scip. 1. S , c. 6.
(7) Varro de re Rusticà, 1. 1 , c. 40.
(8) Abul. Intro. 1. 1 , c. 3 , Stoff. p. 44.
C c