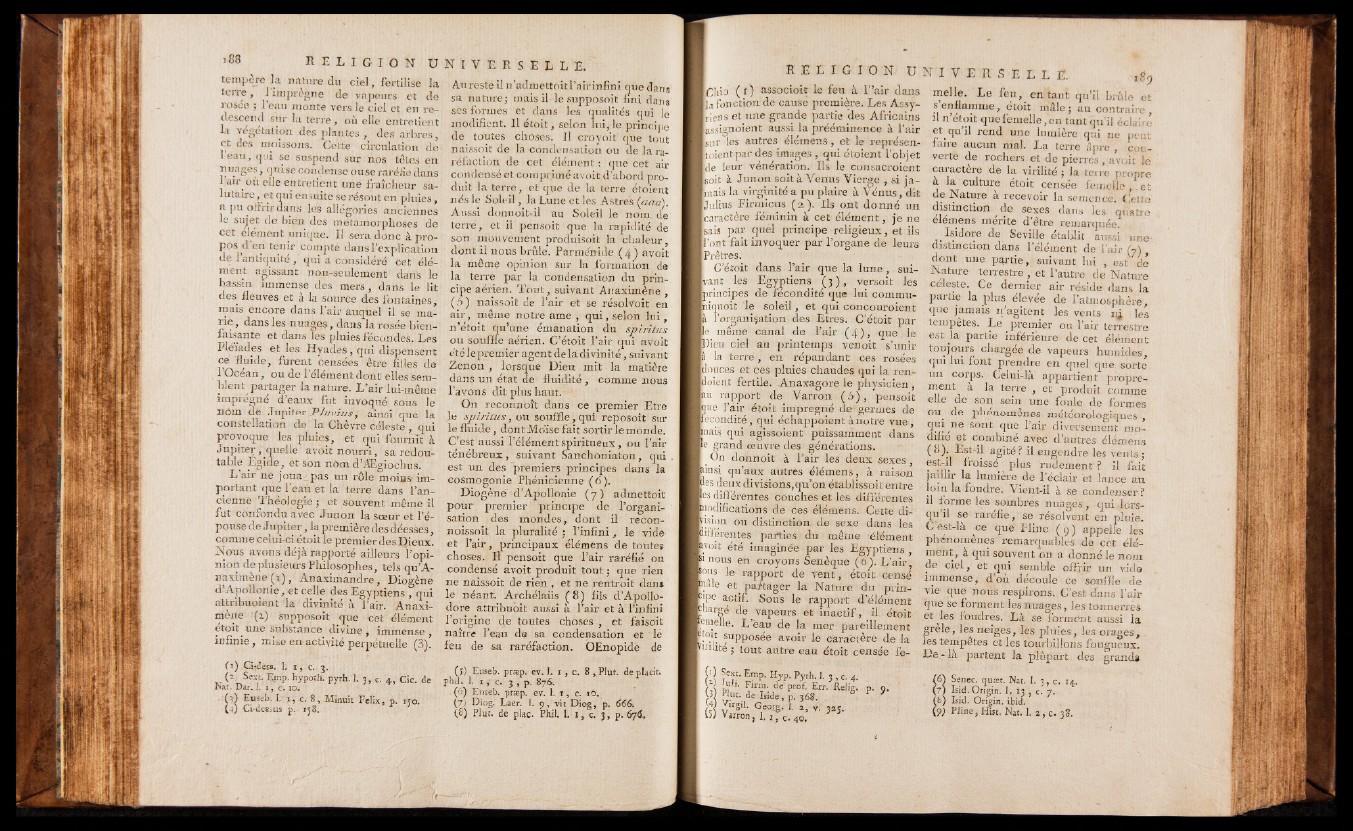
tempère la nature du ciel, fertilise la
terre, 1 imprègne de vapeurs et de
î.osee ; 1 eau monte vers le ciel et en redescend
sur la terre, où elle entretient
la végétation des plantes , des arbres,
et des moissons. Cette circulation cle-
1 eau, qui se suspend sur nos têtes en
nuages, qui se condense ou se raréfie dans
1 air où elle entretient une fraîcheur salutaire,
et qui ensuite se résout en pluies,
a pu offrir dans les allégories anciennes
le sujet de bien des métamorphoses de
cet élément unique. Il sera donc à propos
d en tenir compte dans l’explication
de 1 antiquité , qui a Considéré cet élément
agissant non-seulement dans le
bassin immense des mers, dans le lit
des fleuves et à la source des fontaines,
mais encore dans l’air auquel il se marie
, dans les nuages, dans la rosée bienfaisante
et dans les pluies fécondes. Les
Pléiades et les Hyades, qui dispensent
ce fluide, furent censées être filles de
. ^ Océan, ou de 1 element dont elles semblent
partager la nature. L ’air lui-même
imprégné d’eaux fut invoqué sous le
nom de Jupiter P lu vins, ainsi que la
constellation de la Chèvre céleste , qui
provoque les pluies, et qui fournit à
Jupiter ^quelle avoit nourri, sa redoutable
Egide, et son nom d’AEgiochus.
L ’air ne jouaipas un rôle moins important
que l’eau et la terre dans l’ancienne
Théologie ; et souvent même il
fut coriiondu avec Junon la soeur et l’épouse
de Jupiter, la première des déesses,
comme celui-ci étoit le premier clés Dieux.
Nous avons déjà rapporté ailleurs l’opinion
de plusieurs Philosophes, tels qu’A-
iiaxitnène ( i ) , Anaximandre, Diogène
d Apollonie, et celle des Egyptiens , qui
attribuoient la divinité à. l’air. Anaxi-
mène (t) suppôsoit que cet élément
etoit une substance divine, immense ,
infinie, mise en activité perpétuelle (3).
O) OUdess. 1; i , c. 3.
(2,1 Sext. Emp. hypoîh. pyrh. 1. 3, c. 4, Cic. de
Nat. Dar. 1. 1, c. 10. ■
' I- 3, c. 8, Minuit Félix, p. 130.
(l) Ci-detius p. 158.
Au reste il n ’admettoit l’air infini que dans
sa nature; mais il le supposoit fini dans
ses formes et dans les qualités qui le
modifient. Il étoit, selon lui,-le principe
de toutes choses. Il çroyoit que tout
naissoit de la condensation ou de la raréfaction
de cet élément : que cet air
condensé et comprimé avoit d’abord produit
la terre, et que de la terre étoient
nés le Soleil, la Lune et les Astres (aaa).
Aussi donnoit-il au Soleil le nom de
terre, et il pensoit que la rapidité de
son mouvement produisoit la chaleur,
dont il nous brûle. Parménide (4 ) avoit
la même opinion sur la formation de
la terre par la condensation du principe
aérien. Tout, suivant Anaximène ,
(6) naissoit de l’air et se résolvoit en
air, même notre ame , qui, selon lu i,
n’étoit qu’une émanation du spiritus
ou souffle aérien. C’étoit l’air qui avoit
été lepremier agent de la divinité, suivant
Zenon , lorsque Dieu mit la matière
dans un état de fluidité , comme nous
l ’avons dit plus haut.
On reconnoît dans ce premier Etre
le spiritus, oti souffle, qui reposoit sur
le fluide, dont Moïse fait sortir le inonde.
C’est aussi l’élément spiritueux, ou l’air
ténébreux, suivant Sanchoniaton, qui
est un des premiers principes dans la
cosmogonie Phénicienne (6).
Diogène d’Apollonie (7) admettoit
pour premier principe de l’organisation
des mondes, dont il recon-
noissoit la pluralité ; l’infini , le vide
et l’air, principaux élémens de toutes
choses. Il pensoit que l’air raréfié ou
condensé avoit produit tout ; que rien
ne naissoit de rien , et ne rentroit dan*
le néant. Archélaiis (8) fils d’Apollo-
dore attribuoit aussi à l’air et à l’infini
l’origine de toutes choses , et faisoit
naître l’eau de sa condensation et le
feu de sa raréfaction. OEnopidè de
(5) Euseb. præp. ev. 1. 1 , c. 8 ,PIut. de pUcir.
phii. I. 1 , c. 3 , p. 876.
(6) Euseb. præp. ev. 1. 1 , c. 10.
(7) Diog. Laer. 1. 9 , vit Diog, p. 66f>.
(8) Plut, de plac. Phii. 1. 1 , c. 3, p. 67S.
(Clno ( I ) associoit le feu à l”air dans
lia fonction de cause première. Les Assyriens
et une grande partie des Africains
assignoient aussi la prééminence à l’air
sur les autres élémens, et le représen-
Stoientpar des images , qui étoient l’objet
(de leur vénération. Ils le consacroient
soit à Junon soit à Venus Vierge , si ja-
hnais la virginité a pu plaire à Vénus, dit
[Julius Firmicus (2). Ils ont donné un
[caractère féminin à cet élément, je ne
bais par quel principe religieux, et ils
l’ont fait invoquer par l’organe de leurs
Prêtres. .
C’étoit dans l’air que la lune, suivant
les Egyptiens (3 ) , versoit les
[principes de fécondité que lui cominu-
niquoit le soleil, et qui concouroient
pi l’organisation des Etres. C’étoit par
le même canal de l’air (4 ) , quelle
Dieu ciel au printemps venoit s’unir
p la terre, en répandant yces rosées
[douces et ces pluies chaudes qui la renvoient
fertile. Anaxagore le physicien ,
pu rapport de Varron (6 ) , pensoit
fjue l’àir étoit imprégné de germes de
fécondité, qui échâppoient à notre vue ,
pais qui agissoient puissamment dans
le grand oeuvre des .générations.
[ On donnoit à l’air les deux sexes
funsi qu’aux autres élémens, à raison
les deux divisions,qu’on établissoit entre
les différentes couches et les différentes
fcodificatiohs de ces élémens. Cette division
ou distinction de sexe dans les
.afferentes parties du même 'élément
pvoit été imaginée par les Egyptiens ,
pi nous en croyons Senèque (6). L ’air,
jscms le rapport de Vent, étoit censé
nale et partager la Nature du prin~
|pe actif. Sous le rapport delément
marge de ^vapeurs et inactif, il étoit
lemelle. L ’eau de la mer pareillement
[toit supposée avoir le caractère de la
■ nhté ; tout autre eau étoit censée fe-
W fjll E“ P‘ h5'P- pyrh-13 > c. 4.
a S f l Drm. de prof. Err. Relie, p. 9.
(3) Plut, de Iside, p. 368. ^
! Vtrgil. Georg. 1. », v. 325.
151 Virron, 1. 1, c. 40.
nielle. Le feu, entant qu’il brûle et
s enflamme, etoit mâle; au contraire,
fl n’étoit que femelle ,en tant qu’il éclairé
et qu il rend une lumière qui ne peut
faire aucun mal. La terre âpre , couverte
cle rochers et de pierres, avoit le
caractère de la virilité ; la terre propre
à la culture étoit censée femelle, et
de Nature à recevoir la semence. Cette
distinction de sexes dans les quatre
elémens mérite d’être remarquée.
Isidore de Seville établit aussi une-
distinction dans l’élément de 1 air (7)
dont une partie, suivant lui , est dé
Nature terrestre , et l ’autre cle Nature
céleste. Ce dernier air réside dans la
partie la plus élevée de l ’atmosphère,
que jamais n’agitent les vents nj, les
tempêtes. Le premier ou l’air terrestre
est la partie inferieure de cet élément
toujours chargée de vapeurs humides,
qui lui font prendre en cpiel que sorte
un corps. Celui-là appartient proprement
à la terre , et produit comme
elle de son sein une foule de formes
ou de phénomènes météorologiques ,
T !j 116 s°nt que l’air diversement modifié
et combiné avec d’autres élémens
(8). Est-il agité? il engendre les vents;
est-il froissé plus rudement: ? il fait
jaillir la lumière de l ’éclair et lance au
loin la foudre, Vient-il à se condenser ?
il f orme les sombres nuages, qui lors-
qu’il se raréfie, se résolvent en pluie.
C est-la ce que Pline (9) appelle les
phénomènes remarquables de cet élément,
à qui souvent on a donné le nom
de ciel, et qui semble offrir un vicia
immense, d’où découle ce souffle de
vie que nous respirons. C’est dans l’air
que se forment les nuages, les tonnerres
et les foudres. Là se forment aussi la
grêle, les neiges, les pluies, les orages,
les tempêtes et les tourbillons fougueux.
De- là partent la plûpart des grand*
(6) Senec. qviæt. Nat. I. 3, c. 14.
(7) Isid.Origin. 1. 13 , c. 7.
(b) Isid. Origin. ibid.
(9) Pline, Hist. Nat. 1, 2 , c. 3$.