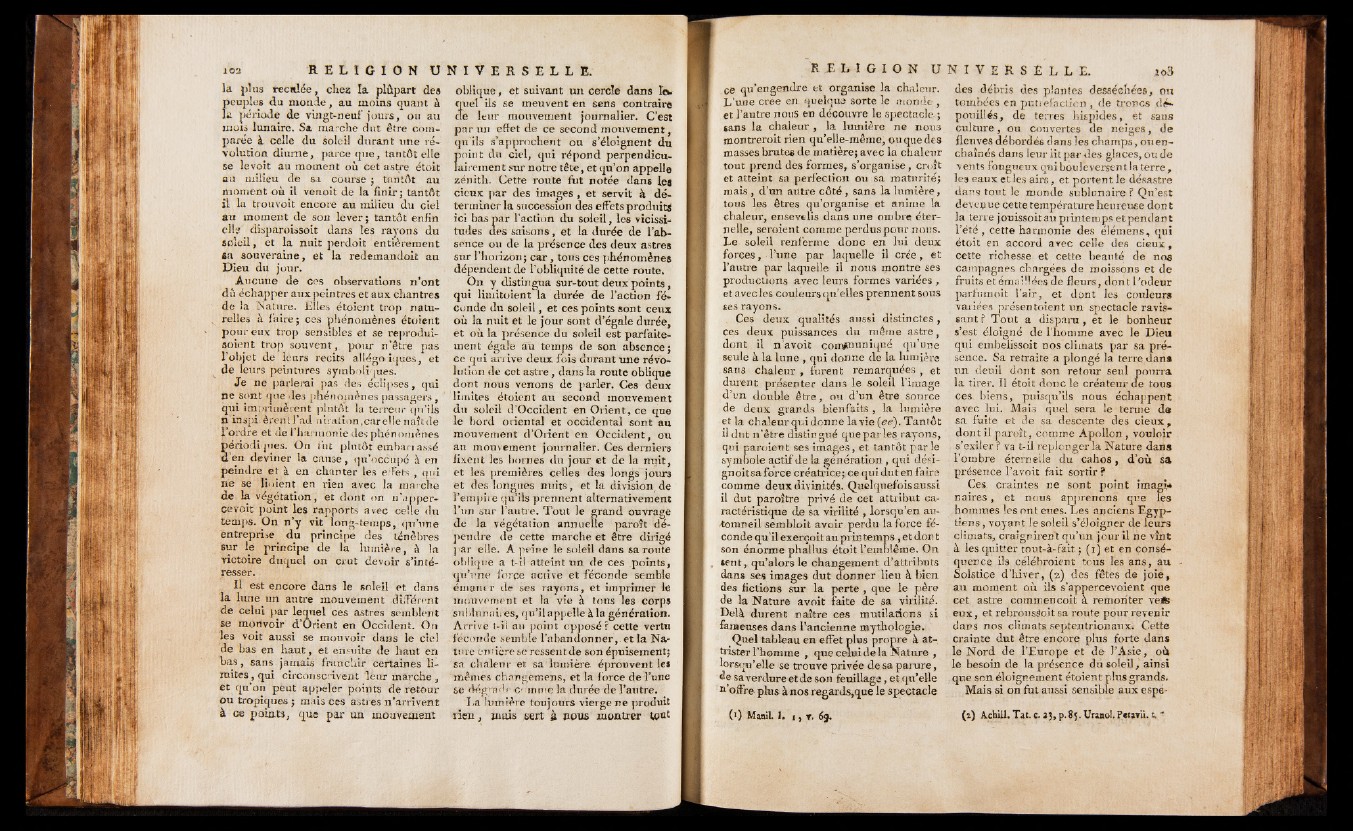
la plus recalée, chez la plûpart des
peuples du monde, au moins quant à
la période de vingt-neuf jours, ou au
mors lunaire. Sa marche dut être comparée
à celle du soleil durant une révolution
diurne, parce que, tantôt elle
se levoit au moment où cet astre étoit
au milieu de sa course ; tantôt au
moment où il venoit de la finir ; tantôt
il la trouvoit encore au milieu du ciel
au moment de son lever; tantôt enfin
elle disparoissoit dans les rayons du
soleil, et la nuit perdoit entièrement
ta souveraine, et la redemandoit au
Dieu du jour.
Aucune de cos observations n’ont
dû échapper aux peintres et aux chantres
de la Nature. Elles étoient trop naturelles
à faire; ces phénomènes étoient
pour eux trop sensibles et se reprodui-
soient trop souvent,, pour n’être pas
l’objet de leurs récits allégoiques, et
de leurs peintures symboliques.
Je ne parlerai pas des éclipses, qui
ne sont que des phénomènes passagers,
qui impi miment plutôt la terreur qu’ils
n inspi èrent l ad niration,car elle naît de
1 ordre et de l’harmonie des phénomènes
ériodi pies. On fut plutôt embarrassé
’en deviner la cause, qu’occupé à en
peindre et à en chanter les effets , qui
ne se liaient en rien avec la marche
de la végétation, et dont on n'.ipper-
cevôit point les rapports avec celle du
temps. On n’y vit long-temps, qu’une
entreprise du principe des ténèbres
sur le principe de la lumière, à la
victoire duquel on crut devoir s’intéresser.
Il est encore dans le soleil et dans
la lune un autre mouvement différent
de celui par lequel ces astres semblent
se mouvoir d’Orient en Occident. On
les voit aussi se mouvoir dans le ciel
de bas en haut, et ensuite de haut en
bas, sans jamais franchir certaines limites
, qui circonscrivent leur marche ,
et qu’on peut appeler points de retour
ou tropiques $ mais ces astres n’arriyent
à ce points, que par un mouvement
oblique, et suivant un cercle dans lo.
quel ils se meuvent en sens contraire
de leur mouvement journalier. C’est
par un effet de ce second mouvement,
qu'ils s’approchent ou s’éloignent du
point du ciel, qui répond perpendiculairement
sur notre tête, et qu’on appelle
zénith. Cette route fut notée dans les
cieux par des images , et servit à déterminer
la succession des effets produit#
ici bas par l’action du soleil, les vicissitudes
des saisons, et la durée de l’absence
ou de la présence des deux astres
sur l'horizon; car, tons ces phénomènes
dépendent de l’obliquité de cette route.
On y distingua sur-tout deux peints,
qui limitoient la durée Se l’action féconde
du soleil, et ces points sont ceux
où la nuit et le jour sont d’égale durée,
et où la présence du soleil est parfaitement
égale élu temps de son absence;
ce qui aii ive deux fois durant une révo-
lution de cet astre, dans la route oblique
dont nous venons de parler. Ces deux
limites étoient au second mouvement
du soleil d’Occident en Orient, ce que
le bord oriental et occidental sont au
mouvement d’Orient en Occident, ou
au mouvement journalier. Ces derniers
fixent les bornes du jour et de la nuit,
et les premières celles des longs jours
et des longues nuits, et la division de
l'empire qu’ils prennent alternativement
l’un sur l’autre. Tout le grand ouvrage
de la végétation annuelle paroît dépendre
de cette marche et être dirigé
par elle. A peine le soleil clans sa route
oblique a t-il atteint un de ces points,
qu’une force active et féconde semble
émaner de ses rayons, et imprimer le
mouvement et la vie à tous les corps
sublunaires, qu’il appelle à la génération.
Arrive t-il au point opposé? cette vertu
féconde semble l’abandonner, et la Nature
ornière se ressent de son épuisement;
sa chaleur et sa lumière éprouvent les
mêmes changemens, et la force de l’une
se dégradr c rnme la durée de l’autre.
La lumière toujours vierge re produit
rien, mais sert à nous montrer tout
ce qu’engendre et organise la chaleur.
L ’une créé en quelque sorte le monde ,
et l’autre nous en découvre le spectacle ;
sans la chaleur , la lumière ne nous
montrerait rien qu’elle-même, ou que des
masses brutes de matière; avec la chaleur
tout prend des formes, s’organise, croît
et atteint sa perfection ou sa maturité;
mais , d’un autre côté, sans la lumière,
tous les êtres qu’organise et anime la
chaleur, ensevelis dans une ombre éternelle,
seraient comme perdus pour nous.
Le soleil renferme donc en lui deux
forces, l’une par laquelle il crée, et
l’autre par laquelle il nous montre ses
productions avec leurs formes variées ,
et avec les couleurs qu’elles prennent sous
ses rayons.
Ces deux qualités aussi distinctes,
ces deux puissances du même astre,
dont il n’avoit comfnuniqué qu’une
seule à la lune, qui donne de la lumière
sans chaleur, furent remarquées, et
durent présenter dans le soleil l’image
d’un double être, ou d’un être source
de deux grands bienfaits, la lumière
et la chaleur qui donne la vie (ee). Tantôt
il dnt n’être distingué queparles rayons,
qui paraient ses images, et tantôt par le
symbole actif de la génération, qui dési-
gnoitsa force créatrice; ce qui dut en faire
comme deux divinités.. Quelquefois aussi
il dut paraître privé de cet attribut caractéristique
de sa virilité , lorsqu’en au-
'tornneil sembloit avoir perdu la force féconde
qu’il exerçoit au printemps, et don t
son énorme phallus était l’emblème. On
sent, qu’alorsle changement d’attributs
dans ses images dut donner lieu à bien
des fictions sur la perte , que le père
de la Nature avoit faite de sa virilité.
Delà durent naître ces mutilations si
fameuses dans l’ancienne mythologie.
Quel tableau en effet plus propre à attrister
l’homme , que celui de la Nature ,
lorsqu’elle se trouve privée de sa parure,
de sa verdure et de son feuillage, et qu’elle
u offre plus à nos regards,que le spectacle
(0 Manil. 1. 1 , t. 6j .
jo 3
des débris des plantes desséehées, ou
tombées en putréfaction , de troncs dépouillés,
de terres bispides, et sans
culture, ou couvertes de neiges, de
fleuves débordés dans les champs, ou enchaînés
dans leur lit par des glaces, ou de
vents fougueux qui bouleversent la terre,
les eaux etles airs, et portent le désastre
dans tout le monde sublunaire ? Qu’est
deven ue cette température heureuse don t
la terre jouissoit au printemps et pendant
l’été, cette harmonie des élémens, qui
étoit en accord avec celle des cieux,
cette richesse et cette beauté de nos
campagnes chargées de moissons et de
fruits et émaillées de fleurs, dont l'odeur
parfumoit l’air, et dont les couleurs
variées présentoient un spectacle ravissant?
Tout a disparu, et le bonheur
s’est éloigné de l’homme avec le Dieu
qui embelissoit nos climats par sa présence.
Sa retraite a plongé la terre dans
un deuil dont son retour seul pourra
la tirer. Il étoit donc le créateur de tous
ces biens, puisqu’ils nous échappent
avec lui. Mais quel sera le terme da
sa fuite et de sa descente des cieux,
dont il paroît, comme Apollon, vouloir
s’exiler? va t-il replonger la Nature dans
l’ombre éternelle du cahos, d’où sa
présence l’avoit fait sortir ?
Ces craintes ne sont point imaginaires
, et nous apprenons que les
hommes les ont eues. Les anciens Egyptiens,
voyant le soleil s’éloigner de leurs
climats, craignirent qu’un jour il ne vînt
à les quitter tout-à-fait ; (i) et en conséquence
ils célébraient tous les ans, au
Solstice d’hiver, (2) des fêtes de joie,
au moment où ils s’appercevoient que
cet astre çommencoit à remoriter veJS
eux, et rebrousâoit sa route pour revenir
dans nos climats septentrionaux-. Cette
crainte dut être encore plus forte dans
le Nord de l’Europe et de- l’Asie, où
le besoin de la présence du soleil, ainsi
que son éloignement étoient plus grands.
Mais si on fut aussi sensible aux espé-
(i) Actiiil. Tat. c. 33, p-85. Uranol. Petavii. A '