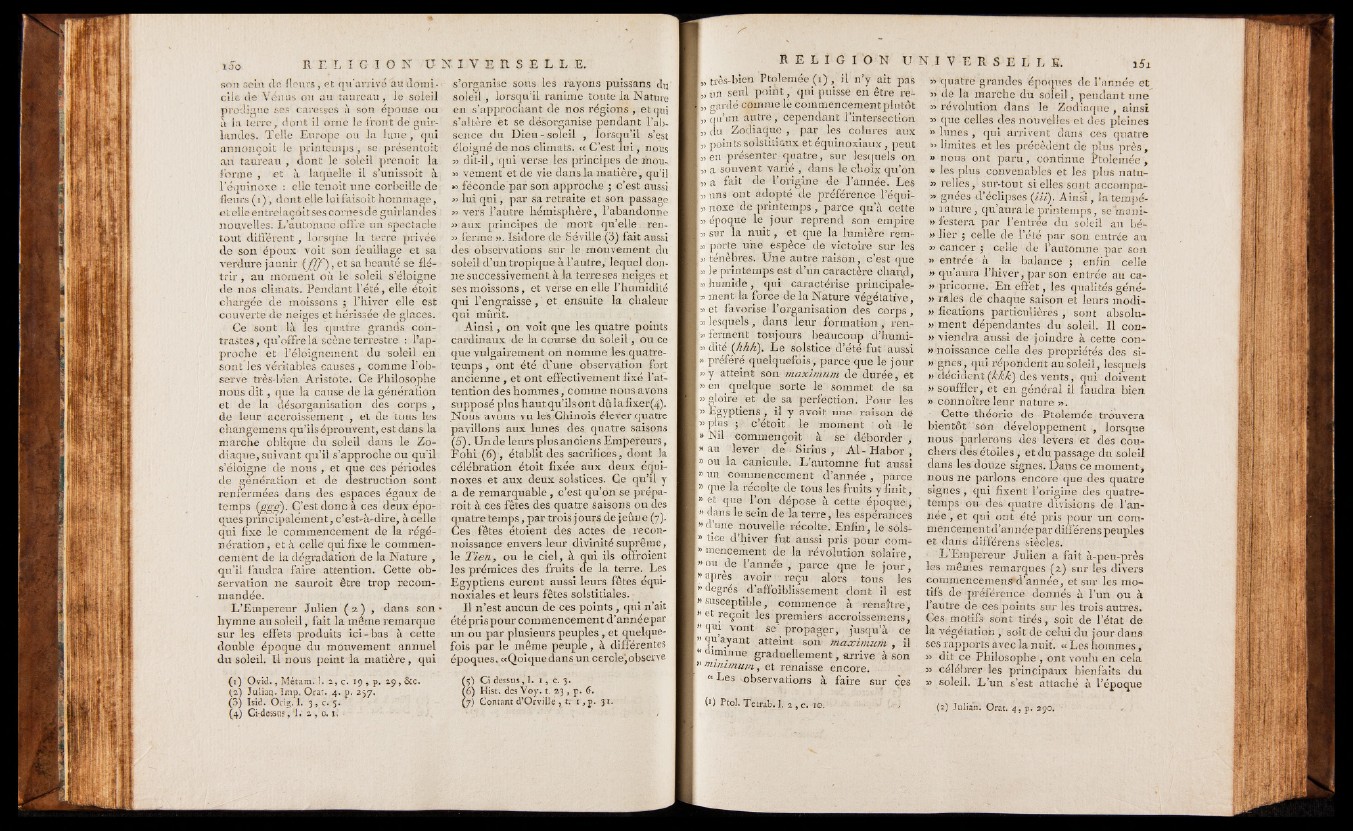
son sein (le fleurs, et qu'arrivé au domicile
de Vénus ou au taureau, le soleil
prodigue ses caresses à son épouse ou
à la terre, dont il orne le front de guirlandes.
Telle Europe ou la lune, qui
annonçoit le printemps, se présentoit
au taureau , dont le soleil prenoit la
forme , et à laquelle il s’unissoit à,
l ’équinoxe : elle tenait une corbeille de
fleurs (1), dont elle luifaisoit hommage,
et elle entrelaçoit ses cornes de guirlandes :
nouvelles: L ’automne offre un spectacle
tout différent, lorsque la terre privée
de son époux voit son feuillage et sa
verdure jaunir ( f f f ) , et sa beauté se flétrir
, au moment où le soleil s’éloigne
de nos climats. Pendant l’été, elle étoit
chargée de moissons ; l’hiver elle est
couverte de neiges et hérissée de glaces.
Ce sont là les quatre grands contrastes
, qu’offre là scène terrestre : l’approche
et l’éloignement du soleil en
sont les véritables causes , comme l’observe
très-bien Aristote. Ce Philosophe
nous d it, que la cause de la génération
et de la désorganisation des corps ,
de leur accroissement , et de tous les
changemens qu’ils éprouvent, est dans la
marche oblique du soleil dans le Zodiaque,
suivant qu’il s’approche ou qu’il
s’éloigne de nous , et que ces périodes
de génération et de destruction sont
renfermées dans des espaces égaux de
temps (ggg) ■ C’est donc à ces deux époques
principalement, c’est-à-dire, à celle
qui fixe le commencement de la régénération
, et à celle qui fixe le commencement
de la dégradation de la Nature ,
qu’il faudra faire attention. Cette observation
ne sauroit être trop recommandée.
L ’Empereur Julien ( a ) , dans son *
hymne an soleil, fait la même remarque
sur les effets produits ici-bas à cette
double époque du mouvement annuel
du soleil. Il nous peint la matière, qui 1 2 3 4
(1) Ovid., Métam. !. a, c'. 19 , p. 29, ôte.
(2) Juiiaq. Imp, Orar. 4. p. 2W.
(3) Isid. Orîg. 1. 3 , c. 5.
(4) Ci-dessus, 1. 2 , o. 1.
s’organise sons les rayons puissans du
soleil, lorsqu’il ranime toute la Nature
en s’approchant de nos régions , et qui
s’altère et se désorganise pendant l'absence
du Dieu-soleil , lorsqu’il s’est
éloigné de nos climats. « C’est lu i, nous
33 dit-il, qui verse les principes de mou-
33 vement et de vie dans la matière, qu’il
»3 féconde par son approche ; c’est aussi
33 lui qui, par sa retraite et son passage
33 vers l’autre hémisphère, l’abandonne
33 aux principes de mort qu’elle. ren-
33 ferme ». Isidore de Séville (3) fait aussi
des observations sur le mouvement du
soleil d’un tropique à l’autre, lequel donne
successivement à la terre ses neiges et
ses moissons, et verse en elle l’humidité
qui l’engraisse, et ensuite la chaleur
qui mûrit.
Ainsi, on voit que les quatre points
cardinaux de la course du soleil, ou ce
que vulgairement on nomme les quatre-
temps , ont été d’une observation fort
ancienne , et ont effectivement fixé l’attention
des hommes, comme nous avons
supposé plus haut qu’ils ont dûlalixer(4).
.Nous avons vu les Chinois élever quatre
pavillons aux lunes des quatre saisons
(5). Un de leurs pins anciens Empereurs,
Fohi (6) , établit des sacrifices, dont la
célébration étoit fixée aux deux équinoxes
et aux deux solstices. Ce qn’il y
a de remarquable, c’est qu’on se préparoi
t à ces fêtes des quatre saisons ou des
quatre temps, par trois jours de jeûne (7).
Ces fêtes étoient des actes de recon-
noissance envers leur divinité suprême,
le Tien, ou le ciel, à qui ils olfroient
les prémices des fruits de la terre. Les
Egyptiens eurent aussi leurs fêtes équinoxiales
et leurs fêtes solstitiales.
Il n’est aucun de ces points , qui n’ait
été pris pour commencement d’année par
un ou par plusieurs peuples, et quelquefois
par le même peuple, à différentes
époques, «Qoique dans un cercle", observe
(5) Ci dessus, 1. 1 , c. 3.
6) Hist. des Voy. t. 23 , p. 6.
7) Contant d’Orviilè , t . 1 3 p. 31*
§f ' • |P
,m seul point, qui puisse en être regardé
comme lé commencementplutôt
|„ qu’un autre, cependant l’intersection
|, du Zodiaque , par les colures aux
„ points solstiliaux et équinoxiaux , peut
j en présenter quatre, sur lesquels on
L a souvent varié , dans le choix qu’on
„ a fait de l’origine de l’année. Les
uns ont adopté de préférence l’équi-
, noxe de printemps , parce qu’à cette
> époque le jour reprend son empire
> sur la nuit, et que la lumière rem-
3 porte une espèce de victoire sur les
0 ténèbres*. Une autre raison, c’est que
3 le printemps est d’un caractère chaijd,
3 humide , qui caractérise principale,-
ment la force de la Nature végétative,
L et favorise l ’organisation des corps ,
3 lesquels , dans leur formation, ren-
3 ferment toujours beaucoup d’humi-
33 dite (hhh). Le solstice d’été fut aussi
P préféré quelquefois, parce que le jour
[33 y atteint son maximum de durée, et
J» en. quelque sorte le sommet de sa
33 gloire et de sa perfection. Pour les
1 ’ Égyptiens , il y avoit une raison dé
> plus ;■ c’étoit 1 le moment ' où le
»Nil eommençoit à se déborder ,
» au lever de » Sirius , Al - Habor ,
» ou la canicule. L ’automne fut aussi
» un commencement d’année , parce
» que la récolte de tous les fruits y finit,
» et que l’on dépose à cette époque;,
» dans le sein de la terre, les espérances
«d’une nouvelle récolte. Enfin, le sôls-
» tice d’hiver fut aussi pris pour com-
» mencement de la révolution solaire,
«ou de l’année , parce que le- jour,
» après avoir reçu alors tous les
» degrés d’afï'oihlissement dont il est
» susceptible, commence à renaître,
« et reçoit les premiers accroissemens,
« qui vont se" propager, jusqu’à ce
» qu ayant atteint son maximum , il
« diminue graduellement, arrive à son
« minimum, et renaisse encore. -
| Ées -observations à faire sur ces
(•) Ptol. Tetrab. 1. 2 , c. io. -
33 quatre grandes époques de l’année et
33 de la marche du soleil, pendant une
33 révolution dans le Zodiaque , ainsi
>3 que celles des nouvelles et des pleines
» lunes , qui arrivent dans ces quatre
33 limites et les précèdent de plus près,
» nous ont paru, continue Ptolemée ,
» les plus convenables et les plus natu-
33 relies, sur-tout si elles sont accompa-
3» gnées d’éclipses (iii). Ainsi, laternpé-
» rature, qu’aura le printemps, se'mani-
» Pestera par l ’entrée du soleil au bé-
» lier 5 celle de l ’été par son entrée au
33 cancer $ celle de l’automne par son
» entrée à la balance ; enfin celle
» qu’aura l ’hiver, par son entrée au ca-
» pricorne. En effet, les qualités géné-
» râles de chaque saison et leurs modi-
» fications particulières , sont absolu-
» ment dépendantes du soleil. Il con-
» viendra aussi de joindre à cette con-
»noissance celle des propriétés des si-
» giles. qui répondent au soleil, lesquels
» décident (J-M) des vents, qui doivent
» souffler, et en général il faudra bien.
» connoître leur nature 3».
Cette théorie de Ptolemée trouvera
bientôt "sôn développement ,- lorsque
nous parlerons des levers et des couchers
dès étoiles, et du passage du soleil
dans les douze signes. Daiis ce moment,
nous ne parlons encore que des quatre
signes, qui fixent l’origine des quatre-
temps ou-des quatre divisions de l’an-
liee , et qui ont été pris pour un commencement
d’an n ée par différen s peuples
et dans différens siècles.
L ’Empereur Julien a fait à-peu-près
les mêmes remarques (z) sur les divers
commencement d’année, et sur les motifs
(le-'préférence donnés à l’un ou à
l’autre de ces points sur les trois autres.
Ces motifs sont tirés, soit de l’état de
la végétation i soit de celui du jour dans
ses rapports avec la nuit. « Les hommes,
33 dit ce Philosophe , ont voulu en cela
33 célébrer les principaux bienfaits du
33 soleil. L ’un s’est attaché à l’époque
(2) Julian. Orat. 4, p. 290.