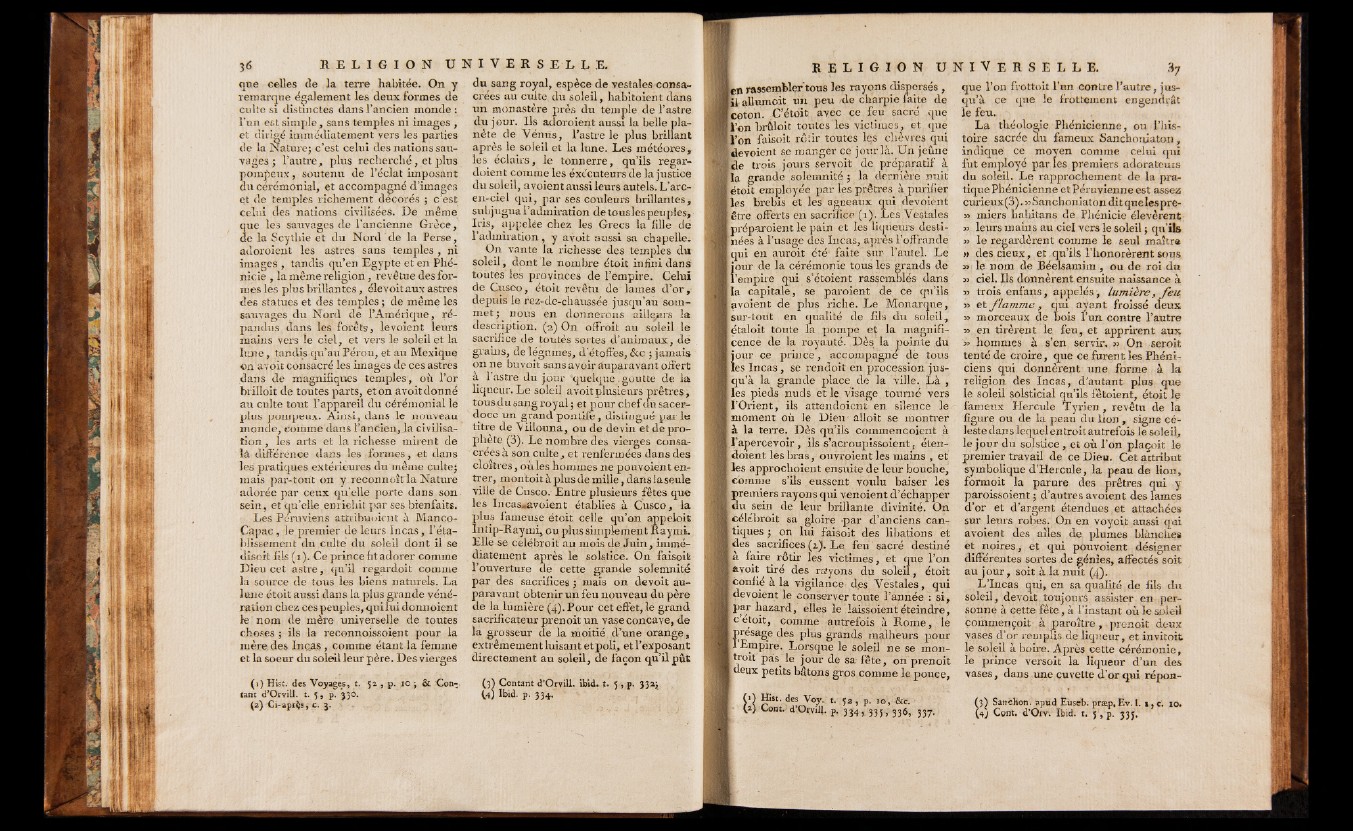
que celles de la terre habitée. On y
remarque également les deux formes de
culte si distinctes dans l’ancien monde :
l’un est simple, sans temples ni images ,
et dirigé immédiatement vers les parties
de la Nature; c’est celui des nations sauvages
; l’autre, plus recherché, et plus
pompeux, soutenu de l’éclat imposant
du cérémonial, et accompagné d’images
et de temples richement décorés ; c’est
celui des nations civilisées. De même
que les sauvages de l’ancienne Grèce,
de la Scythie et du Nord de la Perse,
adoroient les astres sans temples , ni
images , tandis qu’en Egypte et en Phénicie
, la même religion, revêtue des formes
les plus brillantes, élevoitaux astres
de6 statues et des temples ; de même les
sauvages du Nord de l’Amérique, répandus
dans les forêts, levoient leurs
mains vers le ciel, et vers le soleil et la
lune, tandis qu’au Pérou, et au Mexique
on avoit consacré les images de ces astres
dans de magnifiques temples, où l’or
brilloit de toutes parts, et on avoit donné
au culte tout l’appareil du cérémonial le
plus pompeux. Ainsi, dans .le nouveau
monde, comme dans l’ancien, la civilisation
, les arts et la richesse miren t de
là différence dans les formes, et dans
les pratiques extérieures du même culte;
mais par-tout on y reconnoît la Nature
adorée par ceux qu'elle porte dans son
sein, et qu’elle.enrichit par ses bienfaits.
Les Péruviens attribuaient à Manco-
Capac, le premier de leurs Incas, l’établissement
du culte du soleil dont il se
disoit fils (1). Ce prince ht adorer comme
Dieu cet astre, qu’il regardoit comme
la source de tous les biens naturels. La
lune était aussi dans la plus grande vénération
chez ces peuples, quilui donnoient
le nom de mère universelle de toutes
choses ; ils la reconnoissoi^nt pour la
mère, des Inças, comme étant la femme
et la soeur du soleil leur père. Des vierges 1 2
(1) Hist. des Voyages, t. 52 , p. 10 ; & Contant
d’Orvill. t. 5, p. 33Ô.
(2) Ci-apiès, c, 3.
du sang royal, espèce de vestales consacrées
au cuite du soleil, habitoient dans
un monastère près du temple de l ’astre
du jour. Ils adoroient aussi la belle planète
de Vénus, l’astre le plus brillant
après le soleil et la lune. Les météores ,
les éclairs, le tonnerre, qu’ils regar-
doient comme les éxéçuteurs de la justice
du soleil, avoient aussi leurs autels. L’arc-
en-ciel qui, par ses couleurs brillantes,
subjugua l’admiration de touslespeuples,
Iris, appelée chez les Grecs la fille de
l ’admiration, y avoit aussi sa chapelle.
On vante la richesse des temples du
soleil, dont le nombre étoit infini dans
toutes les provinces de l’empire. Celui
de Çusco, étoit revêtu de lames d’or,
depuis le rez-de-chaussée jusqu’au sommet;
nous en donnerons ailleurs la
description, (a) On offroit au soleil le
sacrifice de toutes sortes d’animaux, de
grains, de légumes, d étoffes, &c ; jamais
on ne buvoit sans avoir auparavant offert
à l’astre du jour ‘quelque , goutte de la
liqueur. Le soleil avoit plusieurs prêtres,
tous du sang royal ; et pour chef du sacerdoce
un grand pontife, distingué par le
titre de Villouna, ou de devin et de prophète
(3). Le nombre des vierges consacrées
à son culte, et renfermées dans des
cloîtres, où les hommes ne pouvoient entrer,
m ontoit à plus de mille, dans 1 a seule
ville de Cusco. Entre plusieurs fêtes que
les Incas*avoient établies à Cusco, la
plus fameuse étoit celle qu’on appeioit
Intip-Raymi, ou plus simplement Raymi.
Elle se cèiébroit au mois de Juin, immédiatement
après le solstice. On faisoit
l ’ouverture de cette grande solemnité
par des sacrifices ; mais on devoit auparavant
obtenir un feu nouveau du père
de la lumière (4). Pour cet effet, le grand
sacrificateur prenoit un vase concave, de
la grosseur de la moitié d’une orange,
extrêmement luisant et poli, et l’exposant
directement au soleil, de façon qu’il pût
(3) Contant d’Orvill. ibid. t. 5, p. 331;
(4) Ibid. p. 334.
[en rassembler'tous les rayons dispersés ,
■ il allumoit un peu -de charpie faite de
'coton. C’étoit ayec ce feu sacré que
l’on brûloit toutes les victimes, et qué
l’on faisoit rôtir toutes lqs chèvres qui
dévoient se manger ce jour là. Un jeûne
de trois jours servoit de préparatif à
la grande solemnité ; la dernière nuit
étoit employée par les prêtres à purifier
les brebis et les agneaux qui dévoient
être offerts en sacrifice (1). Les Vestales
préparoient le pain et les liqueurs destinées
à l’usage des Incas, après l’offrande
qui en auroit 6té; faite sur l’autel. Le
jour de la cérémonie tous les grands de
l'empire qui s’étoient rassemblés dans
la capitale, se paroient de, ce qu’ils
avoient de plus riche. Le Monarque,
sur-toüt en qualité de fils du soleil ,
étaloit toute la pompe et la magnificence
de la royauté. Dès la pointe du
jour ce prince, accompagne de tous
les Incas, se rendoit en procession jus-
qu’à la grande place, de la ville. Là ,
les pieds nuds et le visage tourné vers
l’Orient, ils attendoicnt en silence le
moment où le Dieu- alloit se montrer
à la terre. Dès qu’ils commencoient à
l’apercevoir, ils s’acroupissoient s éten-
doient les bras, ouvraient les mains , et
les approchoient ensuite de leur bouche,
comme s’ils eussent voulu baiser les
premiers rayons qui venoient d’échapper
[du sein de leur brillante divinité. On
célébroit sa gloire -par d’anciens can-
| tiques ; on lui faisoit des libations et
des sacrifices (2). Le feu sacré destiné
|à faire rôtir les victimes, et que l ’on
■ avoit tiré des rayons du soleil, étoit
[confié à la vigilance des Vestales, qui
[dévoient le conserver toute l’année : si,
par hazard, elles le laissoient éteindre,
c étoit, comme autrefois .'à Rome, le
[présage des plus grands malheurs pour
Il Empire. Lorsque le soleil ne se mon-
|troit pàs^ le jour de sa fête, on prenoit
[deux petits bâtons gros comme le pouce,
que l ’on frottait l’un contre l’autre, jusqu’à
ce que le frottement engendrât
le feu.
La théologie Phénicienne, ou l ’histoire
sacrée cm fameux Sanchoniaton,
indiqué ce moyen comme celui qui
fut employé par les premiers adorateurs
du soleil. Le rapprochement de la pratique
Phénicienne et Péruvienne est assez
curieux(3) . »Sanchoniaton dit quelespré-
» miers hahitans de Phénicie élevèrent
» leurs mains au ciel vers le soleil ; qu’ils
» le regardèrent comme le seul maître
» des cieux, et qu’ils l ’honorèrent sous
» le nom de Béelsamim , ou de roi du
33 ciel. Ils donnèrent ensuite naissance à
33 trois enfans, appelés , lumière, feu
33 et flamme , qui ayant froissé deux
33 morceaux de bois l’un contre l’autre
33 en tirèrent le feu, et apprirent aux
33 hommes à s’en servir, 33 On serait
tenté de croire, que ce furent les Phéniciens
qui donnèrent une forme à la
religion des Incas, d'autant plus que
le soleil solsticial qu’ils fêtaient, étoit le
fameux Hercule Tyrien, revêtu de la
figure ou de la peau du lion, signe céleste
dans lequel entroit autrefois le soleil,
le jour du solstice, et où l’on plaçait le
premier travail de ce Dieu. Cet attribut
symbolique d’Hercule, la peau de lion,
formoit la parure des prêtres qui y
paroissoient ; d’autres avoient des lames
d’or et d’argent étendues et attachées
sur leurs robes. On en voyoit anssi qui
avoient des ailes de plumes blanches
et noires , et qui pouvoient désigner
différentes sortes de génies, affectés soit
au jour, soit à.là nuit (4).
L ’Incas qui, en sa quaEté de fils du
soleil, devoit toujours assister en personne
à cette fête, à l’instant où le soleil
çoiùmençoit à paroître, prenoit deux
vases d’or remplis de liqueur, et invitait
le soleil à boire. Après cette cérémonie,
le prince versoit la liqueur d’un des
vases, dans une cuvette d’or qui répon-
UHist, des Voy. t, 52 , p. 10, &c.
ï ) Cont. d’Orvill. p. 334, 335 , 336, 337.
(3) Sanchon. apud Euseb. præp, Ev. I. i , c. 10.
(4) Cont. d’Orv. Ibid, t, 5 , p. 33j.