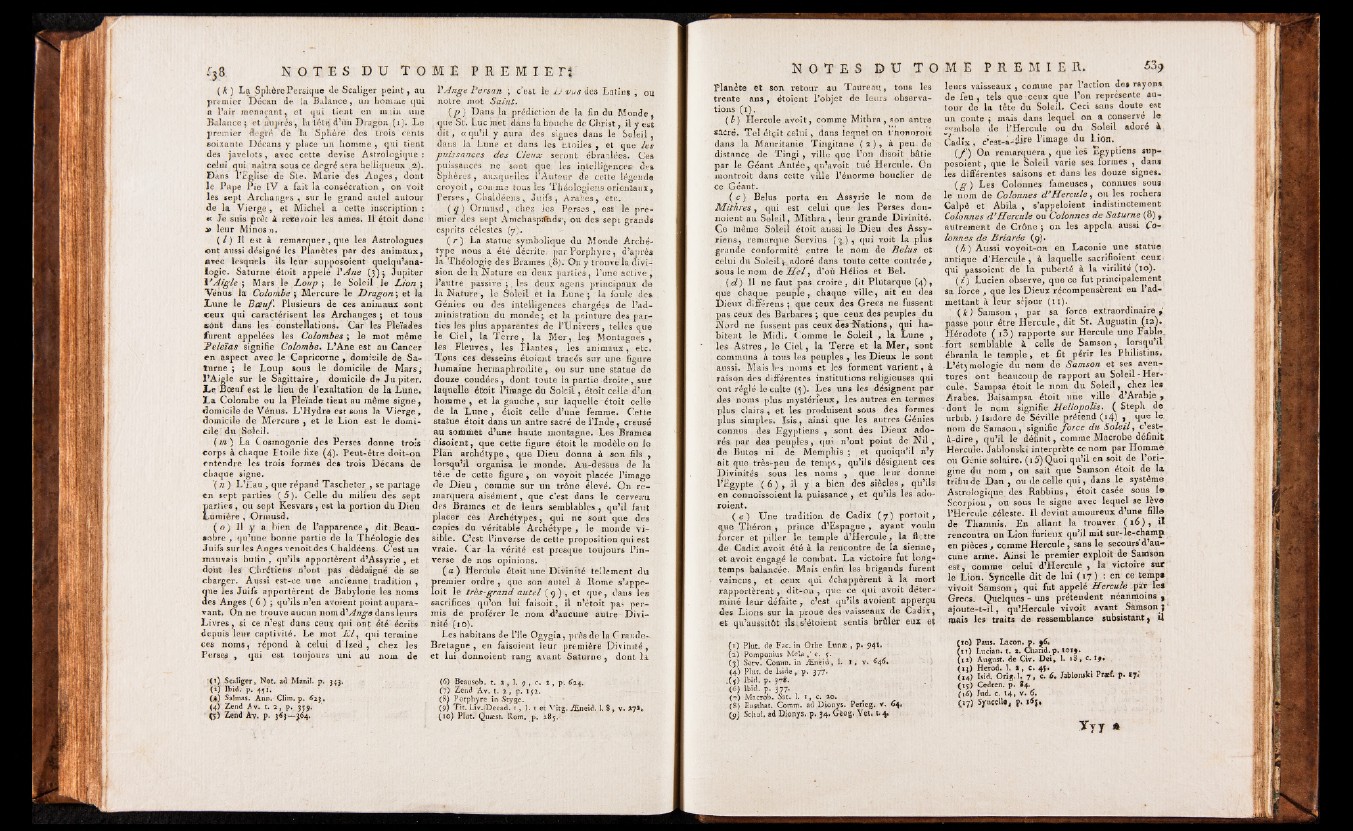
£38 N O T E S D U T O
( k ) La_Sphère Persique de Scaliger peint, au
premier Décan de la Balance, un homme qui
a l’air menaçant, et qui tient en ninin une
Balance ; et aXiprés, la tête d’un Dragon (1). Le
premier degré dè la Sphère des trois 'cents
soixante Décans y place un homme , qui tient
des javelots, avec cette devise Astrologique :
celui qui naîtra sous ce degré sera belliqueux v2).
D ans l ’Eglise de S te. Marie des Anges, dont
le Pape Pie IV a fait la consécration , on voit
les sept Archanges , sur le grand autel autour
de la Vierge , et Michel a cette inscription :
« Je suis prêt à recevoir les âmes. Il étoit donc
» leur Minos ».
(/ ) Il est à remarquer , que les Astrologues
ont aussi désigné les Planètes par des animaux,
avec lesquels ils leûr supposoient quelqu’ana-
iogie. Saturne étoit appelé Y Ane (3) 5 Jupiter 1 * A igle \ Mars le Loup ; le Soleil le Lion ;
Vénus la Colorribe ; Mercure le Dragon\ et la
Lune le Boeuf. Plusieurs de ces animaux sont
ceux qui caractérisent les Archanges ; et tous
sont dans les constellations. Car les Pléiades
lurent appelées les Colombes ; le mot même
Teleïas signifie Colombe. L’Ane est au Cancer
en aspect avec le Capricorne , domicile de Saturne
; le Loup sous le domicile de Mars;
l ’Aigle sur le Sagittaire, domicile de Ju piter.
Le Boeuf est le lieu de l’exaltation de la Lune.
La Colombe ou la Pleïade tient au même signe,
domicile de Vénus. L’Hydre esc sous la Vierge,
domicile de Mercure , et le Lion est le domicile
du Soleil.
(m ) La Cosmogonie des Perses donne trois
corps à chaque Etoile fixe (4). Peut-être doit-on
entendre les trois formes des trois Décans de
chaque signe.
’( n ) L ’Ëau , que répand Tascheter , se partage
en sept parties ( 5). Celle du milieu des sept
arlies , buj sept Kesvars , est la portion du Dieu
umière , Orrnusd.
(0 ) Il y a bien de l’apparence, dit Beau-
sobre , qu’uue bonne partie de la Théologie des
Juifs sur les Ang*s venoitdes Chaldéens. C’est un
mauvais butin , qu’ils apportèrent d’Assyrie , et
dçkït les Chrétiens n’orit pas dédaigné dè se
charger. Aqssi. est-ce une ancienne, tradition ,
que les Juifs apportèrent de Babylone les noms
des Anges ( 6 ) ; qu’ils n’en avoient point auparavant.
On ne trouve aucun nom à?Ange dans leurs
Livres, si ce n’est dans ceux qiii ont été écrits
depuis leur captivité. Le mot E l , qui termine
ces noms, répond à celui d'ized , chez les
Perse# , qui est toujours uni au nom de 1 * 4
(1) Scaliger, Not. ad Manil. p. 343.
ÙJ Ibid. p. 451.
(*) Salmas. Ann. Clim. p. #23.
(4) Zend Av. t. 2, p. 335.
Zend Ay. p. 3^3—364.
M E P R E M I E R
Y Ange Persan ; c’est le U vus des Latins \ ou
notre mot Saint.
{p ) Dans la prédiction de la fin du Monde,
que St. Luc met dans La bouche d'e Christ, il y est
d it, « qu’il y aura des signes dans le Soleil ,
dans la Lune et dans les Etoiles , et que les
puissances des d e u x seront ébranlées. Ces
puissances ne sont que les intelligences^ des
Sphères, auxquelles l ’Auteur de cette légende
croyoit, con nu tous les TLéologiens orientaux,
Perses, Chaldéens, Juifs , Arabes, etc.
(q ) Ormuid, chez les Perses, est le premier
des sept Amchaspîftids*, ou des sept grands
esprits célestes (7).
( r ) La statue symbolique du Monde Archétype
nous a été décrite, par Porphyre, d’après
la Théologiç des Brames (8). On y trouve la division
de la Nature endeux parties , l’une active,
l’autre passive ;, les deux ngens. principaux de
la Nature , le Soleil et la Lune ; la foule des
Génies ou des intelligences chargées de l’administration
du monde; et la peinture des parties
les plus apparentes de l’Univers, telles que
le Ciel, la Terre, la Mer, le§ Montagnes,
les Fleuves, les Plantes, les animaux, etc.
Tous ces desseins étoient tracés sur une figure
humaine hermaphrodite, ou sur une statue de
douze coudées, dont toute la partie droite, sur
laquelle étoit l’image du Soleil, étoit celle d’un
homme , et la gauche, sur laquelle étoit celle
de la Lune, étoit celle d’une femme. Cette
statue étoit dans un antre sacré de l ’Inde, creusé
au sommet d’une haute montagne. Les Bramea
disoient, que cette figure étoit le modèle on le
Plan archétype , que Dieu donna à son fils ,
lorsqu’il organisa le monde. Au-dessus de la
tèce de cette figure, on voyoit placée l’image
de Dieu , comme sur un trône élevé. On remarquera
aisément, que c’est dans le cerveau
des Brames et de leurs semblables, qu’il faut
placer cès Archétypes, qui ne sont que des
copies du véritable Archétype, le monde visible.
C’est l’inverse de cette proposition q-ui est
vraie. Car -la vérité est presque toujours l’inverse
de nos opinions.
( а ) Hercule étoit une Divinité tellement du
premier ordre , que son autel à Borne s’appe-
loit le très-grand autel ( 9 ) , et que, dans les
sacrifices qu’on lui faisoit, il n’étoit pa^ permis
de proférer le nom d’aucune autre Divinité
(10).
Les habitans de l’île Ogygia, près dè la Grande--,
Bretagne, en faisoient leur première Divinité,
et lui donnoient rang avant Saturne , dont la
(б) Beausob. t. 2 , 1. 9 , 0. 2, p. 624.
( 7 ) Zend Av. t. 2, p. J 52.
(81 Porphyre in Styge.
(9) Tit. LivJDecad. 1, 1. x et Vitg. Æneid.l. 8, v. 27*»
(ioj Plut. Quæst. Rom. p. 285.
N O T E S D U T O M E P R E M I E R . 53<>
Planète et son retour au Taureau, tous les
trente ans, étoient l ’objet de leurs observations
(1).
(b) Hercule avoit, comme Mithra, son antre
sacré. Tel étçit celui, dans lequel on rnonoroit
dans la Mauritanie Tingitane { 2 ) , à peu-de
distance de Tingi , ville que l’on disoit bâtie
par le Géant Antée, qu’avoit tué Hercule. On
montroit dans cette ville l ’énorme bouclier de
ce Géant.
( c ) Belus porta en Assyrie le nom de
Mithres, qui est celui que les Perses don-
noient au Soleil, Mithra , leur grande Divinité.
Ce même Soleil étoit aussi le Dieu des Assyriens,
remarque Servius (3,)* qui voit la plus
grande conformité, entre le nom de Belus et
celui du So leilado ré dans toute cette contrée ,
sous le nom de H è f d’où Hélios et Bel.
{d) Il ne faut pas croire, dit Plutarque (4),
que chaque peuple, chaque ville, ait eu des
Dieux difFérens ; que ceux des Grecs ne fussent
pas ceux des Barbares; que ceux des peuples du
Nord ne fussent pas ceux desdNTatioiis, qui habitent
le Midi. Comme le Soleil , la Lune ,
les Astres, le C ie l, la Terre et la Mer, sont
communs à tous les peuples , les Dieux le sont
aussi. Mais les noms et les forment varient, à
raison des différentes institutions religieuses qui
ont réglé le culte (5). Les uns les désignent par
d.es noms plus mystérieux, les autres en termes
plus clairs , et les produisent sous des formes
plus simples. Isis, ainsi que les antres Génies
connus des Egyptiens , sont des Dieux adorés
par des peuples, qui: n’ont point de. Nil ,
de Butos ni de Memphis ; et quoiqu’il n’y
ait que très-peu de temps, qu’ils désignent ces
Divinités sous les noms , que leur donne
l ’Egypte ( 6 ) , il y a bien des siècles, qu’ ils
en connoissoient la puissance , et qu’ils lés ado-
roient.
( e ) Une tradition de Cadix (7 ) portoit,
que Théron , prince d’Espagne , ayant voulu
forcer et piller le temple d’Hercule, la flette
de Cadix avoit été à la rencontre de la sienne,
et avoit engagé le combat. La victoire fut longtemps
balancée. Ma4s enfin les brigands furent
vaincus, et ceux qui échappèrent à la mort
rapportèrent, dit-on , que ce qui avoit déterminé
leur défaite , c’est qu’ils avoient apperçu
des Lions sur la proue des vaisseaux de Cadix,
et qu’aussitôt ils .s’étoient sentis brûler eux et
leurs vaisseaux , comme par l’action de* rayons
de feu , tels que-ceux que l’on représente autour
de la tête du Soleil. Ceci sans doute est
un conte ; mais dans lequel on a conserve le
'vmbole de l’Hercule ou du Soleil adoré à
Cadix,, cWà-iÜfe limage du lion.
( / ) remarquera , que lés jcigyptiens supposoient
, que le Soleil varie ses formes , dans
les différentes saisons et dans les douze signes.
(g ) Les Colonnes fameuses, connues sous
lé nom de Colonnes d*Hercule, ou les rochers
Calpê et Abila , s’appeloient indistinctement
Colonnes d*Hercule ou Colonnes de Saturne (8) ,
autrement de Crône ; on les appela aussi Co-
lonnes de Briarée (9).
(h) Aussi voyoit-on en Laconie une statue
antique d’Hercule, à laquelle sacrifioient ceux
qui passoierit de la puberté à la virilité (10).
( z) Lucien observe, que ce fut principalement
sa force , que les Dieux récompensèrent en. l’admettant
à leur séjour ( 11).
(k) Samson , par sa force extraordinaire,:
asse pour être Hercule, dit St. Augustin (12).
lérpdote ( i3) rapporte sur Hercule une Fablo.
fort semblable à celle de Samson, lorsqu’il
ébranla le temple, et- fit périr les Philistins.
L’éty mologie du nom de Samson et ses aventures
ont beaucoup de rapport au Soleil-Hercule.
Sampsa étoit le nom du Soleil, cbez les
Arabes. Baisampsa étoit une ville d’Arabie f
dont le nom signifie Heliopolis. ( Steph d©
urbib. ) Isidore de Séville prétend ( i4) j que 1®
nom de Samson , signifie force du Soleil, c’est-
à-dire , qu’il le définit, comme Macrobe définit
Hercule. Jablonski interprète ce nom par Homme
ou Génie solaire. ( i5) Quoi qu’il en soit de l’origine
du nom , on sait que Samson étoit de la
tribu de D an , ou (le celle qui, dans le système
Astrologique des Rabbins, étoit casée sous 1©
.Scorpion, ou sous le signe avec lequel se lève
l’Hercule xéleste. Il devint amoureux d’une fille
de Thamnis. En allant la trouver ( 1 6 ) , il
rencontra un Lion furieux qu’il mit sur-le-champ
en pièces , comme Hercule, sans le secours d’aucune
arme. Ainsi le premier exploit de Samson
est, comme celui d’Hercule , la victoire sur
le Lion. Syncelle dit de lui (17 )^ en ce tempe
viVoit Samson, qui fut appelé Herculé .par le»
Grecs. Quelques - uns prétendent néanmoins y
ajoute-t-il, qu’Hcrcule vivojt avant Samson 5
mais les traits de ressemblance subsistant, il
(1) Plut. de Fac. in Orbe Lwiae , p. 94*- •
(2) Pomponius Mela c, 5.
(3) Serv. Comm, in iEneid, 1. 1» v. 646,
(4) Plut. de hide, p. 377.
.($) Ibid. p. 378.
(6) Ibid. p. 377.
(7) Macrob. Sat. 1. 1, c. 1©.
(8) Eusthat. Comm, ad JDionys. Perieg. v. 64»
(9) Schol, ad Dionys. p. 34. Gfcog. Yet. t- 4*
10) Paus. Lacon. p. jj6.
it) Lucian* t. *. Chand.p. 1019.
12) August, de Civ. Dei, 1. 18, c. I#»
13) Herod. 1. 1 , c. 45. .
14) Isid. Orig.l. 7, c. 6 . Jablonski Pr*f. p. 174
15) Cedren. p. 84.
16) Jud. c. 14, v. 61
’17) Syncell*! p. i*j*
Y 77 *