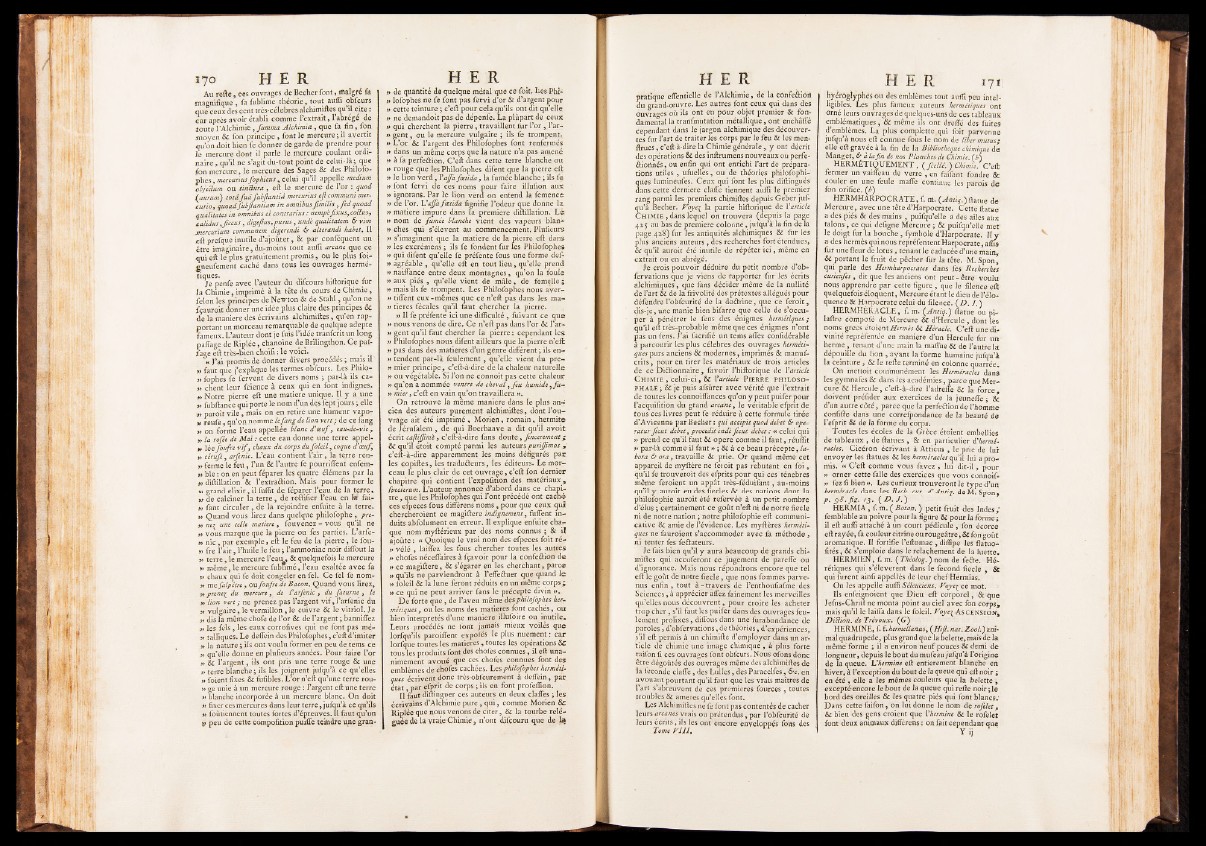
Au refte, ces ouvrages de Becher font, maigre fa
magnifique , fa fublime théorie, tout aufli obfcurs
que ceux des cent très-célebres alchimiftes qu’il cite :
car après avoir établi comme l’extrait, l’abrégé de
toute l ’Alchimie, fumma Alchimioe, que fa fin , fon
moyen & fon principe , font le mercure ; il avertit
qu’on doit bien fe donner de garde de prendre pour
le mercure dont il parle le mercure coulant ordinaire
, qu’il ne s’agit du-tout point de celui-là; que
fon mercure, le mercure des Sages & des Philofo-
phes, mercurius fophicus, celui qu’il appelle medium
objeclum ou tinclura , eft le mercure de 1 or : quod
(auruni) totâ fud fubjlantiâ mercurius ejl communi mer-
curio, quoad fubfiantiam in omnibus Jîmilis ,fed quoad
quàlitates in omnibus ei contrarius: nempèfixus9cocius,
calidus ^jiccus, digejlus, purus, undh qualitatem & vim
jntrcurium communem digerendi & alterandi habet. Il
eft prefque inutile d’ajouter, & par conféquent un
être imaginaire, du-moins tout aufli arcane que ce
qui eft le plus gratuitement promis, ou le plus foi-
cneufement caché dans tous les ouvrages hermétiques.
. .
Je penfe avec l’auteur du difcours hiftorique lur
la Chimie, imprimé à la tête du cours de Chimie,
félon les principes de Newton & de Stahl, qu on ne
fçauroit donner une idée plus claire des principes &
de la maniéré des écrivains alchimiftes, qu’en rapportant
un morceau remarquable de quelque adepte
fameux. L’auteur dont je fuis l’idée tranfcritun long
paffage de Riplée, chanoine de Brilingthon. C e paf-
fage eft très-bien choifi : le voici. ^
« J’ai promis de donner divers procédés ; mais il
» faut que j’explique les termes obfcurs. Les Philo-
» fophes fe fervent de divers noms ; par-là ils ca-
» chent leur fcience à ceux qui en font indignes.
»> Notre pierre eft une matière unique. Il y a une
» fubftance qui porte le nom d’un des fept jours ; elle
» paroît v ile , mais on en retire une humeur vapo-
» reufe, qu’on nomme lefang de lion vert ; de ce fang
» on forme l’eau appellée blanc d'oeuf, eau-de-vie,
» la rofée de Mai : cette eau donne une terre appel-
» lée foufre v if, chaux du corps dufoleil, coque d'oeuf
» cèrufe, arfenic. L’eau contient l’air , la terre ren-
» ferme le feu , l’un & l’autre fe pourriffent enfem-
» ble fon en peut féparer les quatre élémens par la
» diftillation & l’extra&ion. Mais pour former le
» grand élixir, il fuffit de féparer l’eau de la terre,
»1 de calciner la terre, de rectifier l’eau en fer fai-
» fant circuler, de la rejoindre enfuite à la terre.
» Quand vous lirez dans quelque philofophe , pre-
m ner une telle matière, fouvenez - vous qu’il ne
„ vous marque que la pierre ou fes parties. L’arfe-
» n ie ,,par exemple, eft le feu de la pierre, le fou-
» fre l’air , l’huile le feu ; l’ammoniac noir diffout la
» terre, le mercure l’eau . & quelquefois le mercure
» même, le mercure fubnmé, l’eau exaltée avec fa
» chaux qui fe doit congeler en fel. Ce fel fe nom-
» me falpêtre , ou foufre de Bacon. Quand vous lirez,
s» prenez du mercure , de Varfenic , du faturne , le
» lion vert ; ne prenez pas l’argent v i f , l’arfenic du
» vulgaire, le vermillon, le cuivre & le vitriol. Je
» dis la même chofe de l’or & de l’argent ; banniffez
» les fels , les eaux corrofives qui ne font pas mé-
„ talliques. Le deffein desPhilofophes,c’eft d’imiter
„ la nature ; ils ont voulu former en peu de tems ce
» qu’elle donne en plufieurs années. Pour faire l’or
» & l’argent, ils ont pris une terre rouge Sc une
» terre blanche ; ils les joignent jufqu’à ce qu’elles
„ foient fixes & fufibles. L ’or n’eft qu’une terre rou-
» ge unie à un mercure rouge : l’argent eft une terre
» blanche incorporée à un mercure blanc. On doit
» fixer ces mercures dans leur terre, jufqu’à ce qu'ils
» foûtiennent toutes fortes d’épreuves. Il faut qu’un
^ peu de cette compofition puiffe teindre une gran-
» de quantité de quelque métal que ce foit. Les Phi»
» lofophes ne fe font pas fervi d’or & d’argent pour
» cette teinture ; c’eft pour cela qu’ils ont dit qu’elle
» ne demandoit pas de dépenfe. La plupart de ceux
» qui cherchent la pierre, travaillent fur l’or , l’ar-
». gen t, ou le mercure vulgaire ; ils fe trompent.
» L’or & l’argent des Philofophes font renfermés
» dans un même corps que la nature n’a pas amené
» à fa perfection. C’ eft dans cette terre blanche ou
» rouge que les Philofophes difent que la pierre eft
» le lion v erd, Vajfa foetida , la fumée blanche ; ils fe
» font fervi de ces noms pour faire illufion aux
» ignorant. Par le lion verd on entend la femence
» de i’or. Vajfa foetida fignifie l ’odeur que donne la
» matière impure dans la première diftillation. Lé
» nom de fumée blanche vient des vapeurs blan*
» ches qui s’élèvent au commèncement. Plufieurs
» s’imaginent que la matière de la pierre eft dans
» les excrémens ; ils fe fondent fur les Philofophes
» qui difent qu’elle fe préfente fous une forme def-
» agréable , qu’elle eft en tout lieu , qu’elle prend
» naiffance entre deux montagnes, qu’on la foule
» aux piés , qu’elle vient de mâle, de femelle ;
» mais ils fe trompent. Les Philofophes nous aver-
» tiffent eux-mêmes que ce n’eft pas dans les ma-
» tieres fécales qu’il faut chercher la pierre.
» Il fe préfente ici une difficulté , fuivant ce que
» nous venons de dire. Ce n’eft pas dans l’or & l’ar-
» gent qu’il faut chercher la pierre : cependant les
» Philofophes nous difent ailleurs que la pierre n’eft
» pas dans des matières d’un genre différent ; ils en-
» tendent par-là feulement, qu’elle vient du pre-
» mier principe, c’eft-à-dire de la chaleur naturelle
» ou végétable. Si l’on ne connoît pas cette chaleur
» qu’on a nommée ventre de cheval, feu humide, fu -
» mier, c’eft en vain qu’on travaillera ».
On retrouve la meme maniéré dans le plus ancien
des auteurs purement alchimiftes, dont l’ouvrage
aitv été imprimé , Morien, romain, hermite
de Jérufalem , de qui Boerhaave a dit qu’il avoit
écrit cajlijjimé , c’eft-à-dire fans doute, Jîncerement ;
& qu’il étoit compté parmi les auteurs purifjimos »'
c’eft-à-dire apparemment les moins défigurés par.
les copiftes, les traducteurs, les éditeurs. Le morceau
le plus clair de cet ouvrage, c’eft fon dernier
chapitre qui contient l’expofition des matériaux,
fpecierum. L’auteur annonce d’abord dans ce chapitre
, que les Philofophes qui l’ont précédé ont caché
ces efpeces fous différens noms, pour que ceux qui
chercheroient ce magiftere indignement, fuffent induits
abfolument en erreur. Il explique enfuite char
que nom myftérieux par des noms connus ; & i!
ajoute : « Quoique le vrai nom des efpeces foit ré-
» vélé , laiffez les fous chercher toutes les autres
» chofes néceffaires à fçavoir pour la confection de
» ce magiftere, & s’égarer en les cherchant, parce
» qu’ils ne parviendront à l’effeCtuer que quand le
» foleil & la lune feront réduits en un même corps;
» ce qui ne peut arriver fans le précepte divin ».
De forte que, de l’aveu même àes philofophes hermétiques
, ou les noms des matières font cachés, ou
bien interprétés d’une maniéré illufoire ou inutile.
Leurs procédés ne font jamais mieux voiles que
lorfqu’ils parodient expofés le plus nuement : car
lorfque toutes les matières, foutes les opérations &
tous les produits font des chofes connues, il eft unanimement
avoué <jue ces chofes connues font des
emblèmes de chofes cachées. Les philofophes hermétiques
écrivent donc très-obfcurement à deffein, par,
é ta t, par efp*it de corps ; ils en font profeflion.
Il faut diftingqer ces auteurs en deux claffes ; les
écrivains d’Alchimie pure, q ui, comme Morien &
Riplée que nous venons de citer, & la tourbe reléguée
de là vraie Chimie, n’ont difeouru que de la
pratique efïentielle de l’Alchimie, de la Cônfe&iôii
du grand-oeuvre. Les autres font ceux qui dans des
Ouvrages où ils ont en pour objet premier & fondamental
la tranfmutation métallique, ont enchâffé
dépendant dans le jargon alchimique des découvertes
fur l’art de traiter les corps par le feu & les men»
ftrues, c’eft à-dire la Chimie générale, y ont décrit
des opérations & des inftrumens nouveaux ou perfectionnés
, ou enfin qui ont enrichi l’art de préparations
utiles , ufuelles, ou de théories philofpphi-
ques lumineufes. Ceux qui font les plus diftingués
dans cette derniere elaffe tiennent auffi le premier
rang parmi les premiers chimiftes depuis Geber jufqu’à
Becher. Voyt{ la partie hiftorique de l’article Chimie , dans lequel on trouvera (depuis la page
425 au bas de première colonné, jufqu’à la fin de la
page 428) fur les antiquités alchimiques & fur les
plus anciens auteurs, des recherches fort étendues*
& qu’il auroit été inutile de répéter ic i , même en
extrait ou en abrégé.
Je crois pouvoir déduire du petit nombre d’ob»
fervations que je viens de rapporter fur les écrits
alchimiques, que fans décider même de la nullité
de l’art & de la frivolité des prétextes allégués pour
défendre l’obfcurité de la do&rine, que ce feroit,
dis-je, une manie bien bifarre que celle de s’occuper
à pénétrer le fens des énigmes hermétiques;
qu’il eft très-probable même que ces énigmes n’ont
pas un fens. J’ai facrifié un tems affez confidérable
à parcourir les plus célébrés des ouvrages hermétiques
purs anciens & modernes, imprimés & manuf-
crits, pour en tirer les matériaux de trois articles
de ce Diftionnaire, favoir l’hiftorique de l'article Chimie , celui-ci, & l’article Pierre philosophale;
& je puis afsûrer avec vérité que l’extrait
de toutes les connoiffances qu’on y peut puifer pour
Pacquifition du grand arcane, le véritable efprit de
tous ces livres peut fe réduire à cette formule tirée
d’Avicenne par Becher : qui accipit quod débet & ope-
ratur Jtcut debet, procedit indé jicut debet : « celui qui
» prend ce qu’il faut & opéré comme il faut, réüffit
» par-là comme il faut » ; & à ce beau précepte, la-
bora & ora, travaille & prie. Or quand même cet
appareil de myftère ne feroit pas rebutant en f o i ,
qu’il fe trouveroit des efprits pour qui ces ténèbres
même feroient un appât très-féduifant, au-moins
qu’il y auroit eu des fiecles & des nations dont la
philofophie auroit été refervée à un petit nombre
d’élus ; certainement ce goût n’eft ni de notre fiecle
ni de notre nation ; notre philofophie eft communicative
& amie de l’évidence. Les myftères hermétiques
ne faùroient s’accommoder avec fa méthode,
ni tenter fes feftateurs.
Je fais bien qu’il y aura beaucoup de grands chimiftes
qui accuferont ce jugement de pareffe ou
d’ignorance. Mais nous répondrons encore que tel
eft le goût de notre fiecle, que nous fommes parvenus
enfin , tout à - travers de l’enthoufiafme des
Sciences, à apprécier àffez fainement les merveilles
qu’elles nous découvrent, pour croire les acheter
trop cher, s’il faut les puifer dans des ouvrages feulement
prolixes, diffous dans une furabondance de
paroles, d’obfervations, de théories, d’expériences,
s’il eft permis à un chimifte d’employer dans un article
de chimie une image chimique , à plus forte
raifon fi ces ouvrages font obfcurs. Nous ofons donc
être dégoûtés des ouvrages même des alchimiftes de
la fécondé elaffe, des Lulles, des Paracelfes, &c. en
avouant pourtant qu’il faut que les vrais maîtres de
l’art s’abreuvent de ces premières fources , toutes
troubles & ameres qu’elles font.
Les Alchimiftes ne fe font pas contentés de cacher
leurs arcanes vrais ou prétendus, par l’obfcurité de
leurs écrits, ils les ont encore enveloppés fous des
Tome V lI I ,
nÿerôglyptiéS Oit des emblèmes tout âufll péü intelligibles.
Les plus fameux auteurs hermétiques ont
Orné leurs ouvrages de quelques-uns de ces tableaux
emblématiques, & même ils ont drefle des fuites
d’emblèmes. La plus complette^qui foit parvenue
jufqu’à nous eft connue fous le nom de liber miltus;
elle eft gravee à la fin de la Bibliothèque chimique de
Manget, & à la fin de nos Planches de Chimie. (b\
HERMÉTIQUEMENT , ( fcellé. ) Chimie. C ’eft
fermer un vaiffeau de verre , en faifartt fondre &
couler en une feule malle continue les parois de
fon orifice, (b)
HERMHARPOCRATE, f. m. (Andq.)ftatue de
Mercure, avec une tête d’Hatpocrate. Cette ftatue
a des piés & des mains , puifqu’elle a des ailes aüx
talons j ce qui defigne Mercure ; & puifqu’elle met
le doigt fur la bouche , fymbole d’Harpocrate. II y
a des hermès qui nous tepréfentent Harpocrate, aflis
fur une fleur de lotus * tenant le caducée d’une main,-
& portant le fruit de pêcher fur la tête. M. Spon,
qui parle des Hermharpocrates dans fes Recherches
curieufes, dit que les anciens ont peut - être voulu
nous apprendre par cette figure , que le filehce eÆ
quelquefois éloquent, Mercure étant le dieu de Pélo»
quence & Harpocrate celui du filence. (D . J. )
HERMHÊRACLE, f. m. (Antiq.) ftatue ou pi-
laftre compofé de Mercure & d’HercuIe , dont lès
noms grecs étoient Hermes & Héracle. C ’eft une divinité
repréfentée en maniéré d’un Hercule fur un
herme, tenant d’une main la maffue & de l’autre là
dépouille du lion , ayant la forme humaine jufqu’à
la ceinture, & f e refte terminé en colonne quarrée*
On mettoit com'munément les Herméracles dans
les gymnafes & dans les académies, parce que Mercure
& Hercule, c’eft-à-dire l’adreffe & la force,
doivent préfider aux exercices de la jeuneffe ; &
d’un autre côté, parce que la perfe&ionde l’homme
confifte dans une correfpondance de la beauté de
l’efprit & de la forme du corps.
Toutes les écoles de la Grèce étoient embellies
de tableaux , de ftatues , & en particulier A'herméracles.
Cicéron écrivant à Atticus , lè prie de lui
envoyer les ftatues & les herméracles qu’il lui a promis.
« C’eft comme vous fa v e z , lui dit-il, pour
» orner cette falle des exercices que vous connoif-
» fez fi bien ». Les curieux trouveront le type d’un
herméracle dans les Rech. cur. d'Antiq, de M. Spon*
p .S Î .f ip . ,3. ( D. J. )
HERMIA, f.m. ( Botan. ) petit fruit des Indes*
femblable au poivre pour la figure & pour la forme;
il eft aufli attaché à un court pédicule , fon écorce
eft rayée, fa couleur citrine ou rougeâtre, & fon goût
aromatique. Il fortifie l’eftomac , diflîpe les flatuo-
fités, & s’emploie dans le relâchement de la luette.
HERMIEN, f. m. ( Théolog. ) nom de fettev Hé*
rétiques qui s’élevèrent dans le fécond fiecle , &
qui furent ainfi appellés de leur chef Hermias.
On les appelle aufli Séleuciens. Voyeç ce mot.
Ils enfeignoient que Dieu eft corporel, & que
Jefus-Chrilt ne monta point au ciel avec fon corps*
mais qu’il le Iaiffadans le foleil. Foye^ Asc en s io n *
Diction, de Trévoux. (G)
HERMINE, f. f .hermellanus, (Hifl. nat. Zûol,) an i»
mal quadrupède, plus grand que la belette, mais de la
même' forme ; il a environ neuf pouces & demi de
longueur, depuis le bout du mufeau jufqu’à l’origine
de la queue. Vhermine eft entièrement blanche en
hiver, à l’exception du bout de la queue qui eft noir ;
en été , elle a les mêmes couleurs que la belette *
excepté encore le bout de là queue qui refte noir ; le
bord des oreilles & les quatre piés qui font blancs.’
Dans cette faifon, on lui donne le nom de rofelet,
& bien des gens croient que Yherminè & le rofelet
font deux animaux différens ; on fait cependant que