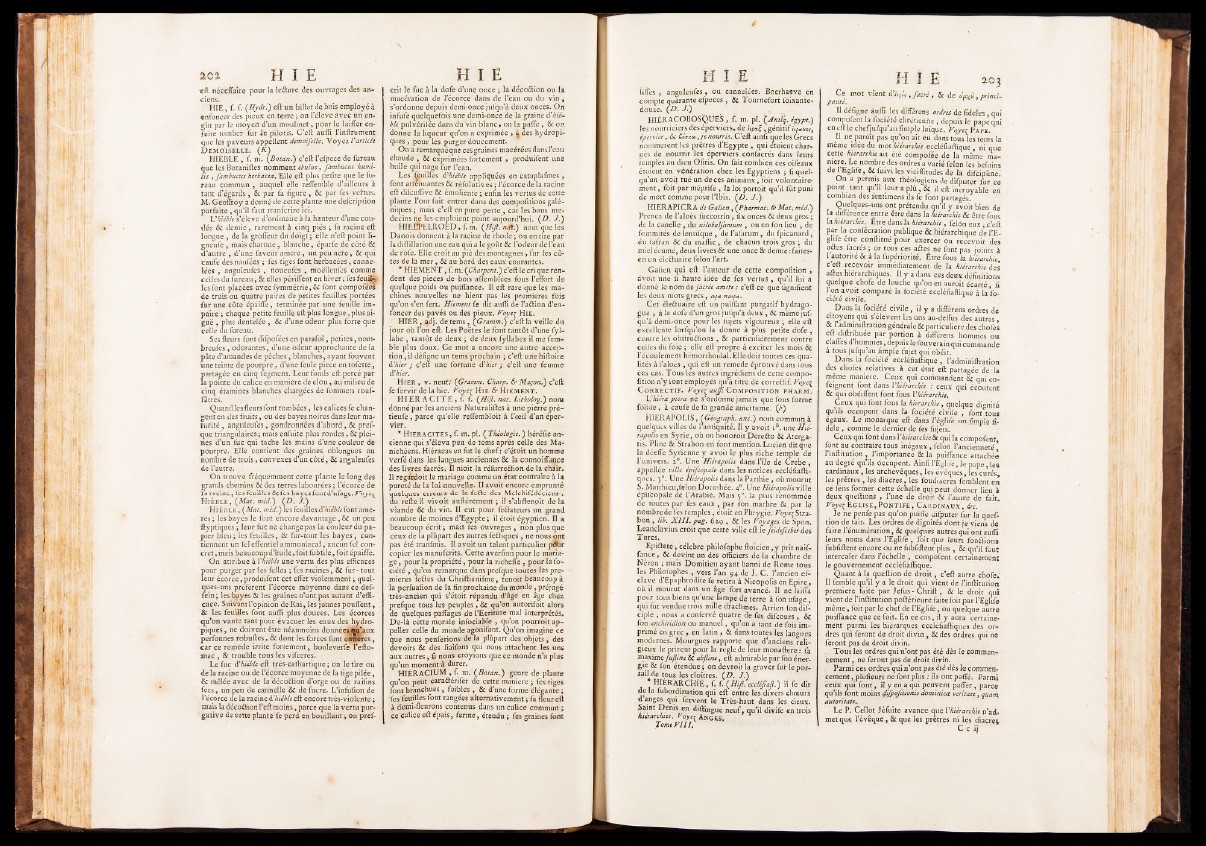
eft néceffaire pour la leûure des ouvrages des aft-
ciens.
HIE, f. f. (Hydr.) eft un billot de bois employé à
enfoncer des pieux en terre ; on l’éleve avec un engin
par le moyert d’un moulinet, pour le laiffer en-
fuite tomber fur 4e pilotis. C ’eft aufli l’inftrument
que les paveurs appellent demoifelle. Voyez Varticle D emoiselle. (/£)
HIÉBLE , f. m. (Botan.) c’ eft l’efpece de fureau
que les Botaniftes nomment ebulus, fambucus humi-
lis , fambucus hcrbacca. Elle efl: plus petite que le fureau
commun , auquel elle reffemble d’ailleurs à
tant d’égards , & par fa figure, 6c par fes veftus.
M. Geoffroy a donné de cette plante une defeription
parfaite , qu’il faut tranferire ici.
Utiiéblc s’élève d’ordinaire à la hauteur d’une coudée
6c demie, rarement à cinq pies ; fa racine efl
longue , de la groffeur du doigt ; elle n’eft point li-
gneufe, mais charnue, blanche, éparfe de côté 6c
d ’autre , d’une faveur amere , un peu acre, & qui
caufe des naufées ; fes tiges font herbacées, cannelées
, anguleufes , noueufes , moëlleufes comme
celles du lureau, & elles périffent en hiver ; fes feui^j
les font placées avec fymmétrie,& font compoféês
de trois ou quatre paires de petites feuilles portées
fur une côte épaiffe, terminée par une feuille impaire
; chaque petite feuille efl plus longue, plus aiguë
, plus dentelée, & d’une odeur plus forte que
celle du fureau.
Ses fleurs font difpofées en parafol, petites, nom-
breufes, odorantes, d’une odeur approchante de la
pâte d’amandes de pêches, blanches, ayant fouvent
une teinte de pourpre , d’une feule piece en rofette,
partagée en cinq fegmens. Leur fonds efl percé par
la pointe du calice en maniéré de clou , au milieu de
cinq étamines blanches chargées de fommets rouf-
ïatres.
Quand Iesfleurs font tombées, les calices fe changent
en des fruits, ou des bayes noires dans leur maturité
, anguleufes, gondronifées d’abord, 6c préf-
que triangulaires; mais enfuite plus rondes, 6c pleines
d’un fuc qui tache les mains d’une couleur de
pourpre. Elle contient des graines oblongues au
nombre de trois, convexes d’un côté, 6c anguleufes
de l’autre. .
On trouve fréquemment cette plante le long des
grands chemins 6c des terres labourées ; l’écorce de
fa ra cine, fes feuilles 6c fes bayes font d’ufage. Voycç HiÉBLE, (Mat. méd.) (D . J.)
Hiéble , (Mat. méd.') les feuilles 6’hiébUionx. ame-
res ; les bayes le font encore davantage, 6c un peu
flyptiques ; leur fuc ne change pas la couleur du pa-
pier bleu ; les feuilles, & fur-tout les ba y es , contiennent
un fel elTentiél ammoniacal, aucun fel concret
, mais beaucoup d’huile,foit fubtile, foit épaiffe.
On attribue à V'hiéble une vertu des plus efficaces
pour purger par les felles ; fes racines, 6c fur - tout
leur écorce, produifent cet effet violemment ; quelques
uns préfèrent l’écorce moyenne dans ce def-
fein ; les bayes & les graines n’ont pas autant d’efficace.
Suivant l’opinion de Ra i, les jeunes pouffent,
& les feuilles font aufli plus douces. Les écorces
qu’on vante tant pour évacuer les eaux des hydropiques,
ne doivent être néanmoins données qp’^ux
perfonnes robuftes, 6c dont les forces font eiftgeres,
car ce remede irrite fortement, bouleverfe l ’efto-
mac , & trouble tous les vifeeres.
Le fuc Ôl hiéble efl très-cathartique ; on le tire ou
de la racine ou de l’écOrce moyenne de la tige pilée,
& mêlée avec de la déco&ion d’orge ou de raifins
fecs, un peu de cannelle & de Lucre. L’infufion de
l’écorce de la racine à?hiéble efl encore très-violente ;
mais la décoftion l’eft moins, parce que la vertu purgative
de cette plante Le perd en bouillant ; on prefcrit
lè lue à la dofe d’une once ; la décoéhon ou la
macération de l’écorce dans de l’eau ou du vin ,
s’ordonne depuis demi-once jufqu’à deux onces. On
infufe quelquefois une demi-once de la graine à’hié*
b le pulvérifée dans du Vin blanc, on la paffe , & on
donne la liqueur qu’on a exprimée , à des hydropiques
, pour les purger doucement.
On a remarquéque ces graines macérées dansl’eau
chaude , & exprimées fortement , produifent une
huile qui nage fur l’eau.
Les feuilles d’hiéble appliquées en cataplafmes ,
font atténuantes 6c réfolutiv es ; l’écorce de la racine
efl difeuflive & émoliente ; enfin les vertus de cette
plante l’ont fait entrer dans des compolitions galéniques
; mais c’eft en pure perte , car les bons médecins
ne les emploient point aujourd’hui. (D . J.)
HIEEPELROED, f. m. (Hifl. ndt.) nom que les
Danois donnent à la racine de rhode ; on en tire par
la diflillation une eau qui a le goût 6c l’odeur de l’eau
de rofe. Elle croît au pié des montagnes, fur les cô*
tes de la mer, 6c au bord des eaux courantes.
* H IEMENT, f. m.(Charpent.) c’eft le cri que rendent
des pièces de bois aflémblées fous l’effort dé
quelque poids ou puiffance. Il efl rare que les machines
nouvelles ne hient pas les premières fois
qu’on s’en fert. Hiement Le dit aufli de l’âttion d’enfoncer
des pavés ou des pieux. Voye^ Hie.
HIER, adj. de tems, (Grammé) c’eft la veille du
jour où l’on efl. Les Poëtes le font tantôt d’une fyl-
labe , tantôt de deux ; de deux fyllabes il me fem*
ble plus doux. Ce mot a encore une autre acception
, il déligne un tems prochain ; c’eft une hiftoire 61 hier ; c’eft une fortune 61 hier ; c’eft une femme
d’hier. Hier , v . neut* (Gramm. Charp. & Maçon,) c’eft
fe fervir de la hie. Voye^ Hie & Hiement.
H IE R A C I T É , f. f. (Hifl. nat. Litkolog.) non*
donné par les anciens Naturaliftes à une pierre pré-
tieufe, parce qu’elle reffembloit à l’oeil d’un éper-
vier.
* Hieracites , f. m. pl. ( Théologie. ) héréfie ancienne
qui s’éleva peu de tems après celle des Manichéens.
Hiéracas en fut le chef: c’étoit un homme
verfé dans les langues anciennes St la connoiffance
des livres facrés. fl nioit la réfurreâion dé la chair.
Il regaudoit le mariage comme un état contraire à la
pureté de la loi nouvelle. Il avoit encore emprunté
quelques erreurs de la feâe des Melchifédéciens :
du refte il vivoit auftérement ; il s’abftenpit de la
viande 6c du vin. Il eut pour fe&ateurs un grand
nombre de moines d’Egypte ; il étoit égyptien. Il a
beaucoup écrit ; mais les ouvrages , non plus que
ceux de la plupart des autres fe&iques , ne nous ont
pas été tranfmis. Il avoit un talent particulier p$hr
copier les manuferits. Cette averfion pour le mariage
, pour la p ropriété, pour la richeffe, pour la fo-
ciéte , qu’on remarque dans prefque toutes les premières
feftes du Chriftianifme, tenoit beaucoup à
la perfualion de la fin prochaine du monde, préjugé
très-ancien qui s’étoit répandu d’âge en âge chez
prefque tous les peuples, 6c qu’on autorifoit alors
de quelques paffages de l’Ecriture mal interprétés.
De-là cette morale infociable , qu’on pourroit ap-
peller celle du monde agonifant. Qu’on imagine ce
que nous penferions'dela plûpait des objets, des
devoirs 6c des liaifons qui nous attachent les uns
aux autres, fi nous1 croyions que ce monde n’a plus
qu’un moment à durer.
HIÉRACIUM , f. m. (Botan.) genre de plante
qu’on peut cara&érifer de cette maniéré ; Les tiges
font branchues , foibles , & d’une forme élégante ;
Les feuilles font rangées alternativement ; fa fleur eft
à demi-fleurons contenus dans un calice commun ;
cë calice eft épais, ferme, étendu ; fes graines font
f
îiffes f anguleufes, Ou canneléés; Boerhaave en
compte quarante efpeces, 6c Tournefort foixanté-
douze. (D. J.) s
HIÉRACOBOSQü ES , L. m. pl. (Antïq. égypt.)
les nourriciers des éperviers, de îipui; , génitif itpmioc,
épervier ,6c Coa-nio ,/e nourris. C ’eft ainfi que les Grecs
nommèrent les prêtres d’Egypte , qui étoient chargés
de nourrir les éperviers confacrés dans leurs
temples au dieu Ofiris. On fait combien ces oifeâux
étoient en vénération chez les Egyptiens ; fi quelqu’un
avoit tué un de ces animaux, foit volontairement
, foit par méprife , la loi portoit qu’il fût puni
de mort comme pour l’Ibis. (D . J .)
HIERAPICRA de Galien, (Pharmaa & Mat-, méd.)
Prenez de l’aloès fuccotrin , lix onces 6c deux gros ;
de la canelle , du xilobalfamum , ou en fon lieu , de
fommités de lentifque , de l’afarum, du fpicanard ;
-du lafran 6c du maftic, de chacun trois gros ; du
miel écumé, deux livres 6c une once & demie : faites-
en un éleduaire félon l’art.
Galien qüi eft l’auteur de cette cômpofitiort ;
àvOit line fi haute idée de fes vertus , qu’il lui a
donné le ndm de f actée amete : c’eft ce que lignifient
les deux mots grecs, npa vrikpa..
Cet éleâuaire eft un puiflàrtt purgatif hydrago-
güé j à la dofe d’un gros jufqu’à deux, 6c même jufqu’à
demi-Once pour les l’ujets vigoureux ; elle eft
excellente lorfqu’on la dohne à plus petite dofe ,
contre les obftruttions , & particuliérement contre
celles dii foie ; elle eft propre à exciter les mois &
l’écoulemerit hétnorrhoïdal. Elle doit toutes ces qualités
à l’aloès , qui èft un remede éprouvé dahs tous
ces cas. Tous les autres ingrédiens de cette compo-
fi'tion n’y Ion remployés qu’à titre de correôif. Voye^
C orrectif. Voye^aujji C omposition pharm.
L’kiéra picra ne s’ordonnë jamais que fous forme
fôlide , à caüfe de fa grande airiei-tume. (b)
HIERAPOLIS, (Géograph. anc.) nom commun à
quelques villes de l’antiquité. Il y avoit i*\ une Hié~
rapolis en Syrie, où on honoroit Dereéio 6c Aterga-
tis. Pline & Strabon en font mention. Lucien dit que
la déeffe Syrienne y avoir le plus riche temple de
l’univers. 20. Une Hiérapolis dans Hie de Crebe *
appellée ville épifcopale dans les notices eccléfiafti-
ques. 30. Une Hiérapolis dans la Parthie , où mourut
S. Matthieu,felon Dorothée. 40. Une Hiérapolis ville
épifcopale de l’Arabie. Mais 50. la plus renommée
de toutes par fes eaux, par fon marbre 6c par le
nombre de fes temples, étoit en Phrygie. Voye^ Stra-
bon , lib. X I I I . pag. 629 , 6c les Voyages de Spon.
Leanclavius croit que cette ville eft le Jèidefceber des .Turcs.
Epittete * célébré philofophe ftoi'cien , y prît nàif-
fance, 6c devint un des officiers de la chambre de
Néron ; mais Domitien ayant banni de Rome tous
les Philofophes , vers Ëan 94 de J. C . l’ancien ef-
clave d’Êpaphrodite fe retira à Nicopolis en Epire,
où il mourut dans un âge fort avancé. Il ne laifta
pour tous biens qu’une lampe de terre à fon ufage,
qui fut vendue trois mille drachmes» Arrien fon dif-
ciple , nous a confervé quatre de fes difeours , 6c
fon enchiridion ou manuel, qu’on a tant de fois imprimé
en grec , en iatin , & dans toutes les langues
modernes. Mourgues rapporte que d*anciens religieux
le prirent pour la réglé de leur monaftere : fa
maxime JuJline 6c abfline, eft admirable par fon énergie
6c fon étendue ; on devroit la graver fui- le por-
tail.de tous les cloîtres. (D . J.)
* HIÉRARCHIE, f. f. (Hifl. eccléfiafi.) il fe dit
de la fubordination qui eft entre les divers choeurs
d anges qui fervent le Très-haut d ans les deux.
Saint Denis en diftingue neuf, qu’il divife en trois
hiérarchies,Tome VrIoIyIe,r Anges.
Ce mot vî'enè , facré, & de ùpxi.Princi-
pauté.
Il défigne âuflî lès différens ordres de fideles , qui
compbfent la fociété chrétienne , depuis le pape qui
en eft le chefjufqu’au fimple laïque. Voye[ Pape.
^11 ne paroit pas qu on ait eu dans tous les tems la
même idée du mot hiérarchie eccléfiaftique , ni que
cette hiérarchie ait été conipôfée de la même ma-
nierq. Le nombre des ordres a varié félon les befoins
d e lE gh fe , & fuivi les viciffitudes de la difeipline.
On a permis aux théologiens de dîfputer fur ce
point tant qu il leur a p lu , 6c il eft incroyable en
combien des fentimens ils fe font partagés.
Quelques-uns ont prétendu qu’il y avoit bien de
la différence entre être dans la hiérarchie 6c être fous
la. hiérarchie. Etre dans la hiérarchie , feldn eux • .c’eft
par la confécration publique & hiérarchique de l’E-
glife être conftitué pour exercer ou recevoir des
ades facrés ; or tous ces ades ne font pas joints à
l ’autorité & à la fupériorité. Être fous la hiérarchie,
c ’eft recevoir immédiatement de la hiérarchie des
ades hiérarchiques. Il y a dans ces deux définitions
quelque chofe de louche qu’on én auroit écarté fi
l’on avoit comparé la iociété eccléfiaftique à la fociété
civile.
Dans la fociété c ivile , il y a différens ordres dé
citoyens qui s’élèvent les fins au-deffus des autres,
& l’adminiftratibn générale 6c particulière des chofes
eft diftribuée par portion à différens hommes ou
claffes d’hommes, depuis le fouverainqui commande
à tous jufqu’au fimple fujet qui obéit. •
Dans la focieie eccléfiaftique , l’adminiftration
des chofes relatives à cet état eft partagée de la
meme maniéré. Ceux qui commandent 6c qui en-
feignerit font dans l ’hiérarchie : ceux qui écoutent
6c qui obéiffent font fous Vhiérarchie.
Ceux qui font fous la hiérarchie, quelque dignité
qu’ils occupent dans la fociété civile , font tous
égaux. Le monarque eft dans l’églife un fimple fidèle
, comme le dernier de fes fujets»
Ceux qui font dans Y hiérarchie 8c qui la compofent,
font au contraire tous inégaux, félon l’ancienneté
l’inftitutiori , l’importance & la puiffance attachée
au degré qu’ils occupent. Ainfi l’Eglife, le pape, les
cardinaux , les archevêques, les évêques, les curés
les prêtres , les diacres, les foudiaeres femblent en
ce feris former cette échelle qui peut donner lieu à
deux queftions , l’une de droit 6c l’autre de fait.
I*oye{ Eglise, Éontifè, Cardinaux, & c.
Je ne penfe pas qu’on puiffe difputer fur la quefi
tion de fait» Les ordres dé dignités dont je viens de
faire l’énumération, 6c quelques autres qui ont aufli
leurs noms dans l’Eglife , foit que leurs fondions
fubfiftent encore ou ne fubfiftent plus , 6c qu’il faut
intercaler dans l’échelle , compofent certainement
le gouvernement eccléfiaftique.
Quant à la queftion de droit, c’eft autre chofe.’
Il femble qu’il y a le droit qui yient de l’inftitution
première raite par Jefus-Chrift, & le droit qui
vient de l’ inftitutibn poftérieure faite foit par l’Eglife
même 9 foit par le chef de l’Eglife, ou quelque autre
puiffance que ce foit. En ce cas ,-il y aura certainement
parmi les hiérarques eccléfiaftiques des ordres
qui feront de droit divin, & des ordres qui ne
feront pas de droit divin.
Tous les ordres qui n’ont pas été dès le commencement
, ne feront pas de droit divin.
Parmi ces ordres qui n’ont pas été dès le commencement
, plufieurs ne font plus ; ils ont paffé. Parmi
ceux qui font, il y en a qui peuvent paffer, parce
qu’ils font moins fifpcfîùonis dominiez vedtate, quant,
autoritale
Le P. Cellot Jéfuite avance que Yhiérarckie n’admet
que l’évêque, & que les pretres ni les diacres
C ç ij