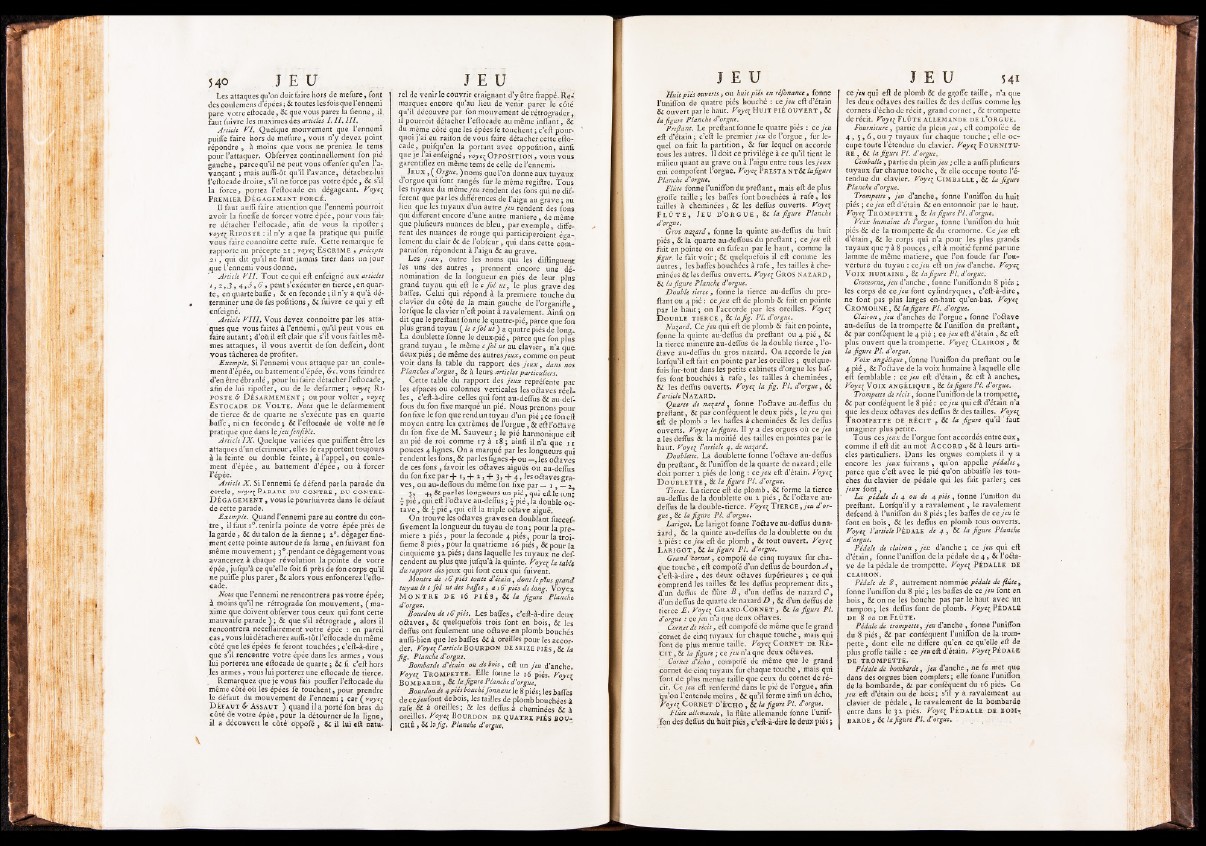
540 J E U Les attaques qu’on doit faire hors de mefure, font
des coulemens d’épées ; & toutes les fois que l’ennemi
pare votre eftocade, 6c que vous parez la fienne, il,
faut fuivre les maximes des articles I. I I . III.
Article VI, Quelque mouvement que l’ennemi
puiffe faire hors de mefure, vous n’y devez point
répondre , à moins que vous ne preniez le tems
pour l’attaquer. Obfervez continuellement fon pié
gauche, parce qu’il ne peut vous offenfer qu’en j ’a-,
vançant ; mais aufli-ôt qu’il l’avance, détachez-lid
i’eftocade droite, s’il ne force pas votre épée, 6c s’il,
la force, portez l’eftocade en dégageant. Voye^
Prem ier D égagement fo r c é .
Il faut aufli faire attention que l’ennemi pourroit
avoir la fineffe de forcer votre épée, pour vous fâi-.
re détacher l’eftocade, afin de vous la ripofter ;
voye{ R iposte : il n’y a que la pratique qui puiffe
vous faire connoître cette rufe. Cette remarque fe
rapporte au précepte 21 ; voye^ Escr im e , précepte
2 1 , qui dit qu’il ne faut jamais tirer dans un jour
.que l ’ennemi vous donne,
Article VII. Tout ce qui eft enfeigné aux articles
1 1 2 , 3 , 4 , J , (T, peut s’exécuter en tierce, en quarte
, en quarte baffe, & en fécondé ; il n’y a qu’à déterminer
une de fes pofitions, 6c fuivre ce qui y eft
enfeigné.
Article V III. Vous devez connoître par les attaques
que vous faites à l’ennemi, qu’il peut vous en
faire autant ; d’où il eft clair que s’il vous faitles mêmes
attaques, il vous avertit de fon deffein, dont
vous tâcherez de profiter.
Exemple. Si l’ennemi vous attaque par un coule-
ment d’épée, ou battement d’épée, &c. vous feindrez
d’en être ébranlé, pour lui faire détacher l’eftocade,
afin de lui ri porter, ou de le defarmer; veyei Riposte
& D ésarmem ent ; ou pour volter, voye{
Esto cad e de V o l t e . Nota que le defarmement
de tierce & de quarte ne s’exécute pas en quarte
baffe, ni en fécondé ; 6c l’eftocade de volte ne fe
pratique que dans le jeu fenjîble.
Article IX . Quelque variées que puiffent être les
attaques d’un efcrimeur, elles fe rapportent toujours
à la feinte ou double feinte, à l’appel, ou coule-
ment d’épée, au battement d’épee, ou à forcer
l’épée.
Article X . Si l’ennemi fe défend parla parade du
cercle, voyc{ Parade du c o n t r e , du co ntre-
D ég ag em en t , vous le pourfuivrez dans le défaut
de cette parade.
Exemple. Quand l’ennemi pare au contre du contre
, il faut i°. tenir la pointe de votre épée près de
la garde, 6c du talon de la fienne ; z°. dégager finement
cette pointe autour de fa lame, enfuivant fon
même mouvement; 3 °. pendant ce dégagement vous
avancerez à chaque révolution la pointe de votre
épée, jufqu’à ce qu’elle foit li près de fon corps qu’il
ne puiffe plus parer, 6c alors vous enfoncerez l’eftocade.
Nota que l’ennemi ne rencontrera pas votre épée;
à moins qu’il ne rétrograde fon mouvement, ( maxime
que doivent obferver tous ceux qui font cette
mauvaife parade ) ; & que s’il rétrograde, alors il
rencontrera neceffairement votre épée : en pareil
cas, vous lui détacherez auflî-tôt l’eftocade du même
côté que les épées fe feront touchées ; c’eft-à-dire ,
que s’il rencontre votre épée dans les armes, vous
lui porterez une eftocade de quarte ; 6c fi c’eft hors
les armes, vous lui porterez une eftocade de tierce.
Remarquez que je vous fais pouffer l’eftocade du
même côté où les épées fe touchent, pour prendre
le défaut du mouvement de l’ennemi ; car ( voye^
D éfaut & A ssaut ) quand il a porté fon bras du
côté de votre épée, pour la détourner de la ligne,
il a découvert le côté oppofé , 6c il lui eft natu-
J E U rel de venir le couvrir craignant d’y être frappé^ Re-'!
marquez encore qu’au lieu de venir parer le côté
qu’il découvre par fon mouvement de rétrograde?,
il pourroit détacher l ’eftocade au même inftanf, 6c
du même côté que les épées fe touchent ; c ’eft pour-,
quoi j’ai eu raifon de vous faire détacher cette eftocade
» puifqu’en la portant avec oppofition, ainfi
que je l’ai enfeigné, voyei Opposition , vous vous
garentiffez en même tems de celle de l’ennemi.
Jeux , (Orgue.') noms que l’on donne aux tuyaux
d’orgue qui font ^rangés fur le même regiftre. Tous
les tuyaux du meme jeu rendeftt des fons qui ne different
que parles différences de l’aigu au grave ; au
lieu que les tuyaux d’un autre jeu rendent des fons
qui different encore d’une autre maniéré, de même
que plufieurs nuances de bleu, par exemple, different
des nuances de rouge qui participeroient également
du clair 6c de l’obfcur, qui dans cette com-
paraifon répondent à l’aigu 6c au grave.
Les. jeu x , outre les noms qui les diftinguent
les uns des autres , prennent encore une dénomination
de la longueur en piés de leur plus
grand tuyau qui eft le c fo l ut, le plus grave des
baffes. Celui qui répond à la première touche du
clavier du côté de la main gauche de l’organifte H
lorfque le clavier n’eft point à ravalement. Ainfi on
dit que le preftant fonne le quatre-pié, parce que fon
plus grand tuyau { le cfol u t) a quatre piés de long.
La doublette fonne le deux-pié, parce que fon plus
grand tuyau , le même c fo l ut au clavier, n’a que.
deux piés ; de même des autres jeux, comme on peut
voir dans la table du rapport des je u x , dans nos
Planches d'orgue, 6c à leurs articles particuliers.
Cette table du rapport des jeux repréfente par
les efpaces ou colonnes verticales les oétaves réelles
, c’eft-à-dire celles qui font au-deflus 6c au-def-
fous du fon fixe marqué un pié. Nous prenons pour
fon fixe le fon que rend un tuyau d’un pié ; ce fon eft
moyen entre les extrêmes de l’orgue , & efti’oâa ve
du fon fixe de M.‘ Sauveur ; le pié harmonique eft
au pié de roi comme 17 à 18 ; ainfi il n’a que 1 1
pouces 4 lignes. On a marqué par les longueurs qui
rendent les fons, 6c parles lignes -f- ou —,les ottaves
de ces fons , favoir les oétaves aiguës ou au-deflus
du fon fixe par-|- i , - f 2 ,+ 3 ,+ 4 , les o&aves grav
es, ou au-deffous du même fon fixe par — 1 , - 2 ,
— 3, — 4, & parles longueurs un p ié , qui eft le ton; pié, qui eft l’oâave au-d tave , & f- pié, qui eft la terfifpulse ; o^éptaivée,l aai gduoëu.ble ocOn
trouve les oftaves graves en doublant fuccef-
fivement la longueur du tuyau de ton; pour la première
2 piés, pour la fécondé 4 piés, pour la troi-
fieme 8 piés, pour la quatrième 16 p iés, & pour la
cinquième 3 2 piés ; dans laquelle les tuyaux ne défi
cendent au plus que jufqu’à la quinte. Voyer la table
du rapport des jeux qui font ceux qui fuivent.
Montre de 16 piés toute d'étain , dont le plus grand
tuyau le c fo l ut des baffes , a 16' piés de long. Voyea
Mo ntr e DE 16 P IÉ S , 6c la figure Planche
d'orgue.
Bourdon de / G piés. Les baffes, c’eft-à-dire deux
oftaves, 6c quelquefois trois font en bois, 6c les
adueffflui-sb ioennt qfueue lleems benaft feusn e oétave en plomb bouchés der. 6c à oreilles pour les accorVoye{
Particle BOURDON DE SEIZE PIÉS , 6c la.
fig. Planche d'orgue.
Bombarde d'étain ou de bois, eft un jeu d’anche.
Voyc[ T r om p e t t e . Elle fonne le 16 piés. Voye^
BOMBARDE, 6c la figure Planche d'orgue. de Bceo/u«r«dfoonn dte d4e p bieosi bs,o luecsh téaf oilnlensa dnet lpel o8m pibé bs;o luecs hbéaefsfe às rafe 6c à oreilles; & les deffus .à cheminées 6c à
oreilles. Voye^ Bourdon de quatre piés bouché
, 6c la fig. Planche d'orgue.
J E U Huit piés ouverts, ou huit piés en téfonance , fonne
l’uniffon de quatre piés bouché : ce jeu eft d’étain
& ouvert parle haut. Voye^ HUIT PIÉ OUVERT, 6c
la figure Planche d'orgue.
Preflant. Le preftant fonne le quatre piés : ce jeu
eft d’étain ; c’eft le premier jeu de l’orgue , fur lequel
on fait la partition, & fur lequel on accorde
tous lès autres. Il doit ce privilège à ce qu’il tient le
milieu quant au grave ou à l’aigu entre tous les jeux
qui compofent l’orgue. Voye{ PRESTA NT& lafigure
Planche d'orgue.
Flûte fonne l’uniffon du preftant, mais eft de plus
groffe taille ; les baffes font bouchées à rafe, les
tailles à cheminées, & les deffus ouverts. Voyeç
F l û t e , J e u d’o R G U E , 6c la figure Planche
d'orgue.
Gros nanard, fonne la quinte au-deffus du huit
pié s, & la quarte au-deffous du preftant ; ce jeu eft
fait en pointe ou en fufeau.par le haut, comme la
figur. le fait v o ir ; 6c quelquefois il eft comme les
autres, les baffes bouchées à rafe, les tailles à cheminées
6c les deffus ouverts. Voye{ Gros nazard ,
6c la figure Planche d'orgue.
Double tierce , fonne la tierce au-deffus du preftant
ou 4 pié : ce jeu eft de plomb & fait en pointe
par le haut ; on l’accorde par les oreilles. Voye^
D ouble t ier c e , 6c la fig. PI. d'orgue.
Nanard. Ce jeu qui eft de plomb & fait en pointe,
fonne la quinte au-deffus du preftant ou 4 p ié , &
la tierce mineure au-deffus de la double tierce, l’o-
étave au-deffus du gros nazard. On accorde le jeu
lorfqu’il eft fait en pointe par les oreilles ; quelquefois
fur-tout dans les petits cabinets d’orgue les baffes
font bouchées à rafe, les tailles à cheminées,
& les deffus ouverts. Voye{ la fig. Pl. <Porgue, 6c
l'article NAZARD.
Quarte de nanard, fonne l’o&ave au-deffus du
preftant, & par conséquent le deux piés, le jeu qui
eft de plomb a les baffes à cheminées 6c les deffus
ouverts. Voye^ la figure. Il y a des orgues où ce jeu
a les deffus & la moitié des tailles en pointes par le
haut. Voyes^ Carticle 4. de nanard.
Doublette. La doublette fonne l’o&ave au-deffus
du preftant, & Tuniffon de la quarte de nazard ; elle
doit porter 2 piés de long : ce jeu eft d’étain. Voye^
D o u b l e tt e, & la figure Pl. d'orgue.
Tierce. La tierce eft de plomb, 6c forme la tierce
au-deffus de la doublette ou 2 piés , 6c l’o&ave au-
deffus de la double-tierce. Voye^T ie r c e ,jeu d’orgue
, 6c la figure Pl. cPorgue.
Larigot. Le larigot fonne l’oftave au-deffus du nazard
, 6c la quinte au-deffus de la doublette ou du
% piés : ce jeu eft de plomb , & tout ouvert. Voye{
La r ig o t , & la figure Pl. d'orgue.
Grand Cornet, compofé de cinq tuyaux fur chaque
touche, eft compofé d’un deffus de bourdon A ,
c’eft-à-dire, des deux oûaves fupérieures ; ce qui
Comprend les tailles 6c les deffus proprement dits,
d’un déffùs de flûte B , d’un deffus de nazard C ,
d’un deffus de quarte de nazard D ,6 c d’un deffus de
tierce E . Voye{ Grand-Cornet , 6c la figure Pl.
tPorgue : cè jeu n’a que deux oftaves.
Cornet de récit, eft compofé de même que le grand
cornet de cinq tuyaux fur chaque touche, mais qui
font de plus menue taille. Voyeç Cornet de Ré-
fciT , & la figure ; ce jeu n’a que deux oftaves.
' Cornet d'écho, compofé de même que le grand
cornet de-cinq tuyaux fur chaque touche , mais qui
font dé plus menue taillé que ceux du cornet de récit.
Ce jeu eft renfermé dans le pié de l’orgue, afin
'qu’on l’entende moins, 6c qu’il forme ainfi un écho.
Voÿé{ CornET D’ÉCHO , & la figure Pl. <Porgue.
flûte allemande, la flûte allemande fonne l’unif-
,'fon deî deffus du huit piés , c’eft-à-dire le deux piés ;
J E U 541
ce jeu qui eft de plomb & de gr.offe taille, n’a que
les deux oétaves des tailles 6c des deffus comme les
cornets d’écho de ré c it, grand corn et, 6c trompette
de récit. Voye^ Flû te allemande de l’o r g u e .
Fourniture , partie du plein je u , eft compofée de
4 , ç , 6 , ou 7
tuyaux fur chaque touche ; elle occupe
toute l’étendue du clavier. Voye{ Fo u rn itu re
, 6c la figure Pl. d'orgue.
Cimballe, partie du plein jeu ;elle a aufli plufieurs
tuyaux fur chaque touche, & elle occupe toute l’étendue
du clavier. Voye{ C im b a l l e , 6c la figure
Planche d'orgue.
Trompette , jeu d’anche, fonne l’uniffon du huit
piés ; ce jeu eft d ’étain 6c en entonnoir par le haut.
Voyei T rom p et t e , 6c la figure P l. d'orgue.
Voix humaine de l'orgue, fonne l’uniffon du huit
piés 6c de la trompette 6c du cromorne. Ce jeu eft
d’é ta in , 6c le corps qui n’a pour les plus grands
tuyaux que 7 à 8 pouces, eft à moitié fermé parune
lamme de même m atière, que l’on foude fur l’ouverture
du tuyau : ce jeu eft un jeu d’anche. Voye£
V o i x humaine , 6c la figure Pl. d'orgue.
Cromorne, jeu d’anche, fonne l’uniffondu 8
piés ;
les corps de ce jeu font cylindryques, c’eft-à-dire,
ne font pas plus larges en-haut qu’en-bas. Voyeç
C r om o r n e , 6c la figure Pl. d'orgue.
Clairon, jeu d’anches de l’orgue, fonne l’oûave
au-deffus de la trompette 6c
l’uniffon du preftant, 6c
par conféquent le 4 pié ; ce jeu eft d’étain , & eft
plus ouvert que la trompette. Voye^ C lairo n , &
la figure Pl. d'orgue.
Voix angélique , fonne l’uniffon du preftant ou le
4 p ié , & l’o&ave de la voix humaine à laquelle elle
eft femblabie : ce jeu eft d’étain , 6c eft à anches»
Voye{ V o ix ANGÉLIQUE , 6c la figure Pl: d'orgue.
Trompette de récit, fonne l’uniffon de la trompette,
6c par conféquent le 8 pié : ce jeu qui eft d’étain n’a
que les deux oôaves des deffus & des tailles. Voye^
T r om p e t t e de r é c it , 6c la figure qu’il'fa u t
imaginer plus petite.
T ous ces jeux de l’orgue font accordés, entre eu x ,
comme il eft dit au mot Ac c o r d , 6c à leurs articles
particuliers. Dans les orgues complets il y a
encore les jeux fuivans , qu’on appelle pédales,
parce que c’eft avec le pié qu’on abbaiffe les touches
du clavier de pédale qui les fait parler; ces
jeux fo n t,
La pédale de 4
ou de 4 piés, fonne l’uniffon du
4
preftant. Lorfqu’il y a ravalem ent, le ravalement
defeend à l’uniffdn du 8 piés ; les baffes de ce jeu fe
font en bois, 6C les deffus en plomb tous ouverts.
Voyc{ l'article PÉDALE de , 6c la figure Planche
d'orgue.
Pédale de clairon , jeu d’anche ; ce jeu qui eft
d ’étain, fonne l’uniffon de la pédale de 4, & l’o&a-
ve de la pédale de trompette. Vlye^ P édalle de
c l a ir o n .
Pédale de 8 , autrement nommée pédale de flûte ,
fonne l’uniffon du 8 pié ; les baffes de ce jeu font en
b ois, & on ne les bouche pas par le haut avec un
tampon ; les deffus font de plomb. Voye^ P éd ale
de 8 ou de Fl û t e .
Pédale de trompent, jeu d’anche , fonne l’uniffon
du 8 piés, 6c par conféquent l’uniffon de la trompette
, dont elle ne différé qu’en ce qu’elle eft de
plus groffe taille : c e /*« eft d’étain. Voyei Péd a le
de t r om p e t t e .
Pédale de bombarde, jeu d’anche , né fe met que
dans des orgues bien complets ; elle fonne l’uniffon
de la bom barde, & par conféquent du 16
pies. C e
jeu eft d’étain ou de bois ; s’il y à. ravalem ent au
Clavier de p édale,3 le ravalement de là bombarde
entre dans le piés. Voye£ Péd a l l e d e . b o m barde
1
> 6C la figure P l. d'orgue.