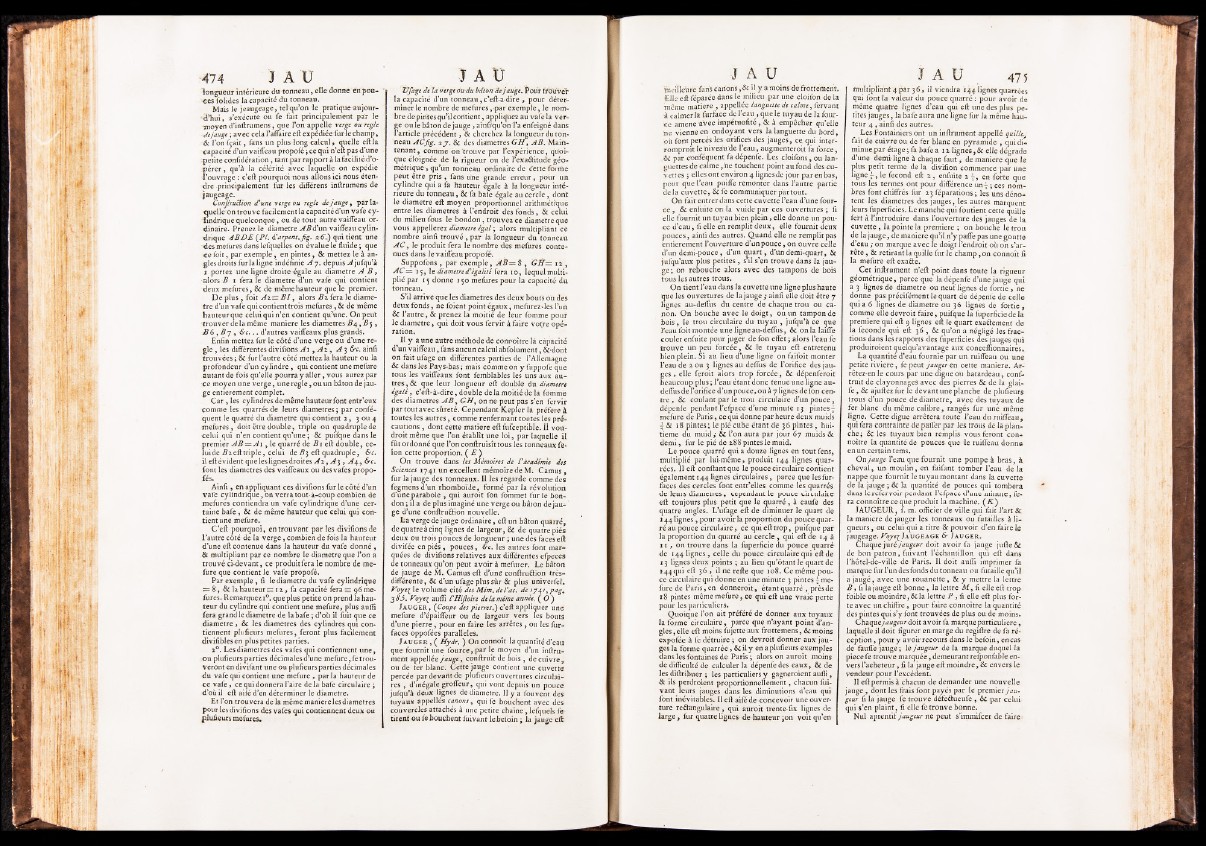
longueur intérieure du tonneau, elle donne enpoü-
-ces iolides la capacité du tonneau.
Mais le jeaugéage, tel qu’on le pratique-aujour-
-d’hui, s’exécute ou fe fait principalement par le
Ttioyen d’inftrumens, que l’on appelle verge ou réglé
de jauge ; avec cela l'affaire eft expédiée furie champ,
& F on d a it, fans un plus long ealcnl, quelle eft la
capacité d’un vaiffeau propofé ; ce qui n’eft pas d’üne
-petite confidération, tant par rapport à la facilité d’o-
qpérer, qu’à la célérité avec laquelle on expédie
■ l’ouvrage : c’eft pourquoi nous allons ici nous éten-
■ dre principalement fur les différens inftrumens de
jaugeage.
Cortfiruclion d'une verge du réglé dtjauge, par laquelle
on trouve facilement la capacité d’un vafe cy lindrique
quelconque, ou de tout autre vaiffeau ordinaire.
Prenez le diamètre A B d’un vaiffeau cylindrique
•4 B D E (iV. d1arpent.fig. atf.) qui tient une
des mefures dans lefquelies on évalue le fluide ; que
c e foit, par exemple, en pintes, & mettez le à angles
droits fur la ligne indéfinie A 7. depuis ^ jufqu’à
1 portez une ligne droite égale au diamètre A B ,
•alors B i fera le diamètre d’un vafe qui contient
deux mefures, & de même hauteur que le premier.
D e p lus , foit A i— B J , alors B z fera le diamètre
d’un vafe qui contient trois mefures, & de même
hauteur que celui qui n’en contient qu’une. On peut
prouver delà même maniéré les diamètres .#4, i? 5 ,
JB 6 , B 7’ , & c .. . d’autres vaiffeaux plus grands.
Enfin mettez fur le côté d’une verge ou d’üne réglé
, les différentes divifions A i y A i , A 3 &c. ainfi
trouvées ; & fur l’autre côté mettez la hauteur ou la
profondeur d’un cylindre , qui contient une mefure
autant de fois qu’elle pourra y aller, vous aurez par
ce moyen une verge, une réglé, ou un bâton de jauge
entièrement complet.
C a r , les cylindres de même hauteur font entr’eux
comme les quarrés de leurs diamètres ; par confé-
quent le quarré du diamètre qui contient 2 , 3 ou 4
mefures, doit être double > triple ou quadruple de
celui qui n’en contient qu’une ; & puifque dans le
premier A B — A 1 , le quarré de B 1 eft double, celui
de B 2 eft triple, celui de B y eft quadruple, &c.
il eftévident queleslignesdroites^2,^3 , A ^ 9 &ct
font les diamètres des vaiffeaux ou desvafes propo-
fés.A
in fi, en appliquant ces divifions furie côté d’un
vafe cylindrique, on verra tout-à-coup combien de
mefures contiendra un vafe cylindrique d’une certaine
bafe , & de même hauteur que celui qui contient
une mefure.
C ’eft pourquoi, en trouvant parles divifions de
l ’autre côté de la verg e, combien de fois la hauteur
d’une eft contenue dans la hauteur du vafe donné ,
& multipliant par ce nombre le diamètre que l’on a
trouvé ci-devant, ce produit fera le nombre de mefure
que contient le vafe propofé.
Par exemple, fi le diamètre du vafe cylindrique
= 8 , & la hauteur = 1 2 , fa capacité fera = 96 mefures.
Remarquez!0, que plus petite on prend la hauteur
du cylindre qui contient une mefure, plus auffi
fera grand le diamètre de la bafe ; d’oit il fuit que ce
diamètre, & les diamètres des cylindres qui contiennent
plufieurs mefures, feront plus facilement
divifibles en plus petites parties.
20. Les diamètres des vafes qui contiennent une,
ou plufieurs parties décimales d’une mefure, fe trouveront
en divifant une ou plufieurs parties décimales
du vafe qui contient une mefure , par la haureur de
ce vafe , ce qui donnera l’aire delà bafe circulaire ;
d’où il eft ailé d’en déterminer le diamètre.
Et l’on trouvera de la même maniéré les diamètres
pour les divifions des vales qui contiennent deux ou
plufieurs mefures»
Hfage de là verge ou-du bâton de jauge. Pouf tfouvét
la capacité d’un tonneau, c’eft-a-dire , pour déter-
miner le nombre de mefures,-par exemple, le nombre
de pintes qu’il contient, appliquez au vafe la verge
ou le bâton de jauge, ârnffqu’on l’a enfeigné dans
l’article précédent, & cherchez la longueur du tonneau
A C fig. 7,y. & des diàmetres G H , A B . Maintenant,
comme o n ‘trouve par l’expériencè, quoique
éloignée de la rigueur ou de PexaéHtude géométrique,
qu’iin tonneau ordinaire de cette forme
peut être pris , fans une grande erreur, pour un
cylindre qui a fa hauteur égale à la longueur intérieure
du tonneau, & fa baie égale au cercle, dont
le diamètre eft moyen proportionnel arithmétique
entre les diamètres à l’endroit des fonds, & celui
du milieu fous le bondon, trouvez cè diamètre quê
vous appellerez diamètre égal ; alors multipliant cè
nombre ainfi trouvé, par la longueur du tonneau
A C 9 le produit fera le nombre des mefures contenues
dans le vaifleau propofé.
Suppofons , par exemple, A B = 8 , GH — 1 2 ,
A C = 1 5 , le diamètre d’égalité fera 10, lequel multiplié
par 15 donne 150 mefures pour la capacité du
tonneau.
S’il arrive que les diamètres des deux bouts ou des
deux fonds, ne foient point égaux, mefurez-les l’un
& l’autre, & prenez la moitié de leur fomme pouf
le diamètre, qui doit vous fervir à faire votre opération.
Il y a une autre méthode dé connoître là capacité
d’un vaiffeau, fans aucun Calcul abfolument, &-dont
on fait ufage en différentes parties de l’Allemagne
& dans les Pays-bas; mais comme on y fuppofe que
tous les vaiffeaux font femblables les uns aux autres
, 8c que leur longueur eft doublé du diamètre
égalé, c’eft-à-dire, double de la moitié de là fomme
des diamètres A B , GH , on ne peut pas s’en fervir
par tout avec sûreté. Cependant Kepler là préféré à
toutes les autres, comme renfermant toutes les précautions
, dont cette matière eft fufceptible. Il vou-
droit même que l’on établît une loi, par laquelle il
fût ordonné que l’on conftruisîttous les tonneaux félon
cette proportion. ( E )
On trouve dans les Mémoires de Vacadémie des
Sciences 1741 un excellent mémoire de M. Camus,
fur la jauge des tonneaux. Il les regarde comme des
fegmensd’un rhomboïde, formé par la révolution
d’une parabole , qui auroit fon fommet fur le bon-
don ; il a de plus imaginé une verge ou bâton dejauge
d’une conftruûion nouvelle.
La verge de jauge ordinaire, eft un bâton quarré,
de quatre à cinq lignes de largeur, 6c de quatre piés
deux ou trois pouces de longueur ; une des faces eft
divifëe en piés, pouces, &c. les autres font marquées
de divifions relatives aux différentes efpeces
de tonneaux qu’on peut avoir à mefurer. Le bâton
de jauge de M. Camus eft d’une conftruétion très-
différente, & d’un ufage plus sûr & plus univerfeL
Voyc^ le volume cité des Mém. de l*ac. de 1741, pag±
38S. Voyeç auffi VHifioire de la même année, ( O )
Ja u g e r , (Coupe des pierres.) c’eft appliquer une
mefure d’épaiffeur ou de largeur vers les bouts
d’une pierre, pour en faire les arrêtes, ou les fur-
faces oppofées parallèles.
Ja u g er , ( Hydr. ) On connoît la quantité d’eau
que fournit une fource,par le moyen d’un inftru-
ment appellée jauge, conftruit de bois , de cuivre,
ou de ter blanc. Cette jauge contient une cuvette
percée par devant de plufieurs ouvertures circulaires
, d’inégale groffeur, qui vont depuis un pouce
ju(qu’à deux lignes de diamètre. Il y a fouvent des
tuyaux appellés canons, qui fe bouchent avec des
couvercles attachés à une petite chaîne, lefquels fe
tirent ou fe bouchent fuivantlebeioin ; la jauge eft
meilleure fariS Canons ,8c il y a moins de frottement.
Elle eft féparée dans le milieu par une cloifon de la
même matière , appellée languette de calme, fervant
à calmer la furfaee de l’eau , que le tuyau de la four-
ce amene a vec imp'étuofité, & à empêcher qu’elle
ne vienne en ondoyant vers la languette du bord,
où font percés les orifices des jauges, ce. qui inter-
romproit leniveaUde l’eau, augmenteroit fa force,
& par cOnféquent fa dépenfe. Les cloifons, ou languettes
de calme ,ne touchent point au fond des cuvettes
; elles ont environ 4 lignes de jour par en bas,
pour que l’eau puiffe remonter dans l’autre partie
de la cuvette, 8t fe communiquer partout.
On fait entrer dans cette cuvette l’eau d’une four-
c e , & enfuite on. la vuide par ces ouvertures ; fi
elle fournit un tuyau bien plein, elle donne un pouce
d’eau, fi elle en remplit deux, elle fournit deux
pouces, ainfi des autres. Quand elle ne remplit pas
entièrement l ’ouverture d’un pouce, on ouvre celle
d’un demi-pouce , d’un quart, d’un demi-quart, &
jufqu’aux plus petites, s’il s’en trouve dans la jaug
e ; on rebouche alors avec des tampons de bois
tous les autres trous.
On tient l’eau dans la cuvette une ligne plus haute
que les ouvertures de la jauge ƒ ainfi elle doit être 7
lignes au-deffus du centre de chaque trou ou canon.
On bouche avec le doigt, ou un tampon de
bois, le trou circulaire du tuyau , jufqu’à ce que
Peau foit montée une ligne au-deffus, & on la laiffe
couler enfuite pour juger de fon effet ; alors l’eau fc
trouve un peu forcée, 8c le tuyau eft entretenu
bien plein. Si aii lieu d’une ligne on faifoit monter
l’eau de 2 ou 3 lignes au deffus de l’orifice des jauges
, elle feroit alors trop forcée, & dépenferoit
beaucoup plus ; l’eau étant donc tenue une ligne au-
deffus de l’orifice d’un pouce, ou à 7 lignes de fon cen- ;
t re , 8c coulant par le trou circulaire d’un pouce,
dépenfe pendant l’efpace d’une minute 13 pintes 7
mefure de Paris, ce qui donne par heure deux muids
| & 18 pintes; le pié cube étant de 36 pintes ; huitième
du muid ; 8c l’on aura par jour 67 muids &
demi, fur le pié de 288 pintes le muid.
Le pouce quarré qui a douze lignes en tout fens,
multiplié par lui-même, produit 144 lignes quar-
rées. Il eft confiant que le pouce circulaire contient
également 144 lignes circulaires, parce que les fur-
faces des cercles font entr’elles comme les quarrés
de leurs diamètres ; cependant le pouce circulaire
eft toujours plus petit que le quarré, à caufe des
quatre angles. L’ufage eft de diminuer le quart de
i44 lignes, pour avoir la proportion du pouce quarré
au pouce circulaire, ce qui eft trop, puifque par
la proportion du quarré au cercle , qui eft de 14 à
11 , on trouve dans la fuperficie du pouce quarré
de 144 lignes , celle du pouce circulaire qui eft de
13 lignes deux points ; au lieu qu’ôtant le quart de
144 qui eft 36 , il ne refte que 108. Ce même pouce
circulaire qui donne en une minute 3 pintes 7 mefure
de Paris, en donneroit, étant quarré , prèsde
18 pintes même mefure, ce qui eft une Vraie perte
pour les particuliers.
Quoique l’on ait préféré de donner aux tuyaux
la forme circulaire, parce que n’ayant point d’angles
, elle eft moins fujette aux frottemens, & moins
expofée à fe détruire ; on deVroit donner aux jauges
la forme quarrée, 8c il y en a plufieurs exemples
dans les fontaines de Paris ; alors on auroit moins
de difficulté de calculer la dépenfe des eaux, 8c de
les diftribuer ; les particuliers y gagneroient aufli,
& ils perdroient proportionnellement, chacun fui-
vant leurs jauges dans les diminutions d’eau qui
font inévitables. Il eft aifé de concevoir une ouverture
rectangulaire, qui auroit trente-fix lignes de
large, fur quatre lignes de hauteur jon voit qu’en
multipliant 4 par 36, il Viendra 144 lignes quarrées
qui font la valeur du pouce quarré : pour avoir de
même quatre lignes d’eau qui eft une des plus petites
jauges, la bafe aura une ligne fur la même hauteur
4 , ainfi des autres.
Les Fontainiers ont un infiniment appellé quille-j
fait de cuivre ou de fer blanc en pyramide , qui diminue
par étage ; fa bafe a 12 lignes, & elle dégrade
d’une demi-ligne à chaque faut,- de maniéré que le
plus petit terme de la divifion commence par une
ligne 7 , le fécond eft 2 , enfuite 2 7 , en forte que
. tous les termes Ont pour différence un-^ ; ces nombres
font chiffrés fur 23 féparations ; les uns dénotent
les diamètres des jauges, les autres marquent
leurs fuperficies. Le manche qui foutient cette quille
fert à l’introduire dans l’ouverture des jauges de la
cuvette, la pointe la première ; on bouche le trou
de la jauge, de maniéré qu’il n’y paffe pas une goutte
d’eau ; on marque avec le doigt l’endroit où on s’arrête
, & retirant la quille fur le champ ,on connoît fi
la mefure eft exafte.
Cet inftrument n’eft point dans toute la rigueur
géométrique, parce que la dépenfe d’une jauge qui
a 3 lignes de diamètre ou neuf lignes de fortie, ne
donne pas précifément le quart de dépenfe de celle
quia 6 lignes de diàmetre ou 36 lignes de fortie ,
comme elle devroit faire, puifque la fuperficie de la
première qui eft 9 lignes eft le quart exa&ement de
la fécondé qui eft 36 , & qu’on a négligé les fractions
dans les rapports des fuperficies des jauges qui
produiroient quelqu’avantage aux conceffionnaires..
La quantité d’eau fournie par un ruiffeau ou une
petite rivière, fe peut jauger en cette maniéré. Ar-
rêtez-en le cours par une digue où batardeau, conf-
truit de clayonnages avec des pierres 8c de la glai-
f e , 8c ajuftez fur le devant une planche de plufieurs
trous d’un pouce de diamètre, avec des tuyaux de
fer blanc du même calibre, rangés fur une mêmé
ligne. Cette digue arrêtera toute l’eau du ruiffeau,
qui fera contrainte de paffer par les trous de la planche;
8c les tuyaux bien remplis vous feront connoître
la quantité de pouces que le ruiffeau donne
en un certain tems.
On jauge l'eau que fournit une pompe à bras, à.
cheval, un moulin, en faifant tomber l ’eau d e là
nappe que fournit le tuyau montant dans la cuvette
de la jauge ; 8c la quantité de pouces qui tombera
dans lerefervoir pendant l’efpace d’une minute, fera
connoître ce que produit la machine, ( f f )
JAUGEUR, l. m. officier de ville qui fait l’art &
la maniéré de jauger les tonneaux ou futailles à liqueurs
,■ ou celui qui a titre & pouvoir d’en faire le
jaugeage. Hoye[ Ja u g ea g e 6* Ja u g e r .
Chaque jurk jaugeur doit avoir fa jauge jufte 8c
de bon patron, fuivant l’échantillon qui eft dans
l ’hôtcl-de-ville de Paris. Il doit auffi imprimer fa
marque fur l’un des fonds du tonneau ou futaille qu’il
a jaugé, avec une rouanette, & y mettre la lettre
B , fi la jauge eft bonne, la lettre M , fi elle eft trop
foible ou moindre, & la lettre P , fi elle eft plus forte
avec un chiffre, pour faire connoître la quantité
des pintes qui s’y font trouvées de plus ou de moins.
Chaquejaugeur doit avoir fa marque particulière,
laquelle il doit figurer en marge du regiftre de fa réception
, pour y avoir recours dans le befoin, en cas
de fauffe jauge ; le jaugeur de la marque duquel la
piecefe trouve marquée, demeurant relponfable envers
l’acheteur , fi la jauge eft moindre, 8c envers le
vendeur pour l’excédent.
II eft permis à chacun de demander une nouvelle
jauge , dont les frais font payés par le premier jaugeur
fi la jauge fe trouve défe&ueufe , 8c par celui
qui s’en plaint, fi elle fe trouve bonne.
Nul aprentif jaugeur ne peut s’immifcer de faire*