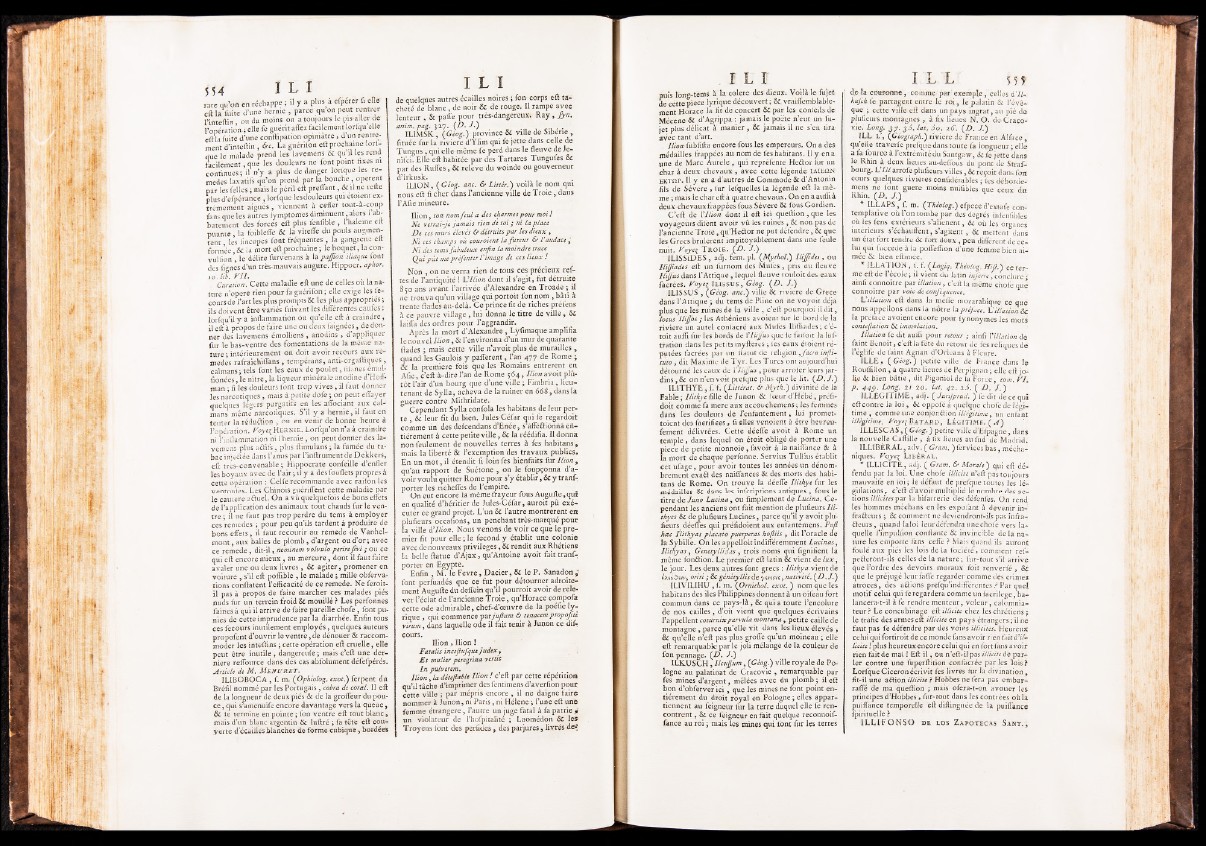
rare qK’on en réchappe ; il y a plus à efpérer fi B g
e â la fuite d’une hernie , parce qu on peut rentrer
l’inteftin, où du moins on a toujours le pis-aller de
l’opération.; elle fe guérit affea facilement lorfqu elle
eftla fuite d’une conftipation opiniâtre , d’un rentre-
ment d’inteftin , &c. La guérifon eftprochame lorf-
que le malade prend les lavemens 6c qu il les rend
facilement, que les douleurs ne font point fixes ni
continues; il n’y a plus de danger lorfque les remettes
laxatifs qu’oii prend par la bouche , opèrent
par les Telles ; mais le péril eft preffant, & u ne relte
plusd’efpérance , lorfque lesdouleurs qui etOient extrêmement
'aiguës , viennent à cefler tout-à-coup
fans que les autres fymptomes diminuent, alors 1 ab-
batement des forces efl plus i'enfible , l’haleine elt
puante , la foiblefle & la vîteffe du pouls augmentent
les üncopes font fréquentes , la gangrené cli
formée, & la mort eft prochaine ; le hoquet , 1a COn-
vulfion , le délire furvenans à la paflion iliaque font
des lignes d’un très-mauvais augure. Hippocr. aphor.
io. lib. VII. | v i
Curation. Cette maladie eft une de celles ou la nature
n’opere rien pour fa guérifon ; elle exige les le-
cours de l’art les plus prompts 6c les plus appropries ;
ils doivent être variés fuivant les différentes caufes :
lorfqu’il y a inflammation ou qu’elle eft k craindre,
il eft à propos de faire une ou deux laignées, de donner
des lavemens émolliens , anodins , d’appliquer
for le bas-ventre des fomentations de la même nature
; intérieurement on doit avoir recours aux remèdes
rafraichiffans , têmpérans, anti-orgaftiques ,
caïmans; tels font les eaux de poulet, tilanes émul-
fionées, le nitre, la liqueur minérale anodine d’Hoft-
man ; fi les douleurs font trop v iv e s , il faut dçmner
les narcotiques , mais à petite dofe ; on peut effayer
quelques légers purgatifs en les' affociant aux caïmans
même narcotiques. S’il y a hernie, il faut en
tenter la rédu&ion , ou en venir de bonne heure à
l ’opération. Voye{ Hernie. Lorfqu’onn’a à craindre
ni l’inflammation ni 1 hernie, on peut donner des lavemens
plus a â ifs , plus ftimulans ; la fumée du tabac
injeâée dans l’ anus par l’inftrument de Dekkers,
eft tres-convenable ; Hippocrate confeille d’enfler
les boyaux avec de l’air ; il y a desfouflets propres à
cette opération : Celfe recommande avec railon les
ventoufes. Les Chinois guériffent cette maladie par
le cautere aftuel. On a vu quelquefois de bons effets
de l’application des animaux tout chauds fur le ventre
; il ne fout pas trop perdre du tems à employer
ces remedes ; pour peu qu’ils tardent à produire de
bons effets, il fout recourir au remede de Vanhel-r
mont, aux balles de plomb, d’argent ou d’or; avec
ce remede, dit-il, neminem volvulo perirtfivi ; ou ce
qui eft encore mieux , au mercure, dont il faut faire
avaler une ou deux livres , & agiter, promener en
voiture , s’il eft poflible , le malade ; mille obferva-
tions conftatent l’efficacité de ce remede. Ne feroit-
il pas à propos de faire marcher ces malades piés
nuds fur un terrein froid & mouillé ? Les perfonnes
faines à qui il arrive de foire pareille chofe , font punies
de cette imprudence par la diarrhée. Enfin tous
ces fecours inutilement employés, quelques auteurs
propofent d’ouvrir le ventre, de dénouer & raccommoder
les inteftins ; cette opération eft cruelle, elle
peut être inutile , dangereufe ; mais c’eft une dernière
reffource dans des cas abfolument défefpérés.
Article de M. MenURET.
ILIBOBOCA , f. m. (Ophiolog. exot.) ferpent du
Bréfil nommé par les Portugais , cobra de coral. Il eft
de la longueur de deux piés & de la groffeur du pouce
, qui s’amenüife encore davantage vers la queue,
& le termine en pointe ; fon ventre eft tout blanc,
mais d’un blanc argentin 6c luftré ; fa tête eft cou-
ÿerte d’écaiiles blanches de forme cubique, bordées
de quelques autres écailles noires ; fon corps eft tacheté
de blanc, de noir 6c de rouge. Il rampe avec
lenteur , & paffe pour très-dangereux* R a y , fyn.
anim.pag. 317. (JD. J.)
ILIMSK, ( Géog.) province & ville de biberie ,
fituée fur la riviere d’Ylim qui fe jette dans celle de
Tungus, qui elle-même fe perd dans le fleuve de Je-
nifei. Elle eft habitée par des Tartares Tungufes 6c
par des Ruffes, 6c releve du woinde ou gouverneur
d’Irkusk.
ILION, ( Géog. anc. & Littlr.') voilà le nom qui
nous eft fi cher dans l’ancienne ville de T ro ie , dans
l’Afie mineure.
Ilion, ton nom feul a des charmes pour moi !
Ne verrai-je jamais . rien de tôt ; ni la place
De ces murs élevés & détruits par les dieux ,
Ni ces champs où cour oient la fureur & l'audace t
Ni des tems fabuleux enfin la moindre trace
Qui put me préfenter l'image de ces lieux J
Non , on ne verra rien de tous ces précieux ref-
tes de l’antiquité ! VIlion dont il s’agit, fut détruite
850 ans avant l’arrivée d’Alexandre en Troade ; il
ne trouva qu’un village qui portoit fon nom , bâti à
trente ftades au-delà. Ce prince fit de riches préfens
à ce pauvre village , lui donna le titre de v ille , 6c
laiffa des ordres pour l’aggrandir.
Après la mort d’Alexandre, Lÿfimaque amplifia
le nouvel Ilion, & l’environna d’un mur de quarante
: ftades ; mais cette ville n’avoit plus de murailles ,
quand les Gaulois y pafferent, l’an 477 de Rome ;
& la première fois que les Romains entrèrent en
Afie, c’eft-à-dire l’an de Rome 564, Ilion avoit plutôt
l’air d’un bourg que d’une ville ; Fimbria, lieutenant
de Sylla, acheva de la ruiner en 668, dans la
guerre contre Mithridate.
Cependant Sylla confola les habitans de leur perte
, 6c leur fit du bien. Jules-Céfar qui fe regardoit
comme vin des defeendans d’Enée, s’affeôionna entièrement
à cette petite v ille , 6c la réédifia. Il donna
non feulement de nouvelles terres à fes habitans ,
mais la liberté & l’ exemption des travaux publics.
En un mot, il étendit fi loin fes bienfaits fur Ilion ,
qu’au rapport de Suétone , on le foupçonna d a-
voir voulu quitter Rome pour s’y établir, & y tranf-
porter les richeffes de l’empire.
On eut encore la même frayeur fous Augufte, qui
en qualité d’héritier de Jules-Céfar, auroit pu exécuter
ce grand projet. L’un & l’autre montrèrent en
plufieurs occafions, un penchant très-marqué pour
la ville d'Ilion. Nous venons de voir ce que le premier
fit pour elle ; le fécond y établit une colonie
avec de nouveaux privilèges, & rendit aux Rhétiens
la belle ftatue d’Ajax , qu’Antoine avoit fait tranfr
porter en Egypte.
Enfin , M. le Fevre, D ac ier, & le P. Sanadon ;
font perfuadés que ce fut pour détourner adroitement
Augufte du deffein qu’il pourroit avoir de relever
l’éclat de l’ancienne T ro ie , qu’Horace compofa
cette ode admirable, chef-d’oeuvre de la poéfie ly rique
, qui commence par juflum & tenacempropojiù
virum, dans laquelle ode il fait tenir à Juùon ce dif-
cours.
Ilion , Ilion !
Fatalis incefiufqut judex,
E t mulier peregrina vertit
In pulverem.
Ilion, la détefiable Ilion ! c’eft par cette répétition
qu’il tâche d’imprimer des fentimens d’averfion pour,
cette ville ; par mépris encore , il ne daigne foire
nommer à Junon, ni Paris, ni Hélene ; l’une eft une
femme étrangère, l’autre un juge fatal à fa patrie jl
un violateur de l’hofpitalité ; Laomédon 6c les
Troyens font des perfides, des parjures, livrés de?
puis lông-tems à la colere des dieux. Voilà le fojet
de cettepiece lyrique découvert; &_vraisemblablement
Horace la- fit de concert 6c par les conlèils de
Mécene & d’Agrippa : jamais.le poète n’eut un fu-
jet plus délicat à manier, 6c jamais il ne s’en tira
#vec tant d’art.
Ilion fubfifta encore fous les empereurs. On a desmédailles
frappées.au nom de fes habitans. Il y en a
une de Marc Aurele , qui repréfente Heéfor lur un
char à deux chevaux , avec cette légende iailûn
EK T flP . Il y en a d’autres de Commode & d’Antonin
fils de Sévere , fur lefquelles la légende eft la même
; mais le char eft à quatre chevaux. On en a auffi à
deux chevaux frappées fous Sévere & fous Gordien.
C ’eft de ^Ilion dont il eft ici queftion, que les
voyageurs dilent avoir vû les ruines , 6c non pas de
l’ancienne T ro ie , qu’Be&or ne put défendre, & que
les Grecs brûlèrent impitoyablement dans une feule
nuit. Voye{ T r o ie . (D . /.);
ILISS1DES , adj. fem. pl. (Mythol.) lliffides , ou
IliJJiades eft un furnom des Mules , pris du fleuve
liifjus dans l’Attique, lequel fleuve rouloit des eaux
fâerées. Foyc{ Il is su s , Géog. (D . J.)
.IL1SSUS , (Géog. anc.') ville & riviere de Grece
dans l’Attique ; du tems de Pline on ne voyoit déjà
plus que lès ruines de la ville , c’eft pourquoi il d it,
locus llijfos ; les Athéniens àvoient lur le bord dé la
riviere un autel conlacré aux Mules Uifliades; c e-
toit aulfi fur les bords de Ÿllijjus que le foilbit la Infla
t io n dans les petits myfteres ; les eaux étoient réputées
facrées par un llatut de religion ,faoo infli-
tuto y dit Maxime de T y r . Les Turcs ont aujourd’hui
détourné les eaux de VIhjfus_, pour arrofer leurs jardins
,& on n’en voit prelque plus que le lit. (D .J .)
IL1TH Y E , f .’f. (Littérat. & Myth.) divinité de la
Fable; Ilithye fille de Junon & foeur d'Hébé, préfi-
doit comme fa mere aux aceouchemens; les femmes
dans les douleurs de l’enfantement, lui promet-
toient des facrifiçes, fi elles venoient à être heureu-
fement délivrées. Cette déeffe avoit à Rome un
temple, dans lequel on étoit obligé .de porter une
piece de petite monnoie, favoir à la naiffance & à
la mort de chaque perfonne. Servius Tullius établit
cet ufage, pour avoir toutes les années un dénombrement
exaft des naiffances & des morts des habitans
de Rome. On trouve la déeffe Ilithye fur les
médailles & dans les inferiptions antiques , fous le
titre de Juno Lucina, ou Amplement de Lucina. Cependant
les anciens ont fait mention de plufieurs Ili-
thyes 6c de plufieurs Lucines, parce qu’il y avoit plufieurs
déefl'es qui préfidoient aux enfantemens. Pofi
hac flithyas placato puerperas hoftiis , dit l’oracle de
la Sybille. On les appelloit indifféremment Lucinas,
Ilithyas, Genetyllidas, trois noms qui lignifient la
même fonftion. Le premier eft latin & vient de lu x ,
le jour. Les dçux autres font grecs : llithya vient de
«As ud-t/y, oriri ; & gènètyllis de ytvteic, nativité. (D .J .)
ILIVILIHU , f. m. (Ornithol. exot. ) nom que les
habitans des îles Philippines donnent à un oifeau fort
commun dans ce pays-là, & qui a toute l’encolure
de nos cailles, d’oîi vient que quelques écrivains
l’appellent cotitrnixparvula montana, petite caille de
montagne, parce qu’elle vit dans les lieux élevés ,
& qu’elle n’eft pas plus greffe qu’un moineau ; elle
eft remarquable par le joli mélange de la couleur de
fon pennage. (D . J.)
ILKUSCH, Ilcujjum, (Géog.) v ille royale de Pologne
au palatinat de Cracovie , remarquable par
fes mines d’argent, mêlées avec du plomb ; il eft
bon d’obferver i c i , que les mines ne font point entièrement
du droit royal en Pologne ; elles appartiennent
au feigneur fur la terre duquel elle fe rencontrent
, 6c ce feigneur en fait quelque reconnoif-
fance au roi ; mais les mines qui font fur les terres
d,e- la couronne, comme par exemple / celles à'Il*
kujch fe partagent entre le ro i, le palatin & l’évêque
; cette ville eft dans un pays ingrat, au pié d®
plufieurs montagnes., à fix lieues N. O. de Craco-
y iq. Long. 3 7 . 3 J . lat. J o , zG. (D . J.)
ILL l’, (Géograph.) riviere de France en Àlface ,
qu’elle traverfe prefque dans toute fa longueur ; elle
a fa fource à l’extrémité du Santgaw, 6c fe jette dans
le Rhin à deux lieues au-defious du pont de Straf-
bourg. WM arrofe plufieurs v illes, 6c reçoit dans fort
cours quelques rivières, confidérables ; fes déborde-
mens ne font guère moins nuifibles que ceux du
Rhin. (D . J.)
* ILLAPS, f. m. (Théolog.) efpece d’ext-afe contemplative
où l’on tombe par des degrés infenfibles
où les fens extérieurs s’aliènent, 6c où les organes
intérieurs s’échauffent, s’agitent, & mettent dans
un état fort tendre 6c fon doux, peu différent de celui
qui fuccede à la poffeflion d’une femme bien aimée
6c bien eftimée.
* ILL AI ION , i. f. (Logiqi Théolog.- Hiß.) ce terme
eft de l’école ; il vient du latin inferre\ conclure -
ainfi connoître par illation, c’eft la même chofe que
connoître par voie de conj'équence.
\Jillation eft dans la meflè mozarabiqwe ce que
nous appelions dans la nôtre la préface. Villation 6c
la préface avoient encore pour iynonymes les mots
contefiaùon 6c immolation.
Illation fe dit auffi pour retour ; ainfi l’illation de
faint Benoît, c’eft la fête du retour de fes reliques dé
l’églife de faint Agnan d’Orléans à Fleure.
ILLE, (Géog. ) petite ville de France dans Iç
Rouffillon, à quatre lieues de Perpignan ; elle eft jolie
& bien bâtie, dit Piganiol de la Force, tom. VI„
p. 44c). Long, z i 20. lut. 42. z 5. ( D . J .)
ILLÉGITIME, adj. ( Junjprud. ) fe dit de ce qui
eft contre la l o i , & oppofé à quelque chofe de légitime
, comme une eonjonôion illégitime, un enfant
illégitime. Voye^ Ba ta rd , LÉGITIME; ( A )
ILLESC A S , ( Géog. ) petite ville d’Efpagne, dans
la nouvelle Caftille , à fix lieues au fud de Madrid.
ILLIBÉRAL, adv. ( Gram. ) fervices bas, mécha-
rfiques. Voye^ Libéral.
* ILLICITE, adj. ( Gram. & Morale) qui eft défendu
par la loi. Une chofe illicite n’eft pas toujours
mauvaife en loi ; le défaut de prefque toutes les lé-
giilations, c’eft d’avoir multiplié le nombre des actions
illicites par la bifarrerie desdéfenles. On rend
les hommes méchans en les expoiànt à devenir in-
frafteurs ; & comment ne deviendront-ils pas infra-
fteurs, quand laloi leur défendra une chofe vers laquelle
l’impulfion confiante & invincible de la nature
les emporte fans ceffe ? Mais quand ils auront
foulé aux piés les lois d e là fociété, comment ref-
pefteront-ils celles de la nature; fur-tout s’il arrive
que l’ordre des devoirs, moraux foit renverfé , 8ç
que le préjugé leur faffe regarder comme des crimes
atroces, des aâions prefqu’indifférentes ? Par quel
motif celui qui fe regardera comme un facrilege, balancera
t-il à fe rendre menteur, voleur, calomniateur
? Le concubinage eft illicite chez les chrétiens ;
le trafic des armes eft illicite en pays étrangers ; il nç
faut pas fe défendre par des voies illicites. Heureux
celui qui fortiroit de ce monde fans avoir rien fait d’i/-
licite ! plus heureuxencore celui qui en fort fans avoir
rien fait de mal ! Eft i l , ou n’eû-il pas illicite de parler
contre une fuperftition confacrée parles lois?
Lorfque Cicéron écrivit fes livres fur la divination,
fit-il une aélion illicite ? Hobbes ne fera pas embar-
raffé de ma queftion ; mais ofera-t-on avouer les
principes d’Hobbes, fur-tout dans les contrées où la
puiffance temporelle eft diftinguée de la puiffance
lpirituelle }
I L L I F G N S O de los Zapotecas Sant.;