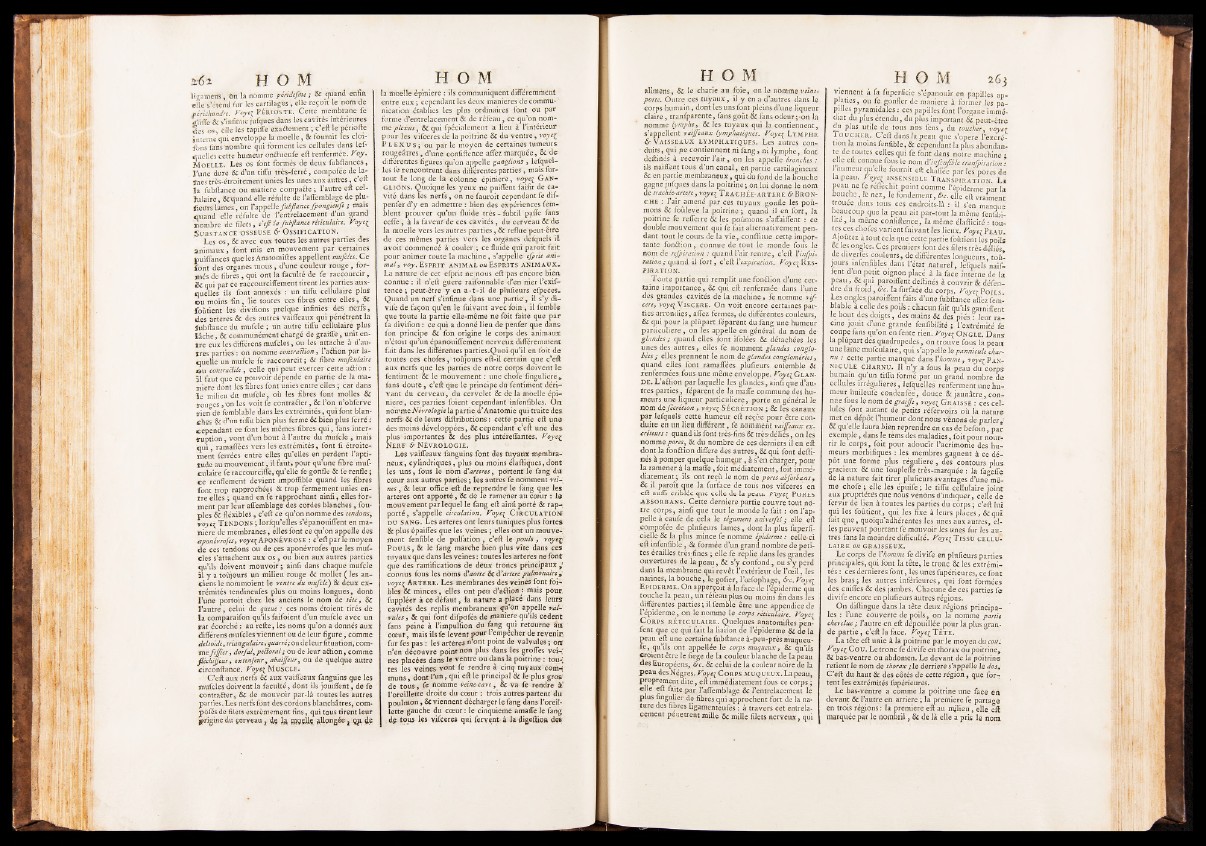
Ïigaïfiéiis, bft la nomme pcndefme ; & quand enfin
«Ue s’étend fur les cartilages-, elle reçpit le nom de
pcrichondre. P'oyK PÉRièiSTÈ. Cette membrane fe
sftiffe & «’infirme jufques dans les cavités intérieures
Ses os> elle les tapiffe exactement ;-c’eft le périofte
interne qui enveloppe la moelle, & fournit les cloi-
ibns fans nombre qui forment les cellules dans lef-
quelles cette humeur onûueufe eft renfermée. Voy. Moelle. Les os font formés de deux fubftances,
l ’une dure & d’un tiffu très-ferré, compofée de lames
très-étroitement unies les unes aux antres, c’ eft
la fubftance ou matière compacte ; l’autre eft cellulaire
, Snjuand elle réfulte de l’affemblage de piu-
Éeitrs lames, on l’appe\\e fubftance fpongieufe ; mais
quand elle réfulte -de l ’entrelacement d’un grand
Sombre de filets, ceftlafubftance réticulaire. Voye.i
^Substance osseuse & Ossific a t io n .
Les os, & avec eux toutes les autres parties des
animaux, font mis en mouvement par certaines
jiuiffances què-les Anatomiftes appellent mufclcs. Ce
font des organes mous, d’une couleur rouge, formés
de fibres , qui ont la faculté de fe raccourcir,
& qui pat ce raccourciffement tirent les parties auxquelles
ils font annexés : un tiffu cellulaire plus
ou moins -fin, lie toutes ces fibres entre elles, &
jfoûtient les divisions prefque infinies des nerfs,
des arteres & des autres vaiffeaux qui pénétrent la
fubftance du mufcle ; un autre tiffu cellulaire plus
Sache, & communément chargé de graiffe, unit entre
eux les différens mufcles, ou les attache à d’autres
parties : on nomme contraction, l’aâion par laquelle
un mufcle fe raccourcit ; & fibre mufculaire
o u contractile , celle qui-peut exercer cette aétion :
àl faut que ce pouvoir dépende en partie de la maniéré
dont les fibres font unies entre elles ; car dans
ïe milieu du mufcle, où les fibres font molles &
rouges ,'on les voit fe contraâer, & l’on n’obferve
xieirde femblable dans les extrémités, qui font blanches
& d’un tiffu bien plus ferme & bien plus ferré :
«rependant ce font les mérites fibres qui, fans interruption
, vont d’un bout à l ’autre du mufcle mais
q u i , ramaffées vers les extrémités, font fi étroitement
ferrées entre elles qu’elles en perdent l’aptitude
au mouvement, il faut, pour qu’une fibre muf-
culaire fe raccourciffe, qu’elle fe gonfle & fe renfle ;
c e renflement devient împoffible quand les fibres
font trop rapprochées & trop fermement unies entre
elles ; quand en fe rapprochant ainfi, elles forment
par leur affemblage des cordes blanches, fou-
pies & fléxibles , c’eft ce qu’on nomme des tendons,
voyei T en dons ; lorfqu’elles s’épanouiffent en maniéré
de membranes, elles font ce qu’on appelle des
aponévrofes, voyei Apo n év ro se : c’eft par le moyen
de ces tendons ou de ces aponévrofes que les mufcles
s’attachent aux os , ou bien aux autres parties
qu’ils doivent mouvoir ; ainfi dans chaque mufcle
àl y a toujours un milieu rouge & mollet ( les anciens
le nommoient le ventre du mufcle) & deux extrémités
tendineufes plus ou moins longues, dont
l ’une portoit chez les anciens le nom de tête, &
l ’autre, celui de queue : ces noms étoient tirés de
la comparaifon qu’ils faifoient d’un mufcle avec un
rat écorché : au refte, les noms qu’on a donnés aux
différens mufcles viennent ou de leur figure, comme
deltoïde, triangulaire, quarré; ou de leur fituatiofl, com-
tnefefjîer, dorfal,pectoral ; ou de leur action, comme
fiéchiffeur, extenfeur, abaijfeiir, ou de quelque autre
circonftance. Voyei Mu sc le.
C’eft aux nerfs & aux vaiffeaux fanguins que les
mufcles doivent la faculté, dont ils jouiffent, de fe
contracter,- & de mouvoir par-là toutes les autres
parties. Les nerfs font des côrdons blanchâtres, comparés
de filets extrêmement fins, qui tous tirent leur
origine du çerveau t 4§ 1% gWgüç, allongée a qji de
ïâ moelle ëpmiere : ils communiquent différertimënt
entre nicatioenu xé ;t acbelpieesn dlaens t plelsu sd eourxd imnaainreiésr éfso dnet cooum mpaur- ' fmoerm e d’entrelacement & de réfeau, ce qu’on nom-, plexus, & qui Spécialement a lieu à l’intérieur
pour les vifeeres de la poitrine & du ventre, voyeç ■
P l e x u s ; ou par le moyen de certaines tumeurs
rdoifufgéreeânttreess f, idg’uurnees qcuo’nofnif atepnpceel laef fez marquée, & de ganglions , lefquel-
lteosu fte lree nlocnogn tdreen lta d acnoslo dninftee reénptiens ipearèr,t ies, -mais fur- voyei G anvgiltéio
dnasn.s Q leuso inqeuref sl,e so ny enuex f anuer pouiti fcfeepnte nfadiafinrt dfee dciaf
penfér d’y en admettre : bien des expériences fem-
bcleefnfet , pàr olau fvaevre uqru'd’ùen cfelsu icdaev ittréèss ,- dfuub ctielr vpeaaffue &fa dnes la moelle vers les autres parties, & reflue peut-être
de ces mêmes parties vers les organes defquels il
ap voouirt acnoimmmere tnocuét eà l ac omualecrh;;i ncee, fslu’aipdep eqlulei paroît fait efprit anim
a l, voy. Es p r it a n im a l ou Espr it s a n im a u x . Lcoan nnauteu r:e i ld en ’ceeftt geufperriet nraei;fnoonunsa belfet pda’esn e nncieorr el’ ebxieifn- tence ; peut-être y en a-t-il de plufieurs efpeces.
Qviufea ndde ufanç onne rqf us’’einnf ilneu efu divaanns tu anvee cp afortinie ,, iill fse’my btflie-
fqau ed itvoiufitoen l:a cpea qrtuiei ae ldleo-nmnêem liee un ed ef opièt nffaeitre q quuee d panasr
fno’ént opirt iqnuci’upne é&pa nfoonu ifofreimgiennet lnee rcvoerupxs ddiefsf éarenmimmaeunxt
fait dans les différentes parties.Quoi qu’il en foit de
taouuxt ense rcfess qcuheo lfeess ,p atrotuiejos udres nefott-riel cceorrtpasin d oquivee nc’te lfet fentiment & le mouvement : une chofe finguliere,
fans doute, c’eft que le principe du fentirrient dérinvaiènrte
,d uce sc epravretiaeus , fodiue ncte rcveepleent d&an td ien lfae nmfiobellelse. éÜpin
nomme Névrologie la partie d’Anatomie qui traite des
nerfs & de leurs diftributions : cette partie eft une?
dpeluss m iominpso drtéavnetelos p&pé edse,s & p lcuesp einntdeafneft fcan’etfets u. ne des Voye£
Ne r f & Né v r o l o g ie . .
Les vaiffeaux fahguins font des tuyaux membraneux,
cylindriques, plus Ou moins élaftiques, dont
les uns, fous le nom d1 arteres, pdrtent le fang du
coeur aux autres parties ; les autres fe nomment veines
, & leur office eft de reprendre le fàng que les
arteres ont apporté, & de le ramener au coeur : les
mouvement par lequel le fang eft airffi porté & rapporté,
s’appelle circulation. Voyei C irculatio ns
d u sa n g . Les arteres ont leurs tuniques plus fortes
& plus épaiffes que les veines ; elles ont un mauve-»
ment fenfible de pulfation, c’eft le pouls, voyeç
P ouls , & le fang marche bien plus vite dans ces
tuyaux que dans les veines : toutes les arteres ne font
que des Ramifications de deux trorics principaux
Connus fous les noms $ aorte 8/tà’artere pulmonaire
voyei Ar t e r e . Les membranes des veinés font foi-
bles & minces, elles ont peu d’aétion : mais pour,
fuppléer à ce défaut, la nature a placé dans leurs
cavités des replis membraneux qu’on appelle valvules,
& qui font difpofés de maniéré qu’ils cedent
fans peine à l’impulfion du fang qui retourne ait
coeur, mais ilsfe lèvent pour l'empêchér de revenir
fur fes pas : les arteres fl point de valvules ; oit
n’en découvre point non plus dans les groffes vei-'
nés placées dans te ventre ou dans la poitrine : tou-^
tes les veines vont fe rendre à cinq tuyaux com-;
muns, dont l’un, qui eft le principal & le plus gros
de tou s, fe nomme veine-cave, & va fe rendre à ’
l’oreillette droite du coeur : trois autres partent du
poulmon, ôc viennent décharger le fang dans l’oreillette
gauche du coeur : le cinquième amaffe le fang
d? tous les vifeeres qui fervent- à 1a digeftfon des
alimens, 8c le .charie au foie, on le nomme veine-
p o r teOutre ces tuyaux, il y en a d’autres dans le
corps humain, dont les uns font pleins d’une liqueur
claire, tranfparente, fans goût & fans odeur ;*on la
nomme tymphe, & les tuyaux qui la contiennent,
s’appellent vaiffeaux lymphatiques. Voyei Lym ph e
& Vaissea u x l y m ph a t iq u e s . Les autres con-
■ duirs, qui pe contiennent ni fang, ni lymphe, font
deftinés à recevoir l’air, on les appelle bronches :
ils naiffent tous d’un canal, en partie cartilagipeux
& en partie membraneux, qui dû fond de la bouche
gagne jufques dans la poitrine ; on ju i donne le nom
de trackèe-artere, voyei TRACHEE-ARTERE & Br o N-’
c h e : l’air amené par ces tuyaux,gonfle les poumons
& fouleve la poitrine ; quand il en fort, la
poitrine fe refferre & les poumons s’affaiffent : ce
double mouvement qui fe fait alternativement pendant
tout le cours de la v ie , conftitue cette importante
fonâion, , connue de tout le monde fous le
nom de refpiration : quand l’air rentre, c’eft Vinfpi-
ration; quand il fort, c’eft Y expiration. Voyei R esp
ir a t io n .
Toute partie qui remplit une fonûion d’une certaine
importance, & qui,eft renfermée dans l’une
des grandes cavités de la machine , fe nomme vif-
cere, voye^ V isc e r e . On voit encore certaines parties
arrondies, affez fermes, de différentes couleurs,
& qui pour la plupart féparent du fang une humeur
particulière, on les appelle en général du nom de-
glandes ; quand elles font ifolées & détachées les
unes des autres, elles fe nomment glandes conglo-
bées ; elles prennent le nom de glandes conglomérées,
quand elles font ramaffées plufieurs enfemble &
renfermées fous une même enveloppe. Voyei Gland
e . L ’aâion par laquelle les glandes, ainfi que d’autres
parties, féparent de la maffe commune des humeurs
une liqueur particulière, porte en général le
nom de fécrétion, voyei Sé c r é t io n ; & les canaux
par lefquels cette humeur eft reçue pour être conduite
en un lieu différent, fe nomment vaijfeaux excréteurs
: quand ils font très-fins & très-déliés, on les
nomme pores, & du nombre dé ces derniers il en eft
dont la fonttion différé des autres, & qui font deftinés
à pomper quelque humqpr, à s’en charger, pour
la ramener à la maffe, foit médiatement, foit immédiatement;
ils ont reçu le nom de pores abforbans,
& il paroît que la furface de tous nos vifeeres en
eft auffi criblée que celle de la peau. Voyei Pores
a b so r b a n s. Cette derniere partie couvre tout notre
corps, ainfi que tout le monde le fait : on l’appelle
à caufe de cela- le tégument univerfel ; elle eft
compofée de plufieurs lames, dont la plus fuperfî-
cielle & la plus. mince fe nomme épiderme : celle-ci
eft infenfible, & formée d’un grand nombre de petites
écaillés très-fines ; elle fe replie dans les grandes
ouvertures de la peau, & s’y confond, ou s’y perd
dans la membrane qui revêt l’extérieur de l’oe il, les
narines, la bouche, le gofier, l ’oefophage, &c. Voyei
E pid e rm e . On apperçoit à la face de l’épiderme qui
touche la peau, un réfeau plus ou moins fin dans les
différentes parties ; il femble être une appendice de
l’épiderme, on le nomme le corps réticulaire. Voyei
C orps r é t ic u l a ir e . Quelques anatomiftes pen-
fent que ce qui fait la liaifon de l’épiderme & de la
peau eft une certaine fubftance à-peu-près niuqueu-
fe , qu’ils ont appellée le corps muqueux, & qu’ils }
croient être le fiege de la couleur blanche de la peau
des Européens, &c. & celui de la couleur noire de la
peau des Nègres. Voyei C orps mu q u eu x . La peau,
proprement d ite, eft immédiatement fous ce corps ;
elle eft faite par l’^ffemblage & l’entrelacement le
plus fingulier de fibres qui approchent fort de la nature
des fibres ligamenteufes : à travers cet entrelacement
pénétrent mille mille filets nerveux, qui
viennent a fa fuperficie s’épanouir en papilles ap-
; P it ié s , ou fe gonfler de maniéré à former les papilles
pyramidales : ces papilles font l’organe immédiat
du plus étendu, du plus important & peut-être
du plus utile de tous nos fens , du toucher, voyei
T o u ch er. C ’eft dans la peau que s’opère l’excrétion
la moins fenfible, & cependant la plus abondante
de toutes celles qui fe font dans notre machine *
elle eft connue fous le nom A'infenfible transpiration:
, Humeur qu’elle fournit eft chaffée par les pores de
la peau. Voyei insensible T ranspiration. La
peau ne fe réfléchit pomt comme l’épiderme par la
bouche, le nez, le fondement, &c. elle eft vraiment
trouee,dans tous ces endroits-là : il s’en manqué
beaucoup que la peau ait par-tout la même fenfibi-
hte, la même confiftence, la même élaftic itétou tes
ces chofes varient fuivant les lieux. Voyei Peau.
Ajoûtez' à;out cela que cette partie foutient les poils
& les ongles. Ces premiers font des filets très-déliés,
de diverles couleurs, de différentes longueurs, toujours
infenfibles dans l’état naturel, lefquels naif-
fçnt d’un petit oignon placé à la face interne de la
peau, & qui paroiffent deftinés à couvrir & défendre
du froid,. &c. la furface du corps. Voyei Po il s .
Les ongles paroiffent fâits d’une fubftance affez fem-
blable à celle des poils : chacun fait qu’ils garniffent
le bout des doigts, des mains & des pies : leur racine
jouit d’une grande fenfibilité ; l ’extrémité fe
coupe fans qu’on en fente rien. Voyei Ongle. Dans
la plupart des quadrupèdes, on trouve fous la peau
une lame mufculaire, qui s’appelle le pannicule charnu
: cette partie manque dans Yhomme, voye^ Pannicule
charnu, Il n’y a fous la peau du corps
humain qu’un tiffu formé par un grand nombre de
cellules irrégulières, iefquelles renferment une humeur
huileulè condenfée, douce & jaunâtre, connue
fous le nom dz graiffe, voyei G r a is s e : ces cellules
font autant de petits réfervqirs où la nature
met en dépôt l’humeur dont nous venons de parler J
& qu’elle faura bien reprendre en cas de befoin, par
exemple, dans le tèms des maladies, foit pour nourrir
le corps, foit pour adoucir l’acrimonie des humeurs
morbifiques : les membres gagnent à ce dépôt
une forme plus régulière, des contours plus
gracieux & une foupleffe très-marquée : la fageffe
de la nature fait tirer plufieurs avantages d’une même
chofe; elle les épuife; le tiffu cellulaire joint
aux propriétés que nous venons d’indiquer, celle de
fervir de lien à toutes les parties du corps ; c’eft lui
qui les foutient, qui les fixe à leurs places, &qut
fait que, quoiqu’adhérentes les unes aux autres, elles
peuvent pourtant fe mouvoir les unes fur les autres
fans la moindre difficulté. Voyei T issu cellulaire
ou graisseux.
Le corps de l’homme fe divife en plufieurs parties
principales, qui font la tête, le tronc & les extrémités
: ces dernieres font, les unes fupérieures, ce font
les bras ; les autres inférieures, qui font formées
des cuiffes & des jambes. Chacune de ces parties fe
divife encore en plufieurs autres régions. lesO : nl ’duinfeti ncgouuev dearntes dlae tpêoteil sd,e uoxn rléag inoonms mprei npcaiprtaie
dchee vpealuret i;e l,’ acu’etrfet lean f aecfte .d épouillée pour la plus granVoyei
Tête.
La tête eft unie à la poitrine par le moyen du coüi
Vjyei C o u . Le tronc fe divife en thorax ou poitrine,
& bas-ventre ou abdomen. L e devant de la poitrine
retient le nom de thorax ; le derrière s’appelle le dosj
C ’eft du,haut & des côtés de cette région, que fartent
les extrémités fupérieures. devLaen bt a&s- vl’eanuttrree ean caormriméreé l;a l ap opirterminieè ruen fee fpaacreta egne
en trois régions : la première eft au milieu, elle eft
marquée par le nombril, 8c de là elle a pris le nom