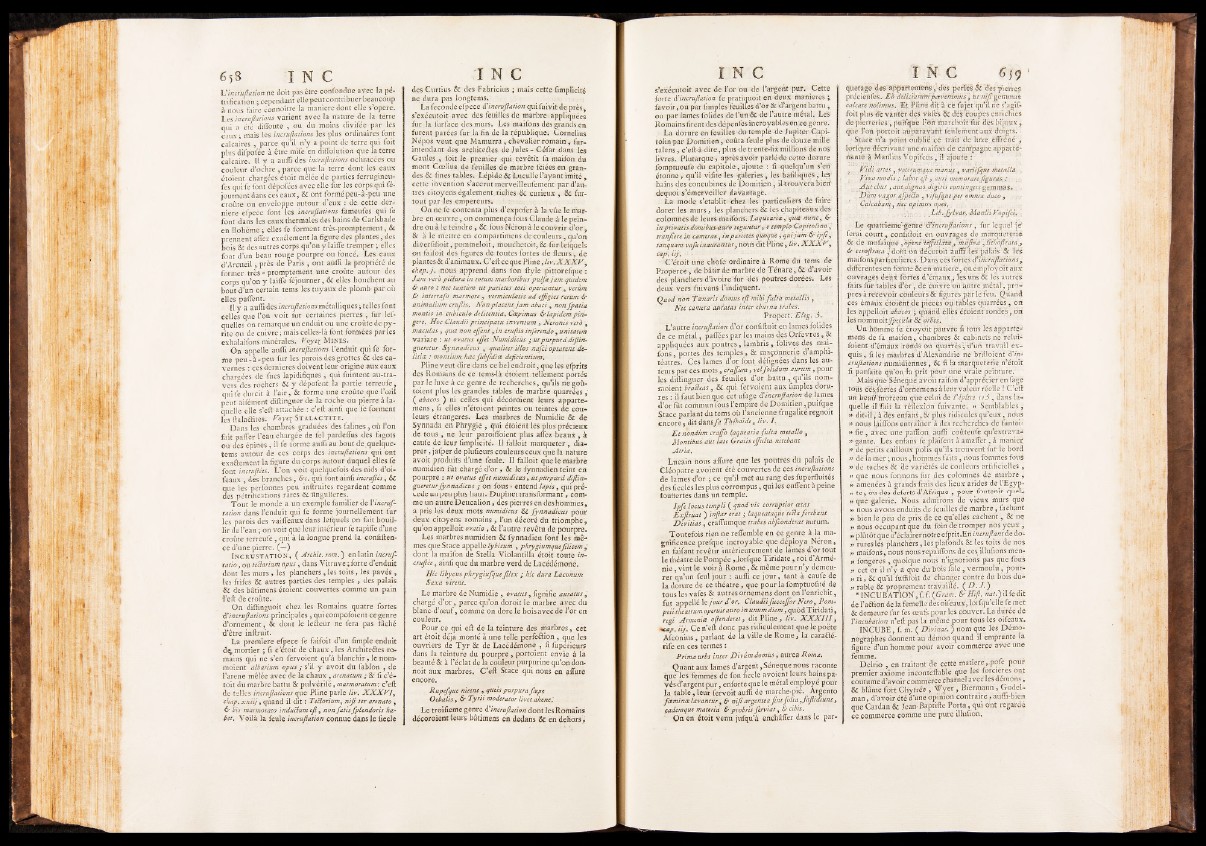
L’incruftaùon ne doit pas être confondue avec la pétrification
; cependant elle peut contribuer beaucoup
à nous faire connoître la maniéré dont elle s’opère.
Les incruftations varient avec la nature d e . la terre
ciui a été diffoute , ou du moins divifée par les
eaux ; mais les incruftations les plus ordinaires font
calcaires , parce qu’il n’y a point de terre qui foit
plus dil'pofée à être mife en diffolution que la terre
calcaire. 11 y a auffi des incruftations ochracées ou
couleur d’oehre , parce que la terre dont les eaux
étoient chargées étoit mêlée de parties ferrugineu-
fes qui fe font dépofées avec elle fur les corps qui fér
journent dans ces eaux, & ont formé peu-à-peu une
croûte ou enveloppe autour d eux : dé. cette dernière
efpeée font les incruftations fameufes qui fe
font dans les eaux thermales des bains de Carlsbade
en Bohème ; elles fe forment très-promptement, &
prennent affez exactement la figure des plantes, des
bois & des autres corps qu’on y laiffe tremper ; elles
font d’un beau rouge pourpre ou foncé. Les eaux
d’Arcueil, près de Paris , ont aùffi la propriété de
former très - promptement une croûte autour des
corps qu’on y laiffe féjourner, & elles bouchent au
Bout d’un certain tems les tuyaux de plomb par.où
elles paffent.
Il y a auffi des incruftations métalliques ; telles font
celles que l’on voit lur certaines pierres-, fur lef-
quelles on remarque un enduit ou une croûte de pyrite
ou de cuivre ; mais celles-là font formées parles
exhalaifons minérales. Voye{ Mines. ^
On appelle auffi incruftations l’enduit qui fe forme
peu-à-peu fur les parois des grottes fk. des cavernes
: ces dernieres doivent leur origine aux eaux
chargées de flics lapidifiques , qui fuintent au-tra-
vers clés rochers & y dépofent la partie terreufe,
qui fe durcit à l’air , & forme une croûte que l’oeil
peut aifément diftinguer de la roche ou pierre à laquelle
elle s’eft'attachée.: c’eft ainfi que 'fe forment
les ftalaâitès1. St a l a c t it e .
Dans les chambres graduées des falines, où l’on
fait paffer l’eau chargée de fel pardeffus des fagots
ou des épines , il fe forme auffi au bout de quelque*
tems autour de ces corps des incruftations qui ont
éxaftement la figure du corps autour duquel elles fe
font incruftics. L’on voit quelquefois des nids d’oi-
feaux , des branches, &c. qui font ainfi incrufl.es, &
que les perfonnes peu inftruites regardent comme
des pétrifications rares & fingulieres.
Tout le monde a un exemple familier de Vincruf-
tation dans l’enduit qui fe forme journellement fur
les parois des vaiffeaux dans lefquels on fait bouillir
de l’eau ; on voit que leur intérieur fe tapiffe d’une
croûte terreufe , qui à la longue prend la confidence
d’une pierre. (—) . .
In c r u s t a t io n , ( Archit. rom. ) en latin incruf
tatio y ou iectorium opus, dans Vitru ve ; forte d’enduit
dont les murs , les planchers , les toits, les pavés ,
les frifes & autres parties des temples , des palais
& des bâtimens étoient couvertes comme un pain
•l’eft de croûte.
On diftinguoit chez les Romains quatre fortes
d’incruftations principales , quicompofoient ce genre
d’ornement, & dont le lefteur ne fera pas fâché
d’être inftruit.
La première efpece fe faifoit d’un fimple enduit
d t mortier ; fi c ’étoit de chaux, les Architeâes romains
qui ne s’en fervoient qu’à blanchir, le nom-
moient albarium opus ; s’il y avoit du fablon de
l’arene mêlée avec de la chaux , arenatum ; & fi c’étoit
du marbre battu & pulvérifé, marmoratum : c’eft
de telles incruftations que Pline parle liv. J O 'X V I f
chap. x x iij, quand il dit : Tectoriuniy niji ter arenato ,
& bis marmorato inductum eft, non fatis fplendoris ha-
bet. Voilà la feule incruflation connue dans le fie de
des Curtius & des Fabrieius ; mais cette fimplicité
ne dura pas longtems.
La fécondé efpece incruflation qui fuivit de près ,
s’exécutoit avec des feuilles de marbre, appliquées
fur la furface des. murs, Les maifons des grands en
furent parées fur,la fin de la république. Cornélius
Népos veut que Mamurra , chevalier romain'^ fur-
intendant des arçhiteftes de Jules - Céfar dans les
Gaules., foit le premier qui,revêtît fa maifon du
mont Coelius de feuilles de marbre fciées en grandes
& fines tables. Lépidè & Luculle l’ayant imité ,
cette invention s’accrut merveilleufement par d’aii-
tres citoyens également riches & curieux , & fur-
tout par les empereurs.
On ne fe contenta plus d’expofer à la vite le marbre
en oeuvre, on commença lbùs Claude à le peindre
ou à le teindre , & fous Néron à le couvrir d’or ,
& à le mettre en compartimens de couleurs , qu’on
diVerfifioit,pommeloit, mouchetoit,& furlefqüeis
on faifoit des figures de toutes fortes de fleurs i, de
plantes & d’animaux. C ’eft Ce que Pline, Uv. X X X V 9
chap. j . nous apprend dans Ion ftyle pittorefque :
Jam vero piclura in totum marboribus pulj’a jam quidern
& auro : nec tantum Ut parûtes toti optriantur., verùnt
.& interrafo marmore, vermiculatis ad effigies rerum &
anima Hum çruftis. Non placent jam abaci , non fpatia
montis in cubïculo delitentia. Coepimus & lapidem pin-
gere. Hoc Claudii principatu inventum , Neronisverb ,
maculas , quee non efj'etit , in cruftis inferetido, unitatetn
variare : ut ovatus effet Numidicùs ; ut purpura diftiru
gueretur Synnadicus -, qu aliter il Los nafci op tarent de-
lititz : montium. hcec.fubfidioe deficientium.-
Pline veut dire dans ce bel endroit, que les êfprits
des Romains de ce tems-là étoient. tellement portés
par le luxé à ce genre de recherches, qu’ils ne goû*-
toient plus les grandes tables de marbre quarrées ,'
( abacos ) ni celles qui déedroient leurs apparte-
mens, fi elles n’étoient peintes ou teintes de couleurs
étrangères. Les marbres de Numidie & de
Synnada en Phrygie , qui étoient les plus précieux
de tous , ne leur pàroifloient plus allez beaux, à
eaufe de leur fimplicité. Il falloit marqueter, dia-
prer, jafper .de plufieurs couleurs ceux que la nature
avoit produits d’une feule. II falloit que le marbre
numidien fût chargé d’or , & le lynnadien teint en
pourpre : ut ovatus effet numidïcus, ut purpura diftin-
guereturfynnadicus ; on fous - entend lapis, qui précédé
un peu plus haut. Dupinettransformant, comme
un autre Deucalion, des pierres en deshômmes,
a pris lés deux mots numidicus & fynnadicus pour
deux citoyens romains , l’un décoré du triomphe ,
qu’on appelloit ovatio, & l’autre revêtu de pourpre.
Les marbres numidien & fynnadien font les mêmes
queStace appelle lybicum , phrygiumqueJîlicemj
dont la maifon de Stella Violantilla étoit toute in-
cruftée, ainfi que du marbre verd de Lacédémone.
Hîc libyeus phrygiufque Jilex ; hîc dura Làcohutn
Saxa virent.
Le marbre de Numidié , ovatus, fignifîe auratus,'
chargé d’o r , parce qu’on dorqit le marbre avec du
blanc-d’oe u f, comme on dore le boisaveede l’or en
couleur.
Pour ce qui eft de la teinture des marbres, cet
art étoit déjà monté à une telle perfeûion , que les
ouvriers de T y r & de Lacédémone , li lupéfieurs
dans la teinture du pourpre, portoient envie à la
beauté & à l’éclat de la couleur purpurine qu’on don-
noit aux marbres. C ’eft Stâce qui nous en affure
encore.
Rupefque nitent, quels purpura fce.pt
Oebalis, & Tyrii moderator livet ahene '. .
Le troifieme genre d’incruflation dont les Romains
décoroient leurs bâtimens en dedans U en dehors ,'
s’exécutoit avec de l’or ou de l’argent put. Cette
forte d’'incruflation fe pratiquoit en deux maniérés ;
fa voir ,oupar fimples feuilles d’o r & d’argent battu,
ou par laines folides de fUn & de l’autre métal. Lés
Romains firent des dépenfës incroyables ëhïeigènre.
La dorure en feuilles du-templc Jie Jupker Capi-
tolinpar Domitien, coûta feule plus de douze mille
talens, c’eft-à-dire, plus de trentè-fix millions dë nos'
livres. Plutarque » aprè§ avoir patlé de cét-te dorure
fomptueuïe du capitole, ajoute : fi quelqu’un s’eii
étonne, qu’il vifite lés galeries, les feàftliqüës , les-
bains des concubines de Domitien , il trouvera bierr
dequoi s’émerveiller davantage. 1
La mode s’établit chez les particuliers dé faire
dprer les murs , les planchers & les chapiteaux des-
colomnesdë leurs ihaïfdriSi 'Laquearia , quà mine, &
inprivatis domibus auro tegurttur , e templo ‘Capitolino,
tranftere ih caméras, in parûtes qUoqué i quijkmdb- ïpft
tanquam vafainaurantur} nOits dit Pline y liv. X X X V ,
càp 't -i ij '. '■ ■
C ’étoit line chofë Ordinàire à Rome du tèrns de
Properce, de bâtir de matbre de Ténare, & d’avoir
des planchers d’ivoire fur des poutres dorées, Les
deux vers fuivans l’indiquent.
Quod lion Tanaris dô'mtis eft mïhi fultamêt'dltis ,
Nec caméra aftratas intir eburhà trdbes.
Propërt'.:Elegi 3.
L’autre incruflation d’or confiftoit en lames folides
de ce métal, paffées par les mains des Orfèvres ,&
appliquées aux poutres, lambris , folives des mai-
fpns, portes des temples, & maçonnerie d’amphi-
téatres. Ces lames d’or font défignées dans les auteurs
par ces mots, craffum, vtlfolidum aurum, pour
les diftinguer des feuilles d’or, .battu , qu’ils nom-
xnoient bracleas , & qui fervoient aux fimples dorures
: il faut bien que çet ufage à*incruflation de lanres
d’or fût commun fous l’empire de Domitien ,puifque
Stace parlant du tems où l’ancienne frugalité regnoit
encore, dit dans fa Thébdide, Uv. I.
E t nondum craffo laqiiearia fultà métallo ,
Montibus aut làte Gratis tffulta nitebant
Àtria.
Lucain nous affure que les poutres du palais de
Cléopâtre avoient été couvertes de cés incruftations
de lames d’or.; ce qu’il met au rang des fuperfluités
des fiecles les plus corrompus, qui les euffent à peine
fouffertes dans un temple.
Jpfe locus iempli ( quod vis corrùptior atlas
Exftriiat ) inflar erat ; laqueataqùe tecta fereb'ant
Divitias, craffumque trabes àbfconderat aurum.
Toutefois tien rie reffemble en ce genre à la magnificence
prefque incroyable que déploya Néron,
en faifant revêtir intérieurement de lames d’or tout
le théâtre de Pompée ,Jorfque Tiridate, roi d’Arménie
, vint le voir à Rome, & même pour n’y demeurer
qu’un feul jour ; auffi ce jour, tant à caufe de
la dorure dé ce théâtre, que pour la fomptuofité de
tous les vafes & autres ornemens dont on l’enrichit,
fut appellé le jour d'or. Claudii fucceffor Nero, Pom-
peii theàtrum operuit auro in unum diem, quôd Tiridati,
rt«i Armenia oftenderet, dit Pline , liv. X X X I I I ,
*cap. iij. Ce n’ eft donc pas ridiculement que le poète
Afconius, parlant de la v ille de Rome, la caraélé-
rife en ces termes :
Prima urbs inter Divum domüs, atîreâ Roma.
Quant aux lames d’argent, Séneque nous raconte
que les femmes de fon fiecle avoient leurs bains pavés
d’argent pur, enforte que le métal employé pour
la table, leur fervoit aufli de marche-pié. Argento
fcemince lavantur, & niji argenteaflnt folia yfaftidiunt,
eademque materia & probris ferviat, & cibis.
On en étoit yenu jufqu’à enchâffer dans le parquetàge
des ‘âppar'terrièriS ,-dès perles $c des pierres
préeieûfes. E-b ddicftamtit'pervcrtimus'l ut'riijigemmas
calcare hbliriitts. 'E t Pline éitû ce fujet'qu’il ne S’agif-
foit plns d'è vanter des vàfeis & «Les coùp'es enrichies
dé pier'fëHëS', rkiïfque l’ën' fnarclïtrtt fur des bij'QUX ,
que 'Poli portoit .aûpà'fayhùtfeüremeût'anx doigts. •
■ Stfié'ë' u ’a point oublié ce trait de lirice effréné ,
tqrfqu'ê décrivant tirié maifon de cafripaghe àp'p'àttê-
riàatë -à Ma'rilitis V opîfcûs, il ajouté : '
. ffidi a r te sy eteiqqtque niants yyariijqüe met alla ,
. f iy d .modis.:- labpf eji ,, auri. memorarefiguras, :
. A n t ebur , autflUgnas digitis cpntingçri gemmâs» ,
E)îcm vagqr. afpictii, vijiifqiue:ptr omnia duco , ,•
Çqlcaban] f nec opimus opes.
. ; Lib. jyiydrr'ManliiVopifci* |
• Le quatriemegëftrëld’Ï7zcr«/?<i/i&72^ , fiir lequel jd
ferai court, confiftoit en Quv.rages de marqueterie
& dé riiofaïquè y6pïrdP^lliküfrhüftva rlïHidftratam,
& cerbflrata ,' doifftbri d'éçOroit 'auffi.les pilais les
maifons p^ticuBères. Datis cés fôft'es cViHcfàftatibns,
différentes en forme & matiefé, oh ëm plôÿoit aux
ouvragés dehx fôrtes d’efriarix i lçs û’ris & lés autres
faits fur tablés d’or , de cmyre ‘on autre m étal, propres
à rééèyôir <cpulëü’rs & figiirës'jpkr lé feu. Quand
ces émaux étoient de piéçë.s ofi.tàbi.es qûarrëés, on
les appelloit abdebs ; qiiàn'd ëllfes 'étoient rondes, on
les üommGttypcèülâ Scjorbès.
Un homme f é croyOit pauvre fi fous les âpparte*
mens de fa.maifon, chambres & cqbinetsrne felu'i^
foient- d’ëmàiix irortds-ovi qùarresyd’un travail exquis,
fi les marbtes d’Alexaridriè ne brîiloiènt d’iji*
crujidtïons numidiérines, & fi la marqueterie n’étoit
fi parfaite qü’bn Jri prît p'du'r une vraie peinture.
Mais qùè Sëne.qüë.aVoit faifôn d’apprécier en fage
tous t':éSr|bf très, d’or tiémens à leur valeur réelle ! C ’éft
un bèan fabrceau que celui de l'épifre. n 3 , dans la-
quelié if Tait la réfleiion fuivanté. « Semblables ,
» dit-il, à des en.fahé, & plus ridicules qu’eu x, nous
» nous laiffons entraîner à des recherches de Fantai-
» fie , avec une paffion. auffi coûteufe qu’extrava-
»' gante. Les enfans fe plàifen't à amaffer, à manier
» dé petits cailloux pdhs qu’ ils troùvent fur le bord
» dé la mer ; nous /hommes faits ? nous fommes fous
»'de.taches & dé variétés de couleurs artificielles ,
» que nous formons fur .des colomnes de frçarbre ,
>> amenées à grands frais des lieux arides de l’Egyp-
» te , du des deferts d’Afrique , pour foutenîr quel-
» que galerie. Nous admirons de vieux murs que
» nous avons enduits de feuilles de marbre, fachant
» bien lé pë’u de prix de ce qu’elles cachent, & ne
» nous occupant que du foin de tromper nos yeux ,
» plutôt que d’éclairer notre efprit.En incruftantàe do*
» rureslés planchers, les plafonds & les toits de nos
» maifons, nous nous répaiffons de ces illufions men-*
» fongerés , quoique nous ft’ ignorions pas que fous
» cet' or il n’y a que du bois fa le , vermoulu, pour-
>> r i , & qu’il fuffifoit de changer contré du bois du-
» rable & proprement travaillé. (L?. /.)'.
* INCU B ATION, C f. {Gram. & Hift. natXiUe dit
de l’aftion de la femelle dés oifèaux, lorfqu’elle fe met
i & demeure fur fes oeufs pour,les couver. La duree dé
Vincubation n’eft pas la niêirié pour tous les oifeaux.
INCUBE, f. m. ( Divinat,.) nom que les Démo-
; nographes donnent au démon quand il emprunte la
figure d’un homme pour avoir commerce avec une
femme. .
Delrio , en traitai^ de cette matière,.pôle pour
premier axiome inconteftable que les forcieres ont
coutume d’avoir commerce charnel avec les démons ,
& blârne fort Chytrée , Wyer , Biermann, Godel-
man, d’avoir été d’une opinion contraire, auffi-bien
que Cardan & Jean-Baptifte Porta, qui ont regardé,
ce.commerce comme une pure illufion.