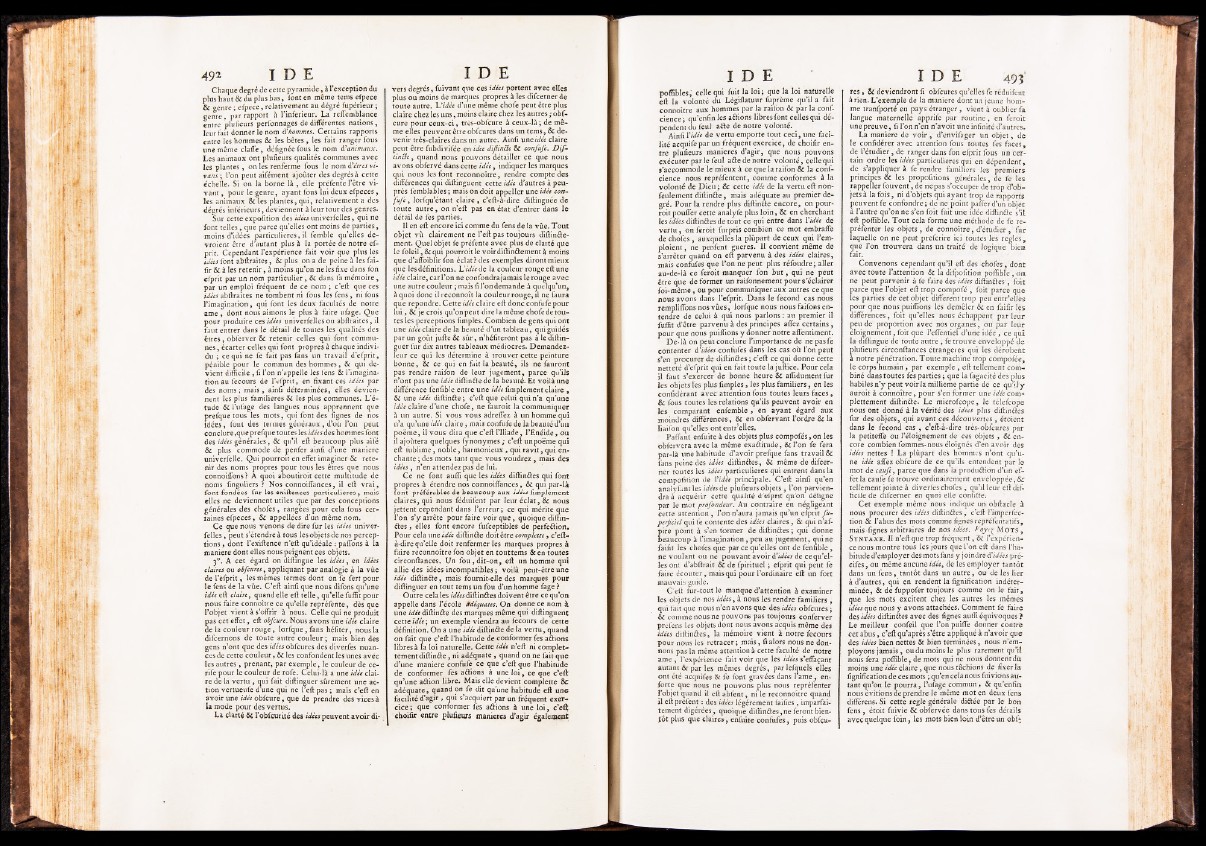
Chaque degré de cette pyramide, à l’exception du
plus haut & du plus bas , font en même tems efpece
& genre ; efpece, relativement au degré füpérieur ;
genre, par rapport à l’inférieur. La relTemblance
entre plufieurs perfonnages de différentes nations,
leur fait donner le nom d'hommes. Certains rapports
entre les hommes & les bêtes , les fait ranger fous
une même claffe, défignée fous le nom d'animaux.
Les animaux ont plufieurs qualités communes avec
les plantes , on les renferme fous le nom d'êtres vi-
vans ; l’on peut aifément ajouter des degrés à cette
échelle. Si on la borne là , elle préfente l’être v ivant
, pour le genre, ayant fous lui deux efpeces,
les animaux & les plantes, qui, relativement a des
dégrés inférieurs, deviennent à leur tour des genres.
Sur cette expofition des idées univerfelles, qui ne
font telles, que parce qu’elles ont moins de parties,
moins d’idées particulières, il femble qu’elles devraient
être d’autant plus à la portée de notre ef-
prit. Cependant l’expérience fait voir que plus les
idées font abftraites, & plus on a de peine à les fai-
fir &c à les retenir, à moins qu’on ne les fixe dans fon
efprit par un nom particulier, & dans fa mémoire,
par un emploi fréquent de ce nom ; c ’eft que ces
idées abftraites ne tombent ni fous les fens, ni fous
l’imagination, qui font les deux facultés de notre
ame , dont nous aimons le plus à faire ufage. Que
pour produire ces idées univerfelles ou abftraites, il
faut entrer dans le détail de toutes les qualités des
êtres, obferver & retenir celles qui font communes
, écarter celles qui font propres à chaque individu
; ce qui ne fe fait pas fans un travail d’efprit,
pénible pour le commun des hommes, & qui devient
difficile , fi l’on n’appelle les fens & l’imagination
au fecours de l’efprit, en fixant ces idées par
des noms ; mais , ainfi déterminées, elles deviennent
les plus familières & les plus communes. L’étude
& l’ufage des langues nous apprennent que
prefque tous les mots, qui font des lignes de nos
idées, font des termes généraux, d’où l’on peut
conclure ,que prefque toutes les idées des hommes font
des idées générales, & qu’il eft beaucoup plus aifé
& plus commode de penfer ainfi d’une maniéré
univerfelle. Qui pourrait en effet imaginer & retenir
des noms propres pour tous les êtres que nous
connoiffons? A quoi aboutiroit cette multitude de
noms finguliers ? Nos connoiffances, il eft v ra i,
font fondées fur les exiftences particulières, mais
elles ne deviennent utiles que par des conceptions
générales des chofes, rangées pour cela fous certaines
efpeces, & appellées d’un même nom.
Ce que nous venons de dire fur les idées univer-
felles, peut s’étendre à tous les objets de nos perceptions
, dont l’exiftence n’eft qu’idéale : paffons à la
maniéré dont elles nous peignent ces objets.
3°. A cet égard on diftingue les idées, en idées
claires ou objcures, appliquant par analogie à la vue
de l’èfprit, les mêmes termes dont on fe fert pour
le fens de la vue. C’eft ainfi que nous difons qu’une
idée eft claire, quand elle eft telle, qu’elle fuffit pour
nous faire connoître ce qu’elle repréfente, dès que
l’objet vient à s’offrir à nous. Celle qui ne produit
pas cet effet, eft obfcurc. Nous avons une idée claire
delà couleur rouge, lorfque,fans héfiter, nous la
difcernons de toute autre couleur ; mais bien des
gens n’ont que des idées obfcures des diverfes nuances
de cette couleur, & les confondent les unes avec
les autres , prenant, par exemple, le couleur de ce-
rife pour le couleur de rofe. Celui-là a une idée claire
de là vertu , qui fait diftinguer sûrement une action
vertueufe d’une qui ne l’eft pas ; mais c’eft en
avoir une idée obfcure, que de prendre des vices à
la mode pour des vertus.
La clarté ôc l’obfcurué des idées peuvent avoir divers
degrés, fuivant que ces idées portent avec elles
plus ou moins de marques propres à les difcerner de
toute autre. L'idée d’une même chofe peut être plus
claire chez les uns, moins claire chez les autres ; obfcure
pour ceux-ci, très-oblcure à ceux-là ; de même
elles peuvent être obfcures dans un tems, & devenir
très-claires dans un autre. Ainfi une idée claire
peut être.fubdivifée en idée diftincle & confufe. Dif-
tincle, quand nous pouvons détailler ce que nous
avons obfervé dans cette idée, indiquer les marques
qui nous les font reconnoître, rendre compte des
différences qui diftinguent cette idée d’autres à peu-
près femblables; mais on doit appellcr un e idée confufe
, lorfqu’étant claire , c’eft-à-dire diftinguée de
toute autre, on n’eft pas en état d’entrer dans le
détail de fes parties.
Il en eft encore ici comme du fens de la vûe. Tout
objet vu clairement ne l’eft pas toujours diftinéte-
ment. Quel objet fe préfente avec plus de clarté que
le foleil, & qu i pourrait le voir diftinâement à moins
que d’affoiblir fon éclat? des exemples diront mieux
que les définitions. Vidée de la couleur rouge eft une
idée claire, car l’on ne confondra jamais le rouge avec
une autre couleur ; mais fi l’on demande à quelqu’un,
à quoi donc il reconnoît la couleur rouge, il ne faura
que repondre. Cette idée claire eft donc confufe pour
lu i, & je crois qu’on peut dire la même chofe de toutes
les perceptions fimples. Combien de gens qui ont
une idée claire de la beauté d’un tableau, qui guidés
par un goût jufte & sûr, n’ héfiter ont pas à le diftinguer
fur dix autres tableaux médiocres. Demandez-
leur ce qui les détermine à trouver cette peinture
bonne, & ce qui en fait la beauté, ils ne fauront
pas rendre raifon de leur jugement, parce qu’ils
n’ont pas une idée diftinâe de la beauté. Et voilà une
différence fenfible entre une idée Amplement claire ,
& une idée diftinûe ; c’eft que celui qui n’a qu’une
idée claire d’une chofe, ne (aurait la communiquer
à un autre. Si vous vous adreffez à un homme qui
n’a qu’une idée claire, mais confufe de la beauté d’un
poëme, il vous dira que c’eft l’Iliade, l’Enéide, ou
il ajoûtera quelques fynonymes ; c’eft unpoëme qui
eft fublime, noble, harmonieux, qui ra v it, qui enchante
; des mots tant que vous voudrez, mais des
idées, n’en attendez pas de lui.
Ce ne font auffi que les idées diftindes qui font
propres à étendre nos connoiffances, & qui par-là
font préférables de beaucoup aux idées Amplement
claires, qui nous féduil'ent par leur é c la t, & nous
jettent cependant dans l’erreur; ce qui mérite que
l’on s’y arrête pour faire voir que, quoique di dindes
, elles font encore fufceptibles de perfedion.
Pour cela une idée diftinde doit être complette , c’eft-
à-dire qu’elle doit renfermer les marques propres à
faire reconnoître fon objet en touttems & en toutes
circonftances. Un fou ,d it-on , eft un homme qui
allie des idées incompatibles ; voilà peut-être une
idée diftinde, mais fournit-elle des marques pour
diftinguer en tout tems un fou d’un homme fage ?
Outre cela les û/kj diftindes doivent être ce qu’on
appelle dans l’école Adéquates. On donne ce nom à
une idée diftinde des marques même qui diftinguent
cette idée ; un exemple viendra au fecours de cette
définition. On a une idée diftinde de la vertu, quand
on fait que c’eft l’habitude de conformer fes adions
libres à la loi naturelle. Cette idée n’eft ni complet-
tement diftinde, ni adéquate , quand on ne fait que
d’une maniéré confufe ce que c’eft que l’habitude
de conformer fes adions à une lo i, ce que c’eft:
qu’une adion libre. Mais elle devient complette &
adéquate, quand on fe dit qu’une habitude eft une
facilité d’agir , qui s’acquiert par un fréquent exercice;
que conformer fes adions à une lo i, c’eflj
choifir entre plufieurs manières d’agir également
poffibles,' celle qui fuit la loi; que la loi naturelle
eft la volonté du Légiflatuur fuprème qu’il a fait
connoître aux hommes par la raifon & par la conf-
cience ; qu’enfinles adions libres font celles qui dépendent
du feul ade de notre volonté.
Ainfi Vidée de vertu emporte tout ce ci, une facilité
acquifepar un fréquent exercice, de choifir entre
plufieurs maniérés d’agir, que nous pouvons
exécuter par le feul ade de notre volonté, celle qui
s’accommode le mieux à ce que la raifon & la confidence
nous repréfentent, comme conformes à là
volonté de Dieu ; & cette idée de la vertu eft non-
feulement diftinde, mais adéquate au premier degré.
Pour la rendre plus diftinde encore, on pourrait
pouffer cette analyfe plus loin, & en cherchant
les idées diftindes de tout ce qui entre dans Vidée de
v ertu , on ferait furpris combien ce mot embraffe
de chofes , auxquelles la plûpart de ceux qui l’emploient,
ne penfent gueres. Il convient même de
s’arrêter quand on eft parvenu à des idées claires,
mais confufes que l’on ne peut plus réfoudre; aller
au-de-là ce ferait manquer fon b u t , qui ne peut
être que déformer un raifonnement pour s’éclairer
foi-même, ou pour communiquer aux autres ce que
nous avons dans l’efprit. Dans le fécond cas nous
rempliffons nos vûes, lorfque nous nous faifons entendre
de celui à qui nous parlons : au premier il
fuffit d’être parvenu à des principes affez certains,
pour que nous puiffions y donner notre affentiment.
De-là on peut conclure l’importance de ne pasfe
contenter d'idées confufes dans les cas où l’on peut
S’en procurer de diftindes ; c’eft ce qui donne cette
netteté d’efprit qui en fait toute la juftice. Pour cela
il faut s’exercer de bonne heure & affidument fur
les objets les plus fimples, les plus familiers, en les
confidérant avec attention fous toutes leurs faces,
& fous toutes les relations qu’ils peuvent avoir en
les comparant enfemble, en ayant égard aux
moindres différences, & en obfervant l’ordre & la
liaifon qu’elles ont entr’elles.
Paffant enfuite à des objets plus compofés, on les
obfervera avec la même exaditude, & l ’on fe fera
par-là une habitude d’avoir prefque fans travail &
fans peine des idées diftindes, & même de difcer-
nér toutes les idées particulières qui entrent dans la
compofition de Vidée principale. C ’eft ainfi qu’en
analyfant les idées de plufieurs objets , l’on parviendra
à acquérir cette qualité d’efprit qu’on défigne
par le mot profondeur. Au contraire en négligeant
cette attention, l’on n’aura jamais qu’un efprit fu-
perficid qui fe contente des idées claires , & qui n’afi-
pire point à s’en former de diftindes ; qui donne
beaucoup à l’imagination, peu au jugement, qui ne
faifit les chofes que par ce qu’elles ont de fenfible,
ne voulant ou ne pouvant avoir èVidées de ce qu’elles
ont d’abftrait & de fpirituel ; efprit qui peut fe
faire écouter , mais qui pour l ’ordinaire eft un fort
mauvais guide.
C ’eft fur-tout le manque d’attention à examiner
les objets de nos idées, à nous les rendre familiers ,
qui fait que nous n’en avons que des idées obfcures ;
éc comme nous ne pouvons pas toujours conferver
préfens les objets dont nous avons acquis même des
idées diftindes, la mémoire vient à notre fecours
pour nous les retracer ; mais, fi alors nous ne donnons
pas la même attention à cette faculté de notre
ame , l ’expérience fait voir que les idées s’effaçant
autant & par les mêmes degrés, parlefquels elles
ont été acquifes & fe font gravées dans l’ame, en-
forte que nous ne pouvons plus nous repréfenter
l’objet quand il eftabfent, ni le reconnoître quand
il eft préfent : des idées légèrement faifies , imparfaitement
digérées , quoique diftindes, ne feront bientôt
plus que claires, enfuite confufes, puis obfçures
, & deviendront fi obfcures qu’elles fe réduifent
à rien. L ’exemple de la maniéré dont un jeune homme
tranfporté en pays étranger, vient à oublier fa
langue maternelle apprife par routine, en ferait
une preuve, fi l’on n’eii n’avoit une infinité d’autres.
La maniéré de v o i r , d’envifager tin objet, de
le confidérer avec atteiltion fous toutes fes faces,
de l’étudier, de ranger dans fon efprit fous un certain
ordre les idées particulières qui en dépendent,
de s’appliquer à fe rendre familiers les premiers
principes & les propofitions générales, de fe les
rappeller fouvent, de ne pas s’occuper de trop d’objets
à la fois, ni d’objets qui ayant trop de rapports
peuvent fe confondre; de ne point pafferd’unobjét
à l’autre qu’on ne s’en foit fait une idée diftinde s’il
eft poffible. Tout cela forme une méthode de fe repréfenter
les objets , de connoître, d’étüdief, fur
laquelle on ne peut preferire ici toutes les réglés ,
que l’on trouvera dans un traité de logique bien
fait.
Convenons cependant qu’il eft des chofes, dont
avec toute l’attention & la difpofition poffible, on
ne peut parvenir à fe faire des idées diftindes, foit
parce que l’objet eft trop compofé , foit parce que
les parties de cet objet different trop peu entr’eflès
pour que nous puiffions les demêler & en faifir lés
différences, foit qu’elles nous échappent par leur
peu de proportion avec nos organes, oit pat leur
éloignement, foit que l’effentiel d’urie idée , ce qui
la diftingue de foute autre , fe trouve enveloppé de
plufieurs circonftances étrangères qui les dérobent
à notre pénétration. Toute machine trop compofée,
le corps humain, par exemple , eft tellement combiné
dans toutes fes parties ; que la fagaeité des plus
habiles n’y peut voir la millième partie dé ce qu’i l y
aurait à connoître, pour s’en former une idée corn-
plettement diftinde. Le microfcope, le télefeope
nous oiit donné à la vérité des idées plus diftindes
fur des objets, qui avant cés découvertes , étoient
dans le fécond cas , c’eft-à-dire très-obfcures par
la petiteffe ou l’éloignement de ces objets , & encore
combien fommes-nous éloignés d’en avoir dés
idées nettes ! La plûpart des hommes n’ont qu’ii-
ne idée affez obfcure de ce qu’ils entendent par le
mot de caufe, parce que dans ia production d’un effet
la caufé fe trouve ordinairement enveloppée, &
tellement jointe à diverfes ehofes , qu’il leur eft difficile
de difcerner en quoi elle confifte.
Cet exemple même nous indique un obftàcle à
nous procurer des idées diftindes, c’eft l’imperfection
& l’abus des mots comme Agnes repréfentatifs ,
mais-Agnes arbitraires de nos idées. Voye^ Mo t s ,
Sy n t a x e. Il n’eft que trop fréquent, & l’expérience
nous montre tous les jours que l’on eft dans l’habitude
d’employer des mots fans y joindre d'idées pré-
cifes, ou même aucune idéef de les employer tantôt
dans un fens, tantôt dans un autre, ou- de les lier
à d’autres, qui en rendent la lignification indéterminée,
& de fuppofer toujours comme on le fair,
que les mots excitent chez les autres les mêmes
idées que nous y avons attachées. Comment fe faire
des idées diftindes avec des lignes auffi équivoques?
Le meilleur confeil que l’on puiffe donner contré
cet abus, c’eft qu’après s’être appliqué à n’avoir que
des idées bien nettes & bien terminées, nous n’employons
jamais, ou du moins le plus rarement qu’il
nous fera poffible, de mots qui ne nous donnent du
moins une idée claire, que nous tâchions de fixer là
lignification de ces mots ; qu’en celanous fuivions autant
qu’on le pourra, l’ufage commun, & qu’enfin
nous évitions de prendre le même mot en deux fens
différens. Si cette réglé générale didée par le bon
fens, étoit fuivie & obfervée dans tous fes détails
avec quelque foin, les mots bien loin d’être un obf*