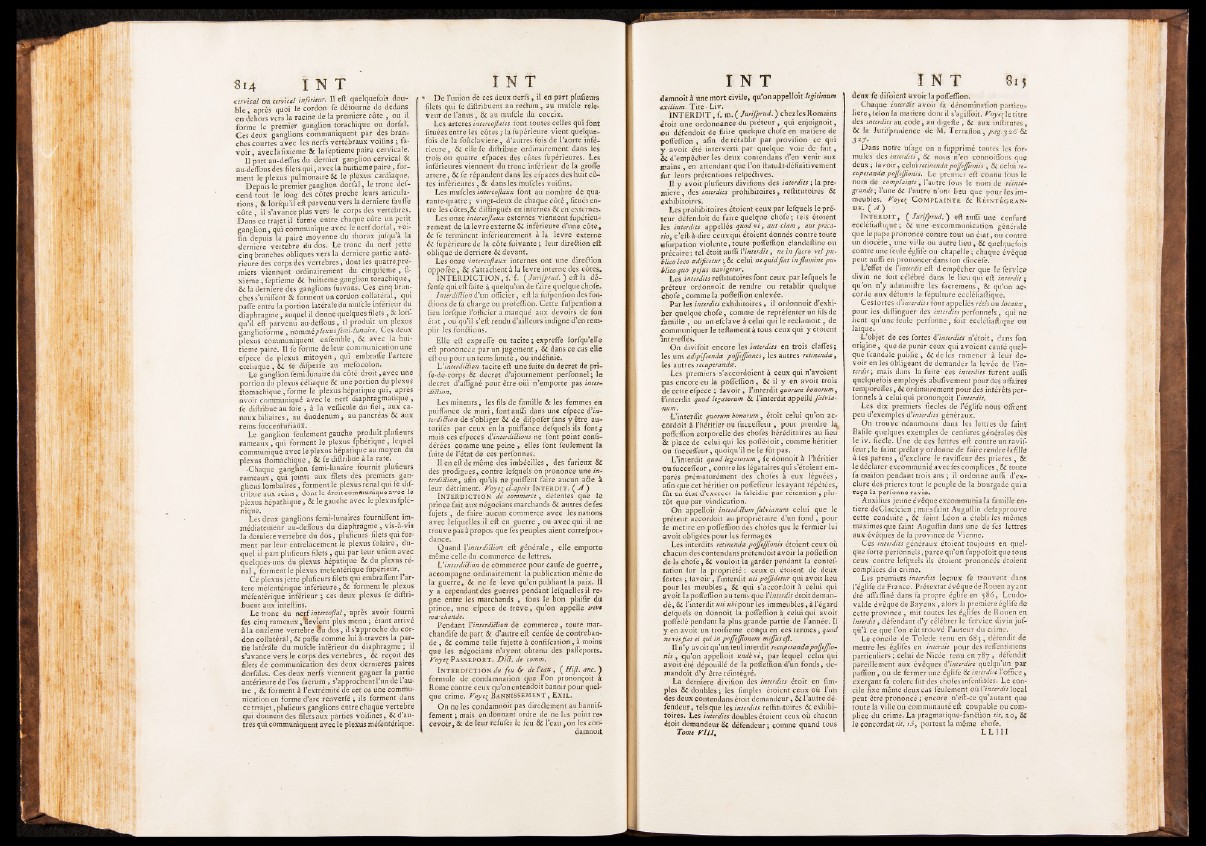
cervical OU cervical inferieur. Il eft quelquefois double
, après quoi le cordon fe détourne de dedans
en dehors vers la racine de la premiere côte , ou il
forme le premier ganglion toràchique ou dorfal.
Ce s deux ganglions communiquent par des bran-*
ches courtes avec les nerfs vertébraux voifins i fa-
v o ir , aveclafixieme & lafeptieme paire cervicale.
Il part au-deffus du dernier ganglion cervical &
au-deffous des filets qui, avec la huitième paire, forment
le plexus pulmonaire ôc le plexus cardiaque.
Depuis le premier ganglion dorfâl, le tronc descend
tout le lorig des côtes proche leurs articulations
, & lorfqu’il eft parvenu vers la derniere fauffe
côte , il s’avance plus vers lé corps des vertébrés.
Dans ce trajet il forme entre chaque côte un petit
ganglion, qui communique avec le nerf dorfal ^vôi-
fin depuis là paire moyenne du thorax jufcju à la
derniere vertebre du dos. Le tronc du nerf jette
cinq branches obliques vers la derniere partie antérieure
des corps des vertebres, dont les quatre.pre-
miers viennent ordinairement du cinquième , fi-
xieme , feptieme ôc huitième ganglion toràchique,
ôc la derniere des ganglions fuivans. Ces cinq branches
s’unifient St forment un cordon collateral, qui
pafle entre la portion latérale du mufcle inferieur dû
diaphragme, auquel il donne quelques filets , 8i lorfqu’il
eft parvenu au-deflous, il produit un plexus
gangliôforme , nommèplexiis femi-lunaire. Ces deux
plexus communiquent enfemble, Ôc avec la huitième
paire. Il fe forme de leur communication une
efpece de plexus mitoyen, qui embrafle 1 artere
coeliaque, & fe difperle au mefocolon.
Le ganglion femi-lunaire du cote droit, avec unè
portion du plexus céliaque & une portion du plexus
ftomachique, forme le plexus hépatique qui, apres
avoir communiqué avec le nerf diaphragmatique ,
fe diftribue ait foie , à la vefîicule du fiel, aux canaux
biliaires, au duodenum, au pancreas ôc aux
reins fuccenturiaux.
Le ganglion feulement gauche produit plufieurs
rameaux, qui forment le plexus fpherique , lequel
communique avec le plexus hépatique au moyen dit
plexus ftomachique , ÔC fe diftribue à la rate.
•Chaque ganglion femi-lunaire fournit plufieurs
rameaux, qui joints aux filets des premiers ganglions
lombaires, formentle plexus rénal qui fe diftribue
aux reins, dont le droit communique avec le
plexus hépathique, & le gauche avec le plexus fplé-
niquè. .
Les deux ganglions femi-lunaires fourniflent îm-
tnédiatemenr au-deflous du diaphragme , vis-à-vis
la derniere vertebre du dos, plufieurs filets qui forment
par leur entrelacement le plexus folâtre, duquel
il part plufieurs filets , qui par leur union avec
quelques-uns du plexus hépatique ôc du plexus renal
, forment le plexus méfentérique fupérieur.
Ce plexus jette plufieurs filets qui embraflent l’ar-
tere méfentérique inférieure, ôc forment le plexus
méfentérique inférieur j ces deux plexus fe diflri-
buent aux iritefiins.
Le tronc du nerf ihlercojlal, après avoir fourni
fes cinq rameaux,devient plus menu ; étant arrive
à la onzième vertebre au dos, il s’approche du cordon
collatéral, ôc pafle comme lui à-travers la partie
latérale du mufclè inférieur du diaphragme ; il
s’avance v efs le corps des vertebres, Ôc reçoit des
filets de communication des deux dernierès paires
dorfales. Ces deux nerfs viennent gagner la partie
antérieure de l’os fâcrùm , s’approchent l’un de l’autre
, ôc forment à l’extrémité de cet os une communication
en forme d’arc renverfé ; ils forment dans
ce trrajet »plufieurs ganglions entre chaque vertebre
qui donnent des filets aux partiès vôifines, ôcd’au-
tres qui communiquent avec le plexus méfentérique.
• De l’union dè ces deux nerfs, il en part plufieurs
filets qui fé diflribuent au reéhim, au mufcle rele-,
veur de l’ahùs, ôc au mufcle dit coccix.
Les arteres intercofiales font toutes celles qui font
fituéesentre lès côtes; ialupérieure vient quelquefois
de la fofiClaviere, d’autres fois de l ’aorte inférieure
, ôc elle fe diftribue ordinairement dans les
trois ou quatre éfpacès dès côtes fupérieures. Les
inférieures viennent du tronc inférieur de là grolle
artere, & fe répandent dans les' èfpaces des huit côtes
inférieures , & dans les mufcles voifins.
Les mufcles intétcofiàüx font au nombre dé qua*
rante-quàtre ; vingt-deux de chaque cô té, fitués entre
les côtés,& diftirigiies en internes & en externes.
Les onze inlercofdùx externes viennent fupérieu-
rement de la levre externe & inférieure d’une côte,
ôc fe terminent inférieurement à la levre externe
ôc fupérieure de la côte fuivante ; leur direction eft
oblique de derrière ôc devant.
Les onze InUrcoßaux internes ont une direâion
Oppofée, ôc s’attachent à la levre interne des côtes.
INTERDICTION, f .vf. \Jiinfprud. ) eft la dè-
fenfe qui eft faite à quelqu’un de faire quelque chofe.
Interdiction d’un officier, èft la fufpenfion des fondions
de fa charge ou profeflion. Cette fufpenfion à
lieu lorfquè l’ofticier a manqué aux devoirs de fori
é ta t, ou qu’il s’eft rendu d’ailleurs indigne d’en remplir
les fondions.
Elle eft exprefle ou tacite ; exprefle lorfqu’elle
eft prononcée par un jugement, ôc dans ce cas elle
eft ou pour un tems limité, ou indéfinie.
L 'interdiction tacite eft une fuite du decret de pri-
fe-de-çorps .& decret d’ajournement perfonnel; le
decret d’aflïgné pour être oui n’emporte pas interdiction.
Les mineurs, les fils de famille & les femmes en
puiflance de mari, fontaufli dans une.efpece d'interdiction
de s’obliger ôc de difpofer fans y être au-
torifés par ceux en la puiflance defquels ils font;
mais ces efpeces d’interdictions ne font point confédérées
comme une peine, elles font feulement la
fuite de l’état de ces perfonnes.
Il en eft de même des imbécilles , des furieux &
des prodigues, contre lefquèls on prononce une interdiction
, afin qu’ils rie puiflent faire aucun ade à
leur détriment. Voye^ci-àprés Int erd it. ( ^ )
In t erd ic t io n de commerce, défenfes que le
prince fait aux négocians marchands ôc autres de fes
fujets , de faire aucun commerce avec les nations
avec lefquelles il eft en guerre , ou avec qui il ne
trouve pas à propos que fes peuples aient correfpon»
dance.
Quand Vinterdiction eft générale , elle emporte
même celle du commerce de lettres.
U interdiction de commerce pour caufe de guerre ,
accompagne ordinairement la publication même de
la guerre, & ne fe leve qu’en publiant la paix. IL
y a cependant des guerres pendant lefquelles il regne
entre les marchands , fous le bon plaifir du
prince, une efpece de tre ve , qu’on appelle trevt
marchande.
Pendant l’interdiction de commerce, toute mar-
chandife de part & d’autre eft cenfée de contrebande
, ôc comme telle fujette à confifcation, à moins ‘
que les négocians n’ayent obtenu des pafleports.
Foye^ Pa sse po rt. Dicl. de comtù.
In t erd ic t io n du feu & de Veau, ( Hiß. anc. )
formule de condamnation que l’on prononçoit à
Rome contre ceux qu’on entendoit bannir pour quelque
crime. Foye%_ Bannissement , Ex il .
On ne les condamnoit pas direâement au bannif-
fement ; mais en donnant ordre de ne les point re*
ce voir, & de leur refüfér le feu ôc l’eau, on lescon-
damnoit;
damnoit à linemort civile, qu’on appeïloît legitimiim
exilium. Tite - Liv.
INTERDIT f. m. ( Jurifprud. ) chez les Romains
«toit une ordonnance du prêteur , qui enjoignoit,
ou défendoit de faire quelque chofe en matière de
pofleflion , afin de rétablir par provifion ce qui
y avoit été interverti par quelque voie de fa it ,
& d’empêcher les deux contendans d’en venir aux
mains , en attendant que l’on ftatuât-définitivement
fur leurs prétentions refpeftives.
Il y avoit plufieurs divifions des interdits ; la première
, des interdits prohibitoires, reftitutoires ÔC
exhibitoires.
Les prohibitoires étoient ceux par lefquels le préteur
défendoit de faire quelque chofe ; tels étoient
les interdits appcllés quod v i, aut clam, aut prèca-
rio c ’eft-à dire ceux qui étoient donnés contre toute
ufurpation violente, toute pofleflion clandeftine ou
précaire : tel étoit aufîi l’interdit, ne in facrô vel pu*
Hico loto adificetur ; ÔC celui ne quidfiat infiumine pu-
■ blico quo pejus navigttur.
Les interdits reftitutoires font ceux par lefquels le
préteur ordonnoit de rendre ou rétablir quelque
«hofe, comme la pofleflion enlevée.
Par les interdits exhibitoires, il ordonnoit d’exhiber
quelque chofe, comme de repréfenter un fils de
famille , ou un efclave à celui qui le reclamoit, de
communiquer le teftamentàtous ceux qui y étoient
Intérefîes.
On divifoit encore les interdits en trois clafles ;
les uns adipifoendee poffeffiones, les autres retinenda ,
les autres recuperanda.
Les premiers s’accordoient à ceux qui n’avoient
pas encore eti la pofleflion, & il y en avoit trois
de cette efpece ; la vo ir , l’interdit quorum bonorum9
i ’interdit quod legatorum & l ’interdit appellèjdlvia-
■ num.
•L’interdît quorum bcfnôrufn, étoit celui qu’on ac-
Cordoit à l’héritier ou fuccefleur , pour prendre la^
pofleflion .corporelle des chofes héréditaires au lieu
& place de celui qui les poflèdoit, comme héritier
ou fuccefleur, quoiqu’il ne le fût pas.
L’interdit quod legatorum , fe dohnoit à l’héritier
ou fuccefleur, contre les légataires qui s’étoient emparés
prématurément des chofes à eux léguées,
afin que cet héritier ou poflefleur les ayant répétées,
fut en état d’exercer la falcidie par rétention , plutôt
que par vindication-.
On appeiloit interdictum falvianum celui que le
préteur accordoit au propriétaire d’un fond , pour
îe mettre en pofleflion des chofes que le fermier lui
avoit obligées pour les fermages
Les interdits retinenda pofjefjionis étoient ceux où
chacun des Contendans prétendoit avoir la pofleflion
de la chofe, & vouloit la garder pendant la contef-
tation fur la propriété: ceux ci étoient de deux
fortes ; (avoir , l’interdit uti pojjidetur qui avoit lieu
pour les meubles, & qui s’accordoit à celui qui
avoit la pofleflion au tems que l’interdit étoit demandé
, & l’interdit uti ubi pour les immeubles, à l’égard
defquels on donnoit la pofleflion à celui qui avoit
pofledé pendant la plus grande partie de l’année. Il
y en avoit un troifieme conçu en ces termes, quod
ne visfiat ci qui in poffejjionem mi fu s eft.
Il n’y avoit qu’un ieul interdit recuperandapofjejjio-
nis , qu’on appeiloit undh v i, par lequel celui qui
avoit été dépouillé de la pofleflion d’un fonds, de-
mandoit d’y être réintégré.
La derniere divifion des interdits étoit en Amples
& doubles ; les Amples étoient ceux où l’un
des deux contendans étoit demandeur, & l ’autre défendeur,
tels que les interdits reftitutoires Ôc exhibitoires.
Les interdits doubles étoient ceux où chacun
étoit demandeur ôc défendeur ; comme quand tous
Tome V l l l%
deux fe difoient avoir la pofleflion-.
Chaque interdit avpit fa dénomination particulière,
lelon la matière dont il s’agiflbit. Foye( le titre
des interdits au code, au digefte , & aux inftitutes,
ôc la Jurilprudence de M. Terraflon , pag.$ ÔC
Dans notre Ufâge on a fupprimé toutes les for*
mules des interdits, ôc nous n’en connoifions que
deux ; lavoir, celui retinendapoffcjjionis , ÔC celui recuperanda
pofjefjionis. Le premier eft connu fous le
nom de complainte, l’autre fous le nom de réinté-
grande ; l’une ÔC l’autre n’ont lieu que pour les immeubles.
Foyei C om p lain te ôc R éintégrant
d e . ( A )
In t e r d it , ( Jurijprud.') eft aufli une ëenfurô
eccléfiaftique ; ôc une excommunication générale
que le pape prononce contre tout un état, ou contre
un diocèle, une ville ou autre lieu , ôc quelquefois
contre une feule églife ou chapelle ; chaque évêque
peut aufli en prononcer dans (on diocèfe.
L’effet de l'interdit eft d’empêcher que le fefvice
divin ne foit célébré dans le lieu qui eft interdit ;
qu’on n’y adminiftre les facreraens , ôc qu’on ac*
corde aux défunts la fépulture eccléfiaftique-.
Ces fortes d’interdits font appellés réels ou locaux,
pour les diftinguer des interdits perfonnefs, qui ne
lient qu’une feule perfonne, foit eccléfiaftique ou
laïque.
L’objet de ces fortes d’interdits n’étoit, dans fort
origine, que de punir ceux qui avoient caufé quel**
que fcandale public , ôcde les ramener à leur devoir
en les obligeant de demander la levée de l'in*
terdit ; mais dans la fuite ces interdits furent aufli
quelquefois employés abufivement pour des affaires
temporelles, ôc ordinairement pour des intérêts per-
fonnels à celui qui prononçoit l’interdit.
Les dix premiers fiecies de l’églife nous offrent
peu d’exemples d’interdits généraux.
On trouve néanmoins dans les lettres de faint
Bafile quelques exemples de certfures générales dès
le iv. fiede. Une de ces lettres eft contre un favif*
feu r jle faint prélat y ordonne de faire rendre la fîllô
à fes pafens , d’exclure le ravifleur des prières , &
le déclarer excommunié avec fes complices, ôc toute
fa maifon pendant trois ans ; il ordonne aufli d’exclure
des prières tout le peuple de la bourgade qui a
reçu la perfonne ravie.
Auxilius jeune évêque excommunia la famille en*
tiere deClacicien ; mais faint Auguftin defâpprouve
cette conduite , ôc faint Léon a établi les mêmes
maximes que faint Auguftin dans une de fes lettres
aux évêques de la province de Vienne.
Ces interdits généraux étoient toujours en quelque
forte perfonnels, parce qu’on fuppofoit que tous
ceux contre lefquels ils étoient prononcés étoient
complices du crime.
Les premiers interdits locaux fe trouvent dans
l’églife de France. Prétextât évêque de Rouen ayant
été aflafliné dans fa propre églife en 586, Leudo*
valde évêque de Bayeux, alors la première églife de
cette province, mit toutes les églifes de Rouen en
interdit, défendant d’y célébrer le fefvice divin juf-
qït’à ce que l’on eut trouvé l’auteur du Cririie.
Le concile de Tolede tenu en 683 , défendit de
mettre les églifes en interdit poür des reflentimens
particuliers ; Celui de Nicée tenu en 787 -, défendit
pareillement aux évêques d’interdire quelqu’un par
pafiïon, ou de fermer une églife ôc interdire l’office ,
exerçant fa colere fur des chofes infonfibles. Le con*
cile fixe même deux cas feulement où Yinterdii local
peut être prohoncé ; encore n’eft-ce qu’autant que
toute la ville ou communauté eft coupable ou complice
du crime. La pragmatique-fanâion tit. 20, ÔC
le concordat tit. iâ9 portent la même chofe.
L L 111