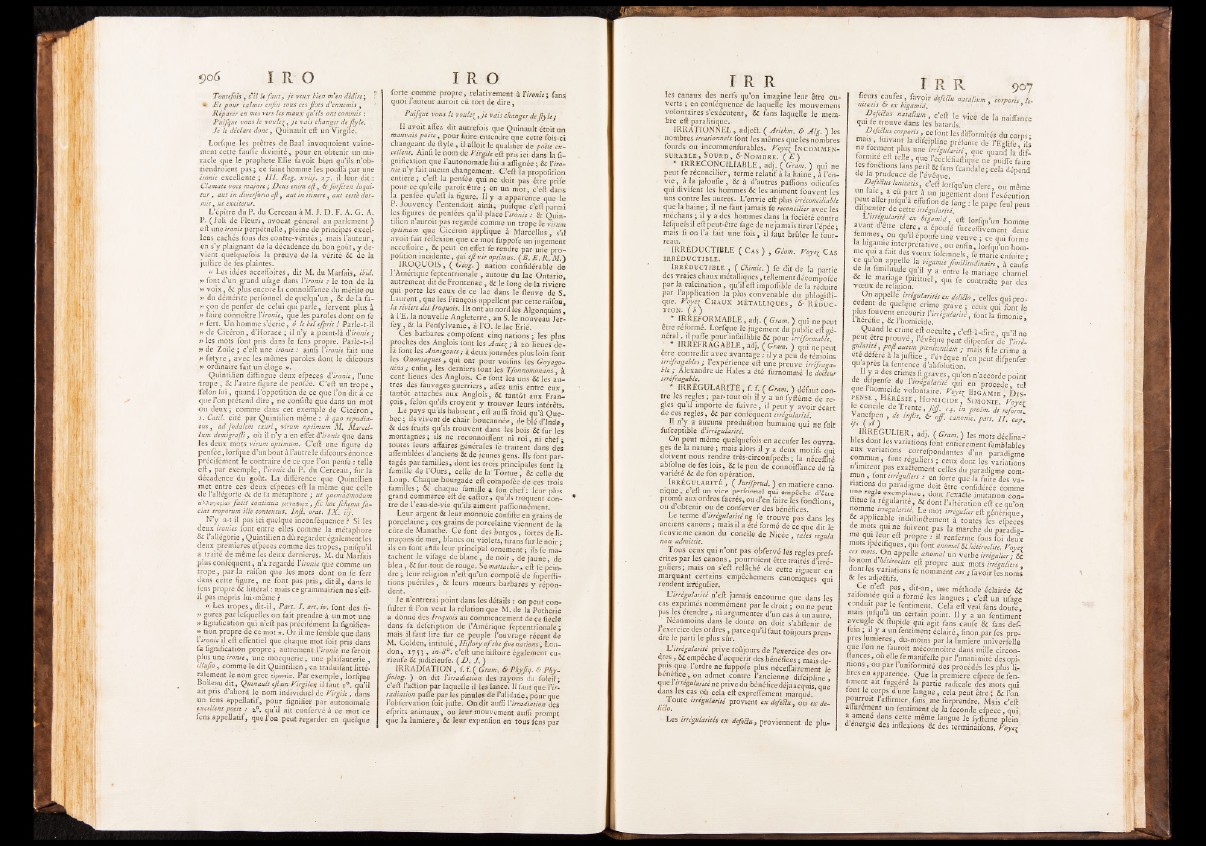
9 0 6 I R O
Toutefois, s’il U faut y je veux bien m’en dédire ;
* E t pour calmer enfin tous ces flots d'ennemis ,
Réparer en mes vers les maux qu’ils ont commis :
Puifque vous le voulez je vais changer de flyle.
Je le déclare donc, Quinault eft un Virgile.
Lorfque les prêtres de Baal invoquoient vainement
cette fauflé divinité, pour en obtenir un miracle
que le prophète Elie la voit bien qu’ils n’ob-
tiendroient pas ; ce faint homme les pouffa par une
ironie excellente ; I II. Reg. xviij. xy. il leur dit :
Clamate voce majore ; Deus enim efi, & forjitan loqui-
tur t aut in diverforio efi y aut in itinere, aut certï dormit
y ut excitetur.
L’épître du P. du Cerceau à M. J. D. F. A. G. A.
P. ( Joli de Fleuri, avocat général au parlement )
eft une ironie perpétuelle, pleine de principes excel-
lens cachés fous des contre-vérités ; mais l’auteur,
en s’y plaignant de la décadence du bon goût, y devient
quelquefois la preuve de la vérité & de la
juftice de fes plaintes.
« Les idées acceffoires, dit M. du Marfais., ibid.
» font d’un grand ufage dans ¥ ironie : le ton de la
» v o ix , & plus encore la connoiffance du mérite ou
» du démérite perfonnel de quelqu’un , & de la fa-
» çon de penfer de celui qui parle, fervent plus à
» faire cônnoître l’ironie9 que les paroles dont on fe
» fert. Un homme s’écrie, 6 le bel efprit ! Parle-t-il
» de Cicéron, d’Horace ; il n’y a point-là d’ironie ;
» les mots font pris dans le fens propre. Parle-t-il
y> de Zoïle ; c’eft une ironie : ainfi l’ironie fait une
» faty re, avec les mêmes paroles dont le difcours
y> ordinaire fait un éloge ».
Quîntilien diftingue deux efpeces à'ironie, l’une
trope , & l ’autre figure de penfée. C ’eft un trope ,
félon lu i, quand l ’oppofition de ce que l’on dit à ce
que l’on prétend dire , ne confifte que dans un mot
ou deux ; comme dans cet exemple de Cicéron,
/. Catil. cité par Quintilien même : à quo repudia-
tus f ad fodalem tauri, virum optimum M. Marcel-
lum dcmigrafli , où il n’y a en effet d’ironie que dans
les deux mots virum optimum. C ’eft une. figure de
penfée, lorfque d’un bout à l’autre le difcours énonce
précifément le contraire de ce que l’on penfe : telle
eft, par exemple, l’ironie du P. du Cerceau, fur la
décadence du goût. La différence que Quintilien
met entre ces deux efpeces eft la même que celle
de l’allégorie & de la métaphore ; ut quemadmodum
aWvyeps<tv facit continua /xîrctçopx , fie hoc fehemafa-
ciat troporum ille contextus. Infi. orat. IX . iij.
N’y a-t-il pas ici quelque inconféqueïice ? Si les
deux ironies font entre elles cpmme la métaphore
& l’allégorie, Quintilien a dû regarder également les
deux premières efpeces comme des tropes, puifqu’il
a traité de même les deux dernieres. M. du Marfais
plus conféquent, n’a regardé l’ironie que comme un
trope, par la raifon que les mots dont on fe fert
dans cette figure, ne font pas pris, dit i l , dans le
feras propre & littéral : mais ce grammairien ne s’eft-
il pas mépris lui-même ?
« Les tropes, dit-il, Part. I . art. iv. font des fi-
» gures par lefquelles on fait prendre à un mot une
>» lignification qui n’eft pas précifément la lignifica-
»> tion propre de ce mot ». Or il me femble que dans
l’ironie il eft effentiel que chaque mot foit pris dans
fa lignification propre ; autrement l’ironie ne feroit
plus une ironie, une mocquerieune plaifanterie
illufio, comme le dit Quintilien, en traduifant littéralement
le nom grec ùpmùa.. Par exemple, lorfque
Boileau dit, Quinault efi un Virgileç il faut i° . qu’il
ait pris d’abord le nom individuel de Virgile , dans
un fens appellatif, pour fignifîer par autonomafe
excellent poète ; 2°. qu’il ait confervé à ce mot ce
fens appellatif, que l ’oa peut regarder en quelque
I R O
forte comme propre , relativement à l’ironie ; fans}
quoi l’auteur auroit eû tort de dire,
Pia f que vous le voùler^je vais changer de fiyle;
Il avoit affez dit autrefois que Quinault étoit un
mauvais poète, pour faire entendre que cette fois-ci
changeant de ftyle., il alloit le qualifier de poète excellent.
Ainfi le nom de Virgile eft pris ici dans la fi-
gnification que 1 autonomafe lui a alîignée ; & Y ironie
n’y fait aucun changement. C ’eft la propofition
entière ; c eft la penfée qui ne doit pas être prife
pour ce qu’elle paroîtêtre ; en un mot, c’eft dans
la penfée qu’eft la figure. Il y a apparence que le
P. Jouvency l’entendoit ainfi, puifque c’eft parmi
les figures de penfées qu’il place l’ironie : & Quintilien
n auroit pas regardé comme un trope le virum
optimum que Cicéron applique à Marcellus, s’il
avoit fait reflexion que ce mot fuppofe un jugement
acceffoire , 6c peut en effet fe rendre par une propofition
incidente, qui efi vit optimus. (B. E. R .M.')
IRO QUOIS, ( Géog. ) nation confidérable de
; l ’Amenque feptentrionale , autour du lac Ontario,
autrement dit de Frontenac , & le long de.la riviere
qui porte les eaux de ce lac dans le fleuve de S.
Laurent, que les François appellent par cette raifoa,
la riviere des Iroquois. Ils ont au nord les Algonquins,
à 1 £. la nouvelle Angleterre, au S. le nouveau Jer-
f e y , & la Penfylvanie, à l’O. le lac Erié.
Ces barbares compofent cinq nations ; les plus
proches des Anglois font les Anie^; à 20 lieues delà
font les Annegouts; à deux journées plus loin font
les Onontagues , qui ont pour voifins les Goyago-
mns ; enfin, les derniers font les Tfonnom onans , à
cent lieues des Anglois. Ce font les uns & les autres
des fauvagesguerriers, affez unis entre eu x,
tantôt attaches aux Anglois, & tantôt aux François
, félon qu’ils croyent y trouver leurs intérêts.
Le pays qu’ils habitent, eft auffi froid qu’à Que-
bec; ils vivent de chair boucannée, de blé d’Inde
& des fruits qu’ils trouvent dans les bois & fur les
montagnes; ils ne reconnoiffent ni ro i, ni ch ef;
toutes leurs affaires générales fe traitent dans des
affemblees d’anciens & de jeunes gens. Ils font partagés
par familles, dont les trois principales font la
famille de l’Ours, celle de la Tortue, & celle du
Loup. Chaque bourgade eft compofée de ces trois
familles ; & chaque famille a fon chef; leur plus
grand commerce eft de caftor, qu’ils troquent contre
de l ’eau-de-vie qu’ils aiment paflïonnémënt.
Leur argent & leur monnoie confifte en grains de
porcelaine ; ces grains de porcelaine viennent de la
côte de Manathe. Ce font des burgos, fortes de limaçons
de mer, blancs ou violets, tirans fur le noir ;
ils en font aftffi leur princip'al ornement ; ils fe ma-
tachent le vifage de blanc, de noir , de jaune, de
bleu, & fur-tout de rouge. Semattacher, eft fe peindre
; leur religion n’eft qu’un compofé de fuperfti-
tions puériles, & leurs moeurs barbares y répondent.
Je n’entrerai point dans les détails : on peut confin
e r fi l’on veut la rélation que M. de la Potherie
a donné des Iroquois au commencement de ce fiècle
dans fa defeription de l’Amérique feptentrionale ;
mais il faut lire fur ce peuple l’ouvrage récent de
M. Colden, intitule, Hifiory o f the five nations, London
» 1753 , in-8°. c’eft unehiftoire également cu-
rieufe &c judicieufe. ( D . J. )
IRRADIATION , f. f. ( Gram. & Phyfiq. & Phy-
Jîolog. ) on dit Yirradiaùon des rayons du foleil;
c’eft l’a&ion par laquelle il les lance. Il faut que l’irradiation
paffe par les pinules de l’alidade, pour que
l’obfervation foit jufte. On dit auffi l’irradiation des
efprits animaux, ou leur mouvement auffi prompt
que la lumière, & leur expenfion en tous fens par
I R R
les canaux des nerfs qu’on imagine leur être ouverts
; en confequence de laquelle les mouvemens
volontaires s’exécutent, & ians laquelle le membre
eft paralitique.
IRRATIONNEL , adjeû. ( Aritkm. & Alg. ) les
nombres irrationnels font les mêmes que les nombres
lourds ou incomrnenfurables. Voyê:[ Incomm ensurable,
So u rd , & Nombre. ( E )
* IRRÉCONCILIABLE, adj. ( Gram. ) qui ne
peut fe réconcilier, terme relatif à la hàiiie, à l’en-
v ie , à la jaloufie, & à d’autres pàffions odieufes
qui divifent les hommes & les animent fouvent les
uns contre les autres. L’envie eft plus irréconciliable
que la haine ; il ne faut jamais fe réconcilier avec les
médians ; il y a des hommes dans la fociété contre
lefqueis il eft peut-être fage de ne jamais tirer l’épée ;
mais fi on l’a fait une fois, il fayt brûler le fourreau.
IRRÉDUCTIBLE ( C as ) , Géom. Voyer C as
IRRÉDUCTIBLE. '
Irréductible , ( Chimie. ) fe dit de la partie
des vraies chaux métalliques tellement décompofée
par la calcination , qu’il eft impoffible de la réduire
par l’application la plus convenable du phlogifti-
que. Voyei C haux MÉTALLIQUES, & RÉDUCTION.
( b )
IRRÉFORMABLE , adj. ( Gram. ) qui ne peut
être réformé. Lorfque le jugement du public eft général
, il paffe pour infaillible & pour irréformable.
n * IRRÉFRAGABLE, adj. ( Gram. ) qui ne peut
etre contredit avec avantage : i l y a peu de témoins
irréfragables ; l’expérience eft une preuve irréfragable
; Alexandre de Haies a été furnommé le docteur
irréfragable.
IRRÉGULARITÉ, f. f. ( Gram. ) défaut con-
tre les réglés ; par-tout oii il y a un fyflème de réglés
qu’il importe de fuivre, il peut y avoir écart
de ces réglés, & par conféquent irrégularité.
Il n’y a aucune produaiqn humaine qui ne foit
fufceptible d*irrégularité.
On peut même quelquefois en accufer les ouvrages
de la nature; mais alors il y a deux motifs qui
doivent nous rendre ‘très-circonfpeas ; la néceffité
abfolue de fes lois, & le peu de connoiffance de fa
Variété & de fon opération.
. Irrégularité , ( Jurifprud. ) en matière cano-
nique, c’eft un vice perfonnel qui empêche d’être
promû aux ordres facrés, ou d’en faire les fondions
ou d obtenir ou de conferver des bénéfices. *
Le terme d irrégularité ne fe trouve pas dans les
anciens canons ; mais il a été formé de ce que dit le
neuvième canon du concile de Nicée , taies régula
hon admittit. °
Tons ceux qui n’ont pas obfervé les réglés pref-
crites par les canons, pourroient être traites d’irréguliers;
mais on s’eft relâché de cette rigueur en
marquant certains empêchemens canoniques qui
rendent irrégulier. ' ^
"L’irrégularité n’eft jamais encourue que dans les
cas exprimés nommément par le droit ; on ne peut
pas les etendre , ni argumenter d’un cas à un autre
j Neanmoins dans le doute on doit s’abftenir dé
1 exercice des ordres, parce qu’il faut toujours pren-
dre le parti le plus sûr.
L ’irrégularité prive toujours de l’exercice des ordres,
& empêche d’acquérir des bénéfices ; mais depuis
que l’ordre ne fuppofe plus néceffairement le
b en é fice^ u admet contre l ’ancienne difeipline
quel irrégularité ne prive du bénéfice déjà acquis, que
dans les cas où cela eft expreffément marqué.
Toute irrégularité provient exdefectu. ou ex de-
liclo.
Les irrégularités ex defectu, proviennent de plu-
I R R 907
lieurs caufes favoir Jtficlu nataliumi mtatts & ex btgamiâ. ■ corporis * U-
W Ê M ■ . c’eft le vicè de la naiffance
qui le trouve dans les bâtards; -
DtfiUus corporis , ce font les difformités du corps -
mais, fuivant la difeipline préfente de l’Eghfe Pils
E S B w quc quand la dif-
W V lf e ’ m cccléliaftiquc ne puiffe faire
H H 1 H H B jugement dont l’exécution
peut aller jufqu à effufion de fang : le pape feul peut
dlfpenfer dé cette irrégularité. * * P™
W m Ê Ê S É m K m eft lorV « n homme
avant dette clerc, a épo'ufé fucceflivemént deux
femmes, ou qu rl époüfe Une Veuve ; ce qui forme
ted),garnie interprétative, ou enfin , loffqu’un hom-
-S. nT'ÔÜ felt BSHhBBSI fe iiiarie énfuite ;
H H à caufe
de la fimihtude qu’il y a entre le mariage charnel
& le martage fpmmel qui fe contiacie par des
voeux de religion. 1
.OnappeUe irrégularités ex dtliéloj. -celles qui pro-
B H 8 ** ftuelq»? çniae grave ; ééifx qui font le
_ a -■ ***- « t u umic , c eir-a-aire, qu i! ne
peut etr« p rouvé, 1 évêque peut dilpenfer de l’irré-
M M ■ „• mais fi le crime a
ete defère à la juftice , l’évêque n’enpéut dlijrenfer
qu après la féntence d ïhfplution. ’ ' P
u . X * c,rimcs.fi,gravés, qu’on .n’àécdrde point
de dhpenfe de l'irrégularité ^ui en procédé, tel
p e n s e , H e r e s i e , H o m i c i d e , S im o n i e . Voyer
VaC„ e fC! e M in dére/rmi
^ f i ’ fart. I I . cap.
bleIfdoÉHULIER , a il' 1 M ) Ies mots déclina-’
blés dont les variations foht entièrement femblables
au x, variations correfpôndantes 'd’ùn paradigme
commun, font réguliers ; ceux dont les variations
' T ? aS Jxa,aement celles du paradigme commun
, font irréguliers : en forte que la fuite des variations
du paradigme doit être confidéréé comme
Une réglé exemplaire, dont f exafte imitation, con-
ftitue la régularité, & dont l ’altération eft ce qu’on
mot. irrégulier é& générique 1
oc applicable indiftinaement à toutes les efpeces
de mots qui ne fuivent. pas la marché du paradigme
qu. leur eft propre : il reuferme fous foi deux
mots ipecifiques, qui font anomal&hétér’odUe. Voyer
ces mots. On appelle anomal un^ verte Irrégulier
le nom d hétéroclite eft propre aux mots, irréguliers
dont les variations fe nomment cas /favoir les noms
oc les adjeéhfs.
<?e pas, dit-on, une méthode éciairée &
railonnee qui a formé les langues ; c’eft un ufage
conduit par le fentiment. Cela eft vrai fans doute,
maïs julquà un certain point. Il y a un fentiment
aveugle & ftupide qui agit fans caufe & fans def-
lein ; il y a un fentiment éclairé, finon par fes propres
lumières , du-moins par la lumière univerfelle
que 1 on ne fauroit méconnoître dans mille circon-
itances, ou elle femanifefte par l’unanimité des opinions
, ou par l ’uniformité des procédés les plus libres
en apparence. Que la première efpece de fen-
timent ait fuggéré la partie radicale des mots qui
tont le corps d’une langue, cela peut être ; & l’on
pourroit l’affirmer, fans, me furprendre. Mais c ’eft
affurement un fentiment de la fécondé efpece,qui
a amene dans cette même langue le fyftème plein"
a cnergie des inflexions ôc des termiiiaifons, Voyef