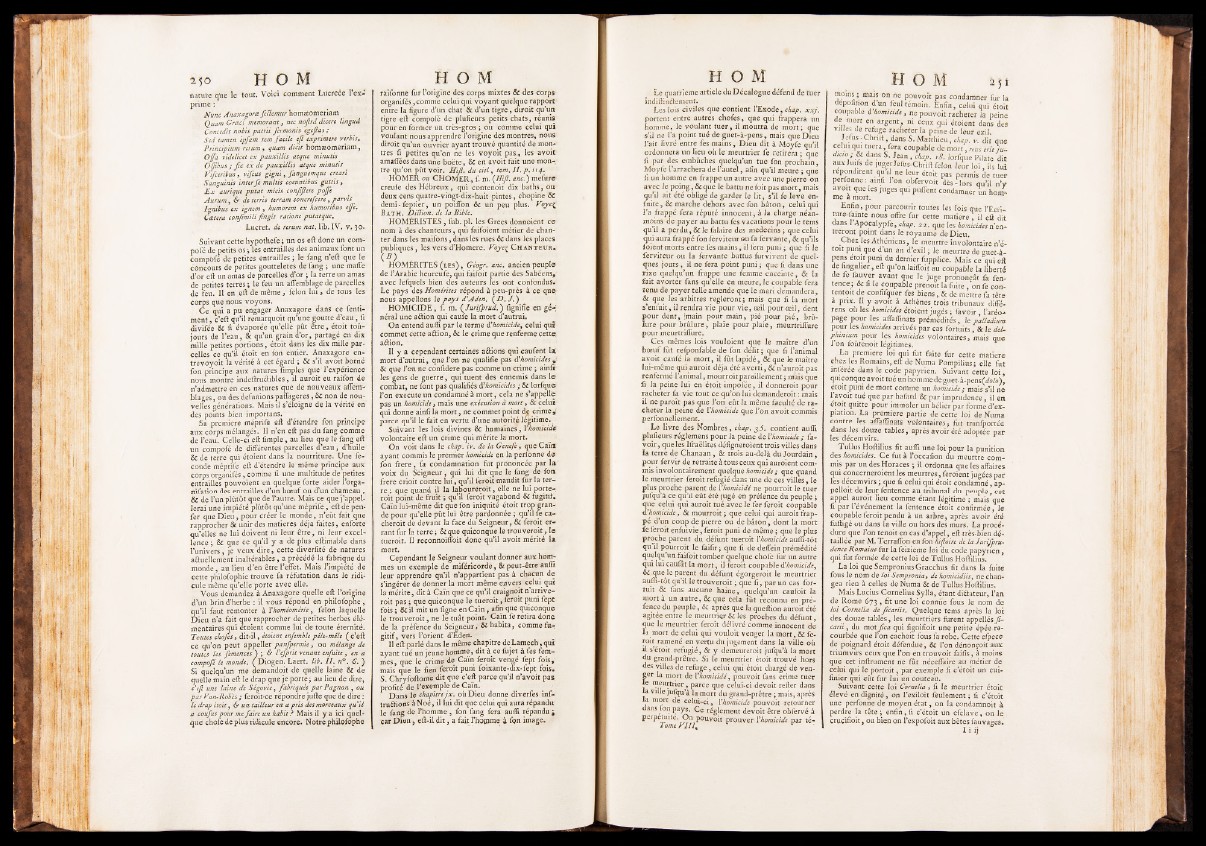
nature que le tout. Voici comment Lucrèce l'exprime
:
Nunc Ahaxagorce feclemur homzéomeriant
Quant Graci memorant , hec nojirâ dictre linguâ
Conccdit nobis patrii fcrmonis egejlas :
Sed tamm ipfam rem facile efi exprimere ver bis»
Principium retùm, quant dicit homaeomeriam,
Ojfa videlicet ex pauxillis atque minutis
Offïbus ; fie tx de pauxillis atque minutis
Vifceribus » vifeus gigni, fanguemque creari
Sanguinis inter fe multis coeuntibus guttis ,
E x aurique putat micis confifiere pojfc
Aurum, & de terris terrant concrefcere, parvis
Ignibus ex ignem , humorerh ex humoribus efie.
Ccetera confinùli fingit ratio ne putatqiie.
Lucret. de rerum nat. lib, IV. v. 30.
Suivant cette hypothefe ; un os eft donc un com-
pofé de petits os ; les entrailles des animaux font un
Compbfé de petites entrailles ; le fang n’eft que le
concours de petites goutteletes de fang ; une maffe
d’or eft un amas de parcelles d’or ; la terre un amas
de petites terres ; le feu un affemblage de parcelles
de feu. Il en eft de même , félon lu i, de tous les
corps que nous voyons.
Ce qui a pu engager Anaxagore dans ce fenti-
ment, c’eft qu’il remarquoit qu’une goutte d’eau, fi
diviféê & fi évaporée qu’elle pût être, étoit toujours
de l ’eâü, & qu’un grain d’o r, partagé en dix
mille petites portions, étoit dans les dix mille parcelles
ce qu’il étoit en fon entier. Anaxagore en-
trevoyoit la vérité à cet égard ; & s’il avoit borné
fon principe aux natures fimples que l’expérience
nous montre indeftruâibles, il auroit eu raifon de
n’admettre en ces natures que de nouveaux affem-
blages, ou des defunions paffageres, & non de nouvelles
générations. Mais il s’éloigne de la vérité en
des points bien importans.
Sa première méprife eft d’étendre fon principe
aux corps mélangés. Il n’en eft pas du fang comme
de l’eau. Celle-ci eft fimple, au lieu que le fang eft
un compofé de différentes parcelles d’eau, d’huile
& de terre qui étoient dans la nourriture. Une fécondé
méprife eft d’étendre le même principe aux
corps organifés, comme fi une multitude de petites
entrailles pouvoient en quelque forte aider l’orga-
nifation des entrailles d’un boeuf ou d’un chameau ,
& de l’un plûtôt que de l’autre. Mais ce que j’appellerai
une impiété plûtôt qu’une méprife, eft de pen-
fer que D ieu , pour créer le monde, n’eût fait que
rapprocher & unir des matières déjà faites, enforte
qu’elles ne lui doivent ni leur être, ni leur excellence
; & que Ce qu’il y a de plus eftimable dans
l’univers, je veux dire, cette diverfité de natures
actuellement inaltérables, a précédé la fabrique du
monde, au lieu d’en être l’effet. Mais l’impiété de
cette philofophie trouve fa réfutation dans le ridicule
même qu’elle porte avec elle.
Vous demandez à Anaxagore quelle eft l’origine
d’un brin d’herbe : il vous répond en philofophe,
qu’il faut remonter à Yhoméomèrie, félon laquelle
Dieu n’a fait que rapprocher de petites herbes élémentaires
qui étoient comme lui de toute éternité.
Toutes chofes, dit-il, étoient enfemble pêle-mêle ( c’eft
ce qu’on peut appeller panfpermie, ou mélange de
toutes les femences ) ; & Vefprit venant enfuite, en a
compofé le monde. ( Diogen. Laert. lib. I I . n°. G. )
Si quelqu’un me demandoit de quelle laine & de
quelle main eft le drap que je porte; au lieu de dire,
c’ejl une laine de Ségovie, fabriquée par Pagnon , ou
par Van-Robes ; feroit-ce répondre jufte que de dire :
le drap étoit, & un tailleur en a pris des morceaux qu il
a coufus pour me faire un habit ? Mais il y a ici quelque
chofe de plus ridicule encore» Notre philofophe
raifonne fur l'origine des corps mixtes & des corps
organifés, comme celui qui voyant quelque rapport
entre la figure d’un chat & d’un tig re, diroit qu’un
tigre eft compofé de plufieurs petits chats, reunis
pour en former un très-gros ; ou comme celui qui
voulant nous apprendre l’origine des montres, nous
diroit qu’un ouvrier ayant trouvé quantité de montres
fi petites qu’on ne les voyoit pas., les avoit
amaffées dans une boëte, & en avoit fait une montre
qu’on pût voir. Hiß. du ciel, tom. II. p. 114.
HOMER ou CHOMER, f. m. (Hiß. anc.') mefüre
creule des Hébreux, qui contenoit dix baths, ou
deux cens quatre-vingt-dix-huit pintes, chopine ÔC
demi - feptier, un poiffon & un peu plus. Voye£
Ba th . Diction, de la Bible.
HOMÉRISTES, fub. pl. les Grecs donnoient ce
nom à des chanteurs, qui faifoient métier de chanter
dans les maifons, dans les rues & dans les places
publiques, les vers d’Homere. Voye^ C h anteur.
( * ) ^ HOMÉRITES (les) , Gèogr. anc. ancien peuple
de l’Arabie heureufe, qui faifoit partie des Sabéens,
avec lefquels bien des auteurs les ont confondus.
Le pays des Homérites répond à peu-près à ce que
nous appelions le pays d'Aden. (D . J. )
HOMICIDE, f. m. (Jurifprud.') fignifie en gé-»
néral une aétion qui caufe la mort d’autrui.
On entend aufli par le terme d'homicide, celui qur
commet cette aélion, & le crime que renferme cette,
aftion.
Il y a cependant certaines aftions qui caufent la'
mort d’autrui, que l’on ne qualifie pas d’homicides .
& que l’on ne confidere pas comme un crime ; ainfr
les gens de guerre, qui tuent des ennemis dans le
combat, ne font pas qualifiés d'homicides ; S>c lorfque
l’on execute un condamné à mort, cela ne s’appelle
pâs ün homicide , mais une exécution à mort, & celui
qui donne ainfi la m ort, ne commet point de crime ^
parce qu’il le fait en vertu d’une autorité légitime.
Suivant les lois divines & humaines, Yhomïcidt
volontaire eft un crime qui mérite la mort.
On voit dans le chap. iv. de la Genefe , que Caïn
ayant commis le premier homicide en la perfonne de
fon frere, fa condamnation fut prononcée par la
voix du Seigneur, qui lui dit que le fang de fon
frere crioit contre lui, qu’il feroit maudit fur la terre
; que quand il la labouréroit, elle ne lui porte-,
roit point de fruit ; qu’il feroit vagabond & fugitif.
Caïn lui-même dit que fon iniquité étoit trop grande
pour qu’elle pût lui être pardonr.ée ; qu’il fe ca-
cheroit de devant la face du Seigneur, & feroit errant
fur la terre; &que quiconque le trouveroit, le
tueroit. Il reconnoiffoit donc qu’il avoit mérité la
mort.
Cependant le Seigneur voulant donner aux hommes
un exemple de miféricordè, & peut-être aufli
leur apprendre qu’il n’appartient pas à chacun de
s’ingérer de donner la mort même envers celui qui
la mérite, dit à Caïn que ce qu’il craignoit n’arrive-
roit pas ; que quiconque le tueroit, feroit puni fept
fois ; & il mit un figne en Ca ïn , afin que quiconque
le trouveroit, ne le tuât point. Caïn fe retira donc
de la préfence du Seigneur, & habita, comme fugitif,
vers l’orient d’Eden. -
Il eft parlé dans le même chapitre de Lantech, qui
ayant tué un jeune homme, dit à ce fujet à fes fem-r
mes, que le crime de Caïn feroit vengé fept fois,
mais que le fien feroit puni foixante-dix-fept fois.
S. Chryfoftome dit que c’eft parce qu’il n’avoit pas.
profité de l’exemple de Caïn.
Dans le chapitre j x . où Dieu donne diverfes inf-
truftions à Noé, il lui dit que celui qui aura répandu
le fang de l’homme, fon fang fera aufli répandu i
car D ieu , eft-il d it, a fait l’homme à fon image.
Le quatrième article du Décalogue défend de tüer
indiftinélement.
Les lois civiles que contient l’Exode, chap. xxj. portent entre autres chofes, que qui frappera un
homme, le voulant tuer, il mourra de mort; que
s’il ne l’a point tué de guet-à-pens, mais que Dieu
l’ait livré entre fes mains, Dieu dit à Moyfe qu’il
ordonnera un lieu où le meurtrier fe retirera ; que
fi par des embûches quelqu’un tue fon prochain,
Moyfe l’arrachera de l’autel, afin qu’il meure ; que
fi un homme en frappe un autre avec une pierre ou
avec le poing, & que le battu ne foit pas mort, mais
qu’il ait été obligé de garder le lit , s’il fe leve en-
fuite , & marche dehors avec fon bâton, celui qui ,
l’a frappé fera réputé innocent, à la charge néanmoins
de payer au battu fes vacations pour le tems
qu’il a perdu, & le falaire des médecins ; que celui
qui aura frappé fon ferviteur ou fa fervante, & qu’ils
foient morts entre fes mains, il fera puni ; que fi le
ferviteur ou la fervante battus furvivent de quelques
jours, il ne fera point puni ; que fi dans une
rixe quelqu’un frappe une femme enceinte, & la
fait avorter fans qu’elle en meure, le coupable fera
tenu de payer telle amende que le mari demandera,
& que les arbitres régleront; mais que fi la mort
s’enfuit, il rendra vie pour v ie , oeil pour oe il, dent
pour dent, imain pour main, pié pour pié, brûlure
pour brûlure, plaie pour plaie, meurtriffure
pour meurtriffure.
Ces mêmes lois vouloient que le maître d’un
boeuf fût refponfable de fon délit ; que fi l’animal
avoit caufé la mort, il fût lapidé, & que le maître
lui-même qui auroit déjà été averti, & n’auroit pas
renfermé l’animal, mourroitpareillement ; n&is que
fi la peine lui en étoit impofée, il donneroit pour
racheter fa vie tout ce qu’on lui demanderoit : mais
il ne paroît pas que l’on eût la même faculté de racheter
la peine de Yhomicide que l ’on avoit commis
p erfonnelïement.
Le livre des Nombres, chap. 3 J . contient aufli
plufieurs réglemens pour la peine de Yhomicide ; fa-
v o ir , que les Ifraëlites défigneroient trois villes dans
la terre de Chanaan, & trois au-delà du Jourdain,
pour fervir de retraite à tous ceux qui auroient commis
involontairement quelque homicide ; que quand
le meurtrier feroit réfugié dans une de ces villes, le
plus proche parent de Yhomicidé ne pourroit le tuer
jufqu’à ce qu’il eût été jugé en préfence du peuple ;
que celui qui auroit tué avec le fer feroit coupable
d'homicide , & mourroit ; que celui qui auroit frappé
d’un coup de pierre ou de bâton, dont la mort
fe feroit enfuivie, feroit puni de même ; que le plus
proche parent du défunt tueroit Yhomicide aufli-tôt
qu il pourroit le faifir; que fi de deffein prémédité
quelqu’un faifoit tomber quelque chofe fur un autre
qui lui caufât la mort, il feroit coupable à!homicide9
& que le parent du défunt égorgeroit le meurtrier
aufîi-tot qu’il le trouveroit ; que f i, par un cas fortuit
& fans aucune haine, quelqu’un caufoit la
mort à un autre, & que cela fût reconnu en préfence
du peuple, & apres que la queftion auroit été
agitée entre le meurtrier & les proches du défunt,
que le meurtrier feroit délivré comme innocent de
la mort de celui qui vouloit venger la mort, & feroit
ramené en vertu du jugement dans la ville où
d s’étoit réfugié, & y demeureroit jufqu’à la mort
du grand-prêtre. Si le meurtrier étoit trouvé hors
des villes de refuge, celui qui étoit chargé de venger
la mort de Yhomicidé, pouvoit fans crime tuer
le meurtrier, parce que celui-ci devoit refter dans
la ville jufqu’à la mort du grand-prêtre ; mais, après
la mort de celui-ci, Yhomicide pouvoit retourner
dans fon pays. Ce réglement devoit être obfervé à
perpétuité. On pouvoit prou ve rYhomicide par té-
Tome V III%
moins ; ihàis ôn île pouvoir pas condamner fur la
dépohtion d un feul témoin. Enfin, celui qui étoit
coupable d'homicide, ne pouvoit racheter la peiné
de mort en argent, ni ceux qui étoient dans des
villes de refuge racheter la peine de leur exil.
Jeius-Chrilè, dans S. Matthieu, chap. v. dit qué
celm qui tuera, fera coupable de mort, nus érit jus.
A r 'u f dedans S. Jean, c % . ,g. lorfque Pilaf e dit
auxJuifs de lugerJefus-Chrift félon leur lo i , ils lut
répondirent qu,l ne leur étoit pas permis de tuer
perfonne: ainfi Ion obfervoit dès-Iôrs qu’il n’v
avoit que les juges qui puffent condamner un hom-
me à mort.
Enfin, pour parcourir toutes les lois que l’ÊctU
ture-fainte nous offre fur ce tte, matière , il eû dit
dans 1 Apocalypfe, chap. 22. que les homicides n'en-
treront point dans le royaume de Dieu.
Chez les Athéniens, le meurtre involontaire n’é-
toit puni que d’un an d’exil ; le meurtre de guet-à-
pens étoit puni du dernier fupplice> Mais ce qui eft
de fingulier, eft qu’on laiffoit au coupable la liberté
de le fauver avant que le juge prononçât fa fen-
tence ; & fi le coupable prenoit la fuite, on fe conten
a it de confifquer fes biens, & de mettre fa tête
à prix. Il y avoit à Athènes trois tribunaux diffé-
rens où les homicides étoient jugés ; favoir, l’aréopage
pour les affaflinats prémédités, le palladium
pour les homicides arrivés par cas fortuits , & le delphinium^
pour les homicides volontaires, mais que
l ’on foûtenoit légitimes.
La première loi qui fut faite fur cette matière
chez les Romains, eft de Numa Pompilius ; elle fut
inférée dans le code papyrien. Suivant cette lo i,
quiconque avoit tué un hommè de guet-à-pens(d/o/o),
étoit puni de mort comme un homicide ; mais s’il ne
1 avoit tue que par hafard & par imprudence, il en
etoit quitte pour immoler un bélier par forme d’expiation.
La première partie de cette loi de Numa
contre les affaflinats volontaires, fut tranfportée
dans les douze tables, après avoir été adoptée par
les décemvirs.
Tullus Hoftilius fit aufli une loi pour la punition
des homicides. Ce fut à l’occafion du meurtre commis
par un des Horaces ; il ordonna que les affaires
qui concerneroient le« meurtres, feroient jugées par
les décemvirs ; que fi celui qui étoit condamné, app
ela it de leur fentence au tribunal du peuple, cet
appel auroit lieu comme étant légitime ; mais que
fi par l’événement la fentence étoit confirmée, le
coupable feroit pendu à un arbre, après avoir été
fuftige ou dans la ville ou hors des murs. La procédure
que l’on tenoit en cas d’appel, eft très-bien détaillée
par M. Terraffon en fon hifioire de la Jurif prudence
Romaine fur la feizieme loi du code papyrien ,
qui fut formée de cette loi de Tullus Hoftilius.
La loi que Sempronius Gracchus fit dans la fuite
fous le nom de loi Semproniay de homicidiis, ne changea
rien à celles de Numa & de Tullus Hoftilius.
Mais Lucius Cornélius Sylla, étant di&ateur, l’an
de Rome 673 , fit une loi connue fous le nom de
loi Cornelia de ficariis. Quelque tems après la loi
des douze tables, les meurtriers furent appellés f i -
carii, du mot fica qui fignifioit une petite épée, recourbée
que l’on cachoit fous fa robe. Cette efpece
de poignard étoit défendue, & l’on dénonçoit aux
triumvirs ceux que l’on en trouvoit faifîs, à moins
que cet infiniment ne fût néceffaire au métier de
celui qui le portoit, par exemple fi c’étoit un cui-
finier qui eût fur lui un couteau.
Suivant cette loi Cornelia, fi le meurtrier étoit
élevé en dignité, on l’exiloit feulement ; fi c’étoit
une perfonne de moyen é ta t, on la condamnoit à
perdre la tête ; enfin, fi c’étoit ün e fd a v e , on le
crucifioit, ou bien on l’expofoit aux bêtes fauvages.
I i i j