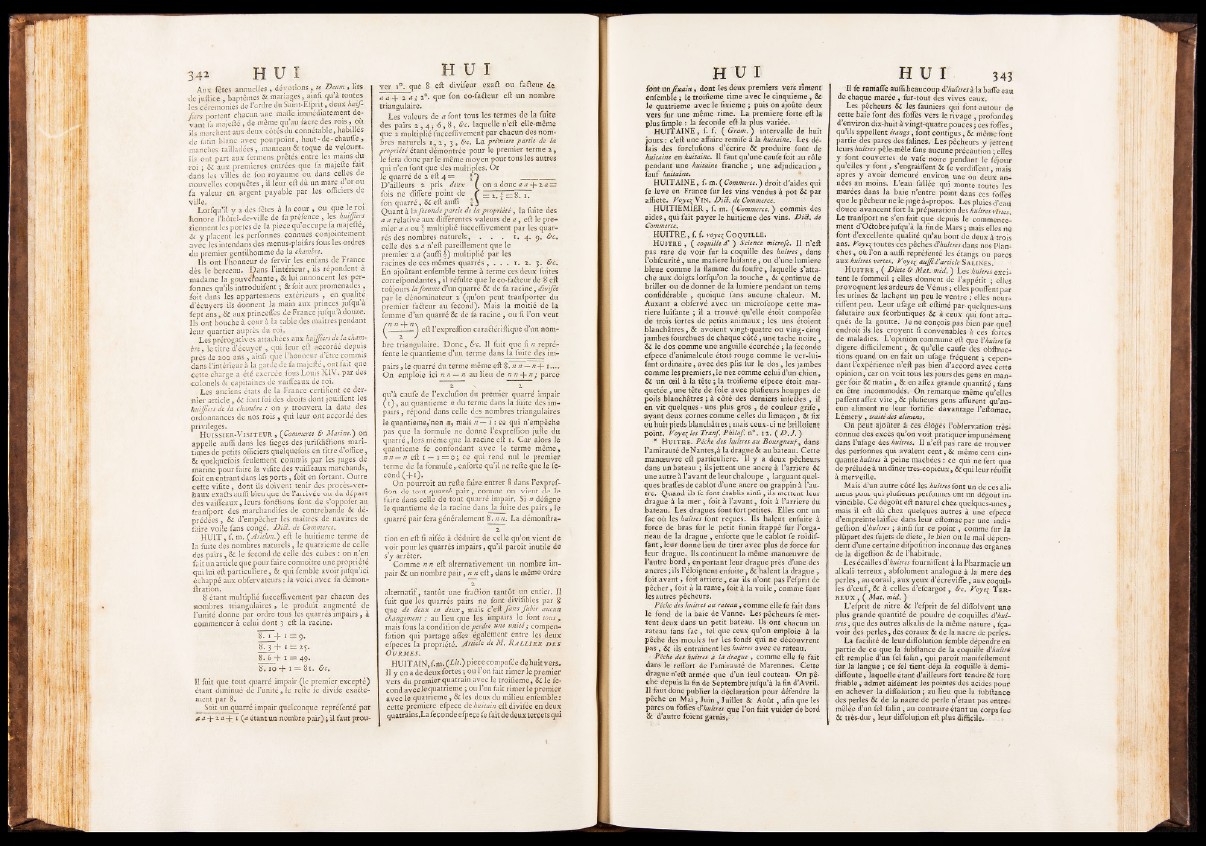
Aux fêtes annuelles , dévotions , te Deum, lits
de juftice baptêmes & mariages, ainfi qù à toutes
les ceremonies de l’ordre duSaint-Efpnt, deux huf-
Jïers portent chacun une maffe immédiatement devant
la majefte, de même qu’au facre des rois , pii
ils marchent aux deux côtés du connétable, habilles
de fatin blanc avec pourpoint, haut-de-chauffe,
manches tailladées, manteau & toque de velours.
Ils ont part aux fermens prêtés entre les mains du
roi ; & aux premières entrées que fa majefte fait
dans les villes de fon royaume ou dans celles de
nouvelles conquêtes, il leur eft dû un marc d’or ou
fa valeur en argent payable par les officiers de
viue. ï •
Lorfqu’il y a des fêtes à la cour , ou que le roi
honore l’hôtel-de-ville de fa préfence , les huiffurs
tiennent les portes de la piece qu’occupe fa majelte,
& y placent les perfonnes connues conjointement
avec les intendans des menus-plaifirs fous les ordres
du premier gentilhomme de la chambre.
Ils ont l’honneur de fervir les enfans de France
dès le berceau. Dans l’intérieur, ils répondent à
madame la gouvernante, & lui annoncent les personnes
qu’ils introduifent ; & foit aux promenades,
foit dans les appartemens extérieurs , en qualité
d’écuyers ils donnent la main aux princes jufqu’à
fept ans, & aux princefles de France jufqu’à douze.
Ils ont bouche à cour à la table des maîtres pendant
leur quartier auprès du roi.
Les prérogatives attachées aux huifjiers de la chambre,
le titre d’écuyer , qui leur eft accordé depuis
près de 200 ans , ainfi que l’honneur d’etre commis
dans l ’intérieur à la garde de fa majefte, ont fait que
cette charge a été exercée fous Louis XIV. par des
•colonels & capitaines de vaiffeaux de roi.
Les anciens états de la France certifient ce dernier
article, & font foi des droits dont jouiffent les
huifjiers de la chambre : on y trouvera la date des
ordonnances de nos rois , qui leur ont accorde des
privilèges. m. i H u issie r -Vis it e u r , ( Commerce & Marine.) on
appelle auffi dans les fieges des jurifdiftions maritimes
de petits officiers quelquefois en titre d’office,
& quelquefois feulement commis par les juges de
marine pour faire la vifite des vaiffeaux marchands,
foit en entrant dans les ports, foit en fortant. Outre
cette v ifite, dont ils doivent tenir des procès-verbaux
exatts auffi bien que de l’arrivée ou du départ
des vaiffeaux, leurs fondions font de s’oppofer au
tranfport des marchandifes de contrebande & dé-
prédées, & d’empêcher les maîtres de navires de
faire voile fans congé. Dicl. de Commerce.
HU IT, f. m. (Arithm.) eft le huitième terme de
la fuite des nombres naturels, le quatrième de celle
des pairs, & le fécond de celle des cubes : on n’en
fait un article que pour faire connoître une propriété
qui lui eft particulière, & qui femble avoir jufqu’ici
échappé aux obfervateurs: la voici avec fa démon-
ftratïon.
8 étant multiplié fucceffivement par chacun des
«ombres triangulaires > le produit augmenté de
l ’unité donne par ordre tous les quarrés impairs, à
commencer à celui dont 3 eft la racine.
8- 1 + 1 = 9*
8. 3 d- 1 = 25.
8 . 6 + 1 = 49.
8 .10 + 1 = 81. &c.
îl fuît que tout quarré impair (le premier excepté)
étant diminué de l’unité, le refte fe divife exactement
par 8.
Soit un quarré impair quelconque repréfenté par
a a + z a +■ 1 (a étant un nombre pair) ; il faut prouver
i° . que 8 eft divifeur exa£t ou fadeur de
a a + z a ; 20. que fon co-fadeur eft un nombre
triangulaire.
Les valeurs de a font tous les termes de la fuite
des pairs a , 4 * 6 , 8 , &c. laquelle n’eft elle-même
que 2 multiplié fucceffivement par chacun des nombres
naturels i , ,a , 3 , &c. La première partie de la
propriété étant démontrée pour le premier terme 2 ,
le fera donc par le même moyen pour tous les autres
qui n’en fqnt que des multiples. Or
le quarré de 2 eft 4 = f ") _______ ,
D ’ailleurs 2 pris deux f on a donc a a + 2 a =
fois ne différé point de f — z> 1 — 8. 1.
fon quarré, & eft auffi f-) 1
Quant à la fécondé partie de la propriété, la fuite des
a a relative aux différentes valeurs de a , eft le premier
a a ou f- multiplié fucceffivement par les quarrés
des nombres naturels, . . . 1. 4. 9. &c.
celle des 2 a n’eft pareillement que le
premier 2 a (auffi f ) multiplié par les
racines de ces mêmes quarrés , . . . 1. a. 3. &c.
En ajoutant enfemble terme à terme ces deux fuites
correfpondantes, il réfulte que le co-fadeur de 8 eft
toujours la fomme d’un quarré & de fa racine, divifèe
par le dénominateur 2 (qu’on peut tranfporter du
premier fadeur au fécond). Mais la moitié de la
fomme d’un quarré & de fa racine , ou fi l’on veut
ç i n + n\^ l’expreffion caradériftique d’un nombre
triangulaire. D o n c , &c. Il fuit que fi n repréfente
le quantieme d’un terme dans la fuite des impairs,
le quarré du terme même eft S .n n — /*+ 1...»
On emploie ici n n — n au lieu de n n - \ - n ; parce
2 v 2
qu’à caüfe de l ’exclufion du premier quarré impair
( 1 ) , au quantieme n du terme dans la fuite des impairs
, répond dans celle des nombres triangulaires
le quantieme,'non n, mais n — 1 : ce qui n’empêche
pas que la formule ne donne l’expreffion jufte du
quarré, lors même que la racine eft 1. Car alors le
quantieme fe confondant avec le terme même,
n n — n eft 1 — 1 = 0 ; ce qui rend nul le premier
terme de la formule , enforte qu’il ne refte que le fécond
(+ 1 ) .
On pou’rroit au refte faire entrer 8 dans l’expreffion
de tout quarré pa ir, comme on vient de le
faire dans celle de tout quarré impair. Si n défigne
le quantieme de la racine dans la fuite des pairs , le
quarré pair fera généralement 8. n n . La démonftra-
2
tion en eft fi aifée à déduire de celle qu’on vient de
voir pour les quarrés impairs, qu’il paroît inutile de
s’y arrêter.
Comme n n eft alternativement un nombre impair
& un nombre pair, n n e ft , dans le même ordre
.2
alternatif, tantôt une fra&ion tantôt un entier. II
fuit que les quarrés pairs ne font divifibles par 8
que de deux en d eu x , mais c’eft fu n s fubir aucun
changement : au lieu que les impairs le font tous ,
mais fous la condition de perdre une unité ; compen-
fation qui partage affez également entre les deux
efpeces la propriété. Article de M. R a l l i e r d e s
O u r m e s .
HUITAIN,f.m. (.Lit.') piece compofée dehuit vers.
Il y en a de deux fortes ; ou l’on fait rimer le premier
vers du premier quatrain avec le troifieme, & le fécond
avec le quatrième ; ou l’on fait rimer le premier
avec le quatrième, & les deux du milieu enfemble :
cette première efpece de huitain eft divifée en deux
quatrains.La fécondé efpeçe fe fait de deux tercets qui
font un fixa in , dont les deux premiers vers riment:
enfemble ; le troifieme rime avec le cinquième, &
le quatrième avec le fixieme ; puis on ajoute deux
vers fur une même rime. La première forte eft la
plusfimple : la fécondé eft la plus variée.
HUITAINE, f. f. ( Gram. ) intervalle de huit
jours : c’eft une affaire remife à la huitaine. Les délais
des forclufions d’écrire & produire font de
huitaine en huitaine. Il faut qu’une caüfe foit au rôle
pendant une huitaine franche ; une adjudication,
ia u f huitaine.
HUITAINE, f. m. ( Commerce. ) droit d’aides, qui
fe leve en France fur les vins vendus à pot & par
affiete. VoyefVIN. Dicl. de Commerce.
HUITIEMIER , f. m. ( Commerce, y commis des
aides, qui fait payer le huitième des vins. Dicl. de
Commerce.
HUITRE, f. f. voyei C o q u il l e .
H u ît r e , ( coquille <£ ) Science microfc. Il n’eft
pas rare de voir fur la coquille des huîtres, dans
l’obfcurité, une matière luifante, ou d’une lumière
bleue comme la flamme du foufre, laquelle s’attache
aux doigts lorfqu’on la touche , & cpntinue de
briller ou de donner de la lumière pendant un tems
confidérable , quoique fans aucune chaleur. M.
Auxant a obfervé avec un microfcope cette matière
luifante ; il a trouvé qu’elle étoit compofée
de trois fortes de petits-animaux ; les uns étoient
blanchâtres, & avoient vingt-quatre ou ving-cinq
jambes fourchues de chaque cô té , une tache noire,
& le dos comme une anguille écorchée ; la fécondé
efpece d’animalcule étoit rouge comme le ver-lui-
fant ordinaire, avec des plis fur le dos, les jambes
comme les premiers, le nez comme celui d’un chien,
& un oeil à la tête ; la troifieme efpece étoit marquetée
, une tête de foie avec plufieurs houppes de
poils blanchâtres. ; à côté des derniers infe&es , il
en v it quelques - uns plus gros , de couleur grifie,
ayant deux cornes comme celles du limaçon , & fix
ou huit pieds blanchâtres ; mais ceux-ci ne brilloient;
point. Voyelles Tranf. Philof. n°. 12. ( D .J . )
* Hu ît r e . Pêche des. huîtres au Bourgneuf, dans
l’amirauté d e Nantes,à la drague & au bateau. Cette
manoeuvre eft particulière. Il y a deux pêcheurs
dans un bateau ; ils jettent une ancre à l’arriere &
une autre à l’avant de leur chaloupe , larguant quelques
braffes de cablot d’une ancre ou grappin à l’autre.
Quand ils fe font établis ainfi, ils mettent leur
drague à la mer, foit à l’avant, foit à l’arriere du
bateau. Les dragues font fort petites. Elles ont un
fac où les huîtres font reçues. Ils halient enfuite à
force de bras fur le petit funin frappé fur l’organeau
de la drague , enforte que le cablot fe roidif-
fânt, leur donne lieu de tirer avec plus de force fur
leur drague. Ils continuent la- même manoeuvre de
l ’autre bord, en portant leur drague près d’une des
ancres ; ils l’éloignent enfuite, & halent la drague,
foit- a van t, foit arriéré, ear ils n’ont pas l’efprit de
pêcher, foit à la rame, foit à la vo ile , comme font
les autres pêcheurs.
Pêche des huîtres au rateau, comme elle fe fait dans
le fond de la baie de Vanne. Les pêcheurs fe mettent
deux dans un petit bateau. Ils ont chacun un
rateau fans fac , tel que ceux qu’on emploie à la
pêche dés moules fur les fonds qui ne découvrent
pas , & ils entraînent les huîtres avec ce rateau.
A Pêche des huîtres à la drague , comme elle fe fait
dans le reffort de l’amirauté de Marennes. Cette
drague n’eft armée que d’un feul couteau^ On pêche
depuis la fin de Septembre jufqu’à la fin d’Avril.
11 A^aut donc publier la déclaration pour défendre la
pêche en Mai, Juin , Juillet & A o û t , afin que les
parcs ou foffes £ huîtres que l’on fait vuider de bord
& d’autre foient garnis,- -
II fé ramaffe auffi beaucoup £ huîtres à la baffe eau
de chaque marée , fur-tout des vives eaux;
Les pêcheurs & les fauniers qui font autour de
eette baie font des foffes vers le rivage , profondes
d’environ dix-huit à vingt-quatre pouces ; ces foffes
qu’ils appellent étangs, font contigus, & même font
partie des parcs des falines. Les pêcheurs y jettent
leurs huîtres pêle-mêle fans aucune précaution ; elles
y font couvertes de vafe noire pendant le féjour
qu’elles y font , s’engraiffent & fe verdiffent, mais
açres y avoir demeuré environ une ou deux années
au moins. L’eau fallée qui monte toutes les
marées dans la baie n’entre point dans ces foffes
que le pêcheur ne le jugé à-propos. Les pluies d’eaii
douce avancent fort la préparation des huîtres vîrtes.
Le tranfpor-t ne s’en fait que depuis le commencement
d’O&obre jufqu’à la fin de Mars ; mais elles ne
font d’excellente qualité qu’au bout de deux à trois
ans. Voye^ toutes ces pêches £ huîtres dans nos Planches,
où l’on a auffi repréfenté les étangs ou parcs
aux huîtres, vertes. Voye^ auffi L'article Sa u n e s .
H u ît r e , ( Diete & Mat. méd. ) Les huîtres excitent
le fommeii ; elles donnent de l’appétit ; elles
provoquent les ardeurs de Vénus ; elles pouffent pat
les urines & lâchent un peu le ventre ; elles nour-
riffent peu. Leur ufage eft eftimé par-quelques-uns
falutaire aux feorbutiques & à ceux qui font attaqués
de la goutte. Je ne conçois pas bien par quel
endroit ils les eroyent fi convenables à ces fortes
de maladies. L’opinion commune eft que l’huître fë
digéré difficilement, & qu’elle caüfe des obftruc^
tiens qua®4 on en fait un ufage fréquent ; cepen-
dant l’expérience n’eft pas bien d’accord avec cette
opinion, car on voit tous les jours des gens en man-
ger foir & m atin, & en affez grande quantité, fans
en être incommodés. On remarque même qu’elles
paffent affez v ite , & plufieurs gens affurent qu’au-
eun aliment ne leur fortifie davantage l’eftomac.
Lémery , traité des alimens.
On peut ajoûter à ces élogès.I’obfervation très-
connue des excès qu’on voit pratiquer impunément
dans l’ufage des huîtres. Il n’eft pas rare de trouver
des perfonnes qui avalent cent, & même cent cinquante
huîtres à peine mâchées : ce qui ne fert que
de prélude à un dîner très-copieux, & qui leur réuffit
à merveille.
Mais d’un autre côté Iqs huîtres font un de ces ali-
mens pour qui plufieurs perfonnes ont un dégoût invincible.
Ce dégoût eft naturel chez quelques-unes,
mais il eft dû chez quelques autres à une efpece
d’empreinte laiffée dans leur eftomaepar une indi-
geftion d'huîtres ; ainfi fur ce point, comme fur la
plûpart des liijets de diete, le bien ou le mal dépendent
d’une certaine difpofition inconnue des organes
de la digeftion & de l’habitude.
Les écailles d'huîtres fourniffent à la Pharmacie un
alkali terreux, abfolument analogue à la mere des
perles, au corail, aux yeux d’écreviffe, aux coquilles
d’oeuf, & à celles d’efeargot, &c. Voye^ T e r r
e u x , ( M a t . méd, )
L’efprit de nitre & l’efprit de fel diffolvent une
plus grande quantité de poudre de coquilles d'huîtres,
que des autres alkalis de la même nature , fça-
voir des perles, des coraux & de la nacre de perles*
La facilité de leur diffolution femble dépendre en
partie de ce que la fubftance de la coquille d'huître
eft remplie d’un fel falin, qui paroît manifeftement
fur la langue ; ce fei tient déjà la coquille à demi-
diffoute, laquelle étant d’ailleurs fort tendre & fort
friable, admet aifément les pointes des acides pour
en achever la diffolution ; au lieu que la fubftance
des perles & de la nacre de perle n’étant pas entremêlée
d’un fel falin, au contraire étant un corps leu
& très-dur, 1 eur diffo lu tion eft plus- difficile. I