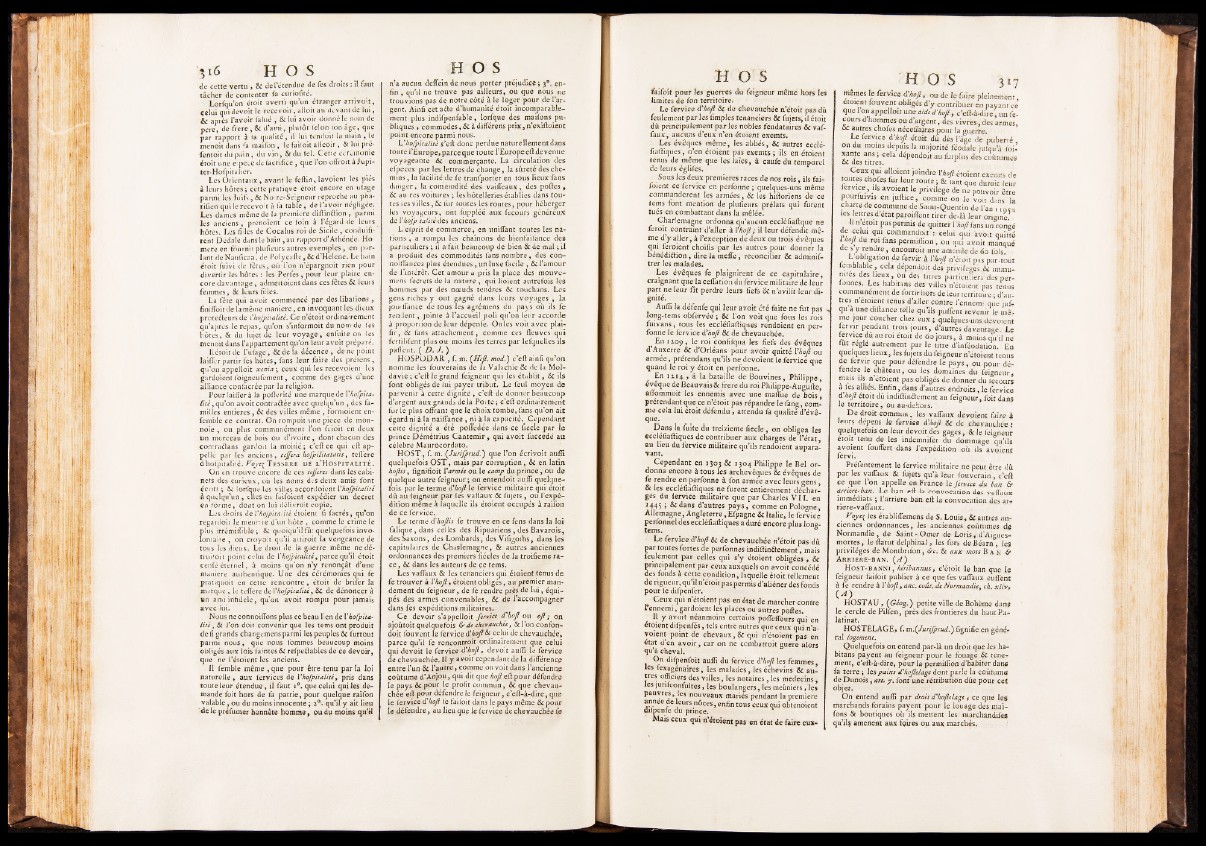
516 H O S
de cette vertu , & de détendue de Tes droits : il faut
tâcher de contenter fa curiofite. 1
Lorfqu’on éioit averti qu’un étranger arnvoit,
celui quidevoit le recevoir, alloit au devant de lui,
& après l’avoir falué , & lu i avoir donné le nom de
pere, de frere , & d’ami, plutôt félon ion âge, que
par rapport à la qualité, il lui tendoit la main, le
menoit dans fa maifon , lefailoit a lleoir, & ltii pré-
fentoit du pain, du vin, &du lel. Cene ceremonie
étoit une eipecè de lacrifice , que l’on oftroit à Jupi-
ter-Hofpitaher.
Les Orientaux , avant le feftin, lavoient les piés
à leurs hôtes ; cette pratique étoit encore en ulage
parmi les Juifs, & No:re-Seigneur reproche au pha-
rifien qullerecevoit à fa table, de l’avoir négligée.
Les dames même de la première diftinélion , parmi
les anciens, prenoient ce foin à l'égard de leurs
hôtes. Les filles de Cocalus roi de Sicile , conduifi-
rent Dédale dans le bain, au rapport d’Athénée. Ho
mere en fournit plufieurs autres exemples , en parlant
de Nauficaa, de Polycafte, 6c d’Helene. Le bain
étoit fuivi de fêtes, où l’on n’épargnoit rien pour
divertir les hôtes : les Perles , pour leur plaire encore
davantage, admettoientdans ces fêtes 6c leurs
femmes, & leurs fiiles.
La fête qui avoit commencé par des libations,
finiffoit de la même maniéré, en invoquant les dieux
proteâeursde Ÿhofpit alité. Ce n’étoit ordinairement
qu’après le repas, qu’on s’informoit du nom de les
hôtes, & du fujetde leur v o y a g e , enfuite on les
menoit dans l’appartement qu’on leur avoit préparé.
Il étoit de l’ul'age, & de la décence , de ne point
laifler partir fes hôtes, fans leur faire des prélens,
qu’on appelloit xenia ; ceux qui les recevoient les
gardôient foigneufement, comme des gages d’une
alliance conlacrée par la religion.
Pour laifler à la pofterité une marque de l'hofpita-
lité, qu’on avoit contrariée avec quelqu’un , des familles
entières, 6c des villes même , formoient en-
femble ce contrat. On rompoit une piece de mon-
noie , ou plus communément l’on feioit en deux
un morceau de bois ou d’ivoire, dont chacun des
contraflans garcloit la moitié ; c’eft ce qui eft appelle
par les anciens, tejftra hofpilitatatis, telTere
d’hofpitaliié. T essere d e l’Ho s p it a l it é .
On en trouve encore de ces tefferes dans les cabinets
des curieux, où les noms des deux amis font'
écrits ; & lorfque les villes accordoient Yhofpitalitc
à quelqu’un, elles en fail'oient expédier un decret
en forme, dont on lui délivroit copie.
Les droits de Y hofpitalité étaient li 1 acres, qu’on
regardoit le meurtre d'un hôte , comme le crime le
plus irrémiffible ; 6c quoiqu’il fut quelquefois involontaire
, on croyoit qu’il aitiroit la vengeance de
tous les dieux. Le droit de la guerre même nedé-
truifôit point celui de Yhofpitalité, parce qu’il étoit
cenfé éternel, à moins qu’on n’y renonçât d’une
maniéré authentique. Une des cérémonies qui fe
pratiquoit en cette rencontre, étoit de brifer la
marque , le telTere de Y hofpitalité, 6c de dénoncer à
un ami infidèle, qu'on avoit rompu pour jamais
avec lui.
Nous ne connoiffons plus ce beau lien de Yhofpitalité
, & l’on doit convenir que les tems ont produit
de fi grands changemensparmi les peuples 6c furtout
parmi nous, que nous l'ommes beaucoup moins
obligés aux lois faintes & refpeûabies de ce devoir,
que ne l’étoient les anciens.
11 femble même , que pour être tenu par la loi
naturelle, aux fervices de V hofpitalité, pris dans
toute leur étendue, il faut i°. que celui qui les demande
foit hors de fa patrie, pour quelque raifon
valable, ou du moins innocente ; qu’il y ait lieu
de le préfumer honnête homme, ou du moins qu’il
HO S n’a aucun deffeinde nous porter préjudiçç ; 3®, enfin
, qu’il ne trouve pas ailleurs, ou que nous ne
trouvions pas de notre côté à le loger pour de l’argent.
Ainfi cet a&e d’humanité étoit incomparablement
plus indifpenfable, lorfque des mailbns publiques
» commodes, & à différent prix, n’exiftoient
point encore parmi nous.
L'hofpitalité s’eft donc perdue naturellement dans
toute l’Europe, parce que toute l’Europe eft devenue
voyageante 6c commerçante. La circulation des
efpeces par les lettres de change, la sûreté des chemins
, la facilité de fe tranfporter en tous lieux fans
danger, la commodité des vaiffeaux, des portes , 6c au.res voitures ; les hôtelleries établies dans toutes
les v illes, 6c fur toutes les routes, pour héberger
les voyageurs, ont fuppléé aux fecours généreux
de Y hofpitalité des anciens.
L'eiprit de commerce, en unifiant toutes les nations
, a rompu les chaînons de bienfaifance des
particuliers ; il a fait beaucoup de bien & de mal ; il
a produit des commodités fans nombre, des con-
noùîances plus étendues, un luxe facile , & l’amour
de l ’intérêt. Cet amour a pris la place des mouve-
mens fecrets de la nature , qui lioient autrefois les
hommes par des noeuds tendres 6c tôuchans. Les
gens riches y ont gagné dans leurs voyages , la
jouiftance de tous les agrémens du pays où ils fe
renient, jointe à l’accueil poli qu’on leur accorde
à proportion de leur dépenfe. On les voit avec plai-
f ir , 6c fans attachement, comme ces fleuves qui
fertilifent plus ou moins les terres par lel'quelles ils
paffent. ( D . J. )
HOSPOD AR , f. m. (Hifi. moi.') c’eft alnfi qu’on
nomme les fouverains de la Valachie & de la Molda
vie; c’ eft le grand feigneur qui les établit, 6c ils
font obligés de lui payer tribut. Le feul moyen de
parvenir à cette dignité , c’eft de donner beaucoup
d’argent aux grandi delà Porte; c’eft ordinairement
furie plus offrant que le choix tombe, fans qu’on ait
égard ni à la naiffance , ni à la capacité. Cependant
cette dignité a été poffedée dans ce fiecle par le
prince Démétrius Cantemir , qui avoit fuccedé au
célébré Maurocordato.
H O ST , f. m. (Jurifprud.) que l’on écrlvoit aufli
quelquefois O S T , mais par corruption, 6c en latin
hofi’is, lignifioit Y armée ou le camp du prince, ou de
quelque autre feigneur ; on entendoit aufli quelquefois
par le terme d'hofi le fervice militaire qui étoit
dû au feigneur par fes vaflaux 6c fujets, ou l’expédition
même à laquelle ils étoient occupés à raifon
de ce fervice.
Le terme à'hofiis fe trouve en ce fçns dans la loi
falique,dans celles des Ripuariens , des Bavarois,
des Saxons, des Lombards, des V ifigoths, dans les
capitulaires de Charlemagne, & autres anciennes
ordonnances des premiers liécles de la troifieme race
, & dans les auteurs de ce tems.
Les vaflaux & les tenanciers qui étoient tenus de
fe trouver à Y kofi, étoient obligés, au premier mandement
du feigneur, de fe rendre près de lu i, équipés
des armes convenables, 6c de l ’accompagner
dans fes expéditions militaires.
Ce devoir s’appelloit fervice d'hofi ou ofi; on
ajoûtoit quelquefois & de chevauchée, 8c l’on confon-
doit fouvent le fervice d'hofi & celui de chevauchée,
parce qu’il fe rcncontroit ordinairement que celui
qui devoit le fervice d'hofi, devoit aufli le fervice
de chevauchée. Il y avoit cependant delà différence
entre l’un 6c l’autre, comme on voit dans l’ancienne
coutume d’Anjou, qui dit que hofi eft pour défendre
le pays 6c pour le profit commun, & que chevauchée
eft pour défendre le feigneur, c’eft-à-dire, que
le lervice d'hofi fe faifoit dans le pays même &pour
le défendre, au lieu que le fervice de chevauchée Çe
H O S
faifoit pouf les guerres du feigneur trtêiné hors les
limites de fon territoire.
Le fervice d'hofi 6c de chevauchée n’étoit pas dû
feulement par les Amples tenanciers & fujets, il étoif
dû principalement par lés nobles feudataires & vaf-
faux, aucuns d’eux n’en étoient exemts.
Les évêques même, les abbés, 6c autres eccléfiaftiques
, n’en étoient pas exemts ; ils en étoient
tenus de même que les laïcs, à caufe du temporel
de leurs églifçs.
Sous le$ deux premières races de nos rois, ils fai-
foient ce fervice en perfonne ; quelques-uns même
commandèrent les armées, 6c les hiftoriens de ce
tems font mention de plufieurs prélats qui furent
tués en combattant dans la mêlée.
Charlemagne ordonna qu’aucun eccléfiaftque ne
feroit contraint d’aller à Y hofi ; il leur défendit même
d y aller, à l’exception de deux ou trois évêques
qui feroient choifis par les autres pour donner la
bénédiâion, dire la mefle, réconcilier & adminif-
trer les malades.
Les évêques fe plaignirent de ce capitulaire,
craignant que la ceffation du fervice militaire de leur
part ne leur fît perdre leurs fiefs 6c n’avilît leur dignité.
Aufli la défenfe qui leur avoit été faite ne fut pas ^
long-tems obfervée ; 6c Ton voit que fous les rois
fuivans, tous les eccléfiaftiques rendoient en personne
le fervice d'hofi 6c de chevauchée.
En 1109 , le roi confilqua les fiefs des évêques
d’Auxerre & d’Orléans pour avoir quitté Yhofi ou
armée, prétendans qu’ils ne dévoient le fervice que
quand le roi y étoit en perfonne.
En 12.14, à la bataille de Bouvines, Philippe,
évêque de Beauvais & frere du roi Philippe-Augufte,
aflommoit les ennemis avec une maflue de bois,
prétendant que ce n’étoit pas répandre le fang, comme
cela lui étoit défendu , attendu fa qualité d’évêque.
Dans la fuite du treizième fiecle, on obligea les
eccléfiaftiques de contribuer aux charges de l’état |
au lieu du fervice militaire qu’ils rendoient auparavant.
Cependant en 1303 & 1304 Philippe le Bel ordonna
encore à tous les archevêques 6c évêques de
fe rendre en perfonne à fon armée avec leurs gens,
& les eccléfiaftiques ne furent entièrement déchargés
du fervice militaire que par Charles V I I . en
J445 9 &dans d’autres p a y s , comme en Pologne,
Allemagne, Angleterre, Efpagne & Italie, le fervice
perfonnel des eccléfiaftiques a duré encore plus long-
Le fervice d'hofi 6c de chevauchée n’étoit pas dû
par toutes fortes de perfonnes indiftinôement, mais
feulement- par celles qui s'y étoient obligées , 6c
principalement par ceux auxquels on avoit concédé
des fonds à cette condition, laquelle étoit tellement
de rigueur, qu il n étoit pas permis d’aliéner des fonds
pour fe difpenfer.
Ceux qui n’étoient pas en état de marcher contre
rennemi, gardôient les places ou autres portes.
Il y avoit néanmoins certains poffefleurs qui en
étoient difpenfés, tels entre autres que ceux qui n’a-
voient point de chevaux, & qui n’étoient pas en
état d’en a vo ir , car on ne ccmbattoit guere alors
qu’à cheval.
On difpenfoit aufli du fervice d'hofi les femmes,
les fexagénaires, les malades, les échevins 6c au-
tres officiers des ville s , les notaires, les médecins,
les junfconfultes, les boulangers, les meuniers, les
pauvres, les nouveaux mariés pendant la première
année de leurs nôces, enfin tous ceux qui obtenoient
«Jilpeole du prince.
Mais ceux qui ri’étoient pas en état de faire eux-
H O S 3 0
memes le fervice i'hoft, ou de le faire pleinement
eloient fouvent obligés d’y. contribuer en payant ce’
rjue I on appelloit une aidt d'hof, c’eÆà-dire * un fecours
d hommes ou d>r|ent, des vivres-, des armes,
pe autres chafes néceflafres pour la guerre.
Le fervice A’hoft étoit dû dès l’âge de puberté ,
on du moins depuis la majorité féodale julqu’à foi-
xante ans ; cela dépendojt au fuiplus-des coutumes
& des titres. I I M M I a ‘lo“ n t H B étaient exemts de
routes cho fes fur leur route ; & tant que durait leur
fervice , ils avoient le p r i v é e de ne pouvoir être
pourluivis en juftice, cpmme on le voit dans la
charte de commune de Saint-Quentin de l’an i f e
lesrfettres d’état paroiffent.tirer de-là leur origine.
II u etoit pas permis de quitter Yhofi fans un congé
f»? 1 Sul. command o if : celui qui avoit quitté
Ihoft du roi fans permiffion, ou qui avoit ihanqué
de s y rehdre, encouroit une amende de 60 fols,
1 ^obligation de Servir à Yhofi n’éroit pas par-tout
1 eniDiable, cela dépendent des privilèges & immunités
des lieux, oii des titres particuliers' des per-
lonnes. Les habitans des villes n’étoient pas tenus
communément de fortir hors 4e leur territoire ; d W
très n’étoient tenus d’aller contre l’ennemi que juf-
qu a une diftance telle qu’ils puffent revenir le mêr
me jour coucher chez eux ; quelques-uns d.ev.oient
lcrvir pendant trois jours, d’autres davantage. Le
lervicedû au roi étoit de 60 jours, à moins qu’il ne
tut régie autrement par le titre d’inféodation. En
quelques lieux, les fujets du feigneur n’étoient tenus
de fervir que pour défendre le pa ys, ou pour défendre
le château, ou les domaines du feigneur,
mais ils n etoient pas obligés de donner du lecours
a ies alliés. Enfin, dans d’autres endroits, le fervice
d hofi etoit du indiftin&ement au feigneur, foi.t dans
le territoire, ou au-dehors.
D e droit commun, les yaflaux dévoient faire à
leurs dépens le fervice d'hofi 6c de chevauchée f
quelquefois on leur devoit des gages, & le feianeur
étoit tenu de les indemnifer du dommage qu’ils
avoient fouffert-dans l’expédition. .oit ils avoienf
fervi.
Préfentement le fervice militaire ne peut,être dû
par les vaflaux & fujets qu’à leur fouverain, c’eft
çe que l’on appelle en France le fervice du baji &
arriere-ban. Le ban eft la convocation des vaflaux
immédiats ; l’arriere ban. eft la convocation dès ar*
riere-vaflaux.
yoye[ ies établiffemens de S. Louis, & autres anciennes
ordonnances, les anciennes coutumes d$
Normandie, de Saint-Oqier de Loris, d’Aigues-»
mortes, le ftarut delphinal, les fors de Béarn , les
privilèges de Montbrifon, àc. & aux mots B a n é
Ar r ie r e -ban. ( ^ )
Ho s t -b a n n i, kéribannus, c’étoit le ban que le
feigneur faifoit publier à ce que fes vaflaux euffent
à fe rendre à Yhofi, anc. coût, de Normandie. ch. xliv•
HO STAU , (Géog.') petite ville de Bohème dans
le cercle de Pilfen, près des frontières du hautPa*
latinat.
HOSTELAGE, f. m.ÇJuriJprud.') lignifie en géné«*
rai logement.
Quelquefois on entend parrià un droit que les ha-*
bitàns payent au feigneur pour le fouage Ôç tene-
ment, c’eft-à-dire, pour la permiffion d’habiter dan«
fa terre ; les pains d'hofielage dont parle la co'ûtumal
de Danois, art. y . font une rétribution due pour cet
objet.
On entend aufli paf droit d'hofielage, ce que les
marchands forains payent pour le -louage des .mai-
fons 8e boutiques où ils mettent les marchandiles
qu’ils amènent aux foires ou aux marchés.