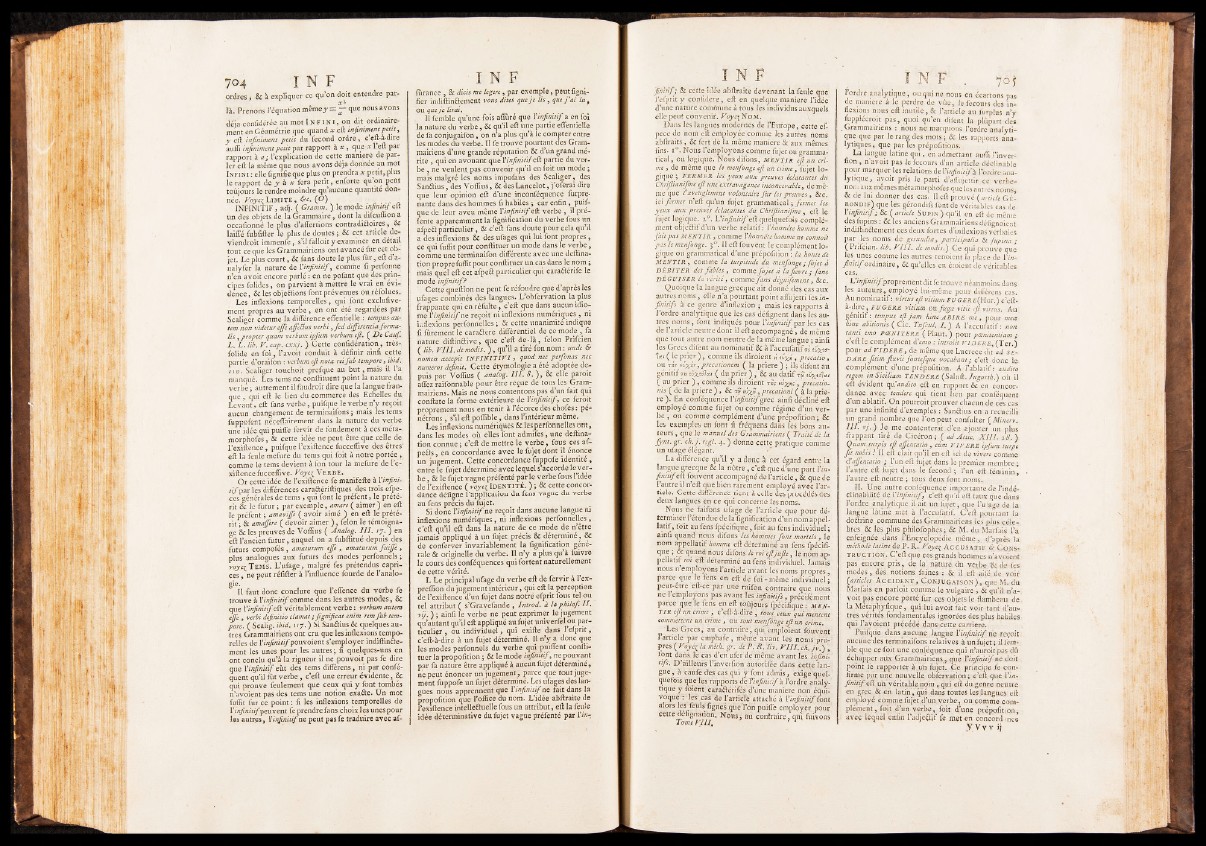
7°4 I N F ordres > & à expliquer ce qu’on doit entendre par-
là. Prenons l’équation meme y = — que nous avons
déjaconfidérée gu mot I n f i n i , on dit ordinairer
ment en Géométrie que quand x eft infiniment petit,
y eft infiniment petit du fécond ordre, ceft-à-dire
aufli infiniment petit par rapport à x , que x l.eft par
rapport à a; l’explication de cette maniéré de parler
eft la même que. nous avons déjà donnée au mot Infini : elle fignifie que plus on prendra * petit,,plus
le rapport de y k x fera petit, enforte qu’on peut
toujours le rendre moindre qu’aucune quantité don-r
née. Koye{Lim it e , & c. (Ô)
INFINITIF , adj. ( Gramm. ) le mode, infinitif eft
un des objets de la Grammaire , dont la difcuffiona
occafionné le plus d’affertions çontradiéloires, &
laiffé fubfifter le plus de doutes ; & cet article de-
viendroit immenfe, s’il falloit y examiner en détail
tout ce que les Grammairiens ont avancé fur cet objet.
Le plus court, & fans doute le plus fûr, eft d’a-
nalyfer la nature de l’infinitif, comme fi perfonne
n’en avoit encore parlé : en ne pofaot que des principes
folides, on parvient à mettre le vrai en évidence
, & les objeriions font prévenues pu réfolues.
Les inflexions temporelles, qui font exclufi veinent
propres au verbe , en ont été regardées par
Scaliger comme la différence effentielle : tempus au-
tem non videtur effe ajfeclus verbi, fed differentia formct-
lis , propter quam verbum ipfum verbum eft. ( De Cauf.
L. L. lib. V. cap. cxxj. ) Cette confidération, très-
folide en f o i , l’avoit conduit à définir ainfi cette
partie d’oraifon : verbum ejl nota ni fub tempore, ibid.
i io. Scaliger touchoit prefque au b u t , mais il l’a
manaué. Les tems ne conftituent point la nature du
verbe ; autrement il faudroit dire que la langue franque
, qui eft le lien du commerce des Echelles du
Levant, eft fans verbe, puifque le verbe n’y reçoit
aucun changement de terminaifons ; mais les tems
fuppofer.t néceffairement dans la nature du verbe
une idée qui puiffe fervir de fondement à ces méta--
morphofes, & cette idée ne peut être que celle de
l ’exiftence, puifque l’exiftence fucceflive des êtres'
eft la feule mefure du tems qui foit à notre portée ,
comme le tems devient à fon tour la mefure de l’exiftence
fucceflive. Voye^ Verbe.
Or cette idée de l’exiftence fe manifefte à Vinfini-
t if par les différences cara&ériftiques des trois efpe-
ces générales de tems, qui font le préfent, le prétérit
& le futur ; par exemple, amare ( aimer ) en eft
le préfent ; amaviffe ( avoir aimé ) en eft le prétérit
; & amaffere ( devoir aimer ) , félon le témoignage
& les preuves de Vofîius ( Analog. I I I . iy . ) en
eft l’ancien futur, auquel on a fubftitué depuis des
futurs compofés , amaturum effe ,. amaturum fuiffe ,
plus analogues aux futurs des modes perfonnels ;
voye^ T ems. L’ufage, malgré fes prétendus caprices
, ne peut réfifter à l’influence fourde de l’ana.lo-
gie.I
l faut donc conclure que l’effence du verbe fe
trouve à Y infinitif comme dans les autres modes, &
que l’infinitif eft véritablement verbe : verbum autem
effe , verbi definitio clamat; fignificat enim rem fub tempore.
( Scalig. ibid. i /y. ) Si San&ius & quelques autres
Grammairiens ont cru que les inflexions temporelles
de Yinfinitif pouvoient s’employer indiftin&e-
ment les unes pour les autres ; fi quelques-uns en
ont conclu qu’à la rigueur il ne pouvoit pas fe dire
que Yinfinitif eût des tems différens, ni par confé-
quent qu’il fut v erbe, c’eft une erreur évidente, &
qui prouve feulement que ceux qui y font tombés
n’avoient pas des tems une notion exaûe. Un mot
fuffit fur ce point : fi les inflexions temporelles de
Yinfinitif peuvent fe prendre fans choix les unes pour
les autr.es, Yinfinitif ne peut pas fe traduire avec affûrance
, & dicis me legere, par exemple, peutfigni-
fier incliftinttement vous dites que je Us, que j'a i lu i
ou que je lirai.
Il femble qu’une fois afluré que Yinfinitif a en foi
la nature du verbe, & qu’il eft une partie effentielle
de fa conjuga.ifon, on n’a plus qu’à le compter entre
les modes du verbe. Il fe trouve pourtant des Grammairiens
d’une grande réputation & d’un grand mérite
, qui en avouant que Yinfinitif eft partie du verbe
, ne veulent pas convenir qu’il en foit un mode ;
mais malgré les noms impofans des Scaliger, des
Sanftius, des Voflius, & des Lancelot, j ’olerai dire
que leur opinion eft d’une iriconféquence furpre-
nante dans des hommes fi habiles ; car enfin, puifque
de leur aveu même Yinfinitif eft v erbe, il préfente
apparemment la fignification du verbe fous un
afpeft particulier, & c’eft fans doute pour cela qu’il
a des inflexions & des ufages qui lui font propres,
ce qui fufiit pour conftituer un mode dans le verbe ,
comme une terminaifon differente avec une deftina-
tion propre fuffit pour conftituer un cas dans le nom ;
mais quel eft cet afpeft particulier qui caraûerife le
! mode infinitiffV . . .
Cette queftion ne peut fe réfoudre que d’après les
! ufages combinés des langues. L’obfervation la plus
; frappante qui en réfulte, c’eft que dans aucun idiome
Yinfinitif ne reçoit ni inflexions numériques , ni
inflexions perfonnelles ; & cette unanimité indique
fi fûrement le caraûere différentiel de ce mode , fa
nature diftinftive, que c’eft de -là, félon Prifcien
( lib. V III. de modïs. ) , qu’il a tiré fon nom : unde &
\ nomtn accepit IN F IN IT IV I , quod nec perfonas nec
numéros définit. Cette étymologie a ete adoptée depuis
par Voflius ( analog. I II. 8. ) , & elle paroît
affez raifonnable pour être reçue de tous les Grammairiens.
Mais ne nous contentons pas d’un fait qui
conftate la forme extérieure de Yinfinitif, ce feroit
proprement nous en tenir à l’ecorce des chofes : pénétrons
, s’il eft poflible, dans l’intérieur même.
Les inflexions numériques & les perfonnelles ont,
dans les modes oit elles font admifes, une deftina-
tion connue ; c’eft de mettre le verbe, fous ces af-
p e â s , en concordance avec le fujet dont il énonce
un jugement. Cette concordance fuppofe identité ,
entre le fujet déterminé avec lequel s’accorde le verbe
, & le fujet vague préfenté par le verbe fous l’idée
de l ’exiftence ( voye^ Id en t it é . ) ; & cette concordance
défigne l ’application du fens vague du verbe
au fens précis du fujét. .
Si donc Yinfinitif ne reçoit dans aucune langue ni
inflexions numériques, ni inflexions perfonnelles ,
c ’eft qu’il eft dans la nature de ce mode de n’être
jamais appliqué à un fujet précis & détermine , &
de conferver invariablement la fignification generale
& originelle du verbe. Il n’y a plus qu’à luivre
le cours des conféquences qui fortent naturellement
de cette vérité.
I. Le principal ufage du verbe eft de fervir à l’ex-
preflion du jugement intérieur, qui eft la perception
de l’exiftence d’un fiijet dans notre efprit fous tel ou
tel attribut ( s’Gravefande , Introd. à la philof. II.
vij. ) ; ainfi le verbe ne peut exprimer le jugement
qu’aütant qu’il eft appliqué au fujet univerfelou particulier
, ou individuel, qui exifte dans 1 efprit,
c’eft-à-dire à un fujet déterminé. Il n’y a donc que
les modes perfonnels du verbe qui puiffent conftituer
la propofition ; & le mode infinitif, ne pouvant
par fa nature être appliqué à aucun fujet détermine,
ne peut énoncer un jugement, parce que tout jugement
fuppofe un fujet déterminé. Les ufages des langues
nous apprennent que Yinfinitif ne fait dans la
propofition que l’office du nom. L’idée abftraite de
l’exiftence intellectuelle fous un attribut, eft la feule
idée déterminative du fujet vague préfenté par Y infihitif
; & cette idée abftraite devenant la feule que
f efprit y cpnfidere, eft en quelque maniéré l’idée
d’une nature commune à tous les individus auxquels
elle peut convenir. Voye^ Nom.
Dans lès làngüès rtiodernës de l’Europe, cette ef-
pece de nom eft employée comme les autres noms
abftraits, & fer't dé la même maniéré & aux mêmes
fins. i° . Nous l’employons comme fujet ou grammatical,
ou logique. NouS difons, mentir eft un crime
, de même que le menfonge eft uh crime, fujet logique^
FERMER les yeux aux preuves éclatantes du
Chriftianifmieft une‘extravagance inconcevable, de même
que f aveliglèmeht volontaire fur les preuves , &c.
ici fermer n’eft qu’un füjet grammatical ; fermer les
yeux aux preuves éclatantes du Chnftianifme , eft le
fujet logique. i° . L'infinitif eft quelquefois complément
objedif d’un verbe relatif : Y honnête homme rte
fait pas MENTIR »comme Y honnête homme ne connoît
pas le menfonge. 3®. Il eft fou vent le complément logique
ou grammatical d’une prépôfition : la honte de
MENTIR , comme la turpitude du menfonge; fujet à
d é b i t e r des fables, comme fujet à la fievre ; fans
dé g u i s e r La vérité, comme fans déguijement, &c.
Quoique la langue grecque ait donné des cas aux
autres noms, elle n’a pourtant point affujetti fes infinitifs
à ce genre d’inflexion ; mais les rapports à
l ’ordre analytique que les cas défignent dans les autres
noms, font indiqués pour Yinfinitif par les cas
de l’article neutre dont il eft accompagné, de même
que tout autre nom neutre de la même langue ; ainfi
les Grecs difent au nominatif & à l’àccufatifT0 tvyir-
'la.i ( le prier ) , comme ils diroient « «J*» , precatio,
ou Tiir tvxnv, precationem ( la priere ) ; ils difent au
génitif t» tvxtiUcti ( du prier ) , & au datif f£ iuxiclai
( au prier ) , comme ils diroient t«V tu%ac , precatio-
nis ( de la priere ) , & t» tùx», precationi ( à la priere
). En conféquence Yinfinitif grec ainfi décliné eft
employé comme fujet ou comme régime d’un verbe
, ou comme complément d’une prépofition ; &
les exemples en font fi fréquens dans les bons auteurs,
que le manuel des Grammairiens ( Traité de la
fyjit. gr. ch.j. ‘régi. 4. ) donne cette pratique comme
un ufage élégant.
La différence qu’il y a donc à cet égard entre la
langue grecque & la nôtre , c’eft que d’une part I’in-
finitifeft fouvent accompagné de l’article, & que de
l’autre il n’eft que bien rarement employé avec l ’article.
Cette différence tient à celle des procédés des
deux langues en ce qui concerne les noms.
Nous ne faifons ufage de l ’article que pour déterminer
l ’etèndue de la fignification d’un nom appél-
la tif, foit au fens fpécifique, foit au fens individuel ;
ainfi quand nous difons les hommes font mortels, le
nom appèllatif homme eft déterminé au fens fpécifique
; & quand nous difons te roi eftjufte, lé nom ap-
pellatif roi eft-déterminé au fens individuel. Jamais
nous n employons l’article avant les noms propres,
parce^que le fens en eft de foi-même individuel;
peut-etre effee par une rai'fôn contraire que. nous
ne 1 employons pas avant les infinitifs, précisément
parce que. le fens en eft toujours fpécifique : men-
tir dftun crime , c eft-à-dirè , tous ceux qui mentent
commettent un frime , owtbütmenfàhge eft un crime.
Les Grecs | au contraire , qui emploient fouvent
l’article par emphafe, même avant les noms:biro-'
près ( Voyèi la méth. gr. de P .R . liv. V I I I .ch .jv .) ,
font dans, le Cas d’en ufer dé même avant les infini-
ùfs. D ’ailleurs l’inverfion àutorifée dans cette langue
, à caufe des cas qui font admis, exige quelquefois
quelles rapports de Yinfinitif à l’ordre analytique
y foient. caïaéféfifés d’une maniéré non équi-
voquë : les- cas de l’airticfè attaché à Yinfinitif font
alors Iqs fèjils lignes qùel’ôh puiffe employer pour
cette defignation. Nous ; au conîraire, qui futYons
Tome VIII,,
l’ordre analytique; ou qui ne nous en écartons pas
de maniéré a le perdre de vue, lefecoiirs des in-
. flexions nous eft inutile, & l’article au furpluS n’y
fuppléeroit pas, quoi qu’en difent la plupart des
.Grammairiens : nous ne marquons l’ordre analytique
que par le rang des mots ; & les rapports analytiques
j que par les prépofitions;
La langue latine qui, en admettant aufli l’inverfion
, n’a voit pas le fecours d’un article déclinable
pour marquer les relations de Yinfinitif à l’ordre analytique,
avoit pris le parti d’affujettir ce verbe-
nom aux mêmes métamorphofes que les autres noms ■
& de lui donner des cas. Il eft prouvé (.article G érondif)
que les. gérondifs font de véritables cas de
Yinfinitif ; & ( article Supin ) qu’il en eft de même
des fupins : & le s anciens Grammairiens défignoient
indiftin&ement ces deux fortes d’inflexions verbales
par les noms de gerundia, participalia & fupina ;
(Prifcian. lib. V III. de modisY) Ce qui prouve que
les unes comme les autres tenoient la place de Yin±
ftnitif ordinaire, & qu’elles en étoient de véritables
cas. | | .
Linfinitif proprement dit fe trouve néahmoins dans
les auteurs, employé lui-même pour différens cas.
Au nominatif : virtus ejl vitium FUGERE(Hor.') c ’eft-
à-dire, FU GERE vitium ou fuga vitii eft virtus. Au
génitif: tempus eft jam hinc a b i r e me, pour méat
hinc abitionis ( Cic. T u f cul. I. ) A l’âcc-ufatif : non
tanti emo poe n ITERE (Plau t.) pour potnitentiam ;
c eft le complément d'emo : introitt v i d e r e , (Ter.)
poiir ad v id e r e , de même que Lucrèce dit ad s e -
DARE Jîtim ftuvii fontefque vocabant; c’eft donc le
complément d’une prépofition. A l’ablatif: audito
regern inSiciliam T e n d ERE (Saluft. Jugurth.) oii il
eft évident ayYaudito eft en rapport & en concor-
danoe avec tendtre qui tient lieu par conféquent
d’un ablatif. On pourroit prouver chacun de ces cas
par une infinité d’exemples : Sanôius en a recueilli
un grand nombre que l ’on peut confulter ( Minerv.
II I . vj.^ Je me contenterai , d’en ajouter un plus
frappant tire de Cicéron ; ( ad Attïc. X I I I . 28. )
Quam, turpis eft affentatio , curn vIVER E ipfum turpe
fit nobis ƒ .11 eft clair qu’il en eft ici de vivere comme
d'ajfentatio.is l’un eft fujet dans le premier membre;
l’autre eft fujet dans le fécond ; l’un eft féminin,
l’autre eft neutre ; tous deux font noms.
IL Une autre conféquence importante de l’indé-
clinabilité de Yinfinitif, c’eft qu’il eft faux que dans
l’ordre analytique if ait un, fujet, que l’ufa^e de la
langue latine.met à l’aeçufatif. C ’eft p.ourtant la
doftrine commune des Grammairiens les .plus célébrés
& les plus philofophës ; & M. du Marfais l’a
enfeignée dans l’Encyclopédie même, d’après la
méthode latine de P. R. Voye^ ACCUSATIF <5* CONSTRUCTION,
C’eft que çes.grands hommes n’avoient
pas, encore .pris, de la natur.e, du verbe. de- fes
modes , des notions faines : & U eft aifé.rde voir
(articles A c c i d e n t C o n ju g aison ) ~ que M> du
Marfais en parloit comme le vulgaire , & qu’il n’a-
voit pa?.encore porté fur ces objets le-flambeaii d e .
la Métaphyfique, qui lui avoit fait voir- tant d’autres
vérités fondamentales ignorées des plus habiles
qui l’avoient précédé dans cette carrière. ■
Puifque dans aucune langue Yinfinitif ne reçoit,
aucune des terminaifons' relatives à un fujet ; il lém-,
ble, que ce foit une .conféquence qui n’auroit pas dû
échapper aüx Grammairiens., que Yinfinitif ne doit
point le .rapporter à.uh. fujet. Ce principe fe confirme
par, une. nouvelle, obfervation; c’eft. que Yinfinitif
eltu h véritable, nom ? qui eft du genre neutre
en grec &,en latin,'qui dans toutes les .langues eft
employé comme fujet d’un. Verbe, ou comme complément
, foit d’un verbe., foit d’une prépofition *
aveç lequel enfin l’acfje«fUf fe met en concord ince y.Vvv ij