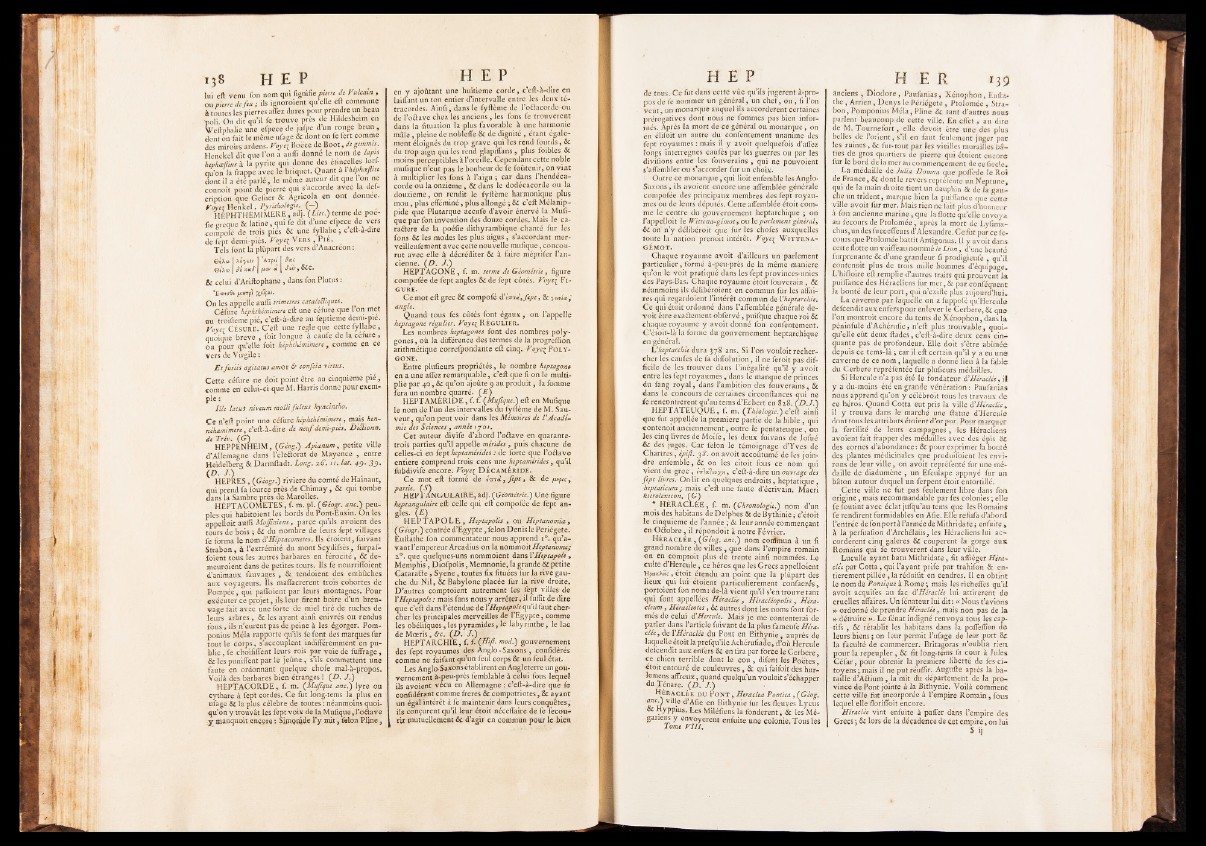
lui eft venu fon nom qui fignific ou pierre de feu ; ils ignoraient qup’eiellrer ee fdte cVomulmcauinne, 'àp otloiu tOesn l edsi tp qieur’riel sf ea llteroz udvuere ps rpèos udr ep rHenilddrees nueni mbe eanu dWoenftt pohna flaieit ulen me êemfpee ucefa dgee &ja fdpoe ndt ’ounn freo fuegrte cbomrumn e, Hdeesn mckireol idrsi ta qrdueen ls’.o Vn oay eaiu Bflro edcoen dneé Bleo onot,m de dgeem lmapeess. hqeup’hoene lllaiu sf ràa plpae p ayvreitce lqe ubi rdiqounente. Qdeusa nétt iàn c1e hlilpehsc eljotirefe- cdoonnnt oilî ta péotéin pt adrel ép,i elerr em qêmuie s a’auctceourrd de ita vqeuce 1l ao nd enle- cription que Gefner & Agricola en ont donnée.
FoHyeÉr PHHeTnHkeÉlM, P1yMr'EuhRoElà,g aied.] . ((-L)u e.) terme de poe,-
fcioem erpeoqfué ed &e tlraotiins ep,i eqsu i fe dit d’une efpece de vers 8c une fyllabe ; c’eft-à-dire
de Tfeeplst dfoenmt il-ap ipélsu. pVaorty ed{e sV veerrss d, ’PAinéa.créon:
G©tt\A<w* JI jx'liy Ktlcvté ' II p‘Aovrp *ti 1I S~t7v , 8CC.
& celui d’Ariftophane, dans fon Plutus :
‘E^etrôt puTp» %oîpo/.
OnC léefsu arpe pheélpleh tahuéfmfii mtrtirmee etrfet su cnaeta cleécfluiqruee qs.ue 1 on met aWuo ytrt{o ifleme pié, c’eft-à-dire au feptieme demi-pié. quoiquCe ébsruevree ., Cfo’eiftt lounngeu reé gàl éc qauufee cdeet tlea f cyelfluarbee ,, ou pour qu’elle foit héphthémimere, comme en ce
vers de Virgile :
Etfuriis agitatus amot & confcia virtus.
cCoemttme ec éefnu rcee lnuei- cdi oqiut ep oMin. tH êatrrrei sa duo cninneq puioèumr ee xpeime-,
p*eIl=le latuS niveum molli fultus hyacintho.
nCéek anm’eimfte preo,i nc’te uftn-àe- dciérfeu rdee hnéephutfh déemrtiimi-periées^. mDaicisli ohnenn-.
de HTrEéPv.P E{GN)H EIM, (Géog.) Apianum, pet.ite ville Hd’eAidlleelmbearggn e& dDaanrsm lf’téaldetû. oLroant gd. ez GM. any.e nlacte. , entre 4$. 3 9 .
(D . J.) , , „ . quiH pErePnRdE fSa ,f (o[uGrécoeg rp.)rè rsi vdiee rCe hdium caoym, t&e d eq uHi ationmaubte, danHsÉ laP TSaAmCbOreM pErèTs EdSe , Mf. amro. llpels. .{Géogr. anc.) peuapplepse
qlluoii th aaubliîtio MieonJtJ lineise nbso, rdpsa rdcue P qoun’til-sE uaxvioni.e Ontn dleess ftoe ufrosr mdea bleo ins o;m 8 cd 'dHué pntaocmombreete sd. eI llse uértos ifeenptt, vfiulliavgaenst Sfotrieanbto tno,u às lle’esx atruétmreist éb adrub amreosn te Sn cfyédriofcsèitsé, , f&ur pdaef-- md’aenuirmoiaeunxt dfaanusv adgee ps e,t it&es ttoenudrso. ieIlnst fed enso uermribflûociheenst aPuoxm pvoéey,a gqeuui rps.a fIflos iemnat fpfaacr releruenrst tmrooins tacgonheosr.t ePso duer evxaégceu ftaeirt caev epcr oujneet, fiolsrt lee udre fimreienlt tbiroéi rdee d r’uunc hberse due
lfeouurss, ialrsb nre’esu ,r e8nct lpeass a dyea pnet ianien fài leensi vérgéosr goeur .r ePnodmu-s tpoounti ules Mcoêrlpa sr,a sp’pacocrtoeu qpule’inlst fien dfoifnfét rdeemsm meanrtq uenes pfuur
b&li cle ,s fpeu nchifofeifnift fpeanrt llee ujresû rnoeis, ps’ailrs vcooime dmee tftuefnfrta ugne e, fVaouitleà ednes obradrobnanreasn tb iqeune élqtruaen gcehso !f e{ Dm. aJl-.à)-propos. cyHthÉarPeT àA fCepOt RcoDrdEe,s .f .C me .f u{tM lounfigq-utee masn cl.a) lpylrues oenu quufa’ogen y8c t rloa upvluâst lceésl éfebprét vdoei xto duet elas :M néuafinqmueo,i nl’so üquaovie
y manquait encore : Simqnjde l’y. où1 * f«l°n Pli116 ?
en y ajoùtant une huitième corde, c’eft-à-dire en
laiffant un ton entier d’intervalle entre les deux té-
tracordes. Ainfi, dans le fyftème de l’oâacorde ou
de l’ottave chez les anciens, les fons fe trouvèrent
dans la fituation la plus favorable à une harmonie
mâle, pleine de nobleffe 8c de dignité, étant également
éloignés du trop grave qui les rend fourds, &
du trop aigu qui les rend glapiffans , plus foibles &
moins perceptibles à l’oreille. Cependant cette noble
mufique n’eut pas le bonheur de fe foûtenir, on vint
à multiplier les fons à l’aigu ; car dans l’hendéca-
corde ou la onzième, & dans le dodécacorde ou la
. douzième, on rendit le fyftème harmonique plus
mou, plus efféminé, plus allongé ; 8c c’eft Mélanip-
pide que Plutarque accufe d’avoir énervé la Mufique
par fon invention des douze cordes. Mais le ca-
raftere de la poéfie dithyrambique chanté fur les
fons 8c les modes les plus aigus, s’accordant mer-
veilleufement avec cette nouvelle mufique, concourut
avec elle à décréditer 8c à faire méprifer l’ancienne.
{D . J.)
HEPTAGONE, f. m. terme de Géométrie, figure
compofée de fept angles 8c de fept côtés. Foye^ Fi g
u r e .
Ce mot eft grec 8c compofé d’«7rri^fept, & ywluf
angle. .
Quand tous fes côtés font égaux, on J’appelle
heptagone régulier. Foye^ RÉGULIER.
Les nombres heptagones font des nombres polygones
, où la différence des termes de la progreflion
arithmétique correfpondante eft cinq. Voye^ Polygone.
Entre plufieurs propriétés, le nombre heptagone
en a une alliez remarquable, c’eft que fi on le multiplie
par 40, & qu’on ajoute 9 au produit, la fomme
fera un nombre quarré. {E )
HEPTAMÉRIDE, f. f. {Mufique.) eft en Mufique
le nom de l’un des intervalles du fyftème de M. Sauveu
r, qu’on peut voir dans les Mémoires de L'Académie
des Sciences , année i j o i .
Cet auteur divife d’abord l’oftave en quarante-
trois parties qu’il appelle mérides , puis chacune de
celles-ci en fept heptamérides : de forte que l’o&ave
efunbtidèirvei fceo emnpcorerned. trois cens une heptamérides, qu’il Voye{ Décaméride.
Ce mot eft formé de *Vra, fept, & de ptpiç,
partie. {S)
HEPTANGULAIRE, adj. {Géométrie?) Une figure
heptangulaire eft celle qui eft compofée de fept angles.
{E)
H E P T A P O L E , Heptapolis , ou Heptanomia,
{Géogr.) contrée d’Egypte, félon Denis le Periégete.
Euftathe fon commentateur nous apprend i°. qu’avant
l’empereur Arcadius on la nommoit Heptanome;
z°. que quelques-uns nommoient dans YHeptapole ,
Memphis, Diofpolis, Memnonie, la grande & petite
Cataratte, Syene, toutes fix fituées fur la rive gauche
du N il, & Babylone placée fur la rive droite.
D ’autres comptoient autrement les fept villes de
YHeptapole : mais fans nous y arrêter, il fuffit de dire
que c’eft dans l’étendue de YHeptapole qu’il faut cher*
cher les principales merveilles de l’Egypte, comme
les obélifques, les pyramides, le labyrinthe, le lac
de Moeris, &c. {D . J.)
HEPTARCHIE, f. f. {&$• mod.) gouvernement
des fept royaumes des Anglo-Saxons , confidérés
comme ne faifant qu’un feiil corps 8c un feul état.
Les Anglo-Saxons établirent en Angleterre un gouvernement
à-peu-près femblable à celui fous lequel
ils avoient vécu en Allemagne : c’eft-à-dire que fe
confidérant comme freres & compatriotes, 8c ayant
un égal intérêt à fe maintenir dans leurs conquêtes, I ils conçurent qu’il leur étoit néceffaire de fe fecoü- I rir mutuellement &: d’agir en commun pour le bien
de tons. Ce fut dans cette vûe qu’ils jugèrent à-propos
de fe nommer un général, un chef, o u , fi l’on
v eu t, un monarque auquel ils accordèrent certaines
prérogatives dont nous ne fommes pas bien informés.
Après la mort de ce général ou monarque, on
en élifoit un autre du confentement unanime des
fept royaumes : mais il y avoit quelquefois d’affez
longs interrègnes caufés par les guerres ou par les
divifions entre' les fouverains , qui ne pouvoient
s’affembler ou s’accorder fur un choix.
■ Outre ce monarque, qui lioit enfemble les Anglo-
Saxons , ils avoient encore une affemblée générale
compofée des principaux membres des fept royaumes
ou de leurs députés. Cette affemblée étoit comme
le centre du gouvernement heptarchique ; on
l’appelloit le Wittena-gémot, ou le parlement général,
8c on n’y délibéroit que fur les chofes auxquelles
toute la nation prenoit intérêt. Foye^ Wittena-
gémot.
Chaque royaume avoit d’ailleurs un parlement
particulier, formé à-peu-près de la même maniéré
qu’on le voit pratique dans les fept provinces-unies
des Pays-Bas. Chaque royaume étoit fouverain, 8c
néanmoins ils délibéroient en commun fur les affai-'
res qui regardoient l’intérêt commun de Yheptarchie.
Ce qui étoit ordonné dans l’affemblée générale de-
voit être exactement obfervé, puifque chaque roi &
chaque royaume y avoit donné fon confentement.
C ’étoit-là la forme du gouvernement heptarchique
en général.
Vheptarchie dura 378 ans. Si l’on vouloit rechercher
les caufes de fa diffolution, il ne feroit pas difficile
de les trouver dans l’inégalité qu’il y avoit
entre les fept royaumes, dans le manque de princes
du fang royal, dans l’ambition des fouverains, &
dans le concours de certaines circonftances qui ne
fe rencontrèrent qu’au tems d’Ecbert en 8z8. (D.J .)
HEPTATEUQUE, f. m. ( Théologie.) c’eft ainfi
que fut appellée la première partie de la bible , qui
contenoit anciennement, outre le pentateuque, ou
les cinq livres de Moïfe, les deux fuivans de Jofué
& des juges. Car félon le témoignage d’Yves de
Chartres, épifi. 38. on avoit accoûtumé de les joindre
enfemble, & on les citoit fous ce nom qui
vient du grec , , c’eft-à-dire un ouvrage des
fept livres. On lit en quelques endroits, heptatique,
heptaticum ; mais c’eft une faute d’écrivain. Macri
hierolexicon. (G)
* HÉRACLÈE, f. m. {Chronologie.) nom d’un
mois des habitans de Delphes & de Bythinie ; c’étoit
le cinquième de l’année ; & leur année commençant
en O&obre, il répondoit à notre Février.
Heraclée , {Géog. anc.) nom coriïhnm à un fi
grand nombre de villes , que dans l’empire romain
on en comptoit plus de trente ainfi nommées. Le
culte d’Hercule, ce héros que les Grecs appelloîent
, étoit étendu au point que la plûpart des
lieux qui lui étoient particulièrement confacrés,
portoient fon nom : de-là vient qu’il s’en trouve tant
qui font appellées Héraclée , Héracléopolis, Héra-
cleum, Héracleotes, & autres dont les noms font formés
de celui d’Hercule. Mais je me contenterai de
parler dans l’article fuivant de Hplus fameufe Héra.
clée, de Y Héraclée du Pont en Bithynie, auprès de
laquelle étoit la prefqu’île Achérufiade, d’où Hercule
defeendit aux enfers & en tira par force le Cerbere
ce chien terrible dont le cou , difent les Poètes *
étoit entouré de couleuvres , & qui faifoit des hur-
lemens affreux, quand quelqu'un vouloit s’échapper
du Ténare. {D . J.)
Heraclée du Pont , Heraclea Pontica, {Géog.
“J 10*) ville d’Afie en Bithynie fur les fleuves Lycus
ce Hyppius. Les Miléfiens la fondèrent, & les Mégariens
y envoyèrent enfuite une colonie. Tous les Tome FUI.
anciens , Diod ore, Paufanias * Xénophon, Eufta*
the, Arrien, Denys le Periégete , Ptolomée , Strabon,
Pomponius Mêla, Pline & tant d’autres nous
parlent beaucoup de cette ville. En effet > au dire
de M. Tournefort, elle devoit être une des plus
belles de l’orient, s’il en faut feulement jtiger par
les ruines , & fur-tout par les vieilles murailles bâties
de gros quartiers de pierre qui étoient encore
fur le bord de la mer au commencement de ce fiecle*
La médaillé de Julia Domna que poffede le Roi
de France, & dont le revers repréfente un Neptune,
qui de la main droite tient un dauphin & de la gauche
un trident, marque bien la puiffance que cette
'ville avoit fur mer. Mais rien ne fait plus d’honneur
à fon ancienne marine, que la flotte qu’elie envoya
au fecours de Ptolomée, après la mort de Lyfima-
chus,un des fucceffeurs d’Alexandre. Ce fut par ce fer
cours que Ptolomée battit Antigonus. Il y avoit dans
cette flotte un vaiffeau nommé le Lion, d’une beauté
furprenante ôc d’une grandeur fi prodigieufe , qu’il
contenoit plus de trois mille hommes d’équipage.
L ’hiftoire eft remplie d’autres traits qui prouvent la
puiffance des Héracliens fur mer, & par conféquent
la bonté de leur port, qui n’exifte plus aujourd’hui.
La caverne par laquelle on a fuppofé qu’Hercule
defeendit aux,enfers pour enlever le Cerbere, & que
l’on montroit encore du tems de Xénophon, dans la
péninfule d’Achérufie, n’eft plus trouvable, quoiqu’elle
eût deux ftades, c’eft-à-dife deux cens cinquante
pas de profondeur. Elle doit s’être abîmée
depuis ce tems-là ; car il eft certain qu’il y a eu unè
caverne de ce nom, laquelle a donné lieu à la fable
du Cerbere repréfentée fur plufieurs médailles.
Si Hercule n’a pas été le fondateur d'Héraclée 9 il
y a du-moins été en grande vénération : Paufanias
nous apprend qu’on y célébroit tous les travaux de
ce héros. Quand Cotta eut pris la ville d'Héraclée,
il y trouva dans le marché une ftatue d’Hercule
dont tous les attributs étoient d’or pur. Pour marquer
la fertilité de leurs campagnes , des Héracliens
avoient fait frapper des médailles avec des épis 8c
des cornes d’abondance : 8c pour exprimer la bonté
des plantes médicinales que produifoient les environs
de leur v ille , on avoit repréfenté fur une médaille
de diadumène , un Efculape appuyé fur un
bâton autour duquel un ferpent étoit entortillé.
Cette ville ne fut pas feulement libre dans fon
origine, mais recommandable par fes colonies ; elle
fe foutint avec éclat jûfqu’au tems que les Romains
fe rendirent formidables en Afie. Elle refufa d’abord
l’entrée de fon port à l’armée de Mithridate ; enfuite ,
à la perfuafion d’Archélaiis, les Héracliens lui accordèrent
cinq galeres & coupèrent la gorge aux
Romains qui 1e trouvèrent dans leur ville»
Luculle ayant batu Mithridate, fit afîiéger Héra-
clée par C o tta, qui l’ayant prife par trahifon & entièrement
pillée, la réduifit en cendres. Il en obtint
le nom de Pontique à Rome ; mais les richeifes qu’il
avoit acquifes au fac d’Héraclée lui attirèrent de
cruelles affaires. Un fénateur lui dit : « Nous t’avions
» ordonné de prendre Héraclée, mais non pas de la
» détruire ». Le fénat indigné renvoya tous les captifs
, 8c rétablit les habitans dans la poffeflïon de
leurs biens ; on leur permit l’ufage de leur port 8c
la faculté de commercer. Britagoras n’oublia rien
pour la repeupler, & fit long-tems fa cour à Jules
Cé far, pour obtenir la première liberté de fes citoyens
; mais il ne put réuflîr. Augufte après la bataille
d’A ô ium , la mit du département de la province
de Pont jointe à la Bithynie. Voilà comment
cette ville fut incorporée à l’empire Romain, fous
lequel elle floriffoit encore.
Héraclée vint enfuite à paffer dans l’empire des
Grecs ; 8c lors de la décadence de cet empire, on lui
S ij