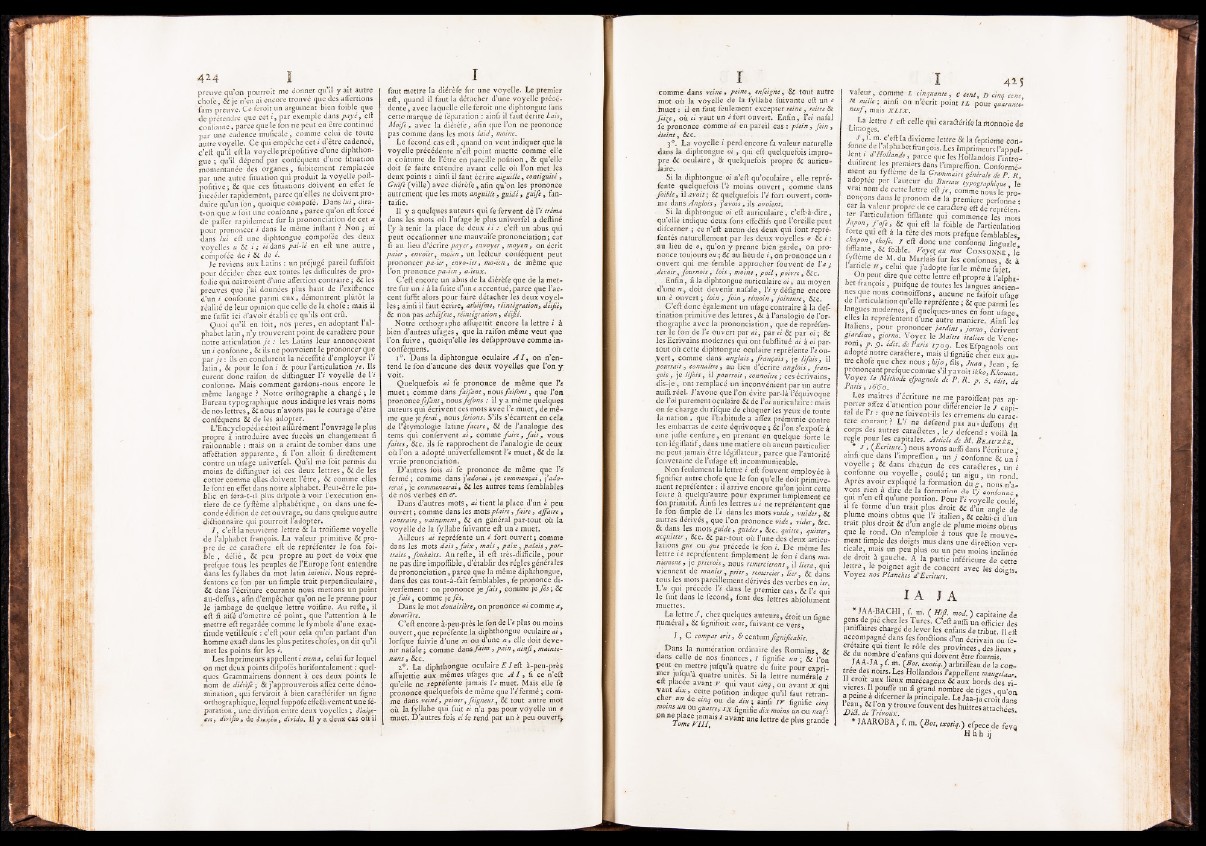
preuve qu’on pourroit me donner qii il y ait autre
choie, & je n’en ai encore trouvé que des affertions
fans pVeuve. Ce feroit un argument bien foible que
de prétendre que cet i , par exemple dans payé, eft
confonne, parce que le l’on ne peut en être continué
par une cadence muficale, comme celui de toute
autre voyelle. Ce qui empêche cet i d’être cadence,
.c’eft qu’il eft la voyelle prépolitive d’une diphthongue
; qu’il dépend par conféquent d’une fituarion
momentanée des organes, fubitement remplacée
par une autre fuuation qui produit la voyelle poft-
politive; & que ces fituations doivent en effet fe
fuccéder rapidement, parce qu’elles ne doivent produire
qu’un Ton, quoique compofe. Dans lui, dira-
t-on que u foit une confonne, parce qu’on eft forcé
de palier rapidement fur la prononciation de cet u
pour prononcer i dans le même inftant ? Non ; ui
dans lui eft une diphtongue compofée des deux
voyelles u & i ; ié dans pai-ïé en eft une autre,
compofée de i & de é.
Je reviens aux Latins : un préjugé pareil fuffifoit
pour décider chez eux toutes les difficultés de pro-
fodie qui naîtroient d’une affertion contraire ; & les
preuves que j’ai données plus haut de 1 exiftençe
d’un i confonne parmi eu x, démontrent plûtot la
réalité de leur opinion que celle de la çhofe : mais il
me fuffit ici d’avoir établi ce qu’ils ont crû.
Quoi qu’il en loit, nos peres, en adoptant l’alphabet
latin, n’y trouvèrent point de caraftere pour
notre articulation j e : les Latins leur annonçoient
un i confonne, & ils ne pouvoient le prononcer que
par j e : ils en conclurent la néceffité d’employer l’i
latin, & pour le fon i & pour l’articulation je . Ils
eurent donc raifon de diftinguer IV voyelle de IV
confonne. Mais comment gardons-nous encore le
même langage ? Notre orthographe a changé ; le
Bureau typographique nous indique les vrais noms
•de nos lettres, & nous n’avons pas le courage d’être
-conféquens 8c de les adopter.
L’Encyclopédieétoit aflïirément l’ouvrage le plus
propre à introduire avec fuccès un changement fi
raifonnable : mais on a craint de tomber dans une
affeôation apparente, fi l’on alloit fi direâement
contre un ufage univerfel. Qu’il me foit permis du
-moins de diftinguer ici ces deux lettres, 8c de les
cotter comme elles doivent l’être, 8c comme elles
le font en effet dans notre alphabet. Peut-être le public
en fera-t-il plus difpofé à voir l’exécution entière
de ce fyftème alphabétique, ou dans une fécondé
édition de cet ouvrage, ou dans quelque autre
diâionnaire qui pourroit l’adopter. 7 , c’eft la neuvième lettre & la troifieme voyelle
de l’alphabet fratiçois. La valeur primitive 8c propre
de ce caraftere eft de repréfenter le fon foible
, délié, 8c peu propre au port de voix que
prefque tous les peuples de l’Europe font entendre
dans les fyllabes du mot latin inimici. Nous repré-
fentons ce fon par un fimple trait perpendiculaire,
8c dans l’écriture courante nous mettons un point
au-deffus, afin d’empêcher qu’on ne le prenne pour
le jambage de-quelque lettre voifine. Au refte, il
eft fi aifé d’omettre cé point, que l’attention à le
mettre eft regardée comme le fymbole d’une exactitude
vetilleufe : c’eft pour cela qu’en parlant d’un
homme exaft dans les plus petites chofes, on dit qu’il
met les points fur les i.
Les Imprimeurs appellent ï tréma, celui fur lequel
on met deux points difpofés horifontalement : quelques
Grammairiens donnent à ces deux points le
nom de diérifi ; & j ’approuverois affez cette dénomination,
qui ferviroit à bien caraftérifer un figne
orthographique, lequel fuppofe effefti vement une réparation
, une divifion entre deux voyelles ; S'ia.ipe-
ffjç, divifio, de divido. Il y a deux cas où il
faut mettre la diérèfe fur une voyelle. Le premier
eft, quand il faut la détacher d’une voyelle précédente,
avec laquelle elle feroit une diphtongue farts
cette marque de féparation : ainfi il faut écrire Lais,
Moïfe, avec la diérèfe, afin que l’on ne prononce
pas comme dans les mots laid, moine.
Le fécond cas e ft , quand on veut indiquer que la
voyelle précédente n’eft point muette comme elle
a coutume de l’être en pareille pofition, & qu’elle
doit fe faire entendre avant celle où l’on met les
deux points : ainfi il faut écrire aiguille, contiguïté,
Guife (ville) avec diérèfe , afin qu’on les prononce
autrement que les mots anguille , guidé, guife , fan-
taifie.
Il y a quelques auteurs qui fe fervent de l’i’ tréma.
dans les mots où l’ufage le plus univerfel a deftiné
ly à tenir la place de deux i i : c’eft un abus qui
peut occafionner une mauvaife prononciation ; car
fi au lieu d’écrire payer, envoyer, moyen, on écrit
paier, envoïer, moien , un lefteur conféquent peut
prononcer pa-ïer, envo-ïer, mo-ien , de même que
l’on prononce pa-ïen , a-ïeux.
C ’eft encore un abus de la diérèfe que de la mettre
fur un i à la fuite d’un e accentué, parce que l’accent
fuffit alors pour faire détacher les deux voyelles
; ainfi il faut écrire, atkéifne, réintégration, déifié,
8c non pas athéïfme, réintégration , déifié.
Notre orthographe alfujettit encore la lettre i à
bien d’autres ufages , que la raifon même veut que
l’on fuive , quoiqu’elle les defapprouve comme in-
conféquens.
i° . Dans la diphtongue oculaire A I , on n’entend
le fon d’aucune des deux voyelles que l’on y
voit.
Quelquefois ai fe prononce de même que Ve
muet; comme dans faifant, nousfaifons, que l’on
prononce fefant, nous fefons : il y a même quelques
auteurs qui écrivent ces mots avec Ve muet, de même
que je ferai, nous ferions. S’ils s’écartent en cela
4 e l’ étymologie latine facere, 8c de l’analogie des
-tems qui confervent a i, comme faire , fa it , vous
faites, 8cc. ils fe rapprochent de l’analogie de ceux
où l’on a adopté univerfellement Ve muet, 8c de la
vraie prononciation.
D ’autres fois ai fe prononce de même que Ve
fermé ; comme dans j’adorai, je commençai, ^adorerai
, je commencerai, 8c les autres tems femblables
de nos verbes en er.
Dans d’autres mots, ai tient la place d’un è peu
ouvert ; comme dans les mots plaire, faire , affaire,
contraire, vainement, 8c en général par-tout où la
voyelle de la fyllabe fuivante eft un e muet.
Ailleurs ai repréfente un ê fort ouvert ; comme
dans les mots dais , fa ix , mais , paix, palais, portraits
, fouhaits. Au refte, il eft très-difficile, pour
ne pas dire impoffible, d’établir des régies générales
de prononciation, parce que la même diphthongue,
dans des cas tout-à-fait femblables, fe prononce di-
verfement: on prononce je fo is , comme fés-, 8c
je fa is , comme je fés.
Dans le mot douairière, on prononce ai comme a,
douanïre.
C ’eft encore à-peu-près le fon de Ve pl(us ou moins
ouvert, que repréfente la diphthongue oculaire a i ,
lorfque fuivie d’une m ou d’une n , elle doit devenir
nafale ; comme dan s faim, pain, ainfi, maintenant
, &c.
2°. La diphthongue oculaire E l eft à-peu-près
aflùjettie aux mêmes ufages que A I , fi ce n’eft
qu’elle ne repréfente jamais Ve muet. Mais elle fç
prononce quelquefois de même que IVfermé ; comme
dans veiné, peiner, feigneur, 8c tout autre mot
où la fyllabe qui fuit ci n’a pas pour voyelle un e
muet. D ’autres fois ei fe rend par un è peu ouvert^
comme dans veine, peine, enfeigne, 8c tout autre
mot où la voyelle de la fyllabe fuivante eft un e
.biuet : il en faut feulement excepter reine , reitre &
fe h e , où ei vaut un é fort ouvert. Enfin, lVi nafal
fe prononce comme ai en pareil cas : plein , fein ,
éteint, 8cc.
3°. La voyelle i perd encore fa valeur naturelle
dans la diphtongue o i , qui eft quelquefois impropre
8c oculaire, & quelquefois propre 8c auriculaire.
Si la diphtongue oi n’eft qu’oculaire, elle repréfente
quelquefois' IV moins ouvert, comme dans
foible, il avoit; & quelquefois IV fort ouvert, comme
dans Anglois, pavois, ils avoient.
- Si la diphtongue oi eft auriculaire, c’eft-à-dire,
qu’elle indique deux fons effeâifs que l’oreille peut
dif cerner ; ce n’eft aucun des deux qui font représentés
naturellement par les deux voyelles o & i :
au lieu de o, qu’on y prenne bien garde, on prononce
toujours ou-, & au lieu de i , on prononce une
ouvërt qui me femble approcher fouvent de Va ;
.devoir, fournois, - lois , moine , p o il, poivre, & c .
Enfin, fi la diphtongue auriculaire oi, au moyen
d’une n , doit devenir nafale, l’iy d éfign e encore
un e ouvert ; loin , foin , témoin , jointure, &c.
C ’eft donc également un ufage contraire à la def-
tination primitive des lettres, & à l’analogie de l’orthographe
avec la prononciation, que de repréfen-
ter le fon de IV ouvert par ai, par ei & par oi ; &
les Ecrivains modernes qui ont fubftitué ai à oi partout
où cette diphtongue oculaire repréfente IV ouv
e r t , comme dans anglais, français, je lifais, il
pourrait, connaître , au lieu d’écrire anglois, français,
je Ufois, il pourroit, connoître ; ces écrivains j
dis-je, ont remplace un inconvénient par un autre
auffiréel. J’avoue que l’on évite par-là l’équivoque
de l’oi purement oculaire & de Voi auriculaire : mais
on fe charge durifque de choquer les yeux de toute
la nation , que l’habitude a aflez prémunie contre
les embarras de cette équivoque ; & l’on s’expofe à
une jufte cenfure, en prenant en quelque forte le
ton légillatif, dans une matière où aucun particulier
ne peut jamais être légillateur, parce que l’autorité
fouveraine de l’ufage eft incommunicable.
Non feulement la lettre i eft fouvent employée à
fignifier autre chofe que le fon qu’elle doit primive-
ment repréfenter : il arrive encore qu’on joint cette
lettre à quelqu’autre pour exprimer fimplement ce
fon primitif. Ainfi les lettres u i ne représentent que
le fon fimple de l’i dans les mots vuide , vuider , &
autres dérivés, que l’on prononce vide, vider, &c.
& dans, les mots guide, guider, &c. quitte, quitter,
acquitter, & c . & par-tout où l’une des deux articulations
gue ou que précédé le fon i. D e même les
lettre i e représentent fimplement le fon i dans maniement,
je prierois, nous remercierons, il liera, qui
viennent de manier, prier, remercier, lier, & dans
tous les mots pareillement dérivés des verbes en ter.
L a qui précédé 1 i dans le premier cas, & IV qui
le fuit dans le fécond, font des lettres abfolument
muettes.
La lettre J , chez quelques auteurs, étoit un figne
numéral, & fignifioit cent, Suivant ce vers °
J , C comparent, & centum fignificabit.
Dans la numération ordinaire des Romains &
dans celle de nos finances, I fignifie un ; & î ’0n
peut en mettre jufqu’à quatre de fuite pour exprimer
jufqu’à quatre unités. Si la lettre numérale I
«it placée avant v qui vaut cinq, ou avant x qui
vaut d ix, cette pofition indique qu’il faut retrancher
de cinq ou de dix-, a in f iV fignifie cinq
moins un ou quatre, I x fignifie dix moins un ou neuf:
a<Tm7rîÏÏ™1 aVanI ““ lettre Ae Plus
valeur, comme l cinquante, c u n i, D cinq uns,
M mille:; ainfi • On n'ëcrit point i i pour qnarantè-
neuf, mais XLIX.
La lettre i eft celle qui caraflérife la monnoie de
Limoges.
i , 1. m. c’eft la dixième lettre & la leptieffle co a .
tonne de lalphabetfrançois.Les Imprimeurs l’appel-
lent! dHolUnd-e, parce que les Hollandois l’intro- ’
duifirent les premiers dans rimpreffion. Conformément
au fyfteme de la Grammaire générale de P R .
adoptée par l’auteur du Bureau typographique, 1e
vrai nom de cette lettre eft j e , comme nous le pro-
nonçons dans le prbnom de la première perfonne •
car la valeur propre de ce CaraSere eft de repréfen-
ter 1 articulation fifflànte qui commencé lés mots
Japon, TjioJe, & qtii eft la foible de l’artictilation
torte qui eft à la tête des mots prefque femblables,
chapon; chofe. j eft donc une confonne linguale,
'fmce ’ ei foible. Voye; au mot C onso nne le
fyftème de M. du Mariais fur les confomics & à
I article h , celui que j’adopte furie mêmefuiet.
, H Peuî t,lre <}««■ cette lettre eft propre à l’alphas
bet françois , püîfque de toutes les langues artcien-
nes que nous cpnnoiffons, aucune ne faifoit ufage
de 1 articulation qti’elle répréfente ; & que parmi les
langues modernes, fi quelques-unes en font ufage ,
elles la'reprefentent d’une autre maniéré, itinfiles
ItaliepsV pour prononcer "jardins , jôfàif, écrivent
giardmo; gtorho-^T,oyez lé Maître ’iatéai de Vefle-;
ront, p. ÿ . édit. d!e Paris iyoç>. Le Efpagnois ont
adoptëmotre daraaere, mais U fignifie chez eux attire
chofe que cheztnous'; Hijà, fils, Juan , Jean fe
prononçant prefque comme s’il y avoit ilài>,Khouan.
Voyez la Méthode efpagnole de P. R. p. J. édit de
Paris, r66o. v - :
Les maîtres d’écriture ne me paroiflent pas ap-
attention pour différencier le H capital
de 1 1 : que ne fuiveiit-ils les erremens du caractère
courant? L ’i ne défeend pas au-defloiis: du
corps des autres caraaetes, l e j defcértd : voilà la
réglé pour les capitales; Article de M . B e a u ï ê e .
* J , (Ecriture.) nous avons auffi dans l’écriture ;
amfi que dans l’impreflion, un j confonne U un i
voyelle ; & dans chacun de ces càràaeres un i
c,on\ô“ e ° a vo y e lle , coulé; un aigu, un rond.
Apres avoir expliqué la formation du g , nousm’a-
Wni rien à dire de la formation dé T’j confonne
qui m’en eft qu’une portion. Pour l’i voyelle coulé’
il le forme dun trait plus droit & d’un angle dé
plume moins obtus que l’i italien, & celui-ci d’un
trait plus droit & d’un angle de plume moins obtus
que le rond. On n’emploie à tous que le' mouvement
fimple des doigts mus dans unexlireaion verticale,
mais tin peu plus ou un peu moins inclinée
de droit à gauche. A la partie inférieure de cette
lettre, le poignet agit de concert avec les doigts
Voyez nos Planches i ’Ecriture. 6
I A J A
* JA A-BACHI, f m. ( Hijl. mod. ) capitaine de
gens de pte chez es Turcs. C ’eft auffi un officier des
lamflaires charge de lever les enfans .de tribut. II eft
accompagné dans fes fondions d’un écrivain ou fe-
cretaire qui tient le rôle des provinces, des lieux,
oc du nombre d’enfans qui doivent être fournis.
JA A-JA, f. m. (Bot. exotiq.') arbrifleau de la con-
tree des noirs. Les Hollandois l’appellent maugelaar.
II croit aux lieux marécageux & aux bords des rivières.
Il pouffe un li grand nombre de tiges qu’on
a peine à difcernef la principale. Le Jaa-ja croît dans
R E M I Y trouve fouvent des huîtres attachées JJ ici. de Trévoux. *
' JAAROBA, f. m, {Bot, exotiq.) efpecede feva
H h h ii M