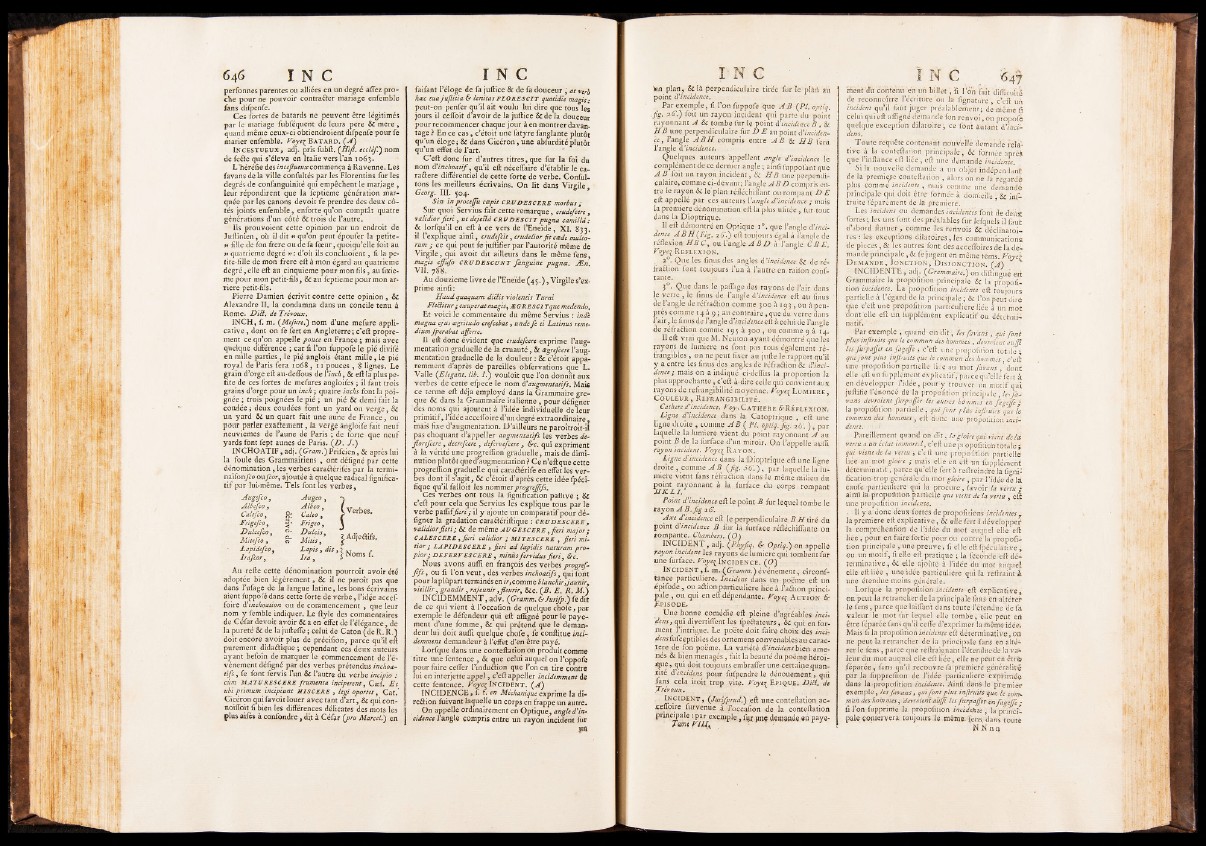
perfonnes parentes ou alliées en un degré allez proche
pour ne pouvoir contra&er mariage enfemble
fans difpenfe.
Ces fortes de bâtards ne peuvent être légitimés
par le mariage fubféquent de leurs pere & mere,
quand même ceux-ci obtiendroient difpenfe pour fe
marier enfemble. Voyt^ Bâ t a r d . (.A )
Incestueux , adj. pris fubft. ([Hift. eccUJ,I) nom
de feéle qui s’éleva en Italie vers l’an 1063.
L ’héréfie des inceflueux commença à Ravenne. Les
favans de la ville confultés par les Florentins fur les
degrés de confanguinité qui empêchent le mariage ,
leur répondirent que la feptieme génération marquée
par les canons devoit fe prendre des deux côtés
joints enfemble, enforte qu’on comptât quatre
générations d’un côté & trois de l’autre.
Ils prouvoient cette opinion par un endroit de
Juftinien, où il dit « qu’on peut époufer la petite-
» fille de fon frere ou de fa foeur, quoiqu’elle foit au
» quatrième degré »: d’où ils concluoient, fi la petite
fille de mon frere eft à mon égard au quatrième
degré, elle eft au cinquième pour mon fils, au fixie-
me pour mon petit-fils, & au feptieme pour mon arriéré
petit-fils.
Pierre Damien écrivit contre cette opinion , &
Alexandre II. la condamna dans un concile tenu à
Rome. DiB. de Trévoux.
INCH, f. m. (Mefure.) nom d’une mefure applicative
, dont on fe fert en Angleterre; c ’eft proprement
ce qu’on appelle pouce en France ; mais avec
quelque différence ; car fi l’on fuppofe le pié divifé
en mille parties, le pié angtois étant mille, le pié
royal de Paris fera 1068, 11 pouces , 8 lignes. Le
grain d’orge eft au-deifous de Yinch, & eft la plus petite
de ces fortes de mefures angloifes ; il faut trois
grains d’orge pour un inc h ; quatre inchs font la poignée
; trois poignées le pié ; un pié & demi fait la
coudée ; deux coudées font un yard ou verg e, &
un yard &c un quart fait une aune de France, ou
pour parler exaftement, la verge angloife fait neuf
neuvièmes de l’aune de Paris ; de forte que neuf
yards font fept aunes de Paris. (Zï. J.)
INCHOATIF, adj. (Gram.) Prifcien, & après lui
la foule des Grammairiens , ont défigné par cette
dénomination , les verbes cara&érifés par la termi-
naifonfeo o u f cor, ajoutée à quelque radical fignifica-
tif par lui-même. Tels font les verbes,
Augefco, Augeo,
Albefco , Albeo, / .
Calefco,
Cu
n- Caleo, g
Frigefco,
Frigeo, \
Verbes.
Dulcefco, 0- Dulcis, J
Mitefco , 0C- Mitis,
Lapidefco , Lapis , dis , T ,
Irafcor, Ira, 1
^.Adjeélifs.
Au refte cette dénomination pourroit avoir été
adoptée bien légèrement, & il ne paroît pas que
dans l’ufage de la langue latine, les bons écrivains
aient fuppofé dans cette forte de verbe, l’idçe accef-
foire à’inchoation ou de commencement , que leur
nom y femble indiquer. Le ftyle des commentaires
de Céfar devoit avoir & a en effet de l’élégance, de
la pureté & de la jufteffe ; celui de Caton (de R. R.)
doit encore avoir plus de précifion, parce qu’il eft
purement didactique ; cependant ces deux auteurs
ayant befoin de marquer le commencement de l’événement
défigné par des verbes prétendus inchoa-
tifs, fe font lervis l’un & l’autre du verbe incipio :
cüm MA T U RES C ERE frumenta inciperent, Cæf. E t
ubi primum incipiunt HISCERE , legi oportet, Cat.
Cicéron qui favoit louer avec tant d’art, & qui con-
noiffoit fi bien les différences délicates des mots les
plus aifes à confondre, dit à Céfar {pro Marcel.) en
faifant l’éloge de fa juftice & de fa douceur ’, at verb
hoec tua ju flitia & lenitas FLORESCIT quotidie magis;
peut-on penfer qu’il ait voulu lui dire que tous les
jours il ceffoit d’avoir de la juftice & de la douceur
pour recommencer chaque jour à en montrer davantage
? En ce ca s , c’étoit une fatyre fanglante plutôt
qu’un éloge ; & dans Cicéron, une ablurdité plutôt
qu’un effet de l’art.
C ’eft donc fur d’autres titres, que fur la foi du
nom d'inchoatif, qu’il eft néceffaire d’établir le ca-
raftere différentiel de cette forte de verbe. Conful-
tons les meilleurs écrivains. On lit dans Virgile
Georg. III. 504.
S in in proceffu ccepit CRU d e s c ERE morbus ;
Sur quoi Servius fait cette remarque, crudefcere ,
validior fieri , ut dejeclâ CRUDESCIT pugna camillâ:
& lorfqu’il en eft à ce vers de l’Eneïde, XI. 833.
il l’explique ainfi, crudefcit, crudelior fit ccede multo-
rum ; ce qui peut fe juffifier par l’autorité même de
Virgile, qui avoit dit ailleurs dans le mêmefens,
magis efiufo CRUDESCUNT fanguine pugnot. Æn.
VIL 788.
Au douzième livre de l’Eneïde (4 5 .) , Virgile s’exprime
ainfi:
Haud quaquam diclis violentis Turni
Fleciitur; exuperat magis, ÆGRES Cl T que medendo.
Et voici le commentaire du même Servius : indh
magna ejus agritudo crefcebat, unde fe ei Latinus remedium
fperabat afferre.
Il eft donc évident que crudefcere exprime l’augmentation
graduelle de la cruauté, & agrefeere l’augmentation
graduelle de la douleur : & c’étoit apparemment
d’après de pareilles obfervations que L.
Valle {Elégant, lib. 1.) vouloit que l’on donnât aux
verbes de cette efpece le nom d’augmentatifs. Mai«
ce terme eft déjà employé dans la Grammaire gre-
que & dans la Grammaire italienne, pour défigner
'des noms qui ajoutent à l’idée individuelle de leur
primitif, l’idée acceffoire d’un degré extraordinaire,
mais fixe d’augmentation. D ’ailleurs ne paroîtroit-il
pas choquant d’appeller augmentatifs les verbes de-
florefeere, decrefcere , defervejcere , &c. qui expriment
à la vérité une progreflion graduelle, mais de diminution
plutôt que d’augmentation } Ce n’eftque cette
progreflion graduelle qui caraftérife en effet les verbes
dont il s’agit, & c’étoit d’après cette idée fpéci-
fique qu’il falloit les nommer progrejjifs.
Ces verbes ont tous la lignification paflive ; &
c’eft pour cela que Servius les explique tous par le
verbe pafliffieri ; il y ajoute un comparatif pour défigner
la gradation cara&ériftique : c r u d e s c e r e ,
validior fieri ; & de même AV GESCERE, fieri major;
CALESCERE, fieri calidior ; m i t e s c e r e , fieri mi-
tior j LAPIDESCERE , fieri ad lapidis naturam pro-
pior; DEFERVESCERE, minus fervidus fieri, &c.
Nous avons aufli en françois des verbes progref-
fifs, ou fi l’on v eu t, des verbes inchoatifs, qui font
pour laplûpart terminés en ir,comme blanchir,jaunir,
vieillir, grandir, rajeunir,fleurir, & c . (B. E. R. M.)
INCIDEMMENT, adv. (Gramm. GJurifp.) fedit
de ce qui vient à l’occafion de quelque choie, par
exemple le défendeur qui eft afligné pour le payement
d’une fomme, & qui prétend que le demandeur
lui doit aufli quelque chofe, fe conftitue inci-
demment demandeur à l’effet d’en être payé.
Lorfque dans une conteftation on produit comme
titre une fentence , & que celui auquel on l’oppofe
pour faire cefler l’induûion que l’on en tire contre
lui en interjette appel, c’eft appeller incidemment de
cette fentence. Voye^ In c id en t . (A )
INCIDENCE, f. f. en Mechanique exprime la di-
re&ion fuivant laquelle un corps en frappe un autre.
On appelle ordinairement en Optique, angle d'incidence
l’angle compris entre un rayon incident fur
un
ton plan , & là perpendiculaire tirée fur le plan au
point d’incidence.
Par exemple, fi l’on fiippofe que A B {PI. optiq.
■fig. 2. G.) foit Un rayon incident qui parte du point
rayonnant A & tombe fur lç point à'incidence B , &
H B une perpendiculaire fur D E au point d’incidence,
l’angle A B H compris entre A B & H B fera
l’angle à.'incidence.
Quelques auteurs appellent angle d'incidence lè
complément de ce dernier angle; ainfi fuppofant que
A B foitun rayon incident, & H B une perpendiculaire
» comme ci-devant; l ’angle A B D compris entre
le rayon & le plan réfléehifiànt ou rompant D E
eft appelle par çès auteurs Y angle d.'incidence • mais
la première dénomination eft la plus ufitée, lur-tout
dans la Dioptriqüe.
Il eft définontré en Optique i° . que l’angle d'incidence
A B H {Fig. 2G.) eft toujours égal à l’angle de
réflexion H B C , ou l’angle A B D à l’angle- C B E .
Voye^ R éflexion.
. 2.0. Que lès-finus des angles d ’incidence & de réfraction
font toujours l’un à l’autre en raifon confiante.
. 30. Que dans le paflage des rayons de l’air dans
le verre , le finus de l’angle d’incidence eft au finus
de l’angle de réfraétion comme 300 à i 9.3 , ou à peu-
pres comme 14 a 9 ; au contraire, que du verre dans
l’air ,1e finus de l’angle d'incidence eft à celui de l’angle
de réfraCtion comme 195 à 300 , ou comme 9 à 14.
Il eft vrai que M. Neiiton ayant démontré que les
rayons de lumière ne font pas tous également ré-
frangibles , on ne peut fixer au jufte le rapport qu’il y a entre les finus des angles de téfraCtion & ^incidence;
mais on a indiqué çi-deflùs la proportion la
plus approchante ; c’eft-à-dire celle qui convient aux
rayons de réfrangibilité moyenne; Voye^ Lumière ,
Co u l eu r , R éfrangibilité.
Cathere d'incidence. A ^ C a th e r E £ RÉFLEXION.
Ligne djincidence dans la Catoptrique , eft une
ligne droite „comme A B ( PI. optiq. fig:2S . ) , par
laquelle la lumière vient du point rayonnant A au
point B de la furfaee d’un miroir. On l’appelle aufli
rayon incident. Voye£ R ayon.
Ligne d'incidence dans la Dioptriqüe eft une ligne
droite , comme A B {fig. 5 G.'), par laquelle la lumière
vient fans réfraction dans le même milieu du
pom^ rayonnant à la furfaee du corps, rompant
P oint d'incidence eft le point B fur lequel tombe le
rayon A B . fig 2G.
Axe d'incidence eft le perpendiculaire B H tiré du
point d’incidence B fur ja furfaee réfléchiflante ou
rompante. Chambers. CO)
IN CIDEN T, adj. (Phyflq. & Optiq.) on appellé
rayon incident les rayons de lumière qui tombent fur
une furfaee. Voye^ Incidence. (O)
Incident , f . m. (Gramm.) événement» circonf-
tance particulière. Incident dans Un poëme eft un
épifode, ou aCtion particulière hée à l ’aCtion princiale
, ou qui en eftdépendante., Foye[ Ac t io n &
pisode.
Une bonne comédie eft pleine d’agréables incident,
qui divernllent les fpeCtateurs » & qui en forment
l’intrigue. Le poëte doit faire choix des inci*.
<fowfufceptibles desornemèqs convenables au caractère
de fon poëme. La variété à'incidens bien amenés
& bien ménagés, fait la beauté du poëme héroïr
cpie, qui doit toujours embraffer une Certaine quantité
d'incident pour fufpendre le dénouement;, qui
fans cela droit trop vite. Voyt{ Épique;.DiB. de
Trévoux..
Incident , (<Jurlfprud.) eft une conteftatiqn ac-
çefloire furvenue à l’occafion de la conteftation
principale : par exemple, fur une demande en paye-
Tamç f lU L *
ment du contenu én un b ille t , fi l’on 'fait difficulté
de rèconnoître récriture ou la fignatiïre , c’eft un
incident qu’il faut juger préalablement; de même fi
celui qui eft affigné demande fon renvoi , Ou propofo
•quelque exception dilatoire ; ce font àûtânt d'inci'-
dens.
Toute requête contenant nouvelle demande rela’*
tive .à la conteftation principale, & formée aprèà
que Tinfîance eft liée, eft une demande Incidente.
Si là nouvelle demande la un objet indépendant
de !a première conteftation',- alors on ne là regardé
plus 'comme incidente , mais comme une'demandé
principale qui doit être formée à dbmicil'e ‘ & inf-
truite l'éparémeht de la premieré’.
Les incident Ou demandes incidentes font de cleïïi
fortes ; les uns font des préalables fur lefquels il faut
d’abord ftatuer, comme les renvois & déclinatoires
: les exceptions dilatoires, les communications
de pièces, & les autres font des acceflbires de la demande
principale, & fe jugent en même têms. Voyêt
D emande, Jonction, D isjonction. (A )
INCIDENTE, adj. (Grammaire.) on diftingué eii
Grammaire la propofition principale & la propofi-
tion incidente. La propofition incidente eft toujours
partielle à l’égard de la principale; & l’onpeutdiré
qüé c’eft une propofition particulière liée à un mot
dont elle eft tin fupplémënt explicatif ou déterminatif.
•
Par exemple , quand oh dit, tes favans , qui font
plUs'ihf 'ruits que Le commun des hommes , devroiént auffi
les fufpaffer en fagejfe » c’eft une propofition totale ;
quiJorré plus injbuits que le commun des homthés c’eft
uhe propofition partielle li;e au mot favans , dont
elle eft iin fupplémënt explicàtifT'pai ce qii’èllë.i'eit à
en développer l’idée, poury trouver un motif qui
juftifie l’énoncé dé la •propofition pfincijjale , le'Ja-
vans deVroient furpaffer lès autres hommes en fageffe $
la propofition partielle , qui font pliis infiruus que U
commun des hommes, eft donc uiie piopofnion incidente.
'
Pareillement quand on dit, lagloirequi vient delà
venu a 'uh éclat immortel, c’eft une pi opofitich totale ;
qui vient de la vertu ; c’eft une propofition partielle
liée au mot gloire ; mais elle eh eft un fupplémënt
déterminatif, parce qu’elle fert à reftreindre là figni-'
fication-trop générale du mot gloire , par l ’idée de la
caufe: particulière qui la procure, lavoir./« vertu ;
ainfi la- propofition partielle qui vient de la vertu eft
une propofition incidente,
- Il ÿ a donc deux fottes de propOfitions incidentes r
là première eft explicative, & elle fert à développer
la eompréhenfion de l’idée du mot auquel elle eft
liée , pour en faireforfir poiir Ou contre la propofi-i
tion principale, une preuve, fi elle;eft fpécülative ».
ou un motif, fi elle eft pratique ; la fécondé eft déterminative,
& elle ajouté à l’idée du mot auquel
elle: eft liée , uneidée particulière qui la rèftraint à
une étendue moins générale.
: Lorfque la ptopolit-ion incidente eft explicative^
on peut la retrancher de la principale fans- en altérer
le fens , parce que laifiant dans toute l’étendue !de fà
valeur le mot fur lequel elle tombe , 'elle"peut eh
être féparéefans qu’il celle d’exprimer la même idée;
Mais fi la propofition incidente eft 'déterminative, Ont
ne peut.la retrancher de la principale fans en al terrer
le fens , parce que réftraighant ’étenduedé là va*
leur du mot auquel elle eft liée, elle ne peut en êtrë&
féparée, fans qu’il recouvre fa:première généralité
par la fuppreffion de l’idée particulière-exprimée
dans là .propofition incidente■. Ainfi dans le premier
exemple, les favans, qui font plus infihdis que U com-
mujt des hommes ‘. devroient.aùfifi les fmpaffkr- mfigêfli ;
fi ron.fupprimé la propofition incidente , la principale
conlervera toujours le même- fens,-dans toute
N N n ij