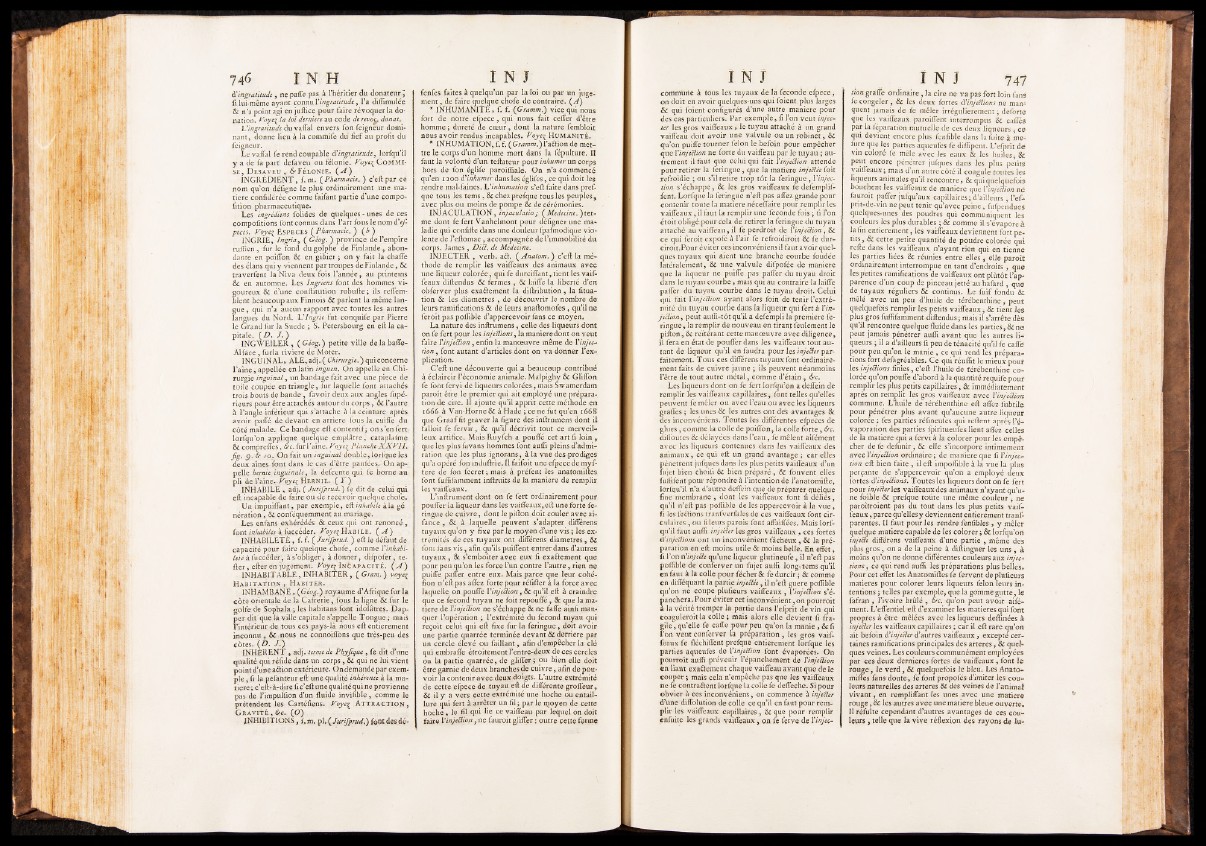
746 I N H
& ingratitude , nepaffe pas à l’héritier du donateur ^
f i lui-même ayant connu Y ingratitude, l’a diffimulée
& n’a point agi en juftice pour faire révoquer la donation.
Voyt^ la loi dernierc au code derevodonat*
Vingratitude du vaffal envers fon feigneur dominant,
donne lieu à la commife du fief au profit du
feigneur.
Le vaffal fe rend coupable d'ingratitude^ lorfqu’il
y a de fa part defaveu ou félonie. Voyt{ C om m ise,
D ésaveu , 6«Félonie. (A )
INGRÉDIENT, f. m. ( Pharmacie. ) c’eft par ce
nom qu’on défigne le plus ordinairement une matière
confidérée comme faifant partie d’une compo-
fition pharmaceutique.
Les ingrédiens folides de quelques - unes de ces
compofitions font connus dans l’art fous le nom <Yef-
ptets. Foyei Especes ( Pharmacie. ) (h )
INGRIE, Ingria, ( Géog. ) province de l’empire
ruflïen , fur le fond du golphe de Finlande, abondante
en poiffon & en gibier ; on y fait la chaffe
des élans qui y viennent par troupes de Finlande, &
traverfent la Niva deux fois l ’année, au primeras
èc en automne. Les Ingriens font des hommes vigoureux
& d’une conftitution robufie; ils reflem-
blent beaucoup aux Finnois & parlent la même langue
, qui n’a aucun rapport avec toutes les autres
langues du Nord. Vlngrie fut conquife par Pierre
le Grand fur la Suede ; S. Petersbourg en eft la capitale.
(D . J.')
INGWEILER , ( Géog.) petite ville delabaffe-
A lfâ ce , furla riviere de Moter.
INGUINAL, ALE,adj.( Chirurgie.) qui concerne
l ’aîne, appellée en latin inguen. On appelle en Chirurgie
inguinal, un bandage fait avec une piece de
toile coupée en triangle, lur laquelle font attachés
trois bouts de bande, favoir deux aux angles fupé-
rieurs pour être attachés autour du corps, & l’autre
à l’angle inférieur qui s’attache à la ceinture après
avoir paffé de devant en arriéré fous la cuifle du
côté malade.. Ce bandage eft contentif; o n s ’enfertr
lorfqu’on applique quelque emplâtre, çataplalme
& compreffes, &c. furl’aîne. Voye% Planche X X V ll .
jig. g .& 10. On fait un inguinal'double, lorfque les
deux aînés font dans le cas d’être paniée&r On appelle
hernie inguinale t la defeente qui fe borne au
pli de l’aîné- Voye^ Hernie. ( T )
INHABILE , adj. ( Jurifprud. ) le dit de celui qui
eft incapable de faire ou de recevoir quelque chofe.
Un impuiffant, par exemple, eft inhabile à la gé
nération, & conféquemment au mariage.
Les enfans exhérédés & ceux qui ont renoncé,
font inhabiies\{\xccèàtr. Voye^ H abile. (A-)
INHABILETÉ, f. f. ( Jurifprud. ) eft le défaut de
capacité pour faire quelque chofe, comme Yinhabi-
leté à fuçeéder, à s’obliger, adonner, difpofer, te-
fter, efter en jugement. Voye^ In ca pa c ité . (A }
INHABITABLE, INHABITER, ( Gram. ) voye^
Ha b it a t iq n i? Habiter.
INHAMBANÉ, {Géog.') royaume d’Afrique fur la
côte orientale de la Cafrerie, fous la ligne & fu-r le
golfe de Sophala ; les habitans font idolâtres. Dap-
per dit que la ville capitale s’appelle Tongue; mais
l’intérieur de tous cés paÿs-là nous eft entièrement
inconnu, & .nous ne connoiffons que très-peu des
côtes. (D . / .)
INHÉRENT , adj. terme de Phyjîque , fe dit d’une
qualité qui réfide dans un corps, & qui ne lui vient
point d’une aâion extérieure. On demande par exemp
l e f l la pefanteur eft une qualité inhérente à la matière
; e’ett-à-dire fi c’eft une qualité qui ne provienne
pas de l’impulfion d’un fluide invifible, comme le
prétendent les Cartéfiens. Voye^ At t r a c t io n ,
Gravité , &c. (O)
INHIBITIONS, f.m. pl .{Jurifprud.') font des dé-
I N J fetifes faites à quelqu’un par la loi ou par un jugement
, de faire quelque chofe de contraire. (A )
* INHUMANITÉ, f. f. (Gramm.) vice qui nous
fort de notre efpece, qui nous fait ceffer d’être
homme ; dureté de coeur, dont la nature fembloit
nous avoir rendus incapables. Voye[ Humanité.
* INHUMATION, f. f. ( Gramm.) l’a&ion de mettre
le corps d’un homme mort dans la fépulture. II
faut la volonté d’un teftateur pour inhumer un corps
hors de fon églife paroiiliale. On n’a commencé
qu’en i zoo à?inhumer dans les églifes, ce qui doit les
rendre mal-faines. inhumation s’eft faite dans pref-
que tous les tems, & chez prefque tous les peuples ,
avec plus du moins de pompe & de cérémonies.
INJACULATION, injaculatio ; f Médecine. ) terme
dont fe fert Vanhelmont pour défigner une maladie
qui confifte dans une douleur fpafmodique violente
de l’eftomac, accompagnée de l’immobilité du
corps. James , Dicl. de Médecine.
INJECTER , verb. att. ( Anatom. ) c’eft la méthode
de remplir les vaiffeaux des animaux avec
une liqueur colorée, qui fe durciffant, tient les vaiffeaux
diftendus & fermes , & laiffe la liberté d’en
obferver plus exaftement la diftribution, la fitua-
tion & les diamètres , de découvrir le nombre de
leurs ramifications & de leurs anaftomofes, qu’il ne
ferôit pas poffible d’appercevoir fans ce moyen.
La nature des inftrumens, celle des liqueurs dont
on fe fert pour les injections, la maniéré dont on veut
faire Yinjection, enfin la manoeuvre même de Y injection
, font autant d’articles dont on va donner l’explication.
C ’eft une découverte qui a beaucoup contribué
à éclaircir l’économie animale. Malpighy & Gliffon
fe font fervi de liqueurs colorées, mais Swamerdam
paroît être le premier qui ait employé une préparation
de cire. Il ajoute qu’il apprit cette méthode en
iôô6 à Van-Horne & à Hade ; ce ne fut qu’en 1668
que Graaf fit graver la figure des inftrumens dont il
falloit fe fervir, & qu’il décrivit tout ce merveilleux
artifice. Mais Ruyfch a pouffé cet art fi loin ,
que les plus favans hommes font auffi pleins d’admiration
que les plus ignorans, à la vue des prodiges
qu’a opéré fon induftrie. Il faifoit une efpece de myf-
tere de fon fecret ; mais à préfent les anatomiftes
font fuftifamment inftruits de la maniéré de remplir
les vaiffeaux.
L’inftrument dont on fe fert ordinairement pour
pouffer la liqueur dans les vaiffeaux, eft une forte fe-
ringue de cuivre, dont le pifton.doit couler avec ai-
fance, & à laquelle peuvent s’adapter différens
tuyaux qu’on y fixe par le moyen d’une vis ; les extrémités
de ces tuyaux ont différens diamètres, &
font fans v is , afin qu’ils puiffent entrer dans d’autres
tuyaux, & s’emboîter avec eux fi exactement que
pour peu qu’on les force l’un contre l’autre, rien ne
puiffe paffer entre eux. Mais parce que leur cohé-
fion n’eft pas affez forte po.ur réfifter à la force avec
laquelle on pouffe YinjeUion, & qu’il eft à craindre
que ce fécond tuyau ne foit repouffé, & que la matière
de Y injection ne s’échappe & ne faffe ainfi manquer
l’opération ; l ’extrémité du fécond tuyau qui
reçoit celui qui eft fixe fur la feringue, doit avoir
une partie quarrée terminée devant 6c derrière par
un cercle élevé ou faillant, afin d’empêcher la clé
qui embraffe étroitement l’entre-deux de ces cercles
ou la partie quarrée, de gliffer; ou bien elle doit
être garnie de deux branches de cuivre, afin de pouvoir
la contenir avec deux doigts. L’autre extrémité
de cette efpece de tuyau eft de différente groffeur,
& il y a vers cette extrémité une hoche ou entail-
lure qui fert à arrêter un fil ; par le moyen de cette
hoche , le fil qui lie ce vaiffeau par lequel on doit
faire Y injection, ne fauroit gliffer : outre cette forme
ï N J commune à tous les tuyaux dé la fécondé efpécè,
on doit en avoir quelques-uns qui foient.plus larges
& qui foient configurés d’une autre maniéré pour
des cas particuliers. Par exemple, fi l’on Veut injecter
les grós vaiffeaux, le tuyau attaché à un grand
vaiffeau doit avoir une valvule ou un robinet, &
qu’on puiffe tourner feion le befoin pour empêcher
que YinjeUion ne forte du vaiffeau par le tuyau ; autrement
il faut que celui qui fait Yinjeciion attende
pour retirer la feringue, que la matière injectée foit
refroidie ; ou s’il retire trop tôt la feringue, Yinjec-
tion s’échappe, & les gros vaiffeaux fe defemplif-
fent. Lorfque la feringue n’eft pas affez grande pour
contenir tonte la matière néceffaire pour remplir les
vaiffeaux, il faut la remplir une fécondé fois ; fi l’on
étoit obligé pour cela de retirer la feringue du tuyau
attaché au vaiffeau, il fe perdroit de Yinjeciion, &
ce qui feroit expofé à l’air fe refroidiroit & fe dùr-
ciroit.Pour éviter ces inconvéniensil faut avoir quelques
tuyaux qui aient une branche eourbe foudée
latéralement, & une valvule difpofée de maniéré
que la liqueur ne puiffe pas paffer du tuyau droit
dans le tuyau courbe, mais qui au contraire la laiffe
paffer du tuyau courbe dans le tuyau droit. Celui
qui fait Yinjeciion ayant alors foin de tenir l’extrémité
du tuyau courbe dans la liqueur qui fert à YinjeUion,
peut aufli-tôt qu’il a defempli la première feringue,
la remplir de nouveau en tirant feulement le
pifton, & réitérant cette manoeuvre avec diligence,
il fera en état de pouffer dans les vaiffeaux tout autant
de liqueur qu’il en faudra pour les injeUer parfaitement.
Tous ees différens tuyaux font ordinairement
faits de cuivre jaune ; ils peuvent néanmoins
l’être de tout autre métal, comme d’étain, &c.
Les liqueurs dont on fe fert lorfqu’on a deffein de
remplir les vaiffeaux capillaires, font telles qu’elles
peuvent fe mêler ou avec l’eau ou avec les liqueurs
graffes ; les unes & les autres ont des avantages &
des inconvéniens. Toutes les différentes efpeces de
gltres, comme la colle de poiffon, la colle forte, &ç.
difloutes & délayées dans l’eau, fe mêlent aifément
avec les liqueurs contenues dans les vaiffeaux des
animaux, ce qui eft un grand avantage ; car elles
pénètrent jufques dans les plus petits vaiffeaux d’un
fujet bien choifi & bien préparé , & fouvent elles
fufftfent pour répondre à l’intention de l’anatomifte,
lorfqu’il n’a d’autre deffein que de préparer quelque
fine membrane , dont les vaiffeaux lont fi déliés,
qu’il n’eft pas poffible de les appercevoir à la v u e ,
fi les ferions tranlverfales de ces vaiffeaux font circulaires
, ou fi leurs parois font affaiffées. Mais lorfqu’il
faut auffi injecter les gros vaiffeaux , ces fortes
d’injections ont un inconvénient fâcheux , & la préparation
en eft moins utile & moins belle. En effet,
fi 1 on xYinjecte qu’une liqueur glutineufe, il n’eft pas
poffible de conferver un fujet auffi long-tems qu’il
en faut à la colle pour fécher & fe durcir ; & comme
en difféquant la partie injectée, il n’eft guere poffible
qu’on ne coupe plufieurs vaiffeaux , Yinjeciion s’épanchera.
Pour éviter cet inconvénient, on pourroit
à la vérité tremper la partie dans l’efprit de vin qui
coagulêfôitla colle; mais alors elle devient fi fra-
fiile, qu’elle fê caffe poxir peu qu’on la manie, & f i
l ’on veut conferver la préparation , les gros vaiffeaux
fe fléchiffent prefque entièrement lorfque les
parties âqtieufes de YinjeUion font évaporées. On
pourroit attfli prévenir l’épanchement de Yinjeciion
en liant exactement chaque vaiffeau avant que de le
cOupèt ; mais cela n’empêche pas que les vaiffeaux
ne fè contractent lorfque la colle fe deffeche. Si pour
obvier à Cés inconvéniens, On commence à injecter
d’une diffolution de Colle ce qu’il en faut pour remplir
les vaiffeaux capillaires , & que pour remplir
enfuite les grands vaiffeaux, on fc ferve de Yinjec-
I N J 747 tion graffe ordinaire, la cire ne va pas fort loin fans
fe congeler, & les deux fortes d’injections ne manquent
jamais de fe mêler irrégulièrement ; defortô
que les vaiffeaux, paroiffent interrompus & caffés
par la feparatiOn mutuelle de ces deux liqueurs ; ce
qui devient encore plus fenfible dans la fuite à me*
liire que les parties aqueufés fe diflîpent. L’efprit de
vin coloré fe mêle avec les eaux & les huiles; &
peut encore pénétrer jufques dans les plus petits
vaiffeaux ; mais d’un autre côté il coagule toutes les
liqueurs animales qu’il rencontre, & qui quelquefois
bouchent les vaiffeaux de maniéré que Yinjeciion né
fauroit paffer jufqu’aux capillaires; d ’ailleurs , l’ef-
prit-de-vin ne peut tenir qu’avec peine, fufpendues
quelques-unes des poudres qui communiquent les
couleurs les plus durables ; ôt comme il s’évapore à
la fin entièrement, les vaiffeaux deviennent fort petits,
& cette petite quantité de poudre colorée qui
refte dans les vaiffeaux n’ayant rien qui en tienne
les parties liées & réunies entré elles ; elle paroît
ordinairement interrompue en tant d’endroits , que
les petites ramifications de vaiffeaux ont plutôt l’apparence
d’un coup de pinceau jetté'au hafard , que
de^ tuyaux réguliers & continus. Le fuif fondu &:
mêlé avec un peu d’huile de térébenthine, peut
quelquefois remplir les petits vaiffeaux, & tient les
plus gros fuffifamment diftendus ; mais il s’arrête dès
qu’il rencontre quelque fluide dans les parties, & né
peut jamais pénétrer auffi avant que les autres liqueurs
; il a d’ailleurs fi peu de ténacité qu’il fe caffé
P.our Peu clu’on manie , ce qui rend les préparations
fort defagréables. Ce qiii réuffit le mieux pour
les injections finies, c’eft l’huile de térébenthine colorée
qu’on pouffe d’abord à la quantité requife pour
remplir les plus petits capillaires, & immédiatement
après on remplit les gros vaiffeaux avec Yinjeciion
commune. L’huile de térébenthine eft affez fubtile
pour pénétrer plus avant qu’aucune autre liqueur
colorée ; fes parties réfineufes qui reftent après l’évaporation
des parties fpiritueufes lient affez celles
de la matière qui a fervi à la colorer pour les empêcher
de fe defunir , & elle s’incorpore intimement
avec YinjeUion ordinaire; de maniéré que û Y injection
eft bien faite , il eft impoffible à la vue la plus
perçante de s’appercevoir qu’on a employé deux
î'ortes à’injeUions. Toutes les liqueurs dont on fe fert
pour injeUerles vaiffeaux des animaux n’aÿant qu’une
foible & prefque toute une même couleur, ne
paroîtroient pas du tout dans les plus petits v a iffeaux
, parce qu’elles y deviennent entièrement tranf-
parentes. Il faut pour les rendre fenfibles , y mêler
quelque matière capable de les colorer ; & lorfqu’on
injeUe différens vaiffeaux d’iine partie , même des
plus gros, on a de la peine à diftinguer les uns , à
moins qu’on ne donne différentes couleurs aux injections
, ce qui rend auffi les préparations plus belles.
Pour cet effet les Anatomiftes fe fervent de plufieurs
matières pour colorer leurs liqueurs félon leurs intentions
; telles par exemple, que la gomme gutte, lé
fafran, l’ivoire brûlé , &c. qu’on peut avoir aifément.
L ’effentiel eft d’examiner les matières qui font
propres à être mêlées avec les liqueurs deftinées à
injeUer les vaiffeaux capillaires ; car il eft rare qu’on
ait befoin d'injeUer d’autres vaiffeaux, excepté certaines
ramifications principales des arteres, & quelques
veines. Les couleurs communément employées
par ces deux dernieres fortes de vaiffeaux , font le
rouge, le v erd, & quelquefois le bleu. Les Anatomiftes
fans doute, fe font propofés d’imiter les couleurs,
naturelles des arteres & des veines de l’animal
v iv an t, en rempliffant les unes avec une matière
rouge, & les autres avec une matière bleue ouverte.
Il réfulte cependant d’autres avantages de ces couleurs
, telle que la vive réflexion des rayons de lu