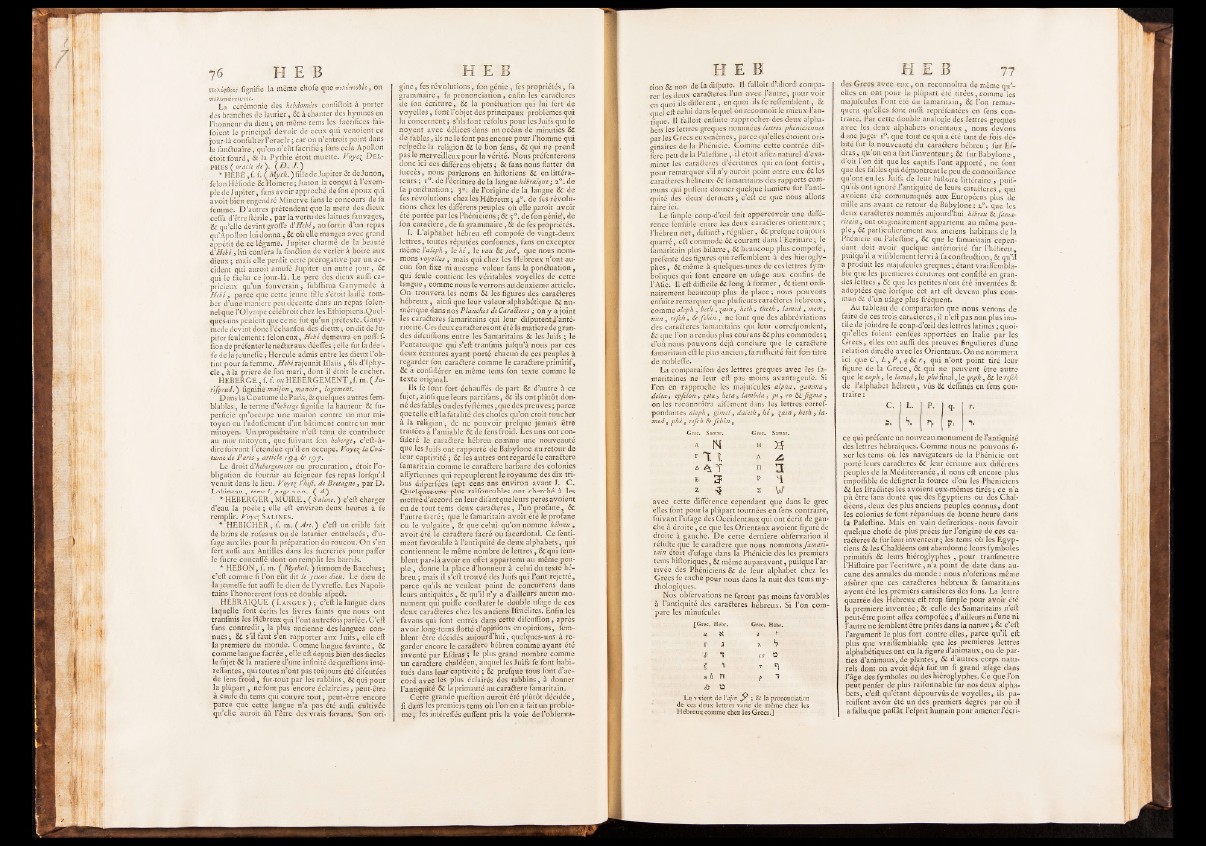
noXii?8a»t fignifiè la même chofe que *oxuWûtaY, ou
7ro\v7retmvroǑ : .
La cérémonie des kebdomées confiftoit à porter
des branches de laurier, &: à chanter des hymnes en
l ’honneur du dieu ; en même tems les facrifices fai-
foient le principal devoir de ceux qui venoient ce
jour-là confulter l’oracle ; car on n’entroit point dans
le fanCtuaire, qu’on n’eût facrifié ; fans cela Apollon
étoit Lourd, & la Pythie étoit muette. Foyei Delphes
( oracle de ). (D. ƒ.)
* HEBÉ, f; f. ( Myth. ) fille de Jupiter & de Junon,
félon Héfiode ScHomere; Junon la conçut à l’exemple
de Jupiter, fans avoir approché de fon epoux qui
avoit bien engendré Minerve fans le concours de fa
femme. D ’autres prétendent que la mere des dieux
ceffa d’être ftérile, par la vertu des laitues fauvages,
& qu’elle devint groffe d’Hebé, aufortir d’un repas
qu’Apollon lui donna, & où elle mangea avec grand
appétit de ce légume. Jupiter charme de la beauté
d’Hebé, lui conféra la fonttion de verfer à boire aux
dieux ; mais elle perdit cette prérogative par un accident
qui auroit amufé Jupiter un autre jour, &
qui le fâcha ce jour-là. Le pere des dieux aufli capricieux
qu’un fouverain, fubftitua Ganymede à
Hebè, parce que cette jeune fille s’étoit laifle tomber
d’une maniéré peu décente dans un repas folen-
nelque l’Olympe celébroit chez les Ethiopiens.Quelques
uns penfent que ce ne fut qu’un prétexte. G anymede
devint doncl’échanfon des dieux ; on dit de Jupiter
feulement : félon eux, Hebè demeura en poflef-
îionde préfenterlene&araux déeffes elle fut la dée!-
Le de la jeùnelîe ; Hercule admis entre les dieux l’obtint
pour fa femme, Hebè rajeunit Iflaiis , fils d’Iphy-
c le , à la priere de fon mari, dont il étoit le cocher.
HEBERGE, f. f. ou HEBERGEMENT, f. m. ( Ju-
rifprud. ) lignifie maifon, manoir, logement.
Dans là Coutume de Paris, & quelques autres fem-
blables-, le ternie d’heberge fignifiè la hauteur & fu-
perficie qu’occupe une maifon contre un mur mitoyen
ou l’adofîement d’un bâtiment contre un mur
mitoyen. Un propriétaire n’ eft tenu de contribuer
au mur mitoyen, que fuivant fon heberge, c’eft-à-
dire fuivant l’étendue qu’il en occupe. Voye{ la Coutume
de Paris , article i *94 & t ÿ j .
Le droit d'hebergement ou procuration, étoit l’obligation
de fournir au feigneur fes repas lorfqu’il
venoit dans le lieu. Foye^ Chijl. de Bretagne , par D.
Lobineau, tome I.page zo o . ( A')
* HEBERGER,d’eau la poêle ; el lMe UefItR eEn,v (ir Soanl indee.u )x ch’eefut rcehs aàrg efer remplir. Foye{ Salines.
* HEBICHER, f. m. ( Art.) c’eft un crible fait
de brins de rofeaux ou de latanier entrelacés, d’u-
fage aux îles pour la préparation du roucou. Gn s’en
fert aufli aux Antilles dans les fucreries pour paffer
le fucre concaffé dont on remplit les barrils.
* HEBON, f. m. ( Mythol. ) furnom de Bacchus ;
c’ eft comme li l’on eût dit le jeune dieu. Le dieu de
la jeunèffe fut aufli le dieu de l’yvrefle. Les Napolitains
l’honorerent fous ce double afpeCl.
HÉBRAÏQUE ( L an g u e ) ; c’eft la langue dans
laquelle font écrits les livres faints que nous ont
tranfmis les Hébreux qui l’ont autrefois parlée. C ’eft
fans contredit, la plus ancienne des langues connues
; & s’il faut s’en rapporter aux Juifs, elle eft
la première du monde. Comme langue favante, ôc
comme langue facrée, elle eft depuis bien des fiecles
le fu je t& la matière d’une infinité de queftions inté-
reffantes, qui toutes n’ont pas toûjours été difcutées
de fens froid, fur-tout par les rabbins, & qui pour
la plupart, ne font pas encore éclaircies, peut-être
à caufe du tems qui couvre tout, peut-être encore
parce que cette langue n’a pas été aufli cultivée
qu’elle auroit dû l’être des Vrais Lavans. Son ori-
H v II XL Ï J
gine, fes révolutions, fon génie , fes propriétés, fa
grammaire, fa prononciation, enfin les caraCteres
de fon écriture, & la ponâuation qui lui fert de
voyelles, font l’objet des principaux problèmes qui
la concernent ; s’ils font réfolus pour les Juifs qui fe
noyent avec délices dans un océan de minuties &
de fables, ils ne le font pas encore pour l’homme qui
refpecte la religion & le bon fens, & qui ne prend
pas le merveilleux pour la vérité. Nous préfenterons
donc ici ces différens objets ; & fans nous flatter du
fuccès, nous parlerons en hiftoriens & en littérateurs
; i° . de l’écriture de la langue hébraïque; z°. de
fa ponéluation ; 3°. de l’origine de la langue & de
fes révolutions chez les Hébreux ; 40. de fes révolutions
chez les différens peuples où elle paroît avoir
été portée par les Phéniciens ; & 50. de fon génie|, de
fon caraCtere, de fa grammaire, & de fes propriétés.
I. L’alphabet hébreu eft compofé de vingt-deux
lettres, toutes réputées confonnes, fans en excepter
même Y a leph , 1 e ké, le vau & jod, que nous nommons
voyelles, mais qui chez les Hébreux n’ont aucun
fon fixe ni aucune valeur fans la ponctuation,
qui feule contient les véritables voyelles de cette
langue, comme nous le verrons au deuxieme article.
On trouvera les noms & les figures des caraCteres
hébreux, ainfi que leur valeur alphabétique & numérique
dans nos Planches de Caractères ; on y a joint
les caraCteres famaritains qui leur difputentj’anté-
riorité. Ces deux caraCteres ont été la matière de grandes
difcuflions entre les Samaritains & les Juifs ; le
Pentateuque qui s’eft tranfmis jufqu’à nous par ces
deux écritures ayant porté chacun de ces peuples à
regarder fon caraCtere comme le caraCtere primitif,
& à confidérer en même tems fon texte comme le
texte original.
Ils fe font fort échauffés de part & d’autre à ce
fujet, ainfi que leurs partifans, & ils ont plûtôt donné
des fables ou des fyftèmes, que des preuves ; parce
que telle eft la fatalité des chofès qu’on croit toucher
a la religion, de ne pouvoir prefque jamais être
traitées à l’amiable & de fens froid. Les uns ont con-
fideré le caraCtere hébreu comme une nouveauté
que les Juifs ont rapporté de Babylone au retour de
leur captivité ; & les autres ont regardé le caraCtere
famaritain comme le caraCtere barbare des colonies
aflyriennes qui repeuplèrent le royaume des dix tribus
difperfées fept cens ans environ avant J. C .
Quelques-uns plus raifonnables ont cherché à les
mettre d’accord en leur difantqueleurs peres avoient
eu de tout tems deux caraCteres, l’un profane, $c
l’autre facré ; que le famaritain avoit été le profane
ou le vulgaire , & que celui qu’on nomme hébreu ,
avoit été, le caraCtere facré ou facerdotal. Ce fenti-
ment favorable à l’antiquité de deux alphabets, qui
contiennent le même nombre de lettres, & qui fem-
blent par-là avoir en effet appartenu au même peuple
, donne la place d’honneur à celui du texte hébreu
; mais il s’eft trouvé des Juifs qui l’ont rejetté,
parce qu’ils ne veulent point de concurrens dans
leurs antiquités , & qu’il n’y a d’ailleurs aucun monument
qui puiffe conftater le double ufage de ces
deux caraCteres chez les anciens Ifraëlites. Enfin les
favans qui font entrés dans cette difcuffion, après
avoir long-tems flotté d’opinions en opinions, Semblent
être décidés aujourd’hui, quelques-uns à regarder
encore le caraCtere hébreu comme ayant été
inventé par Efdras ; le plus grand nombre comme
un caraCtere chaldéen, auquel les Juifs fe font habitués
dans leur captivité ; & prefque tous font d’accord
avec les plus éclairés des rabbins, à donner
l’antiquité & la primauté au caraCtere famaritain.
Cette grande queftion auroit été plûtôt décidée,
fl dans les premiers tems où l’on en a fait un problème,
les intéreffés euffent pris la voie de l’obfervataon
& non de ladifpute. Il falloit^d'abord'comparer
les deux caraCtères-l-un avec l’autre; pour voir
en quoi ils different, en quoi ils fe reflemblenty &
quel eft celui dans lequel on reconnoîtde mieux, l’antique.
Il falloir enfuite rapprocher des deux alphabets
les lettres greques nommées' lettres phéniciennes
parles Grecs eux-mêmes, parce qu’elles-étoient originaires
de la Phénicie. Gomme cette contrée diffère
peu de la Paleftine , il étoit allez naturel d’examiner
les caraCteres d’écritures qui en font fortis,
pour remarquer s’il n’y- auroit point entre eux & les
caraCteres hébreux & famaritains-des rapports communs
qui puflent donner quelque lumière fur l’antiquité
des deux derniers ; e’elt ce que nous allons
faire ici. 1 " .
Le Ample coup-d’oeil fait appercevoir une différence
fenfible entre les-deux caraCteres orientaux ;
l’hébreu net, diftina, régulier, & prefque toûjours
quarré, eft commode & courant dans l’Ecriture; le
famaritain plus bifarre, & beaucoup plus compofé,
préfente des figures qui reflemblent à des hiéroglyphes
, & même à quelques-unes de ces lettres fym-
boliquès qui font encore en ufage aux confins de
l’Afie. Il eft difficile & long à former, & tient ordinairement
beaucoup plus de place ; nous pouvons
enfuite remarquer que plufieurs caraCteres hébreux,
comme aleph, beth , \ain , keth , theth, lamed, mem ,
nun refch, & fchin, ne font que des abbréviations
des caraCteres famaritains qui leur correfpondent,
&: que l’on a rendus plus cour-ans & plus commodes-;
d’où nous-pouvons déjà conclure que le caraCtere
famaritain eft le plus ancien ; larufticité fait fon titre
de noblefle.
La comparaifon- des lettres greques avec les fa-
maritaines ne leur eft pas moins avantageufe. Si
l ’on en rapproche les majufcules alpha, gamma,
delta , epjilon , %cta , heta , lambda, p i , ro & Jigma ,
on les reconnoîtra aifément dans les lettres corref-
pondantes aleph-, gimel, daletk, lié , qain , heth , lamed}
phé f refch & fchin y
reç. Samar. Grec. Samai
A N H 3Î
r 1. T. A j£.
mÊm n a
E 3 p H
z a 2 w
avec cette différence cependant que dans le grec
elles font pour la plûpart tournées en fens contraire,
fuivant l’ufage des Occidentaux qui ont écrit de gauche
à droite, ce que les Orientaux avoient figuré de
droite à gauche. De cette derniere obfervation il
refulte .que le caraCtere que nous nommons famaritain
étcut d’ufage dans la Phénicie dès les premiers
tems hiftoriques, & même auparavant, puilque l’arrivée
des Phéniciens & de leur alphabet chez les
Grecs fe cache pour nous dans la nuit des tems m ythologiques.
Nos observations ne feront pas moins favorables
! à l’antiquité des caraCteres hébreux. Si l’on com-
' pare les minufcules
[Grec. Hébr. Grec. Hébr.
a N l »
T J v : b
* T . c* û
Z 1 T t)
■ il h n t T
& u
Le 7 vient de Yajin y ; & la prononciation
de tes deux lettres varie de même chez les
Hébreux comme chez les Grecs.J •
des-Grecs; avec eu x, on reconnoîtra de même q u elles
en- ont pour la plûpart, été tirées, comme les
majufcules l’ont été du famaritain, 6c l’on remarquera
qu’elles font aufli repréfentées en fens. contraire.
Par cette double analogie des lettres greques
avec les. deux alphabets orientaux , nous devons
donc, juger i°. que tout ce qui a été tant de fois débité
fur la nouveauté du caraCtere hébreu. ; fur Ef-
dras;,.qu’on en a fait l’inventeur ; ôc fur Babylone ,
d’où l’on dit que les captifs l’ont apporté, ne font
que des fables qui démontrent le peu de connoilTance
qu’ont eu les Juifs, de leur hiftoire. littéraire , puif-
qu’ils ont ignoré l’antiquité de leurs caraCteres , qui
avoient été communiqués aux Européens plus de
mille ans avant ce retour de Babylone : z°. que les
deux caraCteres nommés aujourd’hui hébreu 8ç famaritain
, ont originairement appartenu au même peup
le , 6c particulièrement aux anciens habitans de la
Phénicie ou Paleftine, & que le famaritain cependant
doit avoir quelque antériorité fur l’hébreu,
puifqu’il a vifiblement fèrvi à fa conftruCtion, & qu’il
a produit les majufcules greques ; étant vraiffembla-
ble que les premières écritures ont confifté en grandes
lettres , & que les petites n’ont été inventées &
adoptées que lorfque cet art eft devenu plus commun
& d’un ufage plus fréquent.
Au tableau de comparaifon que nous venons de
faire de ces trois caraâeres, il n’eft pas non plus inutile
de joindre le coup-d’oeil des lettres latines ; quoiqu’elles
foient cenfées apportées en Italie par les
Grecs , elles ont aufli des preuves fingulieres d’une
relation direCte avec les Orientaux. On ne nommera
ici que C , 1 , P , q & r , qui n’ont point tiré leur
figure de la Grèce, & qui ne peuvent être autre
que le caph, le lamed, le phi final, le qoph, & le refch
de l’alphabet hébreu, vûs & deflinés en fens contraire
;
C. I L . P. I q. 1 r.
5 . [ *7. 1 - ( i?. ( 1-
Ce qui préfente un nouveau monument de l’antiquité
des lettres hébraïques. Comme nous ne pouvons fixer
les tems où les navigateurs de la Phénicie ont
porté leurs caraCteres & leur écriture aux différens
peuples de la Méditerranée, il nous eft encore plus
impoffible de défigner la fource d’où les Phéniciens
& les Ifraélites les avoient eux-mêmes tirés ; ce n’a
pû être fans doute que des Egyptiens ou des Chal-
déens, deux des plus anciens peuples connus, dont
les colonies fe font répandues de bonne heure dans
la Paleftine. Mais en vain délirerions - nous favoir
quelque chofe de plus précis fur l ’origine de ces ca-
rafteres & fur leur inventeur ; les tems où les Egyptiens
& les Chaldéens ont abandonné leurs fymboles
primitifs , & leurs hiéroglyphes , pour tranfmettre
l’Hiftoire par l’écriture, n’a point de date dans aucune
des annales du monde : nous n’oferions même
afsûrer que ces caraCteres hébreux & famaritains
ayent été les premiers caraCteres des fons. La lettre
quarrée des Hébreux eft trop Ample pour avoir été
la première inventée ; & celle des Samaritains n’eft
peut-être point affez compofée ; d’ailleurs ni l ’une ni
l’autre ne femblent être prifes dans la nature ; & c’eft
l’argument le plus fort contre elles, parce qu’il eft
plus que vraiffemblable que les premières lettres
alphabétiques ont eu la figure d’animaux, ou de parties
d’animaux, de plantes, & d’autres corps naturels
dont on avoit déjà fait un fi grand ufage dans
l’âge des fymboles ou des hiéroglyphes. Ce que l’on
peut penfer de plus raifonnable fur nos deux alphabets,
c’eft qu’étant dépourvus de voyelles, ils pa-
roiffent avoir été un des premiers degrés par où il
a fallu que palïat l’efprit humain pour amener l’éc/i